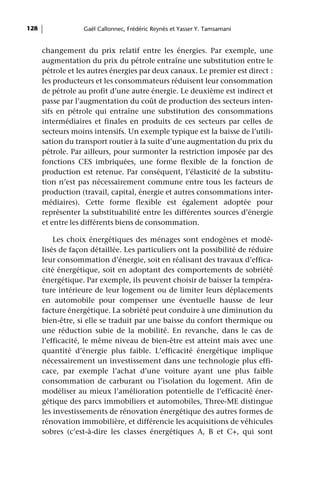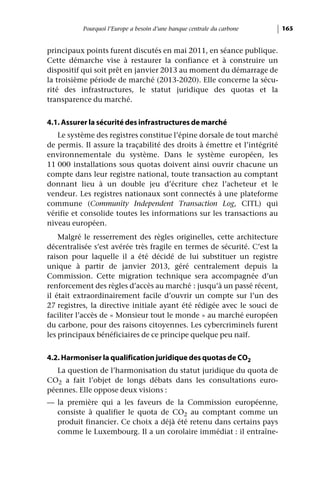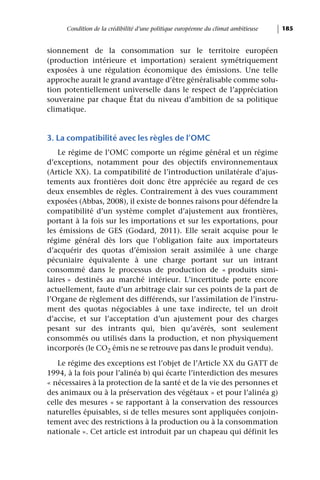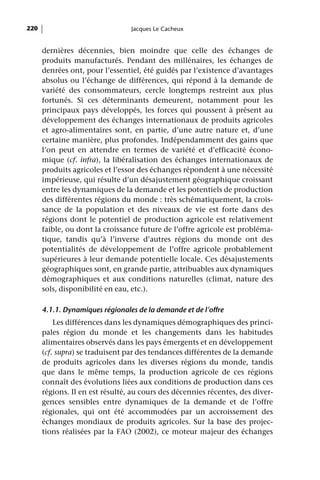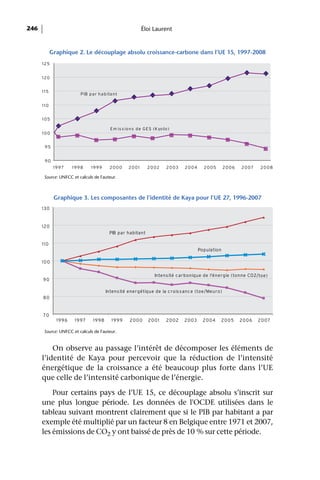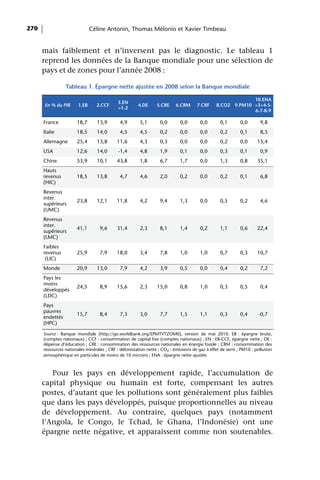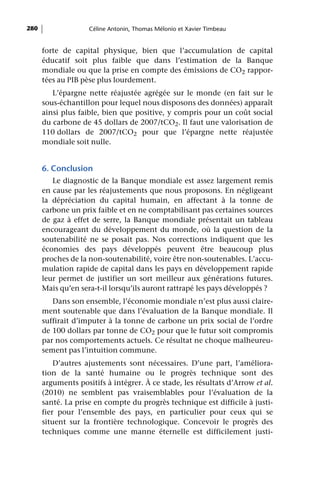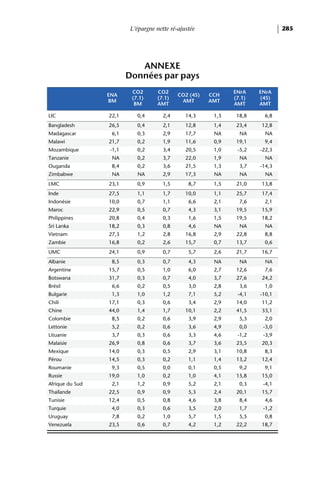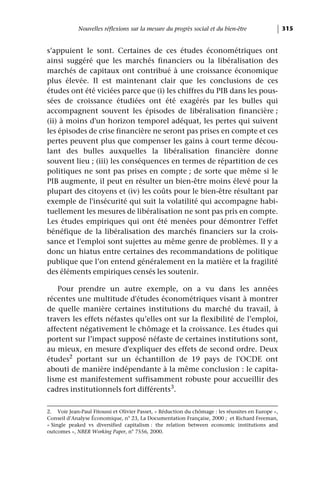Economie du développement soutenable
- 1. Débatset politiques 120 ÉCONOMIE DU DÉVELOPPEMENT SOUTENABLE sous la direction d’Éloi Laurent f
- 3. ÉCONOMIE DU DÉVELOPPEMENT SOUTENABLE
- 5. sous la direction d’Éloi Laurent ÉCONOMIE DU DÉVELOPPEMENT SOUTENABLE f
- 6. Revue de l’OFCE / Débats et politiques OFCE L’OFCE est un organisme indépendant de prévision, de recherche et d’évaluation des politiques publiques. Créé par une convention passée entre l'État et la Fondation nationale des sciences politiques approuvée par le décret n° 81.175 du 11 février 1981, l'OFCE regroupe plus de 40 chercheurs français et étrangers, auxquels s’associent plusieurs Research fellows de renommée internationale (dont trois prix Nobel). « Mettre au service du débat public en économie les fruits de la rigueur scientifique et de l’indépendance universitaire », telle est la mission que l’OFCE remplit en conduisant des travaux théoriques et empiriques, en participant aux réseaux scientifiques internationaux, en assurant une présence régulière dans les médias et en coopérant étroitement avec les pouvoirs publics français et européens. Philippe Weil préside l’OFCE depuis 2011, à la suite de Jean-Paul Fitoussi, qui a succédé en 1989 au fondateur de l'OFCE, Jean-Marcel Jeanneney. Le président de l'OFCE est assisté d'un conseil scientifique qui délibère sur l'orientation de ses travaux et l'utilisation des moyens. Président Philippe Weil Direction Estelle Frisquet, Jean-Luc Gaffard, Jacques Le Cacheux, Henri Sterdyniak, Xavier Timbeau Comité de rédaction Louis Chauvel, Jérôme Creel, Estelle Frisquet, Jean-Luc Gaffard, Éric Heyer, Jacques Le Cacheux, Françoise Milewski, Henri Sterdyniak, Xavier Timbeau, Étienne Wasmer Conseil scientifique Vincent Chriqui, Jean-Philippe Cotis, Rodolphe Dos Santos Ferreira, Jean-Pierre Landau, Cuong Le Van, Jean-Eudes Moncomble, Dominique Plihon, Guillaume Sarkozy, Paul Zagamé Publication Philippe Weil (Directeur de la publication), Gérard Cornilleau (Rédacteur en chef), Laurence Duboys Fresney (Secrétaire de rédaction), Najette Moummi (Responsable de la fabrication) Contact OFCE, 69 quai d’Orsay 75340 Paris cedex 07 Tel. : +33(0)1 44 18 54 00 mail : [email protected] web : www.ofce.sciences-po.fr N° ISSN 1265-9576 – ISSN en ligne 1777-5647 – © OFCE 2011
- 7. Sommaire ÉCONOMIE DU DÉVELOPPEMENT SOUTENABLE sous la direction d’Éloi Laurent INTRODUCTION Quelle place pour l’économie dans la science de la soutenabilité . . . 7 Éloi Laurent GOUVERNANCE ÉCOLOGIQUE ET JUSTICE ENVIRONNEMENTALE Par-delà les marchés et les États : la gouvernance polycentrique des systèmes économiques complexes, conférence Nobel . . . . . . . . . 15 Elinor Ostrom Justice environnementale et performance des entreprises : nouvelles perspectives et nouveaux outils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Michael Ash et James K. Boyce Pour une justice environnementale européenne : le cas de la précarité énergétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Éloi Laurent ÉCONOMIE DU CLIMAT Une évaluation macroéconomique et sectorielle de la fiscalité carbone en France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Gaël Callonnec, Frédéric Reynès et Yasser Yeddir-Tamsamani Pourquoi l’Europe a besoin d’une banque centrale du carbone. . . . 155 Christian de Perthuis L’ajustement aux frontières, condition de la crédibilité d’une politique européenne du climat ambitieuse . . . . . . . . . . . . . 177 Olivier Godard ÉCONOMIE DE LA SOUTENABILITÉ Agriculture mondiale et européenne : défis du XXIe siècle . . . . . . . 197 Jacques Le Cacheux Faut-il décourager le découplage ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Éloi Laurent L’épargne nette ré-ajustée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Céline Antonin, Thomas Mélonio et Xavier Timbeau La mesure de la soutenabilité : les antécédents, les propositions et les principales suites du rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi . . . . . . . . . 287 Didier Blanchet Nouvelles réflexions sur la mesure du progrès social et du bien-être . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 Jean-Paul Fitoussi et Joseph E. Stiglitz Revue de l’OFCE / Débats et politiques – 120 (2011)
- 8. Les propos des auteurs et les opinions qu’ils expriment n’engagent qu’eux-mêmes et non les institutions auxquelles ils appartiennent.
- 9. Introduction QUELLE PLACE POUR L’ÉCONOMIE DANS LA SCIENCE DE LA SOUTENABILITÉ ? Éloi Laurent* OFCE, Observatoire français des conjonctures économiques Le chaînon manquant du savoir écologique La question écologique redessine les frontières des disciplines scien- tifiques. La physique et la chimie, la biologie et la géologie se rapprochent, s’articulent et s’intègrent en une science de la Terre (Earth science) dont l’étude en systèmes (Earth systems) monte en puissance dans les meilleures universités du monde. Ce savoir nouveau ne pourra toutefois se muer en une véritable science de la soutenabilité qu’avec le concours des sciences sociales et des humanités, qui elles-mêmes commencent à organiser leur dialogue méthodologique sur le terrain écologique1. La question de la place de l’économie dans cette recompo- sition fondamentale est donc aujourd’hui posée. Ce premier ouvrage de la série Débats et politiques de la Revue de l’OFCE, entend, à sa mesure, contribuer à l’éclairer. Nos crises écologiques révèlent un paradoxe de la connaissance et de l’action : les progrès considérables des sciences de l’environnement depuis deux décennies sont porteurs de nouvelles toujours plus mauvaises sur l’état des écosystèmes terrestres. Plus nous prenons 1. Je remercie l’Université de Stanford, et en particulier le programme Water and * environmental studies et le Département Atmosphere and Energy de la School of Engineering et du Yang and Yamazaki Environment and Energy Building (Y2E2) pour leur exceptionnelle hospitalité tandis que se fabriquait ce numéro spécial. Je remercie aussi mon assistante Kathleen Low pour la qualité de son travail. 1. Voir sur ce point Poteete, A. R., M. A. Janssen, et E. Ostrom (eds.) 2010. Working Together: Collective Action, the Commons, and Multiple Methods in Practice. Princeton, NJ: Princeton University Press. Revue de l’OFCE / Débats et politiques – 120 (2011)
- 10. 8 Éloi Laurent conscience du problème écologique et plus celui-ci s’aggrave sous nos yeux. « La crise de l'environnement est plus aiguë, plus intransigeante et plus répandue que jamais, malgré des connaissances scientifiques plus étendues que jamais »2. Trois hypothèses au moins sont conce- vables pour envisager ce paradoxe : la première tient au simple effet de qualité de nos instruments de mesure, qui nous informent bien mieux qu’avant sur l’état réel de problèmes environnementaux trop long- temps négligés ; la deuxième, moins évidente, tient à la distance qui peut se former entre ce que nous savons et ce que nous croyons : selon Jean-Pierre Dupuy3, si nous savons davantage que par le passé (que la Nature est devenue vulnérable), nous ne croyons pas assez ce que désormais nous sommes censés savoir ; la dernière hypothèse, privilé- giée ici, est que nous ne savons pas encore tout ce que nous devrions savoir, et notamment sur une question cruciale : comment réformer les systèmes humains pour préserver les systèmes naturels ? Car si les sciences naturelles et physiques nous alertent – en nous signalant des zones d’incertitude encore importantes4 – sur la réalité des crises écologiques, elles ne nous donnent pas les moyens de trans- former les attitudes et les comportements dans les sociétés humaines, sociétés responsables du changement environnemental planétaire, comportements et attitudes seuls à même d’en infléchir le cours. Des spécialistes des océans, sièges de ce qui s’annonce, en lien avec la dyna- mique climatique, comme la plus grave crise environnementale de notre temps, pointent précisément ce chaînon manquant dans le savoir écologique : « Les moyens techniques pour parvenir à des solu- tions pour nombre de ces problèmes [affectant les océans, en particulier leur acidification] existent déjà, mais... les valeurs sociétales actuelles empêchent l'humanité de les traiter efficacement. Surmonter ces obstacles est au cœur des changements fondamentaux nécessaires pour parvenir à un avenir soutenable et équitable ... »5. En termes plus provocants, on pourrait dire que les sciences sociales et les humanités détiennent, en matière environnementale, la clé des solutions aux problèmes révélés par les sciences dures. D’où la néces- saire articulation des deux domaines si l’écologie ne veut pas se résumer 2. Adger, W.N., K. Brown, , D. Conway, 2010. « Progress in global environmental change ». Global Environmental Change 20(4), 547-549. 3. Jean-Pierre Dupuy, 2002, Pour un catastrophisme éclairé, Paris, Seuil. 4. Cette incertitude proprement scientifique ne justifie en rien le soi-disant « scepticisme » dont font commerce un certain nombre de charlatans intéressés, en particulier au sujet du changement climatique. On ne peut que déplorer que ces mêmes charlatans croient bon d'embrigader le discours économique dans leur navrante croisade pour « l'écologie positive ». 5. Rogers, A.D. et d'A. D. Laffoley, 2011, International Earth system expert workshop on ocean stresses and impacts. Summary report. IPSO, Oxford, 18 p.
- 11. Introduction : Quelle place pour l’économie dans la science de la soutenabilité ? 9 à une science toujours plus exacte de la contemplation des désastres. En quoi l’économie peut-elle se rendre utile à cette « grande jonction » ? Quels sont ses avantages comparatifs au sein des sciences sociales ? L’économie comme science de la dynamique L’histoire a pris une bonne longueur d’avance environnementale sur l’économie. Elle met en perspective depuis quatre décennies nos problèmes et nos solutions écologiques et elle est même parvenue à chroniquer avec minutie notre entrée dans ce que John McNeill a appelé un « régime de bouleversement écologique perpétuel »6. Mais la science de la soutenabilité ne pourra se consolider que sur de meilleurs outils d’anticipation de l’avenir. L’économie se révèle bien capable, à cet égard, d’élaborer des modèles de prévision, de simulation et d’actualisation utiles à la décision publique, mais l’évaluation des indi- cateurs existants de soutenabilité environnementale révèle l’insuffi- sance des dispositifs actuels. L’article de Didier Blanchet est sur ce point éloquent. Synthèse de la méthodologie et des enseignements du rapport de la commission Stiglitz-Sen-Fitoussi et évocation de ses premières mises en œuvre, il lève très utilement les malentendus qui ont pu entourer ses travaux pour préciser le cadre et les enjeux des instruments de pilotage de la soutenabilité dont nous disposons et de ceux qui sont en cours de construction, pour mieux en percevoir les orientations et en évaluer la portée. C’est sur ces mêmes insuffisances qu’insistent Céline Antonin, Thomas Mélonio et Xavier Timbeau, qui, après en avoir rappelé les conditions de validité théorique et la méthodologie, pointent les limites de l’épargne nette ajustée telle qu’elle est aujourd’hui calculée par la Banque mondiale, dès lors que sont prises en compte la dépréciation du capital éducatif et des émis- sions de carbone plus conformes à la réalité. Jacques Le Cacheux se livre pour sa part à un exercice de prospective sur une question straté- gique étrangement délaissée dans le débat public actuel : l’avenir des systèmes agricoles, notamment européens, pris entre les dynamiques démographique, alimentaire et écologique. Un article de ce numéro revient précisément sur le concept de découplage, qui, malgré toutes ses limites, ne devrait pas être caricaturé et encore moins abandonné : il se révèle très utile pour penser la transition que doivent accomplir nos économies. L’économie, science de la dynamique, éclaire donc la question des coûts et des bénéfices des politiques de soutenabilité, et 6. John McNeill, 2000, Something New Under the Sun: An Environmental History of the 20th- Century World. New York: Norton.
- 12. 10 Éloi Laurent cette dimension renvoie à la capacité des systèmes économiques de façonner les incitations qui influencent les comportements mais aussi à celle de la discipline économique de mettre en lumière les enjeux de répartition qui se trouvent au cœur de la transition écologique. L’économie comme science des incitations et de la répartition Il est difficile d’imaginer meilleures cartographie et feuille de route que la conférence Nobel d’Elinor Ostrom pour se repérer sur le chemin restant à parcourir en matière de science de la gouvernance écologique et plus précisément de théorie des incitations appliquée à la gestion des ressources communes. Depuis le monde conceptuel de l’après-guerre, où deux types de biens s’offraient à un type d’individu selon deux formes optimales d’organisation, Lin Ostrom a considérablement enrichi l’économie de l’environnement par une approche social-écolo- gique et polycentrique qui a complètement renouvelé le cadre des interactions entre systèmes humains et naturels et la conception des politiques environnementales. Dans cette contribution majeure, elle s’efforce d’être aussi pédagogue qu’elle est savante. Ses travaux, dont elle retrace ici le cheminement, seront au cœur du sommet Rio + 20 en juin prochain, dont l’ambition est de progresser sur les questions connexes de « l'économie verte dans le cadre du développement soute- nable et de l'éradication de la pauvreté » et du « cadre institutionnel du développement soutenable ». L’économie comme science des incitations fournit ainsi aux déci- deurs publics une palette d’instruments qui ne sont pas des panacées prêtes à l’emploi mais au contraire des mécanismes de précision dont les conditions d’efficacité, si elles sont de mieux en mieux connues, n’en demeurent pas moins déterminantes. L’économie du climat offre une illustration de la richesse de cet arsenal et de sa nécessaire intégra- tion à différents niveaux de gouvernance. Gaël Callonnec, Frédéric Reynès et Yasser Yeddir-Tamsamani reviennent sur l’évaluation des effets économiques et sociaux de la taxe carbone en France pour mettre en évidence, à l’aide d’un modèle unique en son genre, la possibilité d’un double dividende économique et environnemental autant à court terme qu’à long terme. Christian de Perthuis explore les pistes de réforme de la surveillance et de la supervision des marchés européens du carbone et conclut à la nécessité de mettre en place une « banque centrale européenne du carbone » capable d’aider l’autorité publique et la société à découvrir graduellement le « bon » prix du carbone. Olivier Godard s’attache enfin à évaluer la pertinence, les modalités et la faisabilité de l’institution d’un ajustement carbone aux frontières de
- 13. Introduction : Quelle place pour l’économie dans la science de la soutenabilité ? 11 l’Union européenne, visant à restaurer l’intégrité économique et envi- ronnementale de la politique climatique européenne. Il montre que sous certaines conditions un tel mécanisme contribuerait à renforcer la cohérence et la crédibilité de l’engagement européen. Ces contribu- tions, prises ensemble, tracent les contours d’une politique française et européenne intégrée, cohérente et efficace en matière d’atténuation du changement climatique. Elles sont rien moins qu’essentielles pour les décideurs français et européens dans la perspective du sommet de Durban (novembre-décembre 2011), qui ne verra pas d’avancées sur le front de l’adoption de cibles contraignantes de réduction de gaz à effet de serre et qui laissera donc la France et l’Union européenne face à leurs engagements et leurs responsabilités. Il serait illusoire et même contre-productif d’isoler cette question des incitations économiques de celle des enjeux de justice et de réparti- tion, omniprésents dans ce qu’il est convenu d’appeler l’économie politique de l’environnement. Ce sont ces enjeux que mettent en évidence Michael Ash et James Boyce qui rappellent le parcours de l’idée de justice environnementale aux États-Unis depuis les années 1980 avant de montrer comment celle-ci peut s’incarner dans des instruments quantitatifs susceptibles de modifier les comportements des entreprises et les pratiques des secteurs industriels les plus polluants. Ces avancées empiriques sont riches d’enseignements pour l’Union européenne, où l’idée de justice environnementale commence tout juste à trouver une traduction dans les politiques publiques. Il faut là aussi progresser et d’abord, comme le montre le dernier article de la première partie, sur le front de la précarité et des inégalités énergé- tiques, qui touchent lourdement la population française. Si les enjeux de répartition jouent un rôle dans les incitations, celle qui se révèle peut-être la plus puissante pour modifier les comportements et les atti- tudes des citoyens dépend de l’action des pouvoirs publics non pas seulement sur le prix mais sur la valeur. C’est l’économie comme science de la mesure de ce qui compte qui s’avère ici décisive. L’économie comme science de la mesure de ce qui compte « Il ne se passe pas une année sans que nos systèmes de mesure ne soient remis en question ». Dans la foulée du Rapport Stiglitz-Sen- Fitoussi, Jean-Paul Fitoussi et Joe Stiglitz reviennent en clôture de ce numéro sur la nécessité de dépasser les mesures actuelles de l’activité économique pour concevoir et surtout mettre en application de véri- tables mesures du progrès social et du bien-être. De la catastrophe de Fukushima à la crise financière, de la révolution dans le monde arabe
- 14. 12 Éloi Laurent aux causes et aux conséquences du chômage de masse et à la crise euro- péenne, ils livrent ici de nouvelles réflexions qui annoncent de nouveaux travaux et de nouvelles avancées. Leur article illustre parfai- tement l’idée qui fonde le rôle essentiel de l’économie comme science de la mesure de ce qui compte vraiment dans les sociétés humaines : mesurer, c’est gouverner. Contributions théoriques et empiriques s’inscrivant au cœur des débats scientifiques les plus intenses du moment sur les grand enjeux écologiques (climat, biodiversité, ressources agricoles, pollutions chimiques, soutenabilité, bien-être), les articles rassemblés ici sont également des appels à l’action, c'est-à-dire à la réforme des politiques publiques françaises et européennes. On trouvera dans les pages qui suivent des propositions explicites ou seulement suggérées de réforme de la politique agricole commune européenne, de création de nouveaux instruments européens de mesure d’exposition au risque environnemental et industriel, de mise en place d’une politique euro- péenne de lutte contre la précarité énergétique, de réforme et d’évaluation des politiques de gestion des ressources écologiques communes, d’institution d’une taxe carbone en France, de création d’une Banque centrale européenne du carbone, de mise en place d’un tarif carbone aux frontières de l’UE, de conception et de mise en œuvre de nouveaux indicateurs de progrès social et de bien-être au sein d’une institution permanente. Ces propositions méritent toutes d’être enten- dues et débattues dans la période politique capitale qui s’ouvre. Ce numéro aura alors réalisé ses ambitions. Cette nouvelle étape éditoriale de la Revue de l’OFCE, désormais en ligne en accès libre et déclinée en deux séries Prévisions et Débats et politiques, a pu compter sur la contribution de quelques-uns des meilleurs spécialistes français et étrangers de l’économie de la soute- nabilité, que je tiens à remercier encore pour la rapidité de leur réponse à ma sollicitation tardive et la très grande qualité de leur propos. Je remercie aussi Philippe Weil pour le soutien immédiat et constant qu’il a apporté à ce projet. Je remercie enfin Laurence Duboys Fresney et Najette Moummi pour leur disponibilité, leur réac- tivité et leur créativité sans lesquelles la réalisation de ce numéro se serait vite révélée insoutenable.
- 15. Part. 1 GOUVERNANCE ÉCOLOGIQUE ET JUSTICE ENVIRONNEMENTALE Par-delà les marchés et les États : la gouvernance polycentrique des systèmes économiques complexes, conférence Nobel . . . . . . . . . 15 Elinor Ostrom Justice environnementale et performance des entreprises : nouvelles perspectives et nouveaux outils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Michael Ash et James K. Boyce Pour une justice environnementale européenne : le cas de la précarité énergétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Éloi Laurent Revue de l’OFCE / Débats et politiques – 120 (2011)
- 17. PAR-DELÀ LES MARCHÉS ET LES ÉTATS LA GOUVERNANCE POLYCENTRIQUE DES SYSTÈMES ÉCONOMIQUES COMPLEXES* Elinor Ostrom** Traduction : Éloi Laurent Dans cet article, je retrace le cheminement intellectuel qui fut le mien au cours du dernier demi-siècle, depuis mes premiers efforts visant à comprendre les systèmes polycentriques de gestion de l'eau en Californie. L'étude dans les années 1970 des « industries » polycentriques de police des zones métropolitaines aux États-Unis m'a convaincu un peu plus de la nécessité d'un nouveau cadre d'analyse unifié, compa- tible avec les enseignements de la théorie des jeux et éloigné des approches monolithiques qui ne reconnaissaient que l'État ou le marché comme forme efficace d'organisation humaine. Ce fut le cadre « Analyse et développement institutionnels » qui nous permit, à de nombreux collègues et à moi, d'entreprendre une série d'études empiriques des cas de gestion de ressources communes à travers le monde. Des expé- riences menées en laboratoire nous ont davantage renseigné encore sur les raisons qui expliquent pourquoi des individus anonymes et isolés ont tendance à surexploiter les ressources communes. Au fil du temps, un ensemble clair de résultats micro-situation- nels a émergé permettant d’identifier les facteurs structurels qui affectent la probabilité d'une coopération sociale accrue. Il est à présent nécessaire de développer des approches plus globales pour étudier plus complètement les facteurs qui favori- sent ou nuisent à l'émergence et à la robustesse de ces efforts de gestion auto-organisés au sein de systèmes polycentriques multi-niveaux, notamment dans le domaine écologique. Il nous faut, si nous voulons vraiment la comprendre, pleinement accepter la complexité de la gouvernance des systèmes économiques et écologiques. Mots-clés : polycentrisme, ressources communes, gouvernance écologique, cadre « analyse et développement institutionnels ». * Cet article est une version révisée de la conférence qu’Elinor Ostrom a donnée à Stockholm, en Suède, le 8 Décembre 2009, quand elle a reçu le Prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel. Cet article est publié ici avec l'autorisation de la Fondation Nobel, qui en détient les droits d’auteur. ** Workshop in Political Theory and Policy Analysis, Indiana University, Bloomington, IN 47408 (e-mail : [email protected]) et Center for the Study of Institutional Diversity, Arizona State University, Tempe, AZ. Je souhaite remercier Vincent Ostrom et mes nombreux collègues du Workshop in Political Theory and Policy Analysis qui ont travaillé avec moi tout au long des années à développer le programme de recherche qui est brièvement discuté dans les pages qui suivent. Je remercie également Arun Agrawal, Andreas Leibbrandt, Mike McGinnis, Jimmy Walker, Tom Wisdom pour leurs utiles suggestions sur cet article ainsi que les membres du Applied Theory Working Group et du Experimental Reading Group, de même que Patty Lezotte pour son excellente compétence éditoriale. Je suis enfin très reconnaissante à la Fondation Ford, la Fondation MacArthur, et la National Science Foundation pour leur soutien capital au fil des ans. Revue de l’OFCE / Débats et politiques – 120 (2011)
- 18. 16 Elinor Ostrom L a recherche contemporaine sur les résultats des divers arrange- ments institutionnels visant à gouverner des ressources communes (common-pool resources) et des biens publics à de multiples échelles s'appuie sur la théorie économique classique, tout en développant une nouvelle théorie pour expliquer des phénomènes qui n’ont pas de correspondance dans le monde dichotomique du « marché » et de « l'État ». Les chercheurs sont progressivement en train de passer de systèmes simples à des cadres d’analyse, des théories et des modèles plus complexes, afin de comprendre la diversité des problèmes et des questions auxquels sont confrontés les êtres humains qui interagissent dans les sociétés contemporaines. Les humains que nous étudions possèdent des structures complexes de motivation et construisent des arrangements institutionnels divers – privés à but lucratif, gouvernementaux et communautaires – qui opèrent à des échelles multiples pour engendrer des résultats qui peuvent être productifs et innovants autant que destructeurs et pervers (North, 1990, 2005). Dans cet article, je vais retracer le cheminement intellectuel qui fut le mien au cours du dernier demi-siècle, depuis le moment où j'ai commencé des études supérieures dans les années 1950. Les premiers efforts visant à comprendre les systèmes polycentriques de gestion de l'eau en Californie furent pour moi formateurs. En plus de travailler avec Vincent Ostrom et Charles M. Tiebout, alors qu’ils étaient en train d’articuler leur concept de systèmes polycentriques de gouvernement des zones métropolitaines, j'ai étudié les efforts d'un large groupe de producteurs d'eau privés et publics confrontés au problème de surexploitation d'un bassin d'eaux souterraines sur la côte dans lequel l’intrusion d'eau salée menaçait les possibilités d’utilisation à long terme. Puis, dans les années 1970, j'ai participé avec des collègues à l'étude des « industries » polycentriques de police des zones métropolitaines aux États-Unis pour constater que la théorie dominante qui sous-tendait les propositions de réforme massive de ces services était erronée. Les zones bénéficiant d’une combinaison de grands et petits « producteurs » de ce service pouvaient réaliser des économies d'échelle dans la production de
- 19. Par-delà les marchés et les États 17 certains de ces services de police tout en évitant les dés-économies d'échelle dans la production d’autres. Ces premières études empi- riques ont conduit au fil du temps à l'élaboration du cadre « Analyse et développement institutionnels » (ADI). Ce cadre d’analyse unifié, compatible avec les enseignements de la théorie des jeux, nous permit d'entreprendre une série d'études empiriques, y compris une méta-analyse d'un grand nombre d’études de cas de gestion des ressources communes à travers le monde. Des études expérimentales soigneusement conçues et menées en laboratoire nous ont permis de tester des combinaisons précises de variables structurelles pour éclairer les raisons qui poussent des individus anonymes et isolés à surexploiter les ressources communes. Le simple fait de permettre à ces individus de pouvoir communiquer entre eux sans même que cette parole ne les engage (cheap talk), permet de réduire la surexploi- tation et d’augmenter les gains communs, contrairement aux prédictions de la théorie des jeux. Qui plus est, de larges études sur les systèmes d'irrigation au Népal et sur les forêts de la planète permettent de contester la présomption selon laquelle les gouverne- ments font toujours mieux que les usagers dans la gestion et la protection de ressources essentielles. À l’heure actuelle, de nombreux chercheurs ont entrepris de nouveaux efforts théoriques. Une voie de recherche centrale consiste à développer une théorie plus générale du choix indivi- duel susceptible de faire droit au rôle crucial de la confiance lorsque se présentent des dilemmes sociaux. Au cours du temps, un ensemble clair de résultats micro-situationnels a émergé au sujet des facteurs structurels qui affectent la probabilité d'une coopéra- tion sociale accrue. Compte tenu de la complexité des paramètres des champs d’analyse plus élargis, il est nécessaire de développer des approches plus globales (ou « configurales ») pour étudier les facteurs qui favorisent ou nuisent à l'émergence et à la robustesse d’efforts de gestion auto-organisés au sein de systèmes polycentriques multi- niveaux. Plus avant, l'application des études empiriques aux poli- tiques publiques nous amène à souligner l'importance de faire correspondre des règles institutionnelles à des contextes socio- écologiques spécifiques. Les politiques à taille unique (one size fits all policies) ne sont pas efficaces. Les modèles et travaux empiriques que de nombreux chercheurs ont entrepris dans les dernières
- 20. 18 Elinor Ostrom décennies nous fournissent un meilleur fondement pour l'analyse des politiques publiques. Après ce bref survol du propos qui va suivre, entrons dans le vif de mon cheminement intellectuel. 1. Le monde d’avant : les systèmes simples Au milieu du XXe siècle, l'effort scientifique prédominant consis- tait à faire rentrer le monde dans des modèles simples et à critiquer les arrangements institutionnels qui n’y correspondaient pas. Je vais brièvement passer en revue les hypothèses de base qui ont été formulées alors et ont été depuis contestées par des chercheurs du monde entier, en particulier Simon (1955) et Ostrom (2008). 1.1. Deux formes optimales d’organisation Le marché était considéré comme l'institution optimale pour la production et l'échange de biens privés. Pour les biens non privés, en revanche, « le » gouvernement devait imposer des règles et des prélèvements à des individus égocentrés afin qu’ils lui procurent les ressources nécessaires pour fonctionner et s’abstiennent de comportements égoïstes. Sans un gouvernement hiérarchique susceptible de les contraindre à respecter les règles communes, en effet, les citoyens et les représentants de la force publique n’obéi- raient qu’à leur intérêt propre et ne parviendraient pas à fournir en quantité efficace les biens publics tels que la paix et la sécurité, et ce à toutes les échelles de gouvernement (Hobbes [1651] 1960 ; Wilson, 1885). On recommandait par exemple qu’une seule entité gouvernementale se substitue à la structure « chaotique » de la gouvernance métropolitaine, pour en accroître l'efficacité, limiter les conflits entre les différentes structures de gouvernement et servir au mieux une population considérée comme homogène (Anderson et Weidner, 1950 ; Gulick, 1957; Friesema, 1966). Cette vision dichotomique du monde permet de rendre compte des inte- ractions et des résultats sur les marchés pour la production et l'échange de biens strictement privés (Alchian, 1950), mais elle n’explique pas de manière satisfaisante la dynamique interne aux entreprises privées (Williamson, 1975, 1986). Pas plus qu’elle ne permet de comprendre la grande diversité des arrangements insti- tutionnels que les humains bâtissent pour gouverner, fournir et gérer les biens publics et les ressources communes.
- 21. Par-delà les marchés et les États 19 1.2. Deux types de marchandises Dans son essai classique à visée typologique, Paul Samuelson (1954) divise les biens en deux types. Les biens privés purs sont à la fois « excluables » (un individu A peut être exclu de la consomma- tion des biens privés s’il ne s’acquitte pas de leur prix) et « rivaux » (tout ce que A consomme ne peut être consommé par personne d'autre). Les biens publics sont à la fois « non excluables » (il est impossible d’empêcher ceux qui n'ont pas payé pour un bien de le consommer tout de même) et « non-rivaux » (quelle que soit la consommation individuelle de A, la consommation des autres ne s’en trouve pas amoindrie). Cette division élémentaire était conforme à la dichotomie du monde institutionnel entre des échanges de biens privés dans un cadre de marché d’une part et des biens appartenant au gouvernement et organisés selon une hiérarchie publique de l’autre. Les gens étaient considérés avant tout comme consommateurs ou électeurs. 1.3. Un modèle unique d'individu L'hypothèse selon laquelle tous les individus sont entièrement rationnels était généralement acceptée dans la théorie économique standard et la théorie des jeux. Des individus pleinement rationnels sont supposés connaître (i) toutes les stratégies possibles disponibles dans une situation particulière, (ii) quels résultats sont liés à quelle stratégie étant donné le comportement probable des autres dans une situation donnée, et (iii) un ordre de classement de chacun de ces résultats en termes de préférences individuelles mesurées par l'utilité. La stratégie rationnelle pour un tel individu dans chaque situation consiste à maximiser son utilité espérée. Alors que l'utilité a été initialement conçue comme un moyen de combiner une diver- sité de valeurs externes sur une seule échelle interne, en pratique, elle en est venue à être assimilée à une seule unité de mesure exter- nalisée, tels que les profits espérés. Ce modèle de l'individu a généré d’utiles et fructueuses prédictions, validées empiriquement, sur les résultats des opérations de transaction de biens aux attributs spéci- fiques sur un marché concurrentiel, mais n’est pas opératoire pour une grande variété de dilemmes sociaux. Je reviendrai à la discussion de la théorie du comportement individuel à la section 7.1.
- 22. 20 Elinor Ostrom 2. Premiers efforts visant à comprendre pleinement les systèmes humains complexes Cette approche des systèmes simples datant du milieu du ving- tième siècle s’est lentement transformée sous l’effet de recherches empiriques approfondies et du développement d'un cadre cohé- rent avec les modèles de la théorie des jeux pour l'analyse d'un large éventail de questions . 2.1. L’étude des industries publiques polycentriques Les études empiriques qui ont été conduites sur la manière dont les citoyens, les entrepreneurs publics locaux et les représentants de la force publique entreprennent de diverses façons de fournir, produire et gérer les industries de service public et les régimes de propriété commune à différentes échelles ont permis des progrès substantiels dans la connaissance, qui ne s'expliquent pas par le recours aux deux formes optimales d’organisation évoquées plus haut. Ostrom, Tiebout et Warren (1961) ont introduit le concept de polycentrisme dans leur effort pour déterminer si les activités d'un large éventail d'organismes publics et privés engagés dans la fourniture et la production des services publics dans les zones métropolitaines étaient chaotiques, comme les chercheurs domi- nants le pensaient, ou au contraire potentiellement productives. Encadré. Le concept de polycentrisme « Le terme ‘polycentrique’ caractérise une situation dans laquelle de nombreux centres de prise de décision sont formellement indépendants les uns des autres. Qu'ils fonctionnent réellement de manière indépen- dante, ou au contraire forment un système interdépendant de relations, est une question empirique qui doit être étudiée pour des cas particu- liers. Dans la mesure où elles se prennent mutuellement en compte dans leurs rapports de concurrence, entrent en relation dans divers engage- ments contractuels et coopératifs ou ont recours à des mécanismes centralisés pour résoudre leurs conflits, les différentes juridictions poli- tiques d’une zone métropolitaine peuvent fonctionner d'une manière cohérente et selon des logiques de comportements d’interaction prévi- sibles. Dans la mesure où ces traits sont rassemblés, on peut dire qu’elles fonctionnent comme un ‘système’ ». (Ostrom, Tiebout, et Warren, 1961: 831-32).
- 23. Par-delà les marchés et les États 21 S'appuyant sur le concept « d’industrie de service public » (Bain, 1959 ; Caves, 1964 ; Ostrom et Ostrom, 1965), plusieurs études portant sur la performance du secteur de l'eau ont été réalisées dans diverses régions de la Californie durant les années 1960 (Ostrom, 1962 ; Weschler, 1968 ; Warren, 1966 ; Ostrom, 1965). Des éléments probants substantiels ont permis d’établir que les diffé- rents organismes publics et privés avaient tenté de mettre en place une organisation efficace des ressources en eau à plusieurs échelles contrairement à l'opinion qui voulait que la présence de multiples unités gouvernementales sans hiérarchie claire fut chaotique. En outre, ces études ont conduit à mettre en lumière trois mécanismes susceptible d’accroître la productivité dans les zones métropoli- taines polycentriques : (i) les villes de petite et moyenne taille sont plus efficaces que les grandes villes pour assurer le suivi des perfor- mances de gestion de leurs citoyens et des coûts, (ii) les citoyens qui ne sont pas satisfaits de la fourniture de services qui leur est procurée peuvent « voter avec leurs pieds » et s’installer dans des juridictions qui se rapprochent davantage de leurs préférences en termes de services publics (éventail et coûts) et (iii) des commu- nautés locales autonomes peuvent passer contrat avec de plus grands producteurs et dénoncer ces contrats quand elles ne sont pas satisfaites des services rendus, tandis que les différents quartiers des grandes villes n'ont pas voix au chapitre. Dans les années 1970, ces premiers travaux sur les diverses manières d'organiser la fourniture de l'eau dans les zones métropo- litaines et leurs effets contrastés ont été étendus à la question de la sécurité et de la police. Ces études posaient directement la question de savoir si des économies d'échelle substantielles existaient dans la production des services de police de quartier en milieu urbain comme l'affirmaient les partisans d’une réforme ample de ces services (Skoler et Hetler, 1970). Pas un seul cas n’a été trouvé d’un large service de police centralisé surpassant, selon de nombreux indicateurs, de petits départements servant des quartiers semblables. Une série d'études a été mené à Indianapolis (Ostrom et al., 1973), Chicago (Ostrom et Whitaker, 1974), et Saint-Louis (Ostrom et Parcs, 1973 ; Ostrom, 1976) et ensuite répliquée à Grand Rapids, Michigan (Ishak, 1972) et Nashville, Tennessee (Rogers et McCurdy Lipsey, 1974). Nous avons constaté qu’alors que de nombreux services de police servaient les quatre-vingt régions
- 24. 22 Elinor Ostrom métropolitaines que nous avons également étudiées, la duplication des services par plus d'un département à un même ensemble des citoyens survenait rarement (Ostrom, Parks et Whitaker, 1978). En outre, la croyance largement répandue selon laquelle la multiplicité des départements dans une zone métropolitaine était moins effi- cace n'a pas trouvé de validation. En réalité, « les producteurs les plus efficaces fournissent plus de service pour un niveau donné de ressources utilisées dans les zones métropolitaines à haute multipli- cité de producteurs de service que ne le font les producteurs efficaces dans les régions métropolitaines qui comptent moins de producteurs » (Ostrom et Parks, 1999: 287). Les régions métropoli- taines comprenant un grand nombre de producteurs autonomes de services directs atteignaient des niveaux plus élevés d'efficacité technique (ibid.: 290). L'efficacité technique était également renforcée dans les régions métropolitaines comptant un petit nombre de producteurs fournissant des services indirects telles que la communication radio et des analyses de laboratoire criminelles. Nous fûmes donc en mesure de rejeter la théorie sous-jacente aux propositions de réforme d’intégration métropolitaine des services. Nous avons démontré en somme que la complexité n'est pas la même chose que le chaos en matière de gouvernance métropoli- taine. Nous avons étendu la portée de cette leçon lorsque nous nous sommes engagés dans d'autres études empiriques de la gouvernance polycentrique des ressources et des systèmes d’infras- tructures à travers le monde (Andersson et Ostrom, 2008 ; Ostrom, Schroeder et Wynne, 1993). 2.2. Doubler les types de biens L’étude de la façon dont les individus font face aux divers problèmes d'intérêt public dans le monde nous a conduits à rejeter le classement des biens en partie double, Buchanan (1965) avait déjà ajouté un troisième type de bien, qu'il a nommé les « biens de club ». Il était en effet possible à des groupes d'individus de créer des associations privées (clubs) pour se doter de biens et services non-rivaux mais à petite échelle dont ils pourraient profiter tout en excluant les non-membres de la participation et donc de la consommation. À la lumière des recherches empiriques et théo- riques conduites depuis lors, nous avons proposé des modifications supplémentaires à la typologie des biens afin d'identifier les diffé-
- 25. Par-delà les marchés et les États 23 rences fondamentales qui affectent les incitations offertes aux individus (Ostrom et Ostrom, 1977). Il s’agit de : (i) remplacer le terme « rivalité dans la consommation » par « soustractabilité d'utilisation » ; (ii) conceptualiser les notions de « soustractabilité d'utilisation » et d’« excluabilité » pour les faire varier de « faible » à « élevée », plutôt que de les considérer simplement comme présente ou absente ; (iii) ajouter explicitement un quatrième type de bien très important – les ressources communes – qui partage avec les biens privés l'attribut de la soustractabilité et la difficulté d'exclusion avec les biens publics (Ostrom et Ostrom, 1977). Les forêts, les systèmes d'eau, les pêcheries, et l’atmosphère de la planète sont tous des ressources communes d'une immense importance pour la survie des êtres humains sur cette terre ; (iv) renommer les biens « de club » en biens « à péage » dès lors que de nombreux biens qui partagent ces caractéristiques sont fournis par les pouvoirs publics à une échelle locale ainsi que par des associations privées. La figure 1 donne un aperçu des quatre grands types de biens qui influent différemment sur les problèmes auxquels sont confrontés les individus dans la conception des institutions susceptibles de leur permettre de les fournir, de les produire et de les consommer. Ces quatre grands types de biens contiennent eux-mêmes de nombreux sous-types qui varient sensiblement selon de nombreux attributs. Par exemple, une rivière et une forêt sont toutes deux des ressources communes. Mais elles diffèrent sensiblement en ce qui concerne la mobilité des unités de ressources produites, la facilité de mesure, l'échelle de temps pour la régénération, et d'autres attributs encore. Des ressources communes spécifiques diffèrent également selon l'étendue spatiale, le nombre d'utilisateurs, et de nombreux autres facteurs. Quand on s'engage dans un véritable travail de terrain, on est confronté à l’immense diversité des situations dans lesquelles les humains interagissent. Calée dans une voiture de police qui patrouille le quartier central d'une grande ville américaine à minuit le samedi, on voit en tant qu'observateur d’autres modes d'interac- tion humaine que lors de la même patrouille dans une banlieue chic un après-midi de semaine à la sortie de l'école. Dans les deux
- 26. 24 Elinor Ostrom cas, on observe la production d'un bien public – la sécurité locale – par un fonctionnaire d'un gouvernement local. Figure 1. Quatre types de biens Capacité de soustraire la ressource à l’usage d’autrui Forte Faible Biens publics: Ressources communes : paix et sécurité Difficulté bassins d'eau souterraine, lacs, de la communauté, défense Forte systèmes d'irrigation, pêcheries, nationale, connaissances, d'exclusion forêts, etc. protection contre les incendies, des prévisions météorologiques, etc. bénéficiaires potentiels Biens privés: Biens de péage (de club) : Faible alimentation, vêtements, théâtres, clubs privés, garderies, automobiles, etc. etc. Source : adapté de E.Ostrom (2005), p. 24. Les individus impliqués dans chaque situation diffèrent en ce qui concerne l'âge, le degré de sobriété, la raison de leur présence et ce qu'ils tentent de réaliser. Et ce contexte influe sur les stratégies de l'agent de police qui est l’objet de l'observation. De la même manière, on peut noter la différence entre mesurer la production de biens publics et prêter attention aux comportements des sociétés d'eau privées, des services de la ville, des compagnies pétrolières privées, et des résidents locaux qui se rencontrent dans divers contextes pour évaluer la responsabilité des uns et des autres dans la surexploitation des eaux souterraines d’un bassin provo- quant une intrusion d'eau salée massive, et décider des actions à entreprendre. Ces personnes sont toutes confrontées au même problème – la surexploitation d’une ressource commune – mais leurs comportements diffèrent considérablement quand ils se réunissent chaque mois dans une association privée, quand ils s'affrontent dans une salle d'audience et quand ils défendent au Parlement et éventuellement devant les citoyens un projet d’aménagement et de conservation. Ces exemples et bien d'autres situations observées dans les systèmes d'irrigation et de gestion des forêts dans de nombreux pays du monde ne ressemblent pas aux modèles standards d’organisation par le marché ou un processus hiérarchique.
- 27. Par-delà les marchés et les États 25 3. Élaboration d'un cadre pour analyser la diversité des situations humaines La complexité et la diversité des paramètres de terrain que nous avons étudiées a généré un effort soutenu des collègues associés au Workshop in Political Theory and Policy Analysis (« l’Atelier » ci- après) pour élaborer le cadre d’analyse ADI (Analyse et Développe- ment institutionnels)1 (Ostrom, 1975 ; Kiser et Ostrom, 1982 ; McGinnis, 1999a, b, 2000 ; Ostrom, 1986, 2005). Ce cadre d’analyse contient un ensemble de composantes imbriquées que les chercheurs en sciences sociales peuvent utiliser dans leurs efforts pour comprendre les interactions humaines et leurs résultats en fonction de diverses situations institutionnelles. Le cadre ADI s'appuie sur des travaux antérieurs sur les transactions ( Commons, [1924] 1968), la logique de situation (Popper, 1961), les structures collectives (Allport, 1962), les cadres relationnels (Irving Goffman, 1974), et la théorie du script (Schank et Abelson, 1977). L'approche s'inspire également de l'œuvre de Koestler (1973) et de Simon (1981, 1995) qui ont tous deux contesté l'hypothèse selon laquelle le comportement humain et ses résultats seraient entière- ment fondés sur un petit ensemble de irréductibles composantes. Alors que les termes cadres, théories et modèles sont utilisés de manière interchangeable par de nombreux chercheurs, nous utili- sons ces concepts de façon imbriquée pour aller du plus général au plus précis dans nos hypothèses de recherche. Le cadre ADI est destiné à contenir l’ensemble le plus général de variables que l'analyste institutionnel peut vouloir utiliser pour étudier une variété de milieux institutionnels, telles que les interactions humaines sur les marchés, dans les entreprises privées, au sein des familles, des organisations communautaires, des assemblées législa- tives et des agences gouvernementales. Il fournit aux chercheurs un langage métathéorique permettant de discuter toute théorie parti- culière ou de comparer les théories entre elles. Une théorie spécifique est utilisée par un analyste pour spécifier quelles parties du cadre sont jugées utiles pour expliquer divers résultats et quels sont leurs rapports. Les théories microsociales, dont la théorie des jeux, la théorie microéconomique, la théorie des coûts de transac- 1. Institutional Analysis and Development (IAD).
- 28. 26 Elinor Ostrom tion, et la théorie des biens publics et des ressources communes sont des exemples de théories spécifiques compatibles avec le cadre ADI. Élaborer des modèles consiste à formuler des hypothèses précises sur un nombre limité de variables au sein d’une théorie que les chercheurs utilisent pour examiner les conséquences formelles de ces hypothèses spécifiques sur la motivation des acteurs et les caractéristiques de la situation dans laquelle ils se trouvent. Le cadre ADI est conçu pour permettre aux chercheurs d'analyser des systèmes qui sont composés de groupes de variables, dont chacune peut ensuite être désagrégée à plusieurs reprises en fonction de la question d'intérêt du moment. Au centre du cadre ADI se trouve le concept de situation d’action affectée par des variables externes (figure 2). Figure 2. Un cadre pour l’analyse institutionnelle Variables externes Conditions biophysiques Attributs de la Situations Interactions communauté d’action Critères Règles en d’évaluation vigueur Résultats Source : adapté de E.Ostrom (2005), p. 15. Les catégories les plus larges de facteurs externes affectant une situation d'action à un moment donné comprennent : (i) les conditions biophysiques, qui peuvent être simplifiées dans certaines analyses pour s’apparenter à l'un des quatre types de biens définis à la figure 1 ; (ii) les attributs d'une communauté, qui peuvent comprendre l'histoire des interactions antérieures, l’homogénéité ou l’hétéro- généité interne des attributs clés, et le capital de connaissances et social des individus susceptibles de participer ou d’être affectés par l’action des autres ;
- 29. Par-delà les marchés et les États 27 (iii) les règles en vigueur, qui précisent comment ceux qui sont impliqués comprennent ensemble qui doit, ne doit pas, ou peut entreprendre des actions qui affectent les autres et font l'objet de sanctions (Crawford et Ostrom, 2005). Les règles en vigueur peuvent évoluer au fil du temps dès lors que ceux qui sont impli- qués dans une situation d'action interagissent avec les autres dans une variété de situations (Ostrom, 2008 ; Ostrom et Basurto, à paraître ; Boyd et Richerson, 1985) ou peuvent vouloir délibérément changer les règles au moyen d’un choix collectif ou constitutionnel. L'ensemble des variables externes affecte une situation d'action et engendre des logiques d'interactions et des résultats qui sont évalués par les participants à la situation d'action (et potentielle- ment par des chercheurs) et rétroagissent à la fois sur les variables externes et la situation d'action. Les composantes internes d'une situation d'action sont explicitement compatibles avec les variables qu'un théoricien utilise pour analyser un jeu formel2. Cela signifie que mes collègues ont pu utiliser des modèles formels de théorie des jeux compatibles avec le cadre ADI pour analyser des combinaisons simplifiées mais néanmoins intéressantes de variables théoriques et en tirer des conclusions qui puissent être testées (voir Acheson et Gardner, 2005 ; Gardner et al., 2000 ; Weis- sing et Ostrom, 1993) ainsi que des modèles à agents (MAA) (Jager et Janssen, 2002 ; Janssen, 2008). Il n'est pas possible de développer un jeu formel (ou même un MAA) pour analyser les situations plus complexes impliquant de nombreuses variables pertinentes qui influent sur les résultats et sont de première importance pour l'analyse institutionnelle. Il est possible, en revanche, d'utiliser un ensemble commun d'éléments structurels pour élaborer des formes structurées codées pour la collecte et l'analyse de données. Et on peut concevoir des expériences utilisant un ensemble commun de variables pour de nombreuses situations présentant un intérêt pour les économistes politiques et déterminer ensuite pourquoi certains comportements et résultats se produisent dans certaines situations 2. Je suis très reconnaissante à Reinhard Selten pour les nombreuses heures de discussion productive que j'ai eue avec lui au début des années 1980, alors que nous commencions à élaborer le cadre ADI, au sujet des composantes internes d'un jeu formel qui pourraient être utilisées dans ce cadre.
- 30. 28 Elinor Ostrom et pas dans d'autres. Pour spécifier la structure d'un jeu et en prédire les résultats, le théoricien doit déterminer : (i) les caractéristiques des acteurs impliqués (y compris le modèle de choix individuel adopté par le théoricien) ; (ii) les positions qu'ils occupent, par exemple, s’ils sont les premiers à jouer ou des joueurs de rang (first mover or row player) ; (iii) l’ensemble des actions dont les joueurs peuvent décider au niveau des différents nœuds d’un arbre décisionnel ; (iv) la quantité d'information disponible à un nœud de décision ; (v) les résultats que les acteurs affectent conjointement ; (vi) un ensemble de fonctions qui relient les acteurs et les actions au niveau des nœuds de décision à des résultats intermédiaires ou finaux ; (vii) les avantages et les coûts associés aux actions choisies et aux résultats obtenus. Ce sont aussi les composantes internes d'une situation d'action comme le montre la figure 3. Comme discuté ci-dessous, l’applica- tion d’un cadre commun à une grande variété d'études de cas a permis une plus grande accumulation de connaissances au sujet des interactions et des résultats dans des environnements très complexes. Le cadre ADI intègre en effet explicitement une situation particulière dans un contexte plus large de variables externes, dont certaines peuvent être délibérément révisées au cours du temps. Figure 3. La structure interne d’une situation d’action Variables externes ACTEURS INFORMATION CONTRÔLE à propos de sur associés à RÉSULTATS POSITIONS Liés à POTENTIELS associés à COÛTS ET BÉNÉFICES NETS attribués à ACTIONS Source : adapté de E.Ostrom (2005), p. 33.
- 31. Par-delà les marchés et les États 29 4. Les individus rationnels sont-ils désespérément piégés dans des dilemmes sociaux ? Les hypothèses classiques sur les comportements des individus rationnels confrontés à une dichotomie de formes organisation- nelles et de biens (cf. supra) masquent les efforts potentiellement productifs des individus et des groupes pour organiser et résoudre les dilemmes sociaux auxquels ils font face, telles que la surexploita- tion des ressources communes et la production insuffisante de biens publics locaux. Les modèles classiques ont été utilisés pour repré- senter les individus impliqués dans un jeu du dilemme du prisonnier ou d'autres dilemmes sociaux comme toujours pris au piège, dépourvu de capacités de changer les structures elles-mêmes. Cette étape dans les théories utilisées pour analyser la condition humaine a été régressive. Le fait que les individus qui sont dans une situation donnée aient le moyen de transformer les variables externes qui affectent leur propre condition varie considérablement d'une situation à l'autre. Il s’agit donc d’une question empirique qui varie d’une situation à l’autre plutôt que d'une logique universelle. Dans un dilemne du prisonnier, les enquêteurs gardent volontaire- ment les prisonniers séparés de sorte qu'ils ne puissent pas communiquer. Mais les utilisateurs d'une ressource commune ne voient pas leurs actions limitées de la sorte. Lorsque les analystes perçoivent que les êtres humains dont ils tentent de modéliser le comportement sont piégés dans des situations perverses, ils font alors l’hypothèse que d’autres êtres humains extérieurs – chercheurs ou représentants de la force publique – sont capables d'analyser la situation, de déterminer pourquoi les résultats d’interaction se révè- lent contre-productifs, et d’envisager les changements dans les règles en vigueur qui permettront aux participants d'améliorer ces résultats. On attend ensuite des responsables extérieurs qu’ils impo- sent un ensemble optimal de règles sur les individus. On suppose donc que la dynamique de changement doit venir de l'extérieur de la situation plutôt que de la réflexion et de la créativité des personnes impliquées dans cette situation et de leur capacité à restructurer leurs propres modèles d'interaction. Pour reprendre les propos de Richard Sugden au sujet de cette approche : « La plupart des théories économiques modernes décrivent un monde dirigé par un gouvernement (et non pas, de manière signi- ficative, par des gouvernements), et voit ce monde à travers les yeux de ce gouvernement. Le gouvernement est censé avoir la
- 32. 30 Elinor Ostrom responsabilité, la volonté et le pouvoir de restructurer la société de quelque manière que ce soit en vue de maximiser le bien-être social. Comme la cavalerie américaine dans tout bon western, le gouvernement tient à se précipiter à la rescousse lorsque le marché « fait défaut », et la tâche des économistes consiste à le conseiller sur le moment et la manière de le faire. On ne fait en revanche que peu ou pas crédit aux individus de la capacité de résoudre entre eux leurs problèmes collectifs. Voilà bien une vision déformée de certaines questions économiques et poli- tiques pourtant importantes. » (Sugden, 1986: 3 ; italiques dans l'original). La représentation donnée par Hardin (1968) d’usagers d’une ressource commune – un pâturage ouvert à tous – piégés dans une tragédie inexorable de surexploitation et de destruction a été large- ment acceptée car elle était conforme à la prévision de non- coopération du dilemme du prisonnier ou d'autres jeux de dilemme social. Cette métaphore a retenu l'attention des cher- cheurs et décideurs du monde entier. Beaucoup ont alors cru que les ressources communes n’étaient détenues par personne. Et on en a déduit que les représentants du gouvernement avaient pour mission d’imposer de nouvelles variables externes (par exemple de nouvelles politiques publiques) afin de prévenir la destruction par les utilisateurs de ces ressources, puisque ceux-ci ne pouvaient pas faire autrement que de détruire les ressources dont leur propre avenir (et le nôtre incidemment) dépendait. 4.1. L’apport des chercheurs de diverses disciplines pour déterminer si les usagers des ressources communes sont toujours piégés socialement Tandis que des cas dramatiques de ressources surexploitées avaient capté l'attention de l’opinion, les études de la gouvernance locale des ressources communes à petite et moyenne échelle sur de longues périodes de temps réalisées par des anthropologues, des historiens de l'économie, des ingénieurs, des historiens, des philo- sophes et des politistes, ne parvenaient pas à attirer celle de la plupart des théoriciens et décideurs (voir McNetting, 1972 ; McCay et Acheson, 1987 ; Coward, 1980). Le cumul des connaissances contenues dans ces études s’est avéré impossible parce que ces travaux ont été menés par des cher- cheurs de diverses disciplines se concentrant sur différents types de ressources situées dans de nombreux pays. Heureusement, le
- 33. Par-delà les marchés et les États 31 National Research Council (NRC) créa au milieu des années 1980 un comité pour évaluer les divers arrangements institutionnels se révélant efficaces pour la conservation et la gestion des ressources communes. Ce comité du NRC rassembla des chercheurs de plusieurs disciplines utilisant le cadre ADI pour commencer à iden- tifier les variables communes dans les cas où les utilisateurs étaient parvenus à s’organiser efficacement et dans ceux où ils avaient échoué (Ronald Oakerson, 1986 ; NRC, 1986). Le fait d’établir de nombreux cas dans lesquels les utilisateurs des ressources avaient effectivement réussi à s'organiser a remis en cause l’hypothèse qui voulait qu'il était impossible pour les utilisateurs des ressources de résoudre eux-mêmes leurs problèmes de surexploitation. Le rapport issu des travaux de ce comité du NRC ouvrit la porte à un éventail d'études utilisant des méthodes variées. Ce comité a égale- ment été l’aiguillon d’un programme de recherche à l’Atelier3 visant à coder et analyser les études de cas d’usage des ressources communes menées par d'autres chercheurs. 4.2. Méta-analyses des études de cas de ressources communes Dans un effort pour aller au-delà de la simple existence de plusieurs cas où les utilisateurs des ressources étaient parvenus à s’auto-organiser efficacement, mes collègues de l'Atelier entrepri- rent une méta-analyse de ces études de cas, identifiées grâce aux activités du comité du NRC4. Grâce à nos études antérieures des systèmes urbains complexes et de l'élaboration d'un cadre et d’un langage commun pour relier les composantes de ces systèmes complexes, nous étions en mesure d’utiliser ce cadre pour nous aider à organiser nos efforts. Le cadre ADI est ainsi devenu le socle de la conception d'un manuel de codage destiné à enregistrer un ensemble cohérent de variables pour chaque étude de cas de gestion de ressource commune. Ce fut un travail considérable. Plus de deux ans furent consacrés à ce manuel (Ostrom et al., 1989). Un problème clé était le peu de recoupement entre les variables identi- fiées par les auteurs d'études de cas issus de diverses disciplines. Il a fallu à notre équipe lire et passer au peigne fin plus de 500 études de cas afin d'identifier un ensemble restreint d’études qui avaient 3. Workshop in Political Theory and Policy Analysis, Indiana University. 4. Cet effort de méta-analyse est décrit au chapitre 4 de Amy Poteete, Janssen et E. Ostrom (2010).
- 34. 32 Elinor Ostrom consigné des informations sur les acteurs, leurs stratégies, l'état de la ressource et les règles en vigueur5. Un ensemble commun de variables a été identifié pour 44 sous-groupes de pêcheurs côtiers (Edella Schlager, 1990, 1994) et 47 systèmes d'irrigation gérées par des agriculteurs ou un gouvernement (Shui Yan Tang 1992, 1994). Sur les 47 systèmes d'irrigation inclus dans l'analyse, 12 étaient gérés par des agences gouvernementales dont seulement 40 % (n = 7) pouvaient se prévaloir de performances élevées. Sur les 25 gérés par les agriculteurs, plus de 70 % (n = 18) avaient un rende- ment élevé (Tang 1994: 234). La conformité à la règle commune se révéla une variable clé affectant la pertinence dans le temps de la gestion de l’eau (Tang 1994: 229). Aucun des groupes de pêcheurs côtiers analysés par Schlager n’était géré par un gouvernement et 11 (soit 25 %) n’étaient pas du tout organisés. Les 33 autres sous- groupes étaient organisés de manière variée, selon des règles informelles qui définissaient qui était autorisé à pêcher dans un endroit particulier et quelle limite devait être appliquée aux quan- tités pêchées (Schlager, 1994: 260). En plus d’identifier des niveaux de coopération élevés, nous avons également trouvé dans certains cas une forme de confirma- tion de la prédiction d’absence de coopération. « Dans les cas de dilemmes de ressources communes dans lesquels les individus ne se connaissent pas, ne peuvent pas communiquer efficacement et ne peuvent donc conclure des accords et élaborer ensemble des normes et sanctions, les prévisions dérivées de modèles d'individus rationnels participant à un jeu non coopératif se voient largement confirmées. Il s’agit de cas rares et l’hypothèse de rationalité complète paraît alors raisonnable » (Ostrom, Gardner et Walker, 1994: 319). Mais, d’'autre part, la capacité à surmonter les dilemmes et à créer une gouvernance efficace étaient beaucoup plus fréquente que prévu et dépendait de la structure de la ressource elle-même et du fait que les règles en vigueur dévelop- 5. Les chercheurs issus d’horizons disciplinaires divers ont tendance à utiliser un vocabulaire et des cadres théoriques très différents quand ils décrivent des situations empiriques. D'autres chercheurs qui ont utilisé la méta-analyse font également état de la nécessité de passer en revue de nombreuses publications pour obtenir des données cohérentes sur les systèmes humains d’utilisation de ressources. Adcharaporn Pagdee, Yeon-Su Kim, et PJ Daugherty (2006) rapportent ainsi avoir consulté plus de 100 articles pour finalement analyser 31 études de cas de gestion forestière. Thomas K. Rudel (2008) indique qu’il a passé en revue près de 1 200 études pour une méta-analyse de 268 cas de changement dans la couverture forestière tropicale.
- 35. Par-delà les marchés et les États 33 pées par les utilisateurs correspondent bel et bien à cette structure (William Blomquist et al., 1994). Dans tous les systèmes auto-orga- nisés, nous avons constaté que les utilisateurs avaient créé des règles de limites, pour déterminer qui pourrait utiliser les ressources, des règles de choix relatives à la répartition du flux des unités de la ressource, et des formes actives de contrôle et de sanc- tion décentralisée des contrevenants aux règles communes (Ibid.: 301). Mais nous n'avons pas trouvé un seul cas où les usagers utilisaient une stratégie de réplique dure (grim trigger) – une forme de punition par laquelle les individus, selon de nombreuses études théoriques, étaient censés résoudre le problème des dilemmes répétés (Dutta, 1990: 264). 4.3. Les faisceaux de droits de propriété liés aux ressources communes Les économistes de l’environnement ont utilisé le terme de « ressources de propriété commune » pour se référer aux pêcheries et aux ressources en eau (Gordon, 1954; Scott 1955; Bell, 1972). Associer ainsi le terme de « propriété » à celui de « ressource » introduit une grande confusion entre la nature d'un bien et l'absence ou la présence d'un régime de propriété (Ciriacy-Wantrup et Bishop, 1975). Une ressource commune peut être détenue et gérée comme une propriété du gouvernement, une propriété privée, une propriété communautaire, ou n’être détenue par personne (Bromley, 1986). Une autre raison de l'absence de connaissances sur les systèmes de propriété locale développés par les utilisateurs était que de nombreux chercheurs présumaient que si les utilisateurs ne possédaient pas le droit d'aliénation de leur ressource – le droit de vendre leur bien –, ils ne détenaient pas de droits de propriété véritables (Alchian et Demsetz, 1973; Anderson et Hill, 1990 ; Posner, 1975). Schlager et Ostrom (1992) s’appuyèrent sur les travaux antéri- eurs de Commons ([1924] 1968) pour imaginer des systèmes de droits de propriété contenant des faisceaux de droits plutôt qu’un seul droit. La méta-analyse des études de cas existante a permis d'identifier cinq droits de propriété que les individus utilisant des ressources communes peuvent posséder de manière cumulative : (i) l'accès, le droit de prendre part à une propriété donnée6 ; (ii) le retrait, le droit de prélever les produits spécifiques d'une
- 36. 34 Elinor Ostrom ressource, (iii) la gestion, le droit de transformer la ressource et d’en réglementer les modes d'utilisation interne, (iv) l'exclusion, le droit de décider qui aura droit d’accès, de retrait ou de gestion (v) enfin l'aliénation, le droit de céder ou de prêter n’importe lequel des quatre premiers droits. Cette conception en faisceaux des droits de propriété est désormais largement acceptée parmi les chercheurs qui ont étudié les divers systèmes de droits de propriété à travers le monde (Brunckhorst, 2000 ; Degnbol et McCay, 2007 ; Paavola et Adger, 2005 ; Trawick, 2001 ; Wilson et al., 1994). 4.4. Lier les composants internes d'une situation d'action à des règles extérieures Les acteurs qui ont des droits de propriété spécifiques à une ressource sont également confrontés à des règles plus fondamen- tales qui affectent la structure des situations d'action dans lesquelles ils sont impliqués. Dans notre méta-analyse, nous avons identifié une incroyable variété de règles spécifiques utilisées dans différents contextes (déterminant par exemple qui peut prélever quel nombre d’unités de ressources à quel endroit et à quelle heure, quelle information devait fournir les utilisateurs, quels coûts et avantages étaient attachés à quelles actions, etc.) En tentant de trouver une approche cohérente pour coder et analyser cette riche diversité de règles spécifiques décrites par les auteurs des études de cas, nous nous sommes de nouveau tournés vers le cadre ADI. Comme nous avions identifié sept composantes d’une situation d'action, il semblait raisonnable de concevoir sept grands types de règles fonctionnant comme des variables externes affectant les composantes des situations d'action (voir figure 4). Les sept types de règles sont les suivants: (i) les règles de limite qui spécifient comment les acteurs devraient être choisis pour entrer ou sortir des positions ; (ii) des règles de position qui spécifient un ensemble de positions, et le nombre d’acteurs détenant chacune ; (iii) les règles de choix qui spécifient quelles actions sont attribuées à un acteur dans une position donnée ; 6. La notion de droits d'accès a intrigué certains chercheurs. Un exemple trivial d'un droit d'accès est l'achat d'un permis pour entrer dans un parc public. Ce permis donne au titulaire le droit d'entrer et de profiter des joies de la randonnée pédestre et des autres activités (la récolte exceptée) pour une période de temps définie.
- 37. Par-delà les marchés et les États 35 (iv) les règles d'information qui spécifient les canaux de communi- cation entre les acteurs et quelle information doit, peut ou ne doit pas être partagée ; (v) Les règles de portée qui spécifient quels résultats pourraient être affectés ; (vi) les règles d'agrégation (telle que les règles de majorité ou d'unanimité) qui spécifient comment les décisions des acteurs à un nœud doivent être reliées à des résultats intermédiaires ou finaux ; (vii) Enfin, les règles de gains qui spécifient comment les avantages et les coûts devraient être distribués aux acteurs selon leurs positions (Crawford et Ostrom, 2005). Une manière utile de concevoir des règles institutionnelles consiste à envisager la partie d'une situation d'action affectée par une règle (figure 4). Figure 4. Les règles comme variables éxogènes affectant directement les éléments d’une situation d’action Règles d’information Règles d’agrégation Règles de limite ACTEURS INFORMATION CONTRÔLE associés à à propos de sur Règles de RÉSULTATS Règles de position POSITIONS Liés à portée POTENTIELS associées à COÛTS ET BÉNÉFICES NETS Règles de choix attribués à ACTIONS Règles de gains Source : adapté de E. Ostrom (2005), p. 189. Cette conceptualisation en sept types de règles (plutôt qu’un ou deux) a suscité l’ire des chercheurs qui auraient voulu s'appuyer sur des modèles simples d'interactions entre les humains. Mais non contents d’identifier un éventail de sept types de règles, nous avons aussi trouvé de multiples variantes de chaque type. Par
- 38. 36 Elinor Ostrom exemple, nous avons trouvé 27 règles de limite décrites par les auteurs des études de cas et utilisées dans au moins une situation d’usage de ressource commune (Ostrom, 1999: 510). Certaines règles spécifiaient diverses formes de résidence, d’appartenance à une organisation, ou des attributs personnels, assignés ou acquis. De même, nous avons trouvé 112 règles de choix différentes qui étaient habituellement composées de deux parties : une formule de répartition précisant où, quand, ou comment les unités de ressources pourraient être prélevées et une base spécifique pour l'application de la formule (telle que la quantité de terres possédée, les tendances historiques d’utilisation de la ressource ou la cession par le biais de loteries) (ibid.: 512). 4.5. Les institutions pérennes de ressources communes Après avoir travaillé pendant plusieurs années avec mes collègues sur le codage des cas des systèmes ayant réussi ou échoué, il m’a semblé que ma tâche était désormais d'entreprendre une analyse statistique minutieuse afin d'identifier les règles spéci- fiques associées aux systèmes efficaces. Je n'avais pas encore complètement digéré le nombre incroyable et la diversité des règles que l'équipe était parvenue à identifier. En 1988, j'ai pris une année sabbatique pour me consacrer à un groupe de recherche organisé par Reinhard Selten au Center for Interdisciplinary Research de l'Université de Bielefeld. Je me suis démenée pour trouver des règles pertinentes pour les environnements écologiques, sociaux, et économiques, mais les règles spécifiques associées à la réussite ou à l'échec des systèmes de gestion variaient considérablement entre les différents environnements. Finalement, j'ai dû aban- donner l'idée que des règles spécifiques pourraient être associés à des cas de réussite. Remontant d’un niveau de généralité, j'ai essayé de comprendre les régularités institutionnelles plus larges des systèmes persistants sur une longue période de temps, régularités absentes dans les cas d’échec. J'ai utilisé le terme de « principes de conception » pour caractériser ces régularités. Je n’entendais pas par là que les pêcheurs, irrigateurs, éleveurs et autres avaient explicitement ces principes à l’esprit quand ils conçurent des systèmes qui se sont maintenus sur de longues périodes de temps. Mon propos était plutôt d'identifier un ensemble d’enseignements
- 39. Par-delà les marchés et les États 37 fondamentaux sous-jacents caractérisant les régimes pérennes par opposition aux cas d'échec (Ostrom 1990)7. Ces principes de conception étant décrits en détail dans E. Ostrom (1990, 2005), je me contenterai d’en énumérer ici seule- ment une brève liste actualisée, telle que développée par Michael Cox, Gwen Arnold et Sergio Villamayor- Tomás (2009) : 1A. Les limites entre utilisateurs et non utilisateurs : des limites claires et comprises de tous au plan local existent entre les util- isateurs légitimes et ceux qui ne le sont pas ; 1B. Les limites des ressources : des frontières claires séparent une ressource commune spécifique d'un système socio-écologique plus large ; 2A. La congruence avec les conditions locales : les règles d’appro- priation et de fourniture sont congruentes avec les conditions sociales locales et environnementales ; 2B. Appropriation et fourniture : les règles d’appropriation sont conformes aux règles de fourniture ; la répartition des coûts est proportionnelle à la répartition des bénéfices ; 3. Les dispositions de choix collectif : la plupart des personnes concernées par un régime de ressources sont autorisées à parti- ciper à la conception et la modification de ses règles ; 4A. La surveillance des utilisateurs : des personnes responsables devant les utilisateurs ou les utilisateurs eux-mêmes assurent la surveillance des niveaux d’appropriation et de fourniture des utilisateurs ; 4B. La surveillance de la ressource : des personnes responsables devant les utilisateurs ou les utilisateurs eux-mêmes assurent la surveillance de l’état de la ressource ; 5. Des sanctions graduées : les sanctions pour infractions aux règles sont d’abord très faibles, mais deviennent de plus en plus fortes si un utilisateur viole une règle de manière répétée ; 6. Mécanismes de résolution des conflits : des instances locales de résolution des conflits entre utilisateurs ou avec des représen- tants de la force publique existent et fonctionnent de manière rapide et peu coûteuse ; 7. Le terme de « principe de conception » a induit de nombreux lecteurs en confusion. Peut- être aurais-je dû utiliser le terme de « meilleures pratiques » pour décrire les règles et la structure des institutions pérennes.
- 40. 38 Elinor Ostrom 7. Reconnaissance minimale des règles : les droits des utilisateurs locaux à édicter leurs propres règles sont reconnus par le gouvernement ; 8. Entreprises imbriquées : quand une ressource commune est étroitement liée à un système socio-écologique plus large, les activités de gouvernance sont organisées en plusieurs couches imbriquées. Ces principes de conception semblent synthétiser les facteurs fondamentaux qui influent sur la probabilité de long terme de survie d'une institution développée par les usagers d'une ressource. Cox, Arnold, et Villamayor-Tomás (2009) ont analysé plus de 100 études menées par des chercheurs pour évaluer la capacité de ces principes à expliquer la réussite ou l'échec de diverses expéri- ences de gestion de ressources communes. Les deux tiers de ces études confirment que les systèmes de ressources pérennes sont caractérisés par la plupart des principes de conception identifiés et que les cas d’échecs ne le sont pas. Les auteurs de certaines études qui ont conclu que les principes de conception étaient inopérants ont eu tendance à les interpréter de manière très rigide et ont ensuite estimé que le succès des systèmes reposait sur des principes plus flexibles. Dans trois cas, la formulation initiale des principes de conception était trop générale et ne distinguait pas entre les conditions écologiques et sociales. Aussi ai-je adopté les améliora- tions aux principes 1, 2 et 4 proposées par Cox et ses coauteurs. 5. Des expériences pour étudier les problèmes liés aux ressources communes L'existence d'un grand nombre de cas où les utilisateurs ont dans les faits surmonté leurs dilemmes sociaux afin de parvenir à une utilisation pérenne, de long terme, de leurs ressources communes a apporté un démenti convaincant à la présomption qui voulait que cela soit impossible. De nombreuses variables influent simultanément sur ces résultats de terrain. Le recours à des modèles de théorie des jeux d’utilisation de ressources communes (Ostrom et Weissing, 1993 ; Ostrom et Gardner, 1993) fut l’une des stratégies que nous avons utilisée pour évaluer les résultats théo- riques d'un ensemble de variables observées sur le terrain. Nous
- 41. Par-delà les marchés et les États 39 avons également pensé qu'il était important d’examiner l'effet de combinaisons précises de variables dans un cadre expérimental. 5.1. Expérimentations de ressources communes dans les laboratoires universitaires Gardner et Walker se sont joints à moi dans un effort prolongé pour construire et tester des modèles minutieusement spécifiés de théorie des jeux compatibles avec le cadre ADI (voir Ostrom, Walker et Gardner, 1992 ; Ostrom, Gardner et Walker, 1994). Les premières expériences commencèrent avec une situation statique de référence qui était aussi simple que possible tout en reflétant les aspects cruciaux de l’appropriation de la ressource commune par les utilisateurs sur le terrain. Nous utilisâmes une fonction de production des gains quadratique basée sur le modèle classique de Gordon (1954). La dotation initiale en ressources pour chacun des huit sujets était un ensemble de jetons que le sujet pouvait allouer entre le marché 1 (qui avait un rendement fixe) et le marché 2 (qui fonctionnait comme une ressource commune et dont le rendement était affecté par les actions de tous les sujets de l'expérience). Les sujets reçurent des informations agrégées de sorte qu'ils ne savaient pas quelles étaient les actions de chaque individu. Chaque sujet i pouvait investir une partie xi de sa dotation en ressources communes (marché 2), la partie restante étant alors être investie sur le marché 1. La fonction de gains que nous avons utilisée (Ostrom, Gardner et Walker 1994:110) était de la forme : (1) ui(x) = we si xi = 0 (2) w(e – xi) + (xi/Σxi)F(Σxi) si xi > 0. L'expérience de référence était un « dilemme des biens communs » dans lequel le résultat de théorie des jeux impliquait une surexploitation importante d'une ressource tandis qu’un résultat bien meilleur pouvait être atteint si les sujets consentaient à réduire leur allocation conjointe. La prédiction de la théorie des jeux non coopératifs était que les sujets allaient investir selon un équilibre de Nash – 8 jetons chacun pour un total de 64 jetons. Les sujets pouvaient gagner beaucoup plus s’ils réduisaient leur alloca- tion dans la ressource commune à un total de 36 jetons. Les sujets dans l’expérience de référence à tours multiples ont largement surinvesti – ils ont investi encore plus de jetons que prévu, de sorte que le résultat conjoint a été pire que ne le prédisait l’équilibre de
- 42. 40 Elinor Ostrom Nash8. Nous fondant sur des travaux antérieurs portant sur les biens publics (Isaac et Walker, 1988), nous avons alors mené une série d’expériences de communication en vis-à-vis dans lesquelles la même fonction de paiement a été conservée. Après une période initiale de dix tours de jeu sans communication, les sujets ont été informés qu'ils pouvaient communiquer les uns avec les autres de manière collective avant de retourner à leurs terminaux informa- tiques pour prendre leurs propres décisions privées. C’était l'occasion d’une parole sans engagement (cheap talk). On prédisait en effet le même résultat dans ces expériences que dans l’expé- rience de référence dès lors qu’un sujet pouvait promettre de coopérer, mais sans qu’une tierce partie ne s’assure que sa parole soit tenue. Les sujets utilisèrent les séances de vis-à-vis pour discuter des stratégies susceptibles de produire les meilleurs résul- tats et se mirent d'accord, quand cela était possible, sur ce que chacun devrait investir. Ils prenaient connaissance du résultat agrégé de leurs investissements après chaque tour, mais pas des décisions individuelles. Cela leur permit de savoir si les investisse- ments totaux étaient plus importants que ceux dont ils étaient convenus. Dans de nombreux cas, les sujets tinrent parole. À l’occasion d’autres tours de jeu, on observa des défections. Les sujets utilisèrent alors les informations recueillies sur les niveaux d'investissement global pour réprimander leurs partenaires si l'investissement total était supérieur à celui dont ils avaient convenu. La possibilité du face-à-face répété se révéla extrêmement utile pour générer des gains communs plus élevés. Ce résultat est en accord avec un grand nombre d'études analysant l’effet du face- à-face sur la capacité des sujets à résoudre une variété de cas de dilemmes sociaux (Voir Ostrom et Walker, 1991 ; Orbell, van de Kragt, et Dawes, 1988 ; Sally, 1995 ; Balliet, 2010). Dans de nombreuses situations de terrain, les utilisateurs de ressources ont mis au point un éventail de manières formelles ou informelles de se sanctionner les uns les autres si les règles 8. Dans les expériences simples et répétées de biens publics, les sujets ont eu initialement tendance à contribuer à un niveau plus élevé que prévu par l'équilibre de Nash (R. Mark Isaac et al., 1984, 1985, 1994 ; Isaac et Walker, 1988 ; Gerald Marwell et Ruth E. Ames, 1979) et les résultats se sont lentement rapprochés du niveau prédit par l'équilibre de Nash à partir d'un niveau supérieur. Dans les jeux de ressources communes en revanche, les sujets ont initialement obtenu des résultats bien pires que ceux prédits par l'équilibre de Nash, dont ils se sont ensuite rapprochés « par en-dessous » (voir aussi Marco Casari et Charles R. Plott, 2003).
- 43. Par-delà les marchés et les États 41 communes étaient enfreintes, bien que ce comportement ne soit pas compatible avec la théorie de la la rationalité complète, libre de toute norme (Elster, 1989: 40-41). Il était donc important d’observer si les sujets, dans un cadre expérimental contrôlé, allaient effectivement utiliser leurs ressources financières pour sanctionner d'autres participants. Après que les sujets eurent joué dix tours de l’expérience de référence de ressource commune, on leur annonçât qu’ils pourraient dans les tours prochains acheter le droit d'imposer une amende à un autre sujet. Nous avons alors constaté beaucoup plus de sanctions dans ce contexte expéri- mental que l’hypothèse d’un niveau zéro9. Les sujets ont augmenté leurs gains bruts du fait de leur sanction mais sensible- ment réduit leurs gains nets en raison de la sur-utilisation de sanctions coûteuses10. Les sanctions s’appliquaient principalement à ceux qui faisaient défection, mais quelques sanctions frappaient les faibles contributeurs, et symbolisaient la vengeance de ceux qui avaient eux-mêmes été sanctionnés. Dans une autre expérience, on donna aux sujets la possibilité de communiquer pour décider ou non d'adopter un système de sanctions qui leur soit propre. Les sujets qui décidèrent d'adopter leur propre système de sanctions atteignirent les rendements les plus élevés de toutes les expériences de ressources menées en laboratoire, avec 90 % de gains possibles, même une fois soustraites les amendes correspondant au petit nombre de défections observées (Ostrom, Walker et Gardner, 1992). Les prédictions de la théorie des jeux non coopératifs se révèlent à peu près valides uniquement lorsque les participants à une expé- rience de laboratoire ne connaissent pas la réputation des autres personnes impliquées dans le dilemme de ressources et ne peuvent pas communiquer avec elles. À l’inverse, lorsque les sujets peuvent communiquer en face-à-face, ils se mettent souvent d'accord sur 9. Voir Joseph Henrich et al. (2006) qui ont conduit des expériences de terrain dans plusieurs pays pour tester si un ensemble beaucoup plus vaste de participants serait également susceptible d’utiliser les sanctions dans les expériences de biens publics. Voir aussi Henrich et al. (2004) pour des rapports d'expériences antérieures de terrain de dilemmes sociaux dans 15 petites communautés. 10. Des résultats similaires existent pour les expériences de biens publics dans lesquelles ceux qui sanctionnent punissent généralement ceux qui contribuent faiblement (Toshio Yamagishi, 1986 ; Ernst Fehr et Simon Gächter, 2002).
- 44. 42 Elinor Ostrom des stratégies communes et s’y tiennent, augmentant substantielle- ment leurs bénéfices nets. En outre, la communication en vue de décider et de concevoir un système de sanctions permet à ceux qui font le choix de cette option d’atteindre des gains proches de l’optimalité. 5.2. L’étude des ressources communes dans les expériences de terrain Une série d'expériences de terrain a été menée par des collègues en Colombie pour évaluer si des villageois aguerris dépendant de ressources communes prennent des décisions au sujet du « temps passé dans la forêt » selon un schéma mathématiquement cohérent avec ceux rapportés ci-dessus. Juan Camilo-Cardenas (2000) a mené des expériences de terrain dans des écoles rurales avec plus de 200 usagers locaux. Il a modifié le schéma des expériences de ressources communes, avec et sans possibilité de communication en face-à- face en demandant aux villageois de prendre des décisions concer- nant « la récolte des arbres ». Les résultats de ces expériences ont été globalement conformes aux conclusions obtenues avec les étudiants. Dans une approche différente, Cardenas, Stranlund, et Willis (2000) ont organisé dix tours d’expériences de référence avec des utilisateurs de ressources de cinq villages qui ont ensuite été autorisés à communiquer en face-à-face pour une série ultérieure d'expériences. Dans cinq autres villages, les participants ont été informés après les tours de l’expérience de référence qu’une nouvelle réglementation entrerait en vigueur qui les contraindrait à ne pas passer plus à chaque tour que la durée optimale de temps dans la forêt. La probabilité d'une inspection était de 1/16 par tour, une faible probabilité mais une probabilité réaliste pour ce qui est du contrôle de la conformité à des règles communes dans des zones rurales des pays en développement. Si un individu dépassait la limite de temps imposée, une pénalité était soustraite à ses gains, mais cette sanction n’était pas révélée aux autres. Dans ce cadre expérimental, les sujets augmentèrent leur niveau de retrait (ndtr : ils refusèrent davantage de coopérer) par rapport aux résultats obtenus lorsque le face-à-face était autorisé et qu’aucune règle ne leur était imposée. D'autres chercheurs ont également constaté que la réglementation imposée de l'extérieur, qui doit théoriquement conduire à des rendements plus élevés, a pour effet de freiner les
- 45. Par-delà les marchés et les États 43 dispositions spontanées à la coopération (voir Frey et Oberholzer- Gee, 1997 ; Reeson et Tisdell, 2008). Fehr et Leibbrandt (2008) ont mené une série intéressante d'expériences portant sur des biens publics avec des pêcheurs qui utilisent l’« accès libre » (open access) d’un lac intérieur au nord-est du Brésil. Ils constatèrent qu'un pour- centage élevé (87 %) des pêcheurs contribuaient au cours de la première période de l'expérience de terrain mais que leur niveau de contribution avait tendance à se stabiliser dans les périodes ulté- rieures. Fehr et Leibbrandt examinèrent la taille des mailles des filets utilisés par les pêcheurs et constatèrent que ceux qui contribuaient le plus dans l'expérience de biens publics utilisaient des filets avec un maillage plus grand. Des mailles plus larges permettent aux jeunes poissons de s'échapper, de se développer et de se reproduire davantage que s'ils sont pris encore petits. En d'autres termes, la coopération observée dans cette expérience était conforme à la coopération correspondant à un véritable dilemme de ressources communes. Ils en conclurent le point suivant : « le fait que notre mesure de laboratoire des préférences relatives aux comportements des autres individus prédise le comportement de terrain accroît notre confiance quant à la pertinence en matière de comportement des préférences relatives aux comportements d’autrui déterminées à partir d'expériences de laboratoire » (Ibid.: 17). En somme, les expériences de ressources communes et de biens publics ont montré que de nombreuses prédictions de la théorie classique de l'action collective ne tiennent pas. On observe davan- tage de coopération que prévu, la parole sans engagement (cheap talk) augmente la coopération, et les sujets sont prêts à investir dans un système de sanction visant les resquilleurs. Les expériences ont également établi qu’il existe une hétérogénéité dans les moti- vations des décisions de prélèvement de la ressource ou de contribution au bien public ainsi que dans celles portant sur l’application de sanctions.
- 46. 44 Elinor Ostrom 6. L’étude des problèmes de ressources communes sur le terrain Ayant mené de vastes méta-analyses d'études de cas et d’expéri- ences, nous avions également besoin d'entreprendre des études de terrain dans le contexte desquelles on pourrait s'appuyer sur le cadre ADI pour concevoir des questions en vue d’obtenir des infor- mations cohérentes au sujet des variables théoriques clés de notre approche. 6.1. Une comparaison des systèmes d'irrigation gérés respectivement par les agriculteurs et le gouvernement au Népal À l’occasion d’une visite au Népal en 1988, nous découvrîmes un grand nombre d'études des systèmes d'irrigation construits et entretenus par les agriculteurs ainsi que certains systèmes gérés par le gouvernement. Shivakoti, Benjamin, et moi-même avons été en mesure de réviser le codage de notre manuel sur les ressources communes afin d'inclure des variables d'intérêt particulier pour la compréhension des systèmes d'irrigation dans un nouveau manuel de codage rédigé pour le projet Nepal Irrigation and Institutions (NIIS). Nous avons codé les cas existants et identifié, à nouveau, de nombreuses « variables manquantes » qui n’avaient pas été discu- tées dans l’étude originale. Des collègues ont fait plusieurs voyages au Népal pour examiner des systèmes décrits dans les études décou- vertes et combler les données manquantes de même que passer en revue les données de l'étude originale. Sur place, nous avons pu ajouter de nouveaux cas à l'ensemble des études (Benjamin et al., 1994). En entreprenant une analyse de ce vaste ensemble de données, Wai Fung Lam (1998) a déterminé trois mesures de performance pouvant être appliquées à tous les systèmes : (i) l’état physique des systèmes d'irrigation, (ii) la quantité d'eau disponible pour les agriculteurs provenant d'un système donné à différentes saisons de l'année, et (iii) la productivité agricole de ces systèmes. En tenant compte des différences environnementales entre les systèmes, Lam est parvenu à la conclusion que les systèmes d'irriga- tion gérés par les agriculteurs eux-mêmes obtenaient des résultats nettement meilleurs selon les trois mesures de rendement. Dans ces systèmes régis par les agriculteurs, ceux-ci communiquaient entre eux lors de réunions annuelles et de façon informelle sur une base régulière, développaient leurs propres accords, déterminaient
- 47. Par-delà les marchés et les États 45 l’attribution des postes de surveillance, et sanctionnaient ceux qui ne se conformaient pas aux règles communes. En conséquence, les systèmes gérés par les agriculteurs étaient susceptibles de produire plus de riz, de distribuer l'eau plus équitablement, et de conserver leur ressource en meilleur état que les systèmes gouvernementaux. Alors que les systèmes gérés par les agriculteurs varient en termes de performance, très peu présentent des performances aussi mauvaises que les systèmes gouvernementaux, toutes choses égales par ailleurs. Au fil du temps, d’autres collègues se sont rendus au Népal pour coder d’autres systèmes d'irrigation. Les conclusions antérieures concernant le niveau supérieur de performance des systèmes gérés par les agriculteurs se sont trouvées confirmées par l’utilisation d’une base de données élargie comprenant 229 systèmes d'irrigation (Joshi et al., 2000 ; Shivakoti et Ostrom, 2002). Nos résultats ne se limitent pas au cas du Népal. Des cherch- eurs ont soigneusement documenté les systèmes agricoles efficaces conçus et exploités par les agriculteurs eux-mêmes dans de nombreux pays, y compris le Japon (Aoki, 2001), l’Inde (Meinzen- Dick, 2007 ; Bardhan, 2000), et le Sri Lanka (Uphoff, 1991). 6.2. Étudier les forêts du monde En 1992, le Dr Marilyn Hoskins, qui dirigeait le programme Forest, Trees and People de la FAO des Nations Unies, a demandé à ses collègues de l'Atelier de tirer parti de notre expérience dans l'étude des systèmes d'irrigation pour développer des méthodes afin d’évaluer l'impact des diverses modalités de gouvernance des forêts dans différents pays du monde. Deux ans de travail intense d’écologistes et de spécialistes des sciences sociales à travers la planète a conduit à l'élaboration de dix protocoles de recherche pour obtenir des informations fiables sur les utilisateurs et la gouvernance des forêts ainsi que sur les conditions écologiques des forêts étudiées. Un réseau de coopération scientifique au long cours, International Forestry Resources and Institutions (IFRI), fut établi avec des centres désormais situés en Bolivie, en Colombie, au Guatemala, en Inde, au Kenya, au Mexique, au Népal, en Tanzanie, en Thaïlande, en Ouganda et aux États-Unis, de nouvelles collabo- rations mises en place en Ethiopie et en Chine (voir Gibson, McKean et Ostrom, 2000 ; Poteete et Ostrom 2004 ; Wollenberg et coll., 2007). L’IFRI est une initiative unique parmi les efforts
- 48. 46 Elinor Ostrom déployés pour étudier les forêts dans la mesure où il s’agit du seul programme interdisciplinaire d’étude et de suivi à long terme des forêts dans plusieurs pays du monde qui appartiennent à des gouvernements, des organisations privées et des communautés. Les forêts sont une forme particulièrement importante de ressources communes étant donné leur rôle dans les émissions et la séquestra- tion du carbone en lien avec le changement climatique (Canadell et Raupach, 2008), la biodiversité qu'elles renferment, et leur contribution aux moyens de subsistance des populations en milieu rural dans les pays en développement. Une recommandation priv- ilégiée des politiques publiques destinées à protéger les forêts et la biodiversité consiste à établir des aires protégées appartenant au gouvernement (Terborgh, 1999). Dans un effort pour examiner si la propriété publique de ces zones protégées étaient une condition nécessaire pour améliorer la densité des forêts, Hayes (2006) a utilisé les données IFRI pour comparer le niveau de densité d’une forêt (sur une échelle de cinq points) déterminé par un forestier ou un écologiste chargé de mesurer la taille des arbres, arbustes, et de la couverture au sol pour un échantillon aléatoire de forêts11. Sur les 163 forêts incluses dans l'analyse, 76 forêts étaient gérées par le gouvernement et reconnues comme forêts protégées et 87 étaient publiques, privées, ou appartenant à une communauté et utilisées pour une variété de finalités. Aucune différence statistique n’a été observée entre la densité des forêts dans les zones protégées offici- ellement et celle des autres zones boisées. Gibson, Williams, et Ostrom (2005) ont examiné le comportement de surveillance de 178 groupes d'utilisateurs et ont observé une forte corrélation entre le niveau de surveillance des forêts et l'évaluation de la densité forestière, même après avoir tenu compte du degré d’organisation des utilisateurs, du degré de dépendance des utilisateurs à l’égard de la ressource et du niveau de capital social au sein du groupe. Chhatre et Agrawal (2008) ont à présent achevé l’examen des 11. Des exercices de mesure poussés sont effectués sur chaque site IFRI, à mesure que l'information est obtenue au sujet des utilisateurs de la forêt, de leurs activités et de leur organisation, ainsi que de leurs arrangements de gouvernance. Comparer simplement les mesures entre les forêts des différentes zones écologiques est trompeuse, car le diamètre moyen à hauteur de poitrine mesuré dans une forêt est fortement affecté par les précipitations, les sols, l'altitude, et d'autres facteurs qui varient considérablement selon les zones écologiques. Par conséquent, nous demandons au forestier ou à l’écologiste qui vient juste de superviser la collecte de données forestières de noter la forêt sur une échelle de cinq points de très clairsemée à très abondante.
- 49. Par-delà les marchés et les États 47 changements dans l’état de 152 forêts soumises à divers arrange- ments de gouvernance selon la taille de la forêt, les activités d'amélioration résultant d’action collective autour des forêts, la taille du groupe d'utilisateurs, et la dépendance des utilisateurs locaux par rapport à une forêt. Ils ont constaté que « les forêts dont la probabilité de régénération est la plus élevée sont susceptibles d'être de petite à moyenne taille avec un faible niveau de dépen- dance des habitants locaux, une faible valeur commerciale, des niveaux élevés de surveillance locale et une forte action collective pour améliorer la qualité de la forêt » (ibid.: 1327). Dans une seconde analyse majeure, Chhatre et Agrawal (2009) se sont concentrés sur les facteurs qui affectent les arbitrages et les syner- gies entre le niveau de stockage du carbone dans les forêts et leur contribution aux moyens de subsistance des habitants locaux. Ils ont ainsi déterminé que les grandes forêts sont plus efficaces pour améliorer à la fois le stockage du carbone et les moyens de subsis- tance, en particulier lorsque les communautés locales sont dotées d’un niveau élevé d’autonomie en matière d’élaboration des règles de gestion. Des études plus récentes menées par Coleman (2009) et Coleman et Steed (2009) constatent également qu’une variable importante affectant l’état des forêts est le degré d'investissement des autorités locales dans la surveillance de l’exploitation de la ressource. En outre, quand les utilisateurs locaux se voient recon- naître des droits de récolte, ils sont davantage susceptibles de surveiller eux-mêmes les usages illégaux. D'autres études ont égale- ment mis en lumière la relation entre le caractère local de la surveillance et le meilleur état des forêts (Ghate et Nagendra, 2005 ; Ostrom et Nagendra, 2006 ; Banane et Gombya-Ssembajjwe, 2000 ; Webb et Shivakoti, 2008). La désignation légale d'une forêt comme aire protégée ne détermine pas par elle-même la densité des forêts. En revanche, les études de terrain détaillées des procédures de surveillance et de contrôle illustrent le défi qu’il y a à obtenir des niveaux élevés de régénération forestière sans une participation active des utilisateurs locaux des forêts (voir Batistella, Robeson, et Moran, 2003 ; Agrawal 2005 ; Andersson, Gibson, et Lehoucq, 2006 ; Tucker, 2008). Notre recherche montre enfin que les forêts sous différents régimes de propriété – gouvernementale, privée, communautaire – sont parfois capables de satisfaire des objectifs sociaux élargis tels
- 50. 48 Elinor Ostrom que la protection de la biodiversité, le stockage du carbone, ou la fourniture de moyens de subsistance. Mais d'autres fois, ces régimes de propriété se révèlent incapables d’atteindre de tels objectifs. Ainsi, lorsque les gouvernements adoptent des politiques de décentralisation autoritaire en laissant les responsables locaux et les utilisateurs dans le flou quant à leurs responsabilités, des forêts autrefois stables peuvent être soumises à la déforestation (Banana et al., 2007). Dès lors, ce n'est pas le type général de gouvernance forestière qui importe pour expliquer l’état des forêts, mais plutôt le fait qu’un dispositif de gouvernance particulier s'insère bien dans le cadre écologique local, et la manière dont les règles spécifiques sont développés et adaptées au fil du temps et notamment si les utilisateurs considèrent le système comme légi- time et équitable (pour un aperçu plus détaillé du programme de recherche IFRI, voir Poteete, Janssen et Ostrom, 2010 : chap. 5). 7. Développements théoriques actuels Après un demi-siècle de nos propres recherches empiriques approfondies et de celles de nombreux chercheurs distingués (par exemple, Baland et Platteau, 2005 ; Berkes, 2007 ; Berkes, Colding, et Folke, 2003 ; Clark 2006 ; Marshall, 2008 ; Schelling 1960, 1978, 1984), où en sommes-nous ? Qu'avons-nous appris ? Nous savons désormais que les théories antérieures mettant en scène des indi- vidus rationnels, mais impuissants, piégés dans des dilemmes sociaux ne sont pas confirmées par un grand nombre d'études util- isant des méthodes variées (Faysse, 2005 ; Poteete, Janssen et Ostrom, 2010). Mais nous ne pouvons pas nous montrer par ailleurs trop optimistes et présumer que les dilemmes pourront toujours être résolus par ceux qui y font face. De nombreux groupes ont peiné et échoué dans cette entreprise (Dietz, Ostrom, et Stern, 2003). En outre, les prescriptions élémentaires de poli- tique publique visant à mettre les ressources communes sous l’autorité des gouvernements, à les privatiser, ou plus récemment à décentraliser leur gestion, peuvent également échouer (Berkes, 2007 ; Brock et Carpenter, 2007 ; Meinzen-Dick, 2007). Nous avons donc devant nous la rude tâche de développer davantage nos théo- ries pour aider à comprendre et à prévoir les situations dans lesquelles des personnes impliquées dans un dilemme de ressources communes seront en mesure de s'auto-organiser et
- 51. Par-delà les marchés et les États 49 comment divers aspects du contexte plus large dans lequel elles se trouvent affectent leurs stratégies, le succès à court terme de leurs efforts, et la pérennité à long terme de leurs succès initiaux. Nous avons donc besoin de développer une meilleure compréhension théorique du comportement des humains ainsi que de l'impact des contextes variés dans lesquels ceux-ci évoluent. 7.1. Élaboration d'une théorie plus générale de l'individu Comme nous en avons discuté précédemment à la section 3, les analyses visant à rendre compte des phénomènes observés dans le monde social sont organisées selon trois niveaux de généralité. Les cadres, tels que le cadre ADI, utilisés pour étudier les modes divers de gestion des ressources communes, sont des dispositifs méta- théoriques qui fournissent un langage général pour décrire les relations à plusieurs niveaux et échelles. Les théories servent à renforcer la connaissance en faisant des hypothèses de base sur des composantes de phénomènes sociaux rencontrés fréquemment et à prédire des résultats généraux. Les modèles sont des applications très spécifiques d'une théorie, et ils sont souvent confondus avec les théories elles-mêmes. Comme Alchian (1950) l’a fait remarquer il y a longtemps déjà, ce qu'on appelle « la théorie du choix rationnel » n'est pas une théorie générale du comportement humain, mais plutôt un modèle utile pour prédire le comporte- ment dans une situation particulière, celle d’un marché très concurrentiel pour les biens privés. Les prédictions dérivées du modèle du choix rationnel sont empiriquement validées dans des marchés ouverts pour les biens privés et d'autres environnements concurrentiels (Holt, 2007 ; Smith et Walker, 1993 ; Satz et Fere- john, 1994). C’est par conséquent un modèle utile pour prédire des résultats dans des contextes concurrentiels liés à des résultats excluables et divisibles. Bien qu’il ne soit pas encore possible de désigner une seule théorie du comportement humain qui a été formulée et testée avec succès dans une variété de contextes, les chercheurs sont actuellement en train de développer et de tester des hypothèses qui sont susceptibles d'être au cœur des développe- ments futurs (Smith, 2003, 2010). Celles-ci ont trait (i) à la capacité des individus dotés d’une rationalité limitée d’accumuler une information plus complète et plus fiable dans des situations répé- tées où une rétroaction existe, (ii) à l'utilisation de méthodes
- 52. 50 Elinor Ostrom heuristiques dans la prise de décisions quotidiennes, et (iii) aux préférences exprimées par les individus quant aux gains pour eux- mêmes et aux normes et préférences liées aux gains obtenus par les autres (voir Poteete, Janssen et Ostrom, 2010: chap. 9 ; Ostrom, 1998). L'hypothèse selon laquelle les individus possèdent des infor- mations complètes sur toutes les décisions à leur disposition, les stratégies probables que d'autres adopteraient, et les probabilités de conséquences spécifiques résultant de leurs propres choix doit être toujours rejetée exceptée dans le cas de la plus simple situation d’interactions répétées. Lorsque des individus à rationalité limitée interagissent dans le temps, il est raisonnable de supposer qu'ils acquièrent des informations plus précises sur les actions qu'ils peuvent entreprendre et les actions possibles d'autres individus (Selten ; 1990 ; Simon 1955, 1999). Certains environnements de ressources communes hautement complexes s’approchent néanmoins du chaos mathématique (Wilson et al., 1994) dans lequel les utilisateurs des ressources ne peuvent pas obtenir des informations complètes sur toutes les combinaisons probables des événements futurs. Dans de nombreuses situations, les individus utilisent des règles bricolées qu’ils ont apprises au cours temps et qui fonctionnent relativement bien dans un contexte particulier. Les pêcheurs finissent ainsi par avoir recours à « la pêche à la connaissance » (Wilson, 1990) dans la mesure où l’usage de ces règles ad hoc au fil du temps leur permet de reconnaître des indices divers des processus environnementaux qu’ils ont besoin de prendre en compte dans leurs propres déci- sions. Lorsque les individus interagissent de manière répétée, il est possible que ces règles s’approchent de la meilleure réponse possible en termes stratégiques et se confondent presque avec des optima locaux (Gigerenzer et Selten, 2001). Cependant, dans des époques caractérisées par des changements rapides ou des chocs soudains, ces méthodes heuristiques peuvent ne pas permettre aux individus d'atteindre des gains très élevés. Les individus appren- nent aussi des normes, systèmes internes de valorisations négatives ou positives, liées à des actions particulières telles que mentir ou être courageux dans des situations données (Crawford et Ostrom, 2005). La force d'un engagement interne (Sen, 1977) peut ainsi être représentée par l’importance de la pondération interne qu’un indi- vidu attribue à des actions et des résultats dans un contexte
- 53. Par-delà les marchés et les États 51 particulier. Parmi ces normes individuelles figurent celles qui sont liées à la valorisation des résultats obtenus par d'autres (Cox et Pont, 2005 ; Cox, Sadiraj et Sadiraj, 2008 ; Andreoni, 1989 ; Bolton et Ockenfels, 2000). Fehr et Schmidt (1999) ont par exemple fait l’hypothèse que les individus n'aimaient pas les résultats inégaux des interactions sociales et étaient par conséquent dotés d’une norme interne d’« aversion à l'inégalité ». Axelrod (1986) postule que les individus qui adoptent des méta- normes liées au fait que d'autres suivent les normes en vigueur dans un groupe permet d'augmenter la probabilité que les normes seront effectivement suivies. Leibbrandt, Gneezy, et List (2010) montrent que les personnes qui travaillent régulièrement en équipe sont davantage susceptibles d'adopter des normes et de se faire confiance les unes les autres que les personnes travaillant seules. Frohlich et Oppenheimer (1992) postulent que de nombreuses personnes adoptent des normes d'équité et de justice. Mais tous les individus n’ont pas les mêmes normes ou perceptions d'une situation (Umut et Putterman, 2007) et peuvent différer substantiellement dans leur manière de considérer l’équité d’un partage donné de gains (Eckel et Grossman, 1996). Se contenter de supposer que les humains adoptent des normes n'est cependant pas suffisant pour prédire leurs comportements dans un dilemme social, en particulier au sein de très grands groupes dépourvus de modalités de communication. Même avec des préférences marquées envers le respect de normes, « les comportements observés peuvent varier selon le contexte parce que la perception de qu’est une ‘chose juste’ a pu varier » (de Oliveira, Croson et Eckel, 2009: 19). Divers aspects du contexte dans lequel les indi- vidus interagissent affectent la façon dont ceux-ci s'informent sur la situation où ils se trouvent et sur les autres personnes avec lesquelles ils interagissent. Les différences individuelles impliquent des variations, mais le contexte des interactions affecte également le comportement au fil du temps (Walker et Ostrom, 2009). Les biologistes reconnaissent à cet égard que l'apparence et le comportement d'un organisme sont affectés par l'environnement dans lequel celui-ci se développe. Par exemple, certaines plantes produisent de grandes feuilles minces (qui augmentent la récolte de photons) en régime de basse lumière, et des feuilles étroites et plus épaisses (qui conser- vent l'eau) en régime de haute lumière ; certains insectes
- 54. 52 Elinor Ostrom développent des ailes seulement s’ils vivent dans des conditions de surpeuplement (et sont donc susceptibles de se trouver à court de nourriture là où ils se trouvent). De tels développe- ments contingents à l’environnement sont si banaux qu'ils pourraient être considérés comme une propriété universelle des êtres vivants. (David W. Pfennig et Cris LEDON-Rettig 2009: 268) Les chercheurs en sciences sociales doivent eux aussi recon- naître que le comportement individuel est fortement affecté par le contexte dans lequel se déroulent les interactions plutôt que d'être simplement le résultat de différences individuelles. 7.2. Le rôle central de la confiance pour faire face à des dilemmes sociaux Même si Arrow (1974) a souligné il y a longtemps le rôle crucial de la confiance entre participants comme mécanisme le plus effi- cace pour améliorer les résultats transactionnels, la théorie de l'action collective a accordé bien plus d'attention à la spécification des fonctions de paiement qu’à la manière dont les individus construisent mutuellement la confiance au moyen de coûteux efforts de coopération. Les études empiriques confirment toutefois l'importance du rôle de la confiance pour surmonter les dilemmes sociaux (Rothstein, 2005). Comme illustré à la figure 5, les hypo- thèses théoriques mises à jour d'individus capables d’apprendre et susceptibles d’adopter des normes peuvent être utilisées comme base pour comprendre comment les individus peuvent acquérir des niveaux accrus de confiance envers les autres, conduisant à plus de coopération et des gains plus élevés avec des mécanismes de rétroac- tion positive ou négative qui renforcent encore leur apprentissage. Ainsi, ce n'est pas seulement que les individus adoptent des normes, mais aussi que la structure de la situation génère suffisam- ment d'informations sur le comportement probable des autres pour qu’ils deviennent à leurs yeux dignes de confiance et suscep- tibles de supporter leur part des coûts pour surmonter un dilemme social. Dès lors, dans certains contextes, il paraît judicieux d’aller au-delà de la présomption que les individus rationnels sont impuis- sants à surmonter des situations de dilemme social.
- 55. Par-delà les marchés et les États 53 Figure 5. Comment les contextes micro-situationnels et généraux des dilemmes sociaux affectent les niveaux de confiance et de coopération Contexte institutionnel général Contexte institutionnel local Processus d’apprentissage et d’adoption de normes par les participants Niveaux de confiance dans la fiabilité des autres participants Niveaux de coopération entre participants Bénéfices nets tirés de la coopération Source : Poteete, Janssen et Ostrom (2010), p. 227. 7.3. Le niveau d'analyse micro-situationnel Soutenir que le contexte importe dans la construction ou la destruction de la confiance et de la réciprocité ne constitue pas une réponse théorique suffisante permettant de savoir pourquoi et comment les individus parviennent parfois à résoudre leurs dilemmes et d’autres fois non. Les individus qui interagissent dans une situation de dilemme font face à deux contextes : (i) un micro- contexte lié aux attributs spécifiques de la situation d'action dans laquelle les individus interagissent directement et (ii) le contexte plus large du système socio-écologique dans lequel les groupes d’individus sont amenés à prendre des décisions. Un avantage majeur des études conduites en laboratoire ou des expériences de terrain est que le chercheur conçoit le micro-contexte dans lequel l'expérience est menée. Des résultats empiriques de plus en plus nombreux (résumés dans Poteete, Janssen et Ostrom, 2010) ont permis établir que les attributs suivants des micro-contextes affec-
- 56. 54 Elinor Ostrom tent le niveau de coopération des participants (dans les dilemmes de biens publics comme dans ceux des ressources communes). (i) La communication est possible avec l'ensemble des partici- pants. Lorsque le face-à-face est possible, les participants utilisent les expressions faciales, les actions physiques, et la façon dont les mots sont exprimés pour juger de la fiabilité des autres personnes impliquées ; (ii) La réputation des participants est connue. Cette connaissance de l'histoire passée des autres participants, qui peuvent ne pas être personnellement connus avant l'interaction, augmente la probabilité de la coopération ; (iii) Les rendements marginaux par tête sont élevés. Dans cette situation, chaque participant peut savoir que ses propres contributions importeront davantage que si les rendements marginaux étaient faibles et que les autres sont davantage susceptibles de reconnaître ce lien ; (iv) Capacités d'entrée ou de sortie. Si les participants peuvent se retirer d’une situation sociale en contrepartie d’un faible coût, cela leur donne la possibilité de ne pas se faire berner sans réagir et les autres participants peuvent comprendre qu’ils peuvent se retirer (et saisir d'autres opportunités) si leur volonté de coopération ne trouve pas de réciproque ; (v) De plus longs horizons de temps. Les participants peuvent s'attendre à ce que davantage puisse être gagné du fait de la coopération sur une longue période de temps par rapport à une courte période ; (vi) Des capacités de sanction décidées d’un commun accord. Alors que les modalités de sanction imposées ou appliquées de manière externe peuvent réduire le degré de coopération, lorsque les participants eux-mêmes conviennent d’un système de sanctions, ils n'ont bien souvent pas besoin d'utiliser des sanctions fortes ou répétées et les bénéfices nets peuvent en être sensiblement améliorés. D'autres variables micro-situationnelles sont actuellement testées dans des expériences à travers le monde. L’enseignement central qui peut en être tiré est que lorsque les individus sont confrontés à un dilemme social dans un micro-contexte, ils sont davantage susceptibles de coopérer lorsque les variables situation-
- 57. Par-delà les marchés et les États 55 nelles augmentent la probabilité d’accroître la confiance envers les autres que les autres vont leur rendre. 7.4. Le contexte plus large du terrain Des personnes aux prises avec des dilemmes de ressources communes sur le terrain sont également affectées par un ensemble plus large de variables contextuelles liées aux attributs du système social-écologique (SSE) dans lequel elles interagissent. Un groupe de chercheurs en Europe et aux États-Unis travaille actuellement au développement d’un cadre d’analyse reliant le cadre ADI et ses interactions et résultats à un niveau micro à un ensemble large de variables observées sur le terrain12. Comme l’illustre la figure 6, on peut alors envisager des individus qui interagissent dans une Situa- tion d'Action engendrant des Interactions et des Résultats qui sont affectés et affectent en retour un Système de Ressources, des Unités de Ressources, des Système de Gouvernance et des Utilisateurs qui affectent et sont affectés en retour par des Conditions Sociales, Économiques et Politiques, et des Écosystèmes Associés (voir Ostrom, 2007, 2009). La figure 6 donne un aperçu du niveau le plus agrégé de l’ensemble des variables qui existent dans tous les contextes de terrain. Cet ensemble peut être développé de diverses manières quand on essaie d'analyser des questions spécifiques liées aux SSE sur le terrain, mais le temps et l’espace manquent pour entre- prendre ce type de développement dans cet article. Les chercheurs expérimentaux ont atteint un niveau plus large de consensus quant à l'impact des variables micro-situationnelles sur les incita- tions, les niveaux de confiance et le comportement des individus dans des situations de dilemme que le consensus qui prévaut parmi les chercheurs sur le terrain. Peu de variables SSE ont un impact 12. Des chercheurs des Stockholm Environment Institute, International Institute for Applied Systems Analysis, Delft University of Technology, the University of Zurich, Nordland Research Institute of Bodø University College, Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), Humboldt University, Marburg University et du projet NeWATER de l’UE abrité par the University of Osnabrück ont eu plusieurs réunions en Europe pour développer un cadre partagé (initialement développé par E. Ostrom, 2007) destiné à étudier une variété de systèmes de ressources communes. Les chercheurs du Workshop in Bloomington et du Center for the Study of Institutional Diversity at Arizona State University participeront également à cet effort. Un problème central identifié par ces chercheurs est l'absence de recoupement entre les études qui portent sur divers systèmes de ressources naturelles et de ressources humainement conçues.
- 58. 56 Elinor Ostrom totalement indépendant sur les situations d'action auxquelles font face les participants et leurs comportements probables. Les vari- ables SSE les plus déterminantes diffèrent selon les interactions (tels que la surveillance, les conflits, le lobbying, l'auto-organisa- tion) ou les résultats à long terme (telles que la surexploitation, la régénération de la biodiversité, la résilience d'un système écologique par rapport aux perturbations induites par l'homme et la nature) que l’on souhaite prédire. Figure 6. Comment les situations d’action sont encastrées dans les systèmes sociaux-écologiques Conditions sociales, économiques et politiques (S) Systèmes de ressources Systèmes de gouvernance (SR) (SG) Situations d’action Interactions (I) Résultats (R) Unités de ressources (UR) Utilisateurs (U) Lien causal direct Effet de rétroaction Écosystèmes associés (ECO) Source : adapté de Ostrom (2007), p. 151. Un ensemble de dix variables a été identifié par de nombreuses études de terrain comme ayant un impact sur la probabilité des usagers de s'auto-organiser en vue de surmonter un dilemme de res- sources communes (Ostrom, 2009 ; Basurto et Ostrom, 2009). Il s'agit notamment de : la taille, la productivité et la prévisibilité du système de ressources, le degré de mobilité des unités de ressources, l'existence de règles de choix collectif que les utilisateurs peuvent adopter de façon discrétionnaire afin de modifier leurs propres règles de fonctionnement, et de quatre attributs des utilisateurs (le nombre, l'existence de leadership, de capacité entrepreneuriale, la connaissance des SSE, et l'importance du SSE pour les utilisateurs). Lier les variables contextuelles plus larges et les variables micro- contextuelles est l'une des tâches majeures que les scientifiques qui
- 59. Par-delà les marchés et les États 57 travaillent de manière transversale ont devant eux pour com- prendre comment les facteurs sociaux et écologiques influent sur le comportement humain13. 8. La complexité et la réforme Les sciences économiques et sociales ont sensiblement progressé au cours des cinq dernières décennies depuis le temps où les chercheurs faisaient l’hypothèse de deux formes optimales d'organisation, de deux types de marchandises et d’un modèle d’individu. De nombreuses études empiriques éclairent la diversité des contextes particuliers dans lesquels les individus doivent résoudre leurs problèmes de ressources communes, le succès de certaines de ces solutions, durables sur de longues périodes de temps, et les arrangements institutionnels qui améliorent ou nuisent à la capacité des individus de résoudre à une plus petite échelle leurs problèmes efficacement et durablement (voir, par exemple, Agrawal et Gibson, 2001 ; Gibson et al., 2005 ; Schlager et Blomquist, 2008). Bien qu'il n'y ait pas encore une seule théorie bien développée qui explique tous les résultats obtenus dans divers micro-contextes comme l’expérience de laboratoire ou les contextes plus larges des pêcheries, des systèmes d'irrigation, des forêts, des lacs, et d'autres ressources communes, de larges points d’accord existent. Au demeurant, nous n'avons pas non plus une seule théorie normative de la justice qui peut être appliquée de manière parfaitement claire à tous les contextes (Sen 2009). Instaurer la confiance entre individus et développer des règles institutionnelles bien adaptées aux systèmes écologiques utilisés sont d'une importance capitale pour résoudre les dilemmes sociaux. Le résultat surprenant selon lequel les utilisateurs des ressources en relativement bon état, ou même en voie d’améliora- tion, investissent dans divers moyens de surveillance mutuels est lié à la nécessité essentielle du renforcement de la confiance. Malheureusement, les analystes politiques, les représentants de la force publique et les chercheurs qui appliquent toujours les mêmes modèles mathématiques simples à l'analyse des paramètres de 13. Voir James I. Stewart (2009) pour une étude importante liant taille du groupe, acceptation des normes de coopération et des droits de propriété dans 25 camps miniers du sud-ouest américain.
- 60. 58 Elinor Ostrom terrain n'ont pas encore assimilé les leçons centrales rappelées ici. Trop souvent, une seule recommandation politique, telle que l’instauration de quotas individuels transférables (QIT) est formulée et appliquée pour toutes les ressources d'un type particu- lier, comme les pêcheries. Bien que plusieurs systèmes de QIT fonctionnent avec succès, le temps et les efforts nécessaires pour traduire le concept théorique général d'un système de QIT en un système opérationnel dans un endroit particulier implique plusieurs années de travail acharné par les pêcheurs concernés ainsi que les représentants du gouvernement (voir Clark, 2006 ; Yandle, 2007 ; Yandle et Dewees, 2003 ; Eggertsson, 1990). D'autres chercheurs proposent de développer les zones protégées appartenant au gouvernement comme la « seule » façon de s'assurer que la biodiversité soit protégée dans le monde (Terborgh, 1999). Des études minutieuses des aires protégées ont pourtant montré que l'expulsion fréquente des peuples autochtones qui vivaient dans une région pendant des siècles avant la création d’un parc naturel sur leur territoire n'a pas produit les résultats positifs escomptés. Au moyen de la télédétection, Liu et al. (2001) ont calculé que le taux de perte et de fragmentation de l'habitat de haute qualité après que la Réserve naturelle de Wolong a été établie dans le sud-ouest de la Chine a été beaucoup plus élevé qu'avant sa création. Daniel Brockington et James Igoe (2006) ont examiné 250 rapports sur les aires protégées et les expulsions auxquelles elles ont donné lieu et en ont conclu que ces déplacements de popula- tion « infligent des dommages matériels et des préjudices psychologiques considérables. Mais ces dommages ne sont pas seulement matériels, ils ont également trait au remodelage du paysage et de la mémoire qu'ils imposent » (ibid.: 246). David Bray et ses collègues (2004) ont conduit une étude détaillée de l’effica- cité d'un autre type de réforme. En utilisant des images Landsat, ils ont trouvé un « très faible incidence de déforestation nette, de l’ordre de 0,01 % pour la période 1984-2000, le taux le plus bas enregistré de déforestation au sud du Mexique » (ibid.: 333) résul- tant d’une réforme ayant créé des institutions de propriété commune. Un développement positif de la recherche récente est que davantage de chercheurs s’engagent dans des évaluations soigneuses des diverses politiques adoptées pour la gouvernance des ressources communes (Copeland et Taylor, 2009). À la lumière
- 61. Par-delà les marchés et les États 59 d'une étude comparative des modes de gestion privée, communau- taire, et gouvernementale, Grafton (2000) a montré que chacun pouvait s’avérer efficace quand il était bien apparié aux contextes locaux et qu’il impliquait la participation active des utilisateurs. « Chacun est capable de prévenir la dégradation des ressources et d’assurer un flux continu de bénéfices pour les utilisateurs des ressources. Une comparaison du faisceau des droits des trois régimes suggère qu'un facteur commun permet d’assurer une gouvernance réussie des ressources communes : la participation active des utilisateurs des ressources dans la gestion du flux des bénéfices provenant des ressources » (Grafton, 2000: 515). Brooks et al., (2006) ont passé en revue les données générées par 124 projets de conservation et constaté que permettre aux utilisa- teurs locaux de récolter et de vendre certains produits et d’impliquer les communautés dans la conception et l'administra- tion d'un projet sont des facteurs importants de succès dans la gestion. S'éloigner de la présomption que le gouvernement doit résoudre tous les problèmes de ressource commune tout en recon- naissant le rôle important des gouvernements est un grand pas en avant. Espérons qu’à l'avenir les responsables nationaux appren- dront à travailler avec les responsables locaux et régionaux, les organisations non gouvernementales et les groupes locaux de citoyens. La leçon la plus importante pour l'analyse des politiques publiques qu’il importe de tirer du parcours intellectuel que j’ai décrit ici est que les humains possèdent des structures de motiva- tions plus complexes et une plus grande capacité à résoudre les dilemmes sociaux que postulées dans la théorie du choix rationnel. Concevoir des institutions pour contraindre (ou pousser) des individus parfaitement égoïstes à obtenir de meilleurs résultats de leurs interactions a été l’objectif majeur assigné aux gouvernements par les analystes au cours du dernier demi-siècle. De substantielles recherches empiriques me conduisent à affirmer que l’objectif central des politiques publiques devrait plutôt être de faciliter le développement d'institutions qui font ressortir ce qu’il y a de meilleur chez les humains. Nous devons nous demander comment des institutions polycentriques variées peuvent favoriser ou décou- rager l'innovation, l'apprentissage, l'adaptation, la fiabilité, le niveau de coopération des participants, et l’accomplissement de
- 62. 60 Elinor Ostrom résultats plus efficaces, équitables et durables à des échelles multiples (Toonen, 2010). Pour expliquer le monde des interactions et de leurs résultats à des échelles multiples, nous devons également être prêts à faire face à la complexité au lieu de l’écarter. Certains modèles mathéma- tiques s’avèrent très utiles pour expliquer les résultats obtenus dans des contextes particuliers. Nous devrions continuer à utiliser des modèles simples quand ils saisissent assez de la structure élémen- taire sous-jacente et des incitations pour prévoir utilement certains résultats. Mais quand le monde que nous essayons d'expliquer et d'améliorer n'est pas bien décrit par un modèle simple, nous devons continuer à parfaire nos cadres et théories afin d’être capables de comprendre la complexité et non pas simplement de la rejeter. Références bibliographiques Acheson J. M. et R. Gardner, 2005, « Spatial Strategies and Territoriality in the Maine Lobster Industry », Rationality and Society, 17(3): 309-41. Agrawal A., 2005, Environmentality: Technologies of Government and the Making of Subjects, Durham, NC: Duke University Press. Agrawal A. et C. Gibson, ed., 2001, Communities and the Environment: Ethni- city, Gender et the State in Community-Based Conservation, New Brunswick, NJ: Rutgers University Press. Alchian A. A., 1950, « Uncertainty, Evolution et Economic Theory », Journal of Political Economy, 58(3): 211-21. Alchian A. A. et H. Demsetz, 1973, « The Property Rights Paradigm », Journal of Economic History, 33(1): 16-27. Allport F. H., 1962, « A Structuronomic Conception of Behavior: Indivi- dual and Collective », Journal of Abnormal and Social Psychology, 64(1): 3-30. Anderson T. L. et P. J. Hill, 1990, « The Race for Property Rights », Journal of Law and Economics, 33(1): 177-97. Anderson W. et E. W. Weidner, 1950, American City Government, New York: Henry Holt. Andersson K. P. et E. Ostrom, 2008, « Analyzing Decentralized Resource Regimes from a Polycentric Perspective », Policy Sciences, 41(1): 71-93. Andersson K P., C. C. Gibson et F. Lehoucq, 2006, « Municipal Politics and Forest Governance: Comparative Analysis of Decentralization in Bolivia and Guatemala », World Development, 34(3): 576-95.
- 63. Par-delà les marchés et les États 61 Andreoni J., 1989, « Giving with Impure Altruism: Applications to Charity and Ricardian Equivalence », Journal of Political Economy, 97(6): 1447-58. Aoki M., 2001, Toward a Comparative Institutional Analysis, Cambridge, MA: MIT Press. Arrow K J, 1974, The Limits of Organization, New York: Norton. Axelrod R, 1986, « An Evolutionary Approach to Norms », American Poli- tical Science Review, 80(4): 1095-111. Bain J. S., 1959, Industrial Organization, New York: Wiley. Baland J.-M. et J.-P. Platteau, 2005, Halting Degradation of Natural Resources: Is There a Role for Rural Communities? Oxford: Clarendon Press. Balliet D., 2010, « Communication and Cooperation in Social Dilemmas: A Meta-Analytic Review », Journal of Conflict Resolution, 54(1): 39-57. Banana A. Y., et W. Gombya-Ssembajjwe, 2000, « Successful Forest Mana- gement: The Importance of Security of Tenure and Rule Enforcement in Ugandan Forests », in People and Forests: Communities, Institutions et Governance, ed. Clark C. Gibson, Margaret A. McKean et E. Ostrom, 87- 98. Cambridge, MA: MIT Press. Banana A., N. D. Vogt, J. Bahati et W. Gombya-Ssembajjwe, 2007, « Decen- tralized Governance and Ecological Health: Why Local Institutions Fail to Moderate Deforestation in Mpigi District of Uganda », Scientific Research and Essays, 2(10): 434-45. Bardhan P., 2000, « Irrigation and Cooperation: An Empirical Analysis of 48 Irrigation Communities in South India », Economic Development and Cultural Change, 48(4): 847–65. Basurto X. et E. Ostrom, 2009, « Beyond the Tragedy of the Commons », Economia delle fonti di energia e dell’ambiente, 52(1): 35-60. Batistella M., S. Robeson et E. F. Moran, 2003, « Settlement Design, Forest Fragmentation et Landscape Change in Rondônia, Amazônia », Photo- grammetric Engineering and Remote Sensing, 69(7): 805-12. Bell F. W., 1972, « Technological Externalities and Common-Property Resources: An Empirical Study of the U.S. Northern Lobster Fishery », Journal of Political Economy, 80(1): 148-58. Benjamin P., W. F. Lam, E. Ostrom et G. Shivakoti, 1994, Institutions, Incen- tives et Irrigation in Nepal. Burlington, VT: Associates in Rural Development. Berkes, Fikret, 2007. « Community-Based Conservation in a Globalized World », Proceedings of the National Academy of Sciences, 104(39): 15188-93. Berkes F., J. Colding et C. Folke, 2003, Navigating Social-Ecological Systems: Building Resilience for Complexity and Change. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- 64. 62 Elinor Ostrom Blomquist W., E. Schlager, S. Y. Tang et E. Ostrom, 1994, « Regularities from the Field and Possible Explanations », in Rules, Games et Common- Pool Resources, ed. E. Ostrom, R. Gardner et J. Walker, pp. 301-318, Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. Bolton G. E. et A. Ockenfels, 2000, « ERC: A Theory of Equity, Reciprocity et Competition », American Economic Review, 90(1): 166-93. Boyd R. et P. J. Richerson, 1985, Culture and the Evolutionary Process, Chicago: University of Chicago Press. Bray D. B., E. A. Ellis, N. Armijo-Canto et C. T. Beck, 2004, « The Institu- tional Drivers of Sustainable Landscapes: A Case Study of the ‘Mayan Zone’ in Quintana Roo, Mexico », Land Use Policy, 21(4): 333-46. Brock W. A. et S. R. Carpenter, 2007, « Panaceas and Diversification of Environmental Policy », Proceedings of the National Academy of Sciences, 104(39): 15206-11. Brockington D. et J. Igoe, 2006, « Eviction for Conservation: A Global Overview », Conservation and Society, 4(3): 424-70. Bromley D. W., 1986, « Closing Comments at the Conference on Common Property Resource Management », in Proceedings of the Confe- rence on Common Property Resource Management, 591-98. Washington, DC: National Academies Press. Brooks J. S., M. A. Franzen, C. M. Holmes, M. N. Grote et M. Borgerhoff Mulder, 2006, « Testing Hypotheses for the Success of Different Conservation Strategies », Conservation Biology, 20(5): 1528-38. Brunckhorst D. J, 2000, Bioregional Planning: Resource Management beyond the New Millennium, Amsterdam: Harwood Academic. Buchanan J. M. 1965, « An Economic Theory of Clubs », Economica, 32(125): 1-14. Canadell J. G et M. R. Raupach, 2008, « Managing Forests for Climate Change Mitigation », Science, 320(5882): 1456-57. Cardenas J. -C., 2000, « How Do Groups Solve Local Commons Dilemmas? Lessons from Experimental Economics in the Field », Environment, Development and Sustainability, 2(3-4): 305-22. Cardenas J.-C., J. Stranlund et C. Willis, 2000, « Local Environmental Control and Institutional Crowding-Out », World Development, 28(10): 1719-33. Casari M. et C. R. Plott, 2003, « Decentralized Management of Common Property Resources: Experiments with a Centuries-Old Institution », Journal of Economic Behavior and Organization, 51(2): 217-47. Caves R., 1964, American Industry: Structure, Conduct, Performance. Englewood Cliffs, NJ: Prentice- Hall.
- 65. Par-delà les marchés et les États 63 Chhatre A. et A. Agrawal, 2008, « Forest Commons and Local Enforce- ment », Proceedings of the National Academy of Sciences, 105(36): 13286-91. Chhatre A. et A. Agrawal, 2009, « Trade-offs and Synergies between Carbon Storage and Livelihood Benefits from Forest Commons », Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(42): 17667-70. Ciriacy-Wantrup S. V. et R. C. Bishop, 1975, « Common Property’ as a Concept in Natural Resources Policy », Natural Resources Journal, 15(4): 713-27. Clark C. W, 2006, The Worldwide Crisis in Fisheries: Economic Models and Human Behavior. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Coleman E. A, 2009, « Institutional Factors Affecting Biophysical Outcomes in Forest Management. », Journal of Policy Analysis and Mana- gement, 28(1): 122-46. Coleman E. A. et B. C. Steed, 2009, « Monitoring and Sanctioning in the Commons: An Application to Forestry », Ecological Economics, 68(7): 2106-13. Commons J. R., 1968, Legal Foundations of Capitalism, Madison, WI: University of Wisconsin Press, (Orig. Pub. 1924). Copeland B. R. et M. Scott Taylor, 2009, « Trade, Tragedy et the Common », American Economic Review, 99(3): 725-49. Coward E. W., 1980, Irrigation and Agricultural Development in Asia. Ithaca, NY: Cornell University Press. Cox, James C. et Cary A. Deck, 2005, « On the Nature of Reciprocal Motives », Economic Inquiry, 43(3): 623-35. Cox J. C., K. Sadiraj et V. Sadiraj, 2008, « Implications of Trust, Fear et Reciprocity for Modeling Economic Behavior », Experimental Economics, 11(1): 1-24. Cox M., G. Arnold et S. Villamayor-Tomás, 2009, « A Review and Reassess- ment of Design Principles for Community-Based Natural Resource Management », non publié. Crawford S. E. S. et E. Ostrom, 2005. « A Grammar of Institutions », in Understanding Institutional Diversity, 137-74, Princeton, NJ: Princeton University Press. Degnbol P. et B. J. McCay, 2007, « Unintended and Perverse Consequences of Ignoring Linkages in Fisheries Systems », ICES Journal of Marine Science, 64(4): 793–97. de Oliveira A. C. M., R. T. A. Croson et C Eckel, 2009, « Are Preferences Stable across Domains? An Experimental Investigation of Social Prefe- rences in the Field », CBEES Working Paper 2008-3. Dietz T., E. Ostrom et Paul C. Stern, 2003, « The Struggle to Govern the Commons », Science, 302(5652): 1907-12.
- 66. 64 Elinor Ostrom Dutta P. K., 1999, Strategies and Games: Theory and Practice. Cambridge, MA: MIT Press. Eckel C. C. et P. J. Grossman, 1996, « The Relative Price of Fairness: Gender Differences in a Punishment Game », Journal of Economic Behavior and Organization, 30(2): 143-58. Eggertsson T., 1990, Economic Behavior and Institutions, Cambridge, UK: Cambridge University Press. Elster J., 1989, Solomonic Judgements: Studies in the Limitations of Rationality, Cambridge, UK: Cambridge University Press. Faysse N., 2005, « Coping with the Tragedy of the Commons: Game Struc- ture and Design of Rules », Journal of Economic Surveys, 19(2): 239-61. Fehr E. et S. Gächter, 2002, « Altruistic Punishment in Humans », Nature, 415(6868): 137-40. Fehr E. et A. Leibbrandt, 2008, « Cooperativeness and Impatience in the Tragedy of the Commons », IZA Discussion Paper 3625. Fehr E. et K. M. Schmidt, 1999, « A Theory of Fairness, Competition et Cooperation », Quarterly Journal of Economics, 114(3): 817-68. Frey B. S. et F. Oberholzer-Gee, 1997, « The Cost of Price Incentives: An Empirical Analysis of Motivation Crowding-Out », American Economic Review, 87(4): 746-55. Friesema H. P., 1966, « The Metropolis and the Maze of Local Govern- ment », Urban Affairs Review, 2(2): 68-90. Frohlich N. et J. A. Oppenheimer, 1992, Choosing Justice: An Experimental Approach to Ethical Theory. Berkeley, CA: University of California Press. Gardner R. e. H., E. Ostrom et J. A. Walker, 2000, « The Power and Limita- tions of Proportional Cutbacks in Common-Pool Resources », Journal of Development Economics, 62(2): 515-33. Ghate R. et H. Nagendra, 2005, « Role of Monitoring in Institutional Performance: Forest Management in Maharashtra, India », Conservation and Society, 3(2): 509-32. Gibson C. C., M. McKean et E. Ostrom, ed, 2000, People and Forests: Communities, Institutions et Governance, Cambridge, MA: MIT Press. Gibson C. C., J. T. Williams et E. Ostrom, 2005, « Local Enforcement and Better Forests », World Development, 33(2): 273-84. Gibson C. C., K. Andersson, E. Ostrom et S. Shivakumar, 2005, The Sama- ritan’s Dilemma: The Political Economy of Development Aid, Oxford: Oxford University Press. Gigerenzer G. et R. Selten, ed, 2001, Bounded Rationality: The Adaptive Toolbox. Cambridge, MA: MIT Press. Goffman E., 1974, Frame Analysis: An Essay on the Organization of Expe- rience, Cambridge, MA:Harvard University Press.
- 67. Par-delà les marchés et les États 65 Gordon H. S., 1954, « The Economic Theory of a Common-Property Resource: The Fishery », Journal of Political Economy, 62(2): 124-42. Grafton R. Q., 2000, « Governance of the Commons: A Role for the State? », Land Economics, 76(4): 504-17. Gulick L., 1957, « Metropolitan Organization », The ANN ALS of the American Academy of Political and Social Science, 314(1): 57-65. Hardin G, 1968, « The Tragedy of the Commons », Science, 162(3859): 1243-48. Hayes T. M, 2006, « Parks, People et Forest Protection: An Institutional Assessment of the Effectiveness of Protected Areas », World Develop- ment, 34(12): 2064-75. Henrich J., R. Boyd, S. Bowles, C. Camerer, E. Fehr et H. Gintis, ed, 2004, Foundations of Human Sociality: Economic Experiments and Ethnographic Evidence from Fifteen Small-Scale Societies, Oxford: Oxford University Press. Henrich J., R. McElreath, .A. Barr, J. Ensminger, C. Barrett, A. Bolyanatz, J.- C. Cardenas, et al, 2006, « Costly Punishment across Human Socie- ties », Science, 312(5781): 1767–70. Hobbes T., 1651, Leviathan or the Matter, Forme and Power of a Commonwealth Ecclesiasticall and Civil, Ed. Michael Oakeshott, Oxford: Basil Blackwell, 1960. Holt C. A, 2007, Markets, Games et Strategic Behavior, Boston: Pearson Addison Wesley. Isaac R. M. et J. M. Walker, 1988, « Communication and Free-Riding Beha- vior: The Voluntary Contribution Mechanism », Economic Inquiry, 26(4): 585–608. Isaac R. M., K. F. McCue et C. R. Plott, 1985, « Public Goods Provision in an Experimental Environment », Journal of Public Economics, 26(1): 51-74. Isaac R. M., J. M. Walker et S. H. Thomas, 1984, « Divergent Evidence on Free Riding: An Experimental Examination of Possible Explanations », Public Choice, 43(2): 113-49. Isaac R. M., J. M. Walker et A. W. Williams, 1994, « Group Size and the Voluntary Provision of Public Goods: Experimental Evidence Utilizing Large Groups », Journal of Public Economics, 54(1): 1-36. IsHak S., 1972, « Consumers’ Perception of Police Performance: Consolida- tion vs. Deconcentration: The Case of Grand Rapids, Michigan », PhD diss. Indiana University. Jager W. et M. A. Janssen, 2002, « Using Artificial Agents to Understand Laboratory Experiments of Common-Pool Resources with Real Agents », in Complexity and Ecosystem Management: The Theory and Prac- tice of Multi-Agent Systems, ed. Marco A. Janssen, 75-102, Cheltenham, UK: Elgar.
- 68. 66 Elinor Ostrom Janssen M. A, 2008, « Evolution of Cooperation in a One-Shot Prisoner’s Dilemma Based on Recognition of Trustworthy and Untrustworthy Agents », Journal of Economic Behavior and Organization, 65(3-4): 458-71. Joshi N. N., E. Ostrom, G. P. Shivakoti et W. F. Lam, 2000, « Institutional Opportunities and Constraints in the Performance of Farmer-Managed Irrigation Systems in Nepal », Asia-Pacific Journal of Rural Development, 10(2): 67-92. Kiser L. L. et E. Ostrom, 1982, « The Three Worlds of Action: A Metatheore- tical Synthesis of Institutional Approaches », in Strategies of Political Inquiry, ed. Elinor Ostrom, 179-222. Beverly Hills, CA: Sage. Koestler A., 1973, « The Tree and the Candle », in Unity through Diversity: A Festschrift for Ludwig von Bertalanffy, ed. William Gray and Nicholas D. Rizzo, 287-314, New York: Gordon and Breach Science Publishers. Lam W. F., 1998, Governing Irrigation Systems in Nepal: Institutions, Infras- tructure et Collective Action, Oakland, CA: ICS Press. Leibbrandt E., U. Gneezy et J. List, 2010, « Ode to the Sea: The Socio-Ecolo- gical Underpinnings of Social Norms », Unpublished. Liu J., M. Linderman, Z. Ouyang, L. An, J. Yang et H. Zhang, 2001, « Ecolo- gical Degradation in Protected Areas: The Case of Wolong Nature Reserve for Giant Pandas », Science, 292(5514): 98-101. Marshall G. R, 2008, « Nesting, Subsidiarity et Community-Based Environ- mental Governance beyond the Local Level », International Journal of the Commons, 2(1): 75-97. Marwell G. et R. E. Ames, 1979, « Experiments on the Provision of Public Goods I: Resources, Interest, Group Size et the Free Rider Problem », American Journal of Sociology, 84(6): 1335-60. McCay B. J. et J. M. Acheson, 1987, The Question of the Commons: The Culture and Ecology of Communal Resources, Tucson, AZ: University of Arizona Press. McGinnis M. D., ed., 1999a, Polycentric Governance and Development: Readings from the Workshop in Political Theory and Policy Analysis, Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. McGinnis M. D., ed., 1999b, Polycentricity and Local Public Economies: Readings from the Workshop in Political Theory and Policy Analysis, Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. McGinnis M. D., ed., 2000, Polycentric Games and Institutions: Readings from the Workshop in Political Theory and Policy Analysis, Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. Meinzen-Dick R., 2007, « Beyond Panaceas in Water Institutions », Procee- dings of the National Academy of Sciences, 104(39): 15200-05.
- 69. Par-delà les marchés et les États 67 National Research Council, 1986, Proceedings of the Conference on Common Property Resource Management, Washington, DC: National Academies Press. Netting R. McC., 1972, « Of Men and Meadows: Strategies of Alpine Land Use », Anthropological Quarterly, 45(3): 132-44. North D. C., 1990, Institutions, Institutional Change and Economic Perfor- mance, Cambridge, UK: Cambridge University Press. North D. C, 2005, Understanding the Process of Economic Change, Princeton, NJ: Princeton University Press. Oakerson R. J., 1986, « A Model for the Analysis of Common Property Problems », in Proceedings of the Conference on Common Property Resource Management, 13-30. Washington, DC: National Academies Press. Ones U. et L. Putterman, 2007, « The Ecology of Collective Action: A Public Goods and Sanctions Experiment with Controlled Group Formation », Journal of Economic Behavior and Organization, 62(4): 495-521. Orbell J. M., A. van de Kragt et R. M. Dawes, 1988, « Explaining Discus- sion-Induced Cooperation », Journal of Personality and Social Psychology, 54(5): 811-19. Ostrom E., 1965, « Public Entrepreneurship: A Case Study in Ground Water Basin Management », PhD diss. University of California, Los Angeles. Ostrom E., 1976, « Size and Performance in a Federal System », Publius: The Journal of Federalism, 6(2): 33-73. Ostrom E., 1986, « An Agenda for the Study of Institutions », Public Choice, 48(1): 3-25. Ostrom E., 1990, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge, UK: Cambridge University Press. Ostrom E., 1998, « A Behavioral Approach to the Rational Choice Theory of Collective Action », American Political Science Review, 92(1): 1-22. Ostrom E., 1999, « Coping with Tragedies of the Commons », Annual Review of Political Science, 2: 493-535. Ostrom E., 2005, Understanding Institutional Diversity, Princeton, NJ: Prin- ceton University Press. Ostrom E., 2007, « A Diagnostic Approach for Going beyond Panaceas », Proceedings of the National Academy of Sciences, 104(39): 15181-87. Ostrom E., 2008, « Developing a Method for Analyzing Institutional Change », in Alternative Institutional Structures: Evolution and Impact, ed. Sandra S. Batie and Nicholas Mercuro, 48-76. New York: Routledge. Ostrom E., 2009, « A General Framework for Analyzing the Sustainability of Social-Ecological Systems », Science, 325(5939): 419-22.
- 70. 68 Elinor Ostrom Ostrom E. et X. Basurto, à paraître, « Crafting Analytical Tools to Study Institutional Change », Journal of Institutional Economics. Ostrom E. et R. Gardner. 1993, « Coping with Asymmetries in the Commons: Self-Governing Irrigation Systems Can Work », Journal of Economic Perspectives, 7(4): 93-112. Ostrom E. et H. Nagendra, 2006, « Insights on Linking Forests, Trees et People from the Air, on the Ground et in the Laboratory », Proceedings of the National Academy of Sciences, 103(51): 19224-31. Ostrom E. et R. B. Parks, 1973, « Suburban Police Departments: Too Many and Too Small? », in The Urbanization of the Suburbs, ed. Louis H. Masotti and Jeffrey K. Hadden, 367-402. Beverly Hills, CA: Sage. Ostrom E. et R. B. Parks, 1999, « Neither Gargantua nor the Land of Lilli- puts: Conjectures on Mixed Systems of Metropolitan Organization », in Polycentricity and Local Public Economies: Readings from the Workshop in Political Theory and Policy Analysis, ed. Michael D. McGinnis, 284- 305. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. Ostrom E. et J. Walker, 1991, « Communication in a Commons: Coopera- tion without External Enforcement », in Laboratory Research in Political Economy, ed. Thomas R. Palfrey, 287-322. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. Ostrom E. et G. P. Whitaker, 1974, « Community Control and Govern- mental Responsiveness: The Case of Police in Black Neighborhoods », in Improving the Quality of Urban Management, ed. Willis Hawley and David Rogers, 303-34. Beverly Hills, CA: Sage. Ostrom E., R. Gardner et J. Walker, 1994, Rules, Games et Common-Pool Resources, Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. Ostrom E., R. B. Parks et G. P. Whitaker, 1978, Patterns of Metropolitan Poli- cing, Cambridge, MA: Ballinger. Ostrom E., L. Schroeder et S. Wynne, 1993, Institutional Incentives and Sustainable Development: Infrastructure Policies in Perspective, Boulder, CO: Westview Press. Ostrom E., J. Walker et R. Gardner, 1992, « Covenants with and without a Sword: Self-Governance Is Possible », American Political Science Review, 86(2): 404-17. Ostrom E., A. Agrawal, W. Blomquist, E.Schlager et S. Y. Tang, 1989, CPR Coding Manual. Bloomington, IN: Indiana University, Workshop in Political Theory and Policy Analysis. Ostrom E., W. Baugh, R. Guarasci, R. B. Parks et G. P. Whitaker, 1973, Community Organization and the Provision of Police Services. Beverly Hills, CA: Sage. Ostrom E, T. Dietz, N. Dolšak, P. C. Stern, S. Stonich et E. U. Weber, ed, 2002, The Drama of the Commons. Washington, DC: National Acade- mies Press.
- 71. Par-delà les marchés et les États 69 Ostrom V., 1962, « The Political Economy of Water Development », American Economic Review, 52(2): 450-58. Ostrom V., 1975, « Language, Theory and Empirical Research in Policy Analysis », Policy Studies Journal, 3(3): 274-82. Ostrom V., 2008, The Intellectual Crisis in American Public Administration, 3rd ed. Tuscaloosa, AL: University of Alabama Press. Ostrom V. et E. Ostrom, 1965, « A Behavioral Approach to the Study of Intergovernmental Relations », The ANN ALS of the American Academy of Political and Social Science, 359(1): 137-46. Ostrom V. et E. Ostrom, 1977, « Public Goods and Public Choices », in Alternatives for Delivering Public Services: Toward Improved Performance, ed. Emanuel S. Savas, 7-49. Boulder, CO: Westview Press. Ostrom V., C. M. Tiebout et R. Warren, 1961, « The Organization of Government in Metropolitan Areas: A Theoretical Inquiry », American Political Science Review, 55(4): 831-42. Paavola J. et W. N. Adger, 2005, « Institutional Ecological Economics », Ecological Economics, 53(3): 353-68. Pagdee A., Y.-S. Kim et P. J. Daugherty, 2006, « What Makes Community Forest Management Successful: A Meta-Study from Community Forests throughout the World », Society & Natural Resources, 19(1): 33-52. Pfennig D. W. et Cris Ledón-Rettig, 2009, « The Flexible Organism », Science, 325(5938): 268-69. Popper K. R., 1961, The Poverty of Historicism, New York: Harper & Row. Posner R., 1975, « Economic Analysis of Law », in Economic Foundation of Property Law, ed. Bruce A. Ackerman, Boston, MA: Little, Brown and Co. Poteete A. R. et E. Ostrom, 2004, « In Pursuit of Comparable Concepts and Data about Collective Action », Agricultural Systems, 82(3): 215-32. Poteete A. R., M. Janssen et E. Ostrom, 2010, Working Together: Collective Action, the Commons et Multiple Methods in Practice. Princeton, NJ: Prin- ceton University Press. Reeson e. F. et J. G. Tisdell, 2008, « Institutions, Motivations and Public Goods: An Experimental Test of Motivational Crowding », Journal of Economic Behavior and Organization, 68(1): 273-81. Rogers B. D. et C. McC. Lipsey, 1974, « Metropolitan Reform: Citizen Eval- uations of Performance in Nashville-Davidson County, Tennessee », Publius: The Journal of Federalism, 4(4): 19-34. Rothstein Bo, 2005, Social Traps and the Problem of Trust, Cambridge, UK: Cambridge University Press. Rudel T. K, 2008, « Meta-Analyses of Case Studies: A Method for Studying Regional and Global Environmental Change », Global Environmental Change, 18(1): 18-25.
- 72. 70 Elinor Ostrom Sally D., 1995, « Conservation and Cooperation in Social Dilemmas: A Meta-Analysis of Experiments from 1958 to 1992 », Rationality and Society, 7(1): 58-92. Samuelson P. A., 1954, « The Pure Theory of Public Expenditure », Review of Economics and Statistics, 36(4): 387-89. Satz D. et J. Ferejohn, 1994, « Rational Choice and Social Theory », Journal of Philosophy, 91(2): 71-87. Schank R. C. et R. P. Abelson, 1977, Scripts, Plans, Goals et Understanding: An Inquiry in Human Knowledge Structures, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Schelling T. C., 1960, The Strategy of Conflict, Oxford: Oxford University Press. Schelling T. C., 1978, Micromotives and Macrobehavior, New York: Norton. Schelling T. C., 1984, Choice and Consequence: Perspectives of an Errant Economist, Cambridge, MA: Harvard University Press. Schlager E., 1990, « Model Specification and Policy Analysis: The Gover- nance of Coastal Fisheries », PhD diss. Indiana University. Schlager E., 1994, « Fishers’ Institutional Responses to Common-Pool Resource Dilemmas », in Rules, Games et Common-Pool Resources, ed. Elinor Ostrom, Roy Gardner et James Walker, 247-65. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. Schlager E. et W. Blomquist, 2008, Embracing Watershed Politics, Boulder, CO: University Press of Colorado. Schlager E. et E. Ostrom, 1992, « Property-Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis », Land Economics, 68(3): 249-62. Scott A., 1955, « The Fishery: The Objectives of Sole Ownership », Journal of Political Economy, 63(2): 116-24. Selten R., 1990, « Bounded Rationality », Journal of Institutional and Theore- tical Economics, 146(4): 649-58. Sen A. K., 1977, « Rational Fools: A Critique of the Behavioral Foundations of Economic Theory », Philosophy and Public Affairs, 6(4): 317-44. Sen A. K, 2009, The Idea of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press. Shivakoti G. et E. Ostrom, ed, 2002, Improving Irrigation Governance and Management in Nepal. Oakland, CA: ICS Press. Simon H. A., 1955, « A Behavioural Model of Rational Choice », Quarterly Journal of Economics, 69(1): 99-188. Simon H. A., 1981, The Sciences of the Artificial, 2nd ed. Cambridge, MA: MIT Press. Simon H. A., 1995, « Near Decomposability and Complexity: How a Mind Resides in a Brain », In The Mind, the Brain et Complex Adaptive Systems,
- 73. Par-delà les marchés et les États 71 ed. Harold J. Morowitz and Jerome L. Singer, 25-44. Reading, MA: Addison-Wesley. Simon H. A., 1999, « The Potlatch between Economics and Political Science », in Competition and Cooperation: Conversations with Nobelists About Economics and Political Science, ed. James E. Alt, Margaret Levi et Elinor Ostrom, 112–19. New York: Russell Sage Foundation. Skoler D. L. et J. M. Hetler, 1971, « Government Restructuring and Criminal Administration: The Challenge of Consolidation », in Crisis in Urban Government. A Symposium: Restructuring Metropolitan Area Government. Silver Springs, MD: Thomas Jefferson. Smith V. L, 2003, « Constructivist and Ecological Rationality in Econo- mics », American Economic Review, 93(3): 465-508. Smith V. L, 2010, « Theory and Experiment: What Are the Questions? », Journal of Economic Behavior and Organization, 73(1): 3-15. Smith V. L. et J. M. Walker, 1993, « Rewards, Experience and Decision Costs in First Price Auctions », Economic Inquiry, 31(2): 237-45. Stewart J. I, 2009, « Cooperation When N Is Large: Evidence from the Mining Camps of the American West », Journal of Economic Behavior and Organization, 69(3): 213-25. Sugden R., 1986, The Economics of Rights, Co-Operation and Welfare, Oxford: Blackwell. Tang S. Y., 1992, Institutions and Collective Action: Self-Governance in Irriga- tion, San Francisco: ICS Press. Tang S. Y., 1994, « Institutions and Performance in Irrigation Systems », in Rules, Games et Common-Pool Resources, ed. Elinor Ostrom, Roy Gardner et James Walker, 225-45. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. Terborgh J., 1999, Requiem for Nature. Washington, DC: Island Press. Toonen T., 2010, « Resilience in Public Administration: The Work of Elinor and Vincent Ostrom from a Public Administration Perspective », Public Administration Review, 70(2): 193-202. Trawick P. B, 2001, « Successfully Governing the Commons: Principles of Social Organization in an Andean Irrigation System », Human Ecology, 29(1): 1-25. Tucker C. M, 2008, Changing Forests: Collective Action, Common Property and Coffee in Honduras. Berlin: Springer. Uphoff N. T., P. Ramamurthy et R. Steiner, 1991, Managing Irrigation: Analyzing and Improving the Performance of Bureaucracies, New Delhi: Sage. Walker J. et E. Ostrom, 2009, « Trust and Reciprocity as Foundations for Cooperation », in Whom Can We Trust?: How Groups, Networks et Insti- tutions Make Trust Possible, ed. Karen S. Cook, Margaret Levi et Russell Hardin, 91–124, New York: Russell Sage Foundation.
- 74. 72 Elinor Ostrom Warren R. O., 1966, Government of Metropolitan Regions: A Reappraisal of Fractionated Political Organization, Davis, CA: University of California, Institute of Governmental Affairs. Webb E. L. et G. Shivakoti, ed, 2008, Decentralization, Forests and Rural Communities: Policy Outcomes in South and Southeast Asia, New Delhi: Sage India. Weissing F. et E. Ostrom, 1993, « Irrigation Institutions and the Games Irrigators Play: Rule Enforcement on Government– and Farmer– Managed Systems », in Games in Hierarchies and Networks: Analytical and Empirical Approaches to the Study of Governance Institutions, ed. Fritz W. Scharpf, 387-428. Frankfurt, Germany: Campus Verlag. Weschler L. F., 1968, Water Resources Management: The Orange County Expe- rience, Davis, CA: University of California, Institute of Governmental Affairs. Williamson O. E, 1975, Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Impli- cations, New York: Free Press. Williamson O. E., 1986, « The Economics of Governance: Framework and Implications », In Economics as a Process: Essays in the New Institutional Economics, ed. Richard N. Langlois, 171-202, Cambridge, UK: Cambridge University Press. Wilson J. A., 1990, « Fishing for Knowledge”, Land Economics, 66(1): 12-29. Wilson J. A., J. M. Acheson, M. Metcalfe et P. Kleban, 1994, « Chaos, Complexity et Community Management of Fisheries », Marine Policy, 18(4): 291-305. Wilson W., 1885, Congressional Government: A Study in American Politics, Boston: Houghton Mifflin. Wollenberg E., L. Merino, A. Agrawal et E. Ostrom, 2007, « Fourteen Years of Monitoring Community-Managed Forests: Learning from IFRI’s Experience », International Forestry Review, 9(2): 670-84. Yamagishi T., 1986, « The Provision of a Sanctioning System as a Public Good », Journal of Personality and Social Psychology, 51(1): 110-16. Yandle T., 2007, « Understanding the Consequence of Property Rights Mismatches: A Case Study of New Zealand’s Marine Resources », Ecology and Society, 12(2), http://www.ecologyandsociety.org/vol12/ iss2/art27/. Yandle T. et C. M. Dewees, 2003, « Privatizing the Commons... Twelve Years Later: Fishers’ Experiences with New Zealand’s Market-Based Fisheries Management », in The Commons in the New Millennium: Chal- lenges and Adaptation, ed. N. Dolsak and E. Ostrom, 101-27, Cambridge, MA: MIT Press.
- 75. JUSTICE ENVIRONNEMENTALE ET PERFORMANCE DES ENTREPRISES NOUVELLES PERSPECTIVES ET NOUVEAUX OUTILS Michael Ash et James K. Boyce University of Massachusetts, Amherst Traduction : Éloi Laurent Le but de cet article est de familiariser les publics académiques et gouvernementaux français et européens aux nouveaux instruments quan- titatifs empiriques développés et utilisés aux États-Unis pour évaluer la performance environnementale des entreprises et éclairer les enjeux de justice environnementale qui y sont attachés. L'article commence par rappeler les principaux enseignements de la littérature sur la justice envi- ronnementale aux États-Unis, ses avancées et certaines de ses limites. Il présente ensuite des méthodes empiriques et des données très récentes sur la performance environnementale des secteurs industriels et des grandes entreprises américaines. Il insiste enfin sur le fait qu'un enjeu crucial pour de futures avancées dans ces domaines de recherche est la disponibilité de données codées géographiquement (ou géocodées) et l'application de méthodes intégratives visant à faciliter l'interprétation de ces données. Mots-clés : justice environnementale, performance environnementale des entreprises, outils quantitatifs, États-Unis, Union européenne. Revue de l’OFCE / Débats et politiques – 120 (2011)
- 76. 74 Michael Ash et James K. Boyce L e but de cet article est de familiariser les publics académiques et gouvernementaux français et européens aux nouveaux instru- ments quantitatifs empiriques développés et utilisés aux États-Unis pour évaluer la justice environnementale et la performance envi- ronnementale des entreprises. Cet article vise en particulier à décrire le propos de ces études, leur méthodologie (y compris les données et la modélisation qu’elles utilisent) et de livrer leurs résultats les plus récents. Certains des résultats présentés ici ont été précédemment publiés dans des supports grand public et électro- niques tels que Justice in the Air (Ash et al., 2009) et The 2006 Toxic 100 Air Polluters (Ash et Boyce, 2010) mais cet article rend pour la première fois publics les résultats de la version 2007 de l’étude Toxic 100 Air Polluters. On verra notamment qu’un enjeu crucial pour de futures avancées dans ces domaines de recherche est la disponibilité de données codées géographiquement (ou géocodées) et l'application de méthodes intégratives visant à faciliter l'inter- prétation de ces données. Deux thèmes majeurs sont réunis dans la recherche sur la justice environnementale des entreprises. Le premier est l'injustice envi- ronnementale, ou la répartition inégale des aménités environnementales et des nuisances entre les différents groupes raciaux et ethniques et entre les différentes catégories de revenu. Le second est la performance environnementale des entreprises, c'est- à-dire l’examen de l'impact des entreprises sur l'environnement dans le but de développer l'investissement et la gestion sociale- ment responsable des entreprises. L'analyse de la justice environnementale aux États-Unis s'inspire d'un cadre à la fois théorique et empirique bien établi qui conduit, d’une part à constater l’exclusion sociale systématique et persistante dans le temps des Afro-américains, d’autre part à fournir de nouveaux schémas d’analyse qui mettent l’accent sur la croissance démographique des nouveaux groupes minoritaires et sur les changements qui interviennent dans l’organisation spatiale des activités résidentielle et commerciale. Le principe d'organisa- tion commun aux deux cadres d’analyse est une approche
- 77. Justice environnementale et performance des entreprises 75 d'économie politique de l'environnement, qui fait porter l’atten- tion sur les relations de pouvoir à l’œuvre dans le partage, ou non, des biens communs environnementaux. Les frontières de la recherche dans le domaine de la justice envi- ronnementale touchent à l’étude des liens entre santé et éducation d’une part et accès aux aménités environnementales ou exposition aux nuisances de l’autre (Pastor et al., 2003 et Currie et Schmieder, 2009). Les méthodes et les données dont il est question dans le présent article sont potentiellement applicables à ces sujets. 1. Le concept de justice environnementale Le concept de justice environnementale a émergé de la critique de l'exclusion sociale et spatiale de long terme, autrement dit de la ségrégation dont les Afro-américains ont été les victimes aux États- Unis. Les conséquences environnementales de cette ségrégation omniprésente et persistante ont pour la première fois fait l’objet d’un repérage par plusieurs études au début des années 1980, soit trente-cinq ans environ après le développement du mouvement moderne des droits civiques et quelque quinze années après l'émer- gence du mouvement écologiste contemporain. Celui-ci a mis en lumière l'importance des maux environne- mentaux créés par le processus de production et de consommation. Ces maux sont souvent, de par leur nature même, externalisés. Quand une société a décidé d’externaliser ces maux environnementaux, la dynamique d’économie politique va les localiser là où résident les groupes les plus vulnérables et les exclus. Boyce (2002) présente un schéma de cette économie poli- tique des décisions environnementales, en analysant la manière dont les « gagnants environnementaux » sont en mesure d'exercer un pouvoir et d'imposer des décisions sur les « perdants environnementaux ». La justice environnementale peut dès lors être définie en termes d'égalité d'accès à un environnement propre et sain ; la distribu- tion équitable d'une gamme de biens environnementaux, tels que l'accès aux espaces verts, l'air pur, mais aussi les transports publics, fait l'objet de ce champ d'étude. L'injustice environnementale peut être à l’inverse définie comme l'inégal accès à cet environnement
- 78. 76 Michael Ash et James K. Boyce propre et sain des différents groupes sociaux, définis sur la base de la race, de l'ethnie ou de la catégorie de revenu. L’analyse formelle de la justice environnementale a commencé avec la réalisation et la publication d’études destinées à guider les politiques publiques américaines en matière de localisation des établissements de stockage et de traitement des déchets toxiques (ESTDT) dans le sud des États-Unis (United Church of Christ 1987 et US General Accounting Office, 1983). Ces études ont révélé que ces ESTDT étaient situés dans des communautés constituées de manière disproportionnée par des pauvres et, en particulier, des Afro-américaines. Des recherches ultérieures menées par Bullard (1990) et Mohai et Bryant (1992) ont évalué de façon systématique et à des échelles plus larges cette répartition inéquitable des nuisances environnementales aux États-Unis. Parce que la recherche en matière de justice environnementale s’est d’abord concentrée sur le problème de la localisation des ESTDT, les premières analyses ont porté en majorité sur l'évalua- tion de la coïncidence risque-établissement, en d’autres termes le fait de déterminer si les installations polluantes sont situées au sein ou à proximité des quartiers ou communes habités de manière disproportionnée par les populations cibles de la justice environne- mentale. Plus tard, la recherche s’est orientée vers la mise en lumière de l’importance de la « modélisation de panache » (Chakraborty et Armstrong, 1997 ; Mohai et Saha 2007 ; Bouwes et al., 2003 ; Ash et Fetter 2004), qui examine la répartition de l'impact de la pollution plutôt que la seule répartition des sources de pollution. Le courant académique de la justice environnementale s’est en outre révélé controversé, certaines études parvenant à établir des preuves d'exclusion fondée sur la classe sociale, mais pas sur la race (Anderton et al. 1994) tandis que d'autres (Morello-Frosch et al., 2002 ; Pastor et al., 2006 ; Mohai et Bryant 1992 et Ash et Fetter 2004) ont mis en évidence les deux formes d'exclusion. Des désac- cords ont également émergé tant sur la réalité de l'exposition différentielle que sur les processus à l'œuvre. Szasz et Meuser (1997) et Bowen (2000) ont proposé tous deux une revue approfondie de la littérature et leurs interprétations divergentes de celle-ci fait office d'indication supplémentaire de la complexité et du caractère contentieux du sujet.
- 79. Justice environnementale et performance des entreprises 77 Toujours est-il que l'injustice environnementale peut être adoptée comme stratégie par des entreprises désireuses de réduire le coût d'élimination des maux liés à la production industrielle. Ces coûts peuvent être de nature monétaire et politique. Une autre interprétation de l’émergence des injustices environnementales concentre l’analyse sur l'échec de l'État à protéger tous les habitants de manière égale (Hird et Reese, 1998). L'injustice environnemen- tale peut également résulter du fonctionnement « normal » du marché, les plus pauvres des citoyens étant économiquement attirés par des lieux où le prix des terrains et des logements a été déprimé par la contamination toxique de l'environnement. Un volet important de la recherche en matière de justice envi- ronnementale a ainsi tenté de résoudre la question du «Qui vint en premier? ». Beaucoup d'attention a été accordée par les chercheurs à la chronologie de l’installation des habitants (Pastor et al., 2001 et Wolverton, 2009), à l'intensité des risques (Sicotte et Swanson, 2007), et à la question de la proximité spatiale (Ash et Fetter, 2004 ; Mohai et Saha, 2007 ; Saha et Mohai, 2005). L'analyse longitudi- nale se révèle de première importance ici et peut, en principe, être mise en œuvre à l’aide des méthodes décrites dans le présent article. Cependant, on ne peut éluder la complexité des comparaisons inter-temporelles lorsque l’on considère l'évolution des règlements touchant aux classements publics des établissements, des industries et des produits chimiques. Les résultats présentés dans la suite de notre article sont exclusivement transversaux, mais avec l'accumu- lation de plus de vingt années de données dans le Toxics Release Inventory (TRI), les méthodes longitudinales deviendront de plus en plus pertinentes (nous discutons plus bas de certaines des diffi- cultés rencontrées pour établir une base commune de référencement pour les établissements, les industries et les produits chimiques en vue de ces comparaisons intertemporelles). L'importance croissante des nouvelles minorités ethniques, en particulier les Hispaniques, qui sont passés de moins de 5 % de la population américaine en 1970 à un peu plus de 15 % en 2010, a ouvert de nouvelles perspectives en matière d'expérience et d'analyse de l'injustice environnementale. Dans certaines régions métropolitaines, la ségrégation résidentielle des Hispaniques suit des schémas différents de celle des Afro-américains. Dans la région métropolitaine de Chicago, par exemple, où la population afro-
- 80. 78 Michael Ash et James K. Boyce américaine est isolée dans un seul bandeau massif sur les côtés sud et ouest de la ville (la « Ceinture noire ») et pratiquement absente de nombreuses banlieues et de leur marge, les Hispaniques sont plus dispersés, mais sont localement ségrégés dans de nombreuses parties de la ville, les banlieues et les collectivités exurbaines (Koval et al., 2006). Bien que l'emploi sectoriel et l'exposition résidentielle ne soient pas identiques entre les deux communautés ethniques, ils possèdent les mêmes profils géographiques. Les Hispaniques sont surrepré- sentés dans le secteur manufacturier (ainsi que dans l'agriculture et le secteur de la construction, qui ne relèvent pas du Toxics Release Inventory), et les migrations hispaniques ont généralement suivi la transformation géographique de l'industrie manufacturière améri- caine (Parrado et Kandel, 2010 et Garcia, 2011). Les Hispaniques ayant désormais supplanté les Afro-américains comme plus grande minorité ethnique aux États-Unis, de nombreux quartiers de la ville – en particulier à Los Angeles et ailleurs en Californie – d'anciennement Afro-américains, sont devenus hispaniques. Pastor et al. (2001) identifient ces lieux de « barattage ethnique » comme particulièrement exposés à l’injus- tice environnementale. Ash et Fetter ont montré que les Noirs américains ont tendance à vivre à la fois dans des villes plus polluées et dans des quartiers plus pollués au sein des villes. Les Hispaniques vivent en moyenne dans des villes moins polluées, principalement dans les régions moins industrielles de l’ouest et du sud-ouest, mais ils ont systématiquement tendance à vivre dans des zones plus polluées au sein des villes, ce qui est cohérent avec le constat de la ségrégation locale. 2. « Droit de savoir » et performances environnementales des entreprises À peu près au même moment qu’émergeait la préoccupation de justice environnementale, la Environmental Protection Agency (EPA) mettait en place le Toxics Release Inventory (TRI), première traduction du Pollutant Release and Transfer Registry (PRTP). La loi créant le PRTP, unique au monde à l’époque, a 25 ans cette année : elle fut adoptée par le Congrès américain en 1986 dans le sillage du désastreux déversement de produits chimiques dans l’usine
- 81. Justice environnementale et performance des entreprises 79 américaine de Union Carbide (plus tard acquise par Dow Chemical), en 1984, à Bhopal, en Inde, par l'Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (EPCRA 1986). Les rapports rela- tifs à cette loi commencèrent à être publiés en 1987 et les données correspondantes sont considérées comme de qualité suffisante à compter de 1988. Une importante ligne directrice de l'analyse et de l’engagement citoyen prenant appui sur le TRI a trait aux performances environ- nementales des entreprises, avec ou sans attention portée aux inégalités et injustices environnementales. Une conception large de la responsabilité sociale des entreprises englobe à la fois l'investisse- ment socialement responsable et la gestion socialement responsable. Dans le premier cas, les investisseurs socialement responsables refuseront leur capital aux entreprises dont les perfor- mances apparaissent mauvaises après usage d’un filtre permettant de trier les sociétés en fonction de leur participation à des activités indésirables, par exemple, des pratiques douteuses de marketing, différentes formes de pollution, une implication dans des contrats militaires, des violations du droit des travailleurs. Un tel exercice de filtrage peut augmenter le coût de financement des entreprises soumises à examen et décourager ainsi certaines de ces mauvaises pratiques. Dans la deuxième acception, les gestionnaires ou les investisseurs les plus actifs définissent, ciblent, et assurent le suivi d’une batterie d’indicateurs qui vont au-delà du seul bénéfice financier à court terme. L'objectif peut être d'améliorer l'image des entreprises pour attirer les consommateurs, les investisseurs, ou de nouveaux salariés, mais aussi d’améliorer les performances pour éviter de futures pénalités juridiques ou financières. Les données sur la performance des entreprises sont dans les deux cas essentielles. La préoccupation à l’égard du « greenwashing » (« éco- blanchiment »), par lequel les entreprises tentent de projeter une image plus respectueuse de l'environnement que leurs pratiques véritables (Aldhous et McKenna, 2010), a encore accru cette demande de données précises sur la performance environnemen- tale des entreprises. Les États-Unis dépendent en outre fortement de la législation élaborée autour du droit de savoir, plutôt que, par exemple, la réglementation directe, dans la protection des citoyens contre la pollution toxique industrielle. L’approche par le droit de savoir
- 82. 80 Michael Ash et James K. Boyce signifie que les entreprises ont obligation de faire rapport publique- ment de leur pollution. Mais une fois ce rapport rédigé et publié, les citoyens, salariés, consommateurs, actionnaires et dirigeants sont laissés à eux-mêmes quant à la réponse à apporter au rapport. Le droit de savoir n’offre en d’autres termes aucune garantie au droit à l'air pur et à l’eau saine et il faut des institutions intermé- diaires pour convertir le premier droit dans le second. Pour que l’approche par le droit de savoir ait la moindre chance d’améliorer la performance environnementale des entreprises, les différentes parties doivent avoir accès à l'information, la capacité de l’inter- préter et la capacité et la motivation d’y réagir. Certaines initiatives d'information sont privées et tenues secrètes, telles que les indicateurs environnementaux de Trucost, qui intègrent plusieurs centaines de critères de performance envi- ronnementale des entreprises, ou les filtres développés par Innovest pour l'investissement social responsable. D'autres démarches, comme celle entreprise par Goodguide.com, sont publiques et s’efforcent d'intégrer les données provenant de nombreux indices librement accessibles. Le fait est que les États-Unis ont été témoins d’une réduction importante des émissions TRI résultant à la fois de la fermeture d'installations polluantes (à mesure que le pays a continué à subir un processus de désindustrialisation entamé dès avant 1970) et des améliorations (du « verdissement ») dans les procédés industriels en réponse aux pressions des défenseurs de l'environnement. La mise en œuvre des rapports publics TRI a eu un léger effet sur les rendements des titres boursiers des sociétés cotées, et cette pres- sion peut avoir contribué au reflux de la pollution industrielle (Hamilton 1995). Au niveau de la direction des entreprises et avec l'aide des États, quelques signes de verdissement sont également apparus. Par exemple, l'État du Massachusetts a mis en œuvre le Toxics Use Reduction Act, qui prévoit une assistance technique pour les entreprises installées dans l'État en vue de réduire l'impact envi- ronnemental de leurs processus de production. Au plan national, le programme 33/50 a déterminé et dans une certaine mesure atteint des objectifs de réduction volontaire d’émissions d'un ensemble de produits chimiques hautement toxiques1, bien que 1. Pour plus de détails, voir le site de l’EPA http://www.epa.gov/oppt/ar95/opptch01.htm
- 83. Justice environnementale et performance des entreprises 81 certains analystes aient suggéré que tout ou partie de ces réduc- tions auraient eu lieu de toute façon (Vidovic et Khanna, 2007 et Khanna, 2001) et que les objectifs ont été insuffisamment ambi- tieux, s'écartant peu dans les faits de la trajectoire « business-as- usual » (von Hagen, 2000). De même, l'analyse du « verdissement des entreprises » se révèle en l’état insuffisante pour déterminer par exemple si les entreprises ont réellement amélioré leur perfor- mance environnementale ou simplement opté pour d'autres pratiques industrielles reposant sur l’usage de produits chimiques non déclarés ou non réglementés. À la lumière de ces lacunes, des études récentes ont tenté de fusionner l'analyse en termes de justice environnementale, dont l’objet est principalement les récepteurs des pollutions, avec celle des performances environnementales des entreprises, qui est pour sa part surtout fondée sur l’analyse des sources de pollution. Ash et al. (2009), Cendres et Boyce (2010), et Grant et al. (2010) ont ainsi initié un nouveau courant de recherche : la performance de justice environnementale des entreprises. Le caractère spatial de l'activité industrielle est au cœur du problème de l'exposition différentielle des citoyens aux toxiques industriels. L'interface avec l'appareil réglementaire public a aussi son importance, mais la localisation industrielle par rapport aux zones de peuplement est absolument centrale dans ce type d’analyse. Un des éléments clé pour le développement de la recherche en matière de justice environnementale a été la grande disponibilité de données spatiales précises sur les établissements industriels et la répartition de la population. La recherche s'appuie également sur la disponibilité des données chimiques et toxicologiques. À cet égard, le retard américain est patent : la recherche s’appuie sur des indica- teurs dépassés pour de nombreux produits chimiques et une absence de données quant à la grande majorité des produits chimiques utilisés dans les procédés industriels. Le manque de données est également criant sur les interactions possibles entre produits chimiques et impacts synergétiques sur la santé. Du côté des données chimiques, le TRI comprend des indica- teurs à la fois sur les rejets directs dans l'environnement par les établissements industriels et leurs efforts de traitement des déchets et sur les transferts de déchets à des installations hors site pour trai- tement ou stockage (les rejets dans l'environnement associés au
- 84. 82 Michael Ash et James K. Boyce traitement des déchets et de leurs transferts doivent en revanche être estimés). Mais le TRI ne permet pas de rendre compte d’une « balance matérielle » complète, qui permettrait d’établir la comp- tabilité des produits chimiques toxiques contenus dans les produits, les déchets et les rejets. Du côté des données relatives à la population, le recensement décennal de la population et du logement américains, qui est une obligation découlant de la Constitution des États-Unis, contient des données sur les caractéristiques démographiques, sociales et économiques pour des zones géographiquement très détaillées. Certaines données, y compris celles relatives à la race et l'ethnicité, sont disponibles au niveau des îlots de recensement, qui, en moyenne, sont d’un kilomètre carré et comporte 53 personnes (la superficie moyenne est sensiblement plus petite et le nombre de personnes sensiblement plus élevé dans les villes). On peut obtenir davantage de données, y compris sur le niveau et la répartition des revenus et de l'éducation des habitants, en s’appuyant sur les regroupements des îlots de recensement, qui sont des agrégations d’îlots de recensement contenant environ 1 500 personnes, et sur les secteurs de recensement, qui sont des agrégations de plusieurs regroupements d’îlots de recensement. Les données géographique- ment les plus détaillées du recensement géographiquement ne forment pas des zones administratives, mais sont, en principe, conçues pour correspondre aux délimiteurs sociaux, économiques, démographiques ou géographiques. Ainsi, dans les villes, le regrou- pement d’îlots correspond grosso modo à la notion de quartier. Ces données sont accessibles au public, accompagnées d’identifiants géographiques (latitude et longitude d'un point mais aussi infor- mation spatiale complète pour une utilisation au moyen des systèmes d'information géographique). Ces données, leur disponi- bilité et leur géocodage, constituent désormais un élément clé de la recherche sur la distribution socioéconomique et géographique des aménités environnementales. 3. De nouveaux outils : les indicateurs de détection des risques environnementaux Comme on l’a vu, l'intégration des outils de recherche a été un élément central de l'analyse de la justice environnementale aux
- 85. Justice environnementale et performance des entreprises 83 États-Unis. Ces outils dépendent avant tout des données sur les rejets industriels et sur la population, et sur l'aptitude des cher- cheurs à faire correspondre spatialement ces deux types de données. Le projet développé par l’EPA d’indicateurs de détection des risques environnementaux (Risk-Screening Environmental Indicators) est un outil majeur pour l'intégration des données rela- tives aux rejets toxiques des entreprises dans le but d’améliorer la compréhension de toutes les parties concernées (Office of Polluation Prevention and Toxics 2004). Ce projet contient trois contributions importantes susceptibles d’accroître la valeur des données du TRI. Tout d'abord, il utilise un système de pondération de toxicité revu par les pairs qui attribue à chaque produit chimique dangereux une pondération (en livres), ce système permettant aux citoyens de comprendre l'importance pour la santé humaine de produits chimiques à la dénomination obscure. En effet, selon les bases de données utilisées par l’EPA dans la construction des indicateurs du modèle, les quelque 600 produits chimiques et groupes chimiques énumérés dans le TRI ont une toxicité variable pouvant aller jusqu'à neuf ordres de grandeur. La pondération de toxicité calculée pour chaque produit chimique est un nombre sans unité, mais proportionnel au niveau de risque toxi- cologique établi, tel que le risque de cancer dans le cas des substances cancérigènes et celui de dépassement du seuil de dange- rosité pour les produits non-cancérigènes. Deuxièmement, ces indicateurs de détection des risques envi- ronnementaux donnent une idée de la manière dont chaque produit chimique se propage à partir du point de rejet dans la zone environnante (« le sort et le transport »). En ce qui concerne la pollution atmosphérique, la modélisation de panache (plume mode- ling) a été utilisée pour examiner le sort et le transport des rejets industriels toxiques dans les zones alentours (ces modèles fournis- sent des estimations des concentration de produits chimiques toxiques). Dans le cas des indicateurs de détection des risques envi- ronnementaux, ces estimations sont faites à des intervalles de 810 m sur 810 m sur un rayon de 49 km autour de l’établissement. Le modèle de panache AERMOD utilisé pour ces indicateurs a été calibré avec des données de terrain et permet de rendre compte de différences d'exposition à ce niveau de détail, mais il est important
- 86. 84 Michael Ash et James K. Boyce de garder à l'esprit que les micro-données géographiques de ces indicateurs sont estimées. Enfin, ces indicateurs de détection rendent compte de la popu- lation touchée, en utilisant les données du recensement pour évaluer le nombre de personnes vivant dans les zones autour de l'établissement d’où émane la pollution. Parmi les caractéristiques séduisantes de ces indicateurs figurent leur construction par des méthodes bien documentées qui ont subi un examen approfondi conduit par le Science Advisory Board, des panels d'experts extérieurs provenant des secteurs privé et académique en charge de « contrôler la qualité et la pertinence des informations scientifiques et techniques utilisées comme fondement pour la régle- mentation de l’EPA »2. Ces indicateurs sont dès lors parmi les plus rigoureusement contrôlés en usage actuellement et peuvent se préva- loir de la légitimité du processus réglementaire fédéral. Ces données intégrées permettent l'évaluation du risque indivi- duel et du risque encouru par la population en matière de pollutions provenant des produits chimiques des établissements et des entreprises. Le risque individuel à un endroit donné peut être calculé en examinant la concentration estimée de la substance chimique toxique à l'emplacement dit et en pondérant cette concentration par la toxicité du produit. La toxicité pondérée par la concentration étant cumulative, le risque individuel résultant d’une exposition à des pollutions multiples est calculé en addition- nant les risques individuels de chaque rejet. La population à risque est calculée pour chaque zone de 810 m par 810 m en multipliant la toxicité pondérée par la population de chaque zone. La population à risque est ensuite ajustée selon les critères de l'EPA qui recense des « facteurs d'exposition par inhala- tion » permettant de rendre compte de l'absorption différentielle des polluants selon l’âge et le sexe. On peut alors additionner ces facteurs pour obtenir sur la durée du rejet une estimation des risques chroniques potentiels pour la santé humaine. Les risques sur la population sont additifs, de sorte que le risque pour la popu- lation d'un établissement peut être calculé en ajoutant le risque pour la population de l'ensemble de ses rejets. De même, le risque 2. Voir http://yosemite.epa.gov/sab/sabpeople.nsf/WebCommittees/BOARD
- 87. Justice environnementale et performance des entreprises 85 pour la population d'une entreprise peut être calculé en ajoutant le risque pour la population de l'ensemble de ses établissements. Ces données intégrées permettent également d'évaluer l'exposi- tion disproportionnée des minorités ethniques et des personnes à faible revenu aux rejets industriels toxiques. On trouvera le détail de l'analyse dans Ash et Boyce (2010). L'approche consiste à examiner la part du risque total pour la santé d'une entreprise ou d’un produit chimique encouru par un groupe relevant de l’analyse en termes de justice environnementale (cf. supra) et à comparer cette part à la représentation de ce groupe dans la population totale. Nous utilisons la différence en points de pourcentage entre la part du fardeau de pollution et la part dans la population comme indice de disparité. Pour notre analyse de la situation aux États- Unis, nous avons comparé alternativement le fardeau de pollution résultant de produits chimiques ou d’entreprises données à la représentation nationale d’une minorité ethnique ou d’un groupe social à faible revenu et sa représentation dans l'État où la pollution a lieu. D'autres comparaisons sont possibles, notamment entre différents produits chimiques et différentes entreprises. Le tableau 1 présente pour l’année 2007 la valeur des indica- teurs de détection des risques environnementaux (IDRE) pour les dix principaux produits chimiques, classés en fonction de leur risque en matière de maladie chronique résultant de rejets atmos- phériques industriels. Ces dix produits chimiques comptent pour 90 % du risque total et les deux premiers, le chrome (46,3 %) et le diaminotoluène (15,6 %) représentent à eux seuls 60 % du risque total. Le tableau comprend également le poids de toxicité par inha- lation pour les dix produits chimiques et les livres libérées ou transférées vers l'incinération. Même parmi les dix premiers produits chimiques, le poids de toxicité par inhalation diverge considérablement, passant de 110 000 pour le 1,3-Budadiene à 150 000 000 pour le Propylèneimine. La faible correspondance entre les quantités rejetées (rapportés en livres) et les scores IDRE montre bien que c’est l’ensemble du modèle qui permet une juste interprétation du risque pour la santé humaine. Un risque élevé selon l’IDRE peut refléter des rejets importants, une toxicité élevée ou une forte exposition de la population. La colonne « établisse- ments » indique le nombre d'établissements ayant déclaré des rejets dans l'air pour chaque produit chimique.
- 88. 86 Tableau 1. Score IDRE des dix produits toxiques les plus risqués rejetés dans l'air en 2007 Transferts Part du risque Part du risque Toxicité Nombre Rejets Part du risque Score Part du vers l’inci- supporté par les supporté Produit chimique chimique à d’établis- dans l'air supporté par IDRE risque total nération non- Blancs et par les afro- l'inhalation sements (livres) les pauvres (livres) hispaniques américains Chrome et 43000000 1 935 221 276 235 46 ,3 % 615 268 0 38 ,8 17 ,5 13 ,8 ses composés Diaminotoluène 3900000 12 74 652 893 15 ,6 % 4 368 5 861 079 36 ,6 5 ,9 9 ,2 (mélange d'isomères) Michael Ash et James K. Boyce Cobalt et ses composés 17000000 435 56 035 081 11 ,7 % 96 441 0 26 ,1 11 ,4 10,0 Nickel et ses composés 930000 1 925 24 078 061 5 ,0 % 883 495 1 193 33 ,1 14 ,8 12 ,7 Nitroglycérine 2100000 19 17 349 602 3 ,6 % 118 405 106 011 31 ,6 8 ,8 6 ,6 Composés aromatiques 1300000 1 414 9 951 203 2 ,1 % 441 362 66 571 37 ,6 21 ,1 15 ,5 polycycliques Propylèneimine 150000000 3 8 864 527 1 ,9 % 1 482 0 36 ,2 16 ,3 9 ,9 1,3-butadiène 110000 190 6 849 741 1 ,4 % 1 782 512 1 186 246 57,0 15 ,9 16 ,1 Benzène 28000 770 6 009 967 1 ,3 % 5 512 448 2 005 767 50 ,5 22 ,3 16 ,1 Formaldéhyde 46000 582 5 593 402 1 ,2 % 9 247 247 676 018 37 ,4 21 ,3 13 ,9 Source : Calculs des auteurs.
- 89. Justice environnementale et performance des entreprises 87 Le tableau indique également la façon dont le risque de chaque produit chimique est réparti au sein des populations traditionnelle- ment victimes d’injustice environnementale. Par exemple, 38,8 % du risque liés au chrome est encouru par les non-Blancs, qui ne représentent que 30,9 % de la population américaine, soit une disparité de 7,9 points de pourcentage. Les Afro-américains repré- sentent 12 % de la population américaine, mais 17,5 % de la population exposée au risque lié au chrome. Les pauvres consti- tuent 12,4 % de la population mais 13,8 % de celle qui est exposée au danger du chrome. On note une variation dans les produits chimiques : ainsi plus de la moitié du risque au sens des IDRE du 1,3-butadiène utilisé dans la production de caoutchouc synthé- tique est supportée par les non-Blancs. Le tableau 2 présente le risque total pour la santé humaine et la répartition du risque des polluants atmosphériques toxiques indus- triels organisés par secteur industriel pour les dix premiers secteurs les plus polluants. Comme dans le cas des produits chimiques, le tableau rend compte d’un risque très concentré, les deux princi- paux secteurs étant responsables de la moitié du risque total et les dix premiers secteurs représentant environ 90 % de celui-ci. Le cinquième par ordre d’importance, la sécurité nationale et les affaires internationales, reflète l'inclusion des établissements fédéraux dans le TRI (les installations des États et au niveau local ne sont pas incluses), dans les faits des bases militaires. On observe également à nouveau des variations importantes entre secteurs industriels dans la répartition disproportionnée du fardeau de pollution en défaveur des populations concernées par l’injustice environnementale. Pour le raffinage du pétrole par exemple, plus de la moitié du risque total est supportée par des personnes non blanches.
- 90. 88 Tableau 2. Score IDRE des dix secteurs industriels les plus risqués selon leurs rejets dans l'air en 2007 Part du risque Part du risque Nombre Part du Transferts vers Part du risque Score Rejets dans supporté par supporté Secteur industriel d’établis- risque l’incinération supporté par IDRE l'air (livres) les non- Blancs par les afro- sements total (livres) les pauvres et hispaniques américains Produits chimiques et connexes 2 608 133 207 993 27 ,9% 176 382 696 159 297 362 40 ,9 19 ,2 12 ,7 Fabrication de produits métalliques, sauf équipements de machinerie 1 719 108 067 534 22 ,6% 26 451 433 612 640 43 ,1 19 ,3 14 ,7 et de transport Michael Ash et James K. Boyce Matériel de transport 1 034 57 725 948 12 ,1% 41 679 331 944 742 32 ,6 13 12 ,1 Transformation primaire de métaux 1 367 37 352 531 7 ,8% 46 916 813 1 319 147 28 ,5 12 ,8 12 ,6 Sécurité nationale affaires 149 28 257 331 5 ,9% 2 510 441 72 675 33 ,7 13 ,4 9 ,4 internationales Instruments de mesure, d’analyse et de contrôle; instruments pho- 200 21 286 070 4 ,5% 3 068 538 4 065 043 18 9 ,4 9 tographiques, médicaux et optiques Machines industrielles et commer-cia- 688 18 954 988 4 ,0% 4 700 357 84 484 30 ,2 12 ,1 11 ,6 les et matériel informatique Raffinage du pétrole et industries 482 14 079 360 2 ,9% 41 368 230 12 451 527 52 ,5 25 ,9 16 ,5 connexes Pierre, céramique, verre et produits 1 097 12 541 330 2 ,6% 30 006 271 548 773 29 ,2 16 ,1 11 ,2 en béton Électricité, gaz et services sanitaires 712 11 599 732 2 ,4% 637 701 080 5 567 426 35 ,1 16 ,8 12 ,7 Source : Calculs des auteurs.
- 91. Justice environnementale et performance des entreprises 89 Le tableau 3 montre la capacité du modèle IDRE à mesurer la performance au niveau des entreprises. Les données du tableau 3 illustrent le risque total en 2006 pour la santé humaine des toxiques atmosphériques industriels émanant des vingt entreprises privées présentant le plus de risque ainsi que la répartition de ce risque. Cette liste indique elle aussi un déséquilibre important, mais la concentration du risque y apparaît moindre que dans le cas des produits chimiques ou des secteurs industriels. Tableau 3. Score IDRE des vingt grandes entreprises les plus risquées selon leurs rejets dans l’air en 2006 Rejets liés aux Rejets Part du Part du transferts Classe- dans l'air risque risque sup- Score de Vers ment Entreprise (en mil- supporté porté par toxicité l’incinération TRI lions de par les les afro- (en millions de livres) pauvres américains livres) 1 Bayer Group 189 649 0 ,72 8 ,88 9 ,0 % 33 ,8 % 2 Exxon Mobil 170 689 10 ,21 0 ,20 24 ,3 % 65 ,2 % 3 Sunoco 138 743 3 ,88 0 ,81 17 ,5 % 38 ,5 % E, I, du Pont de 4 122 436 12 ,43 22 ,82 16 ,5 % 38 ,3 % Nemours 5 Arcelor Mittal 117 510 1 ,40 0 ,02 21 ,4 % 63 ,2 % 6 Steel Dynamics Inc., 99 952 0 ,74 0 ,00 24 ,6 % 11 ,4 % Archer Daniels 7 97 281 11 ,11 0 ,00 21 ,7 % 28 ,7 % Midland Co., (ADM) 8 Ford Motor Co., 93 854 5 ,09 0 ,00 11 ,8 % 24 ,4 % 9 Eastman Kodak Co., 87 328 1 ,97 0 ,66 14 ,8 % 29 ,5 % 10 Koch Industries 84 044 33 ,56 1 ,94 11 ,4 % 24 ,5 % 11 Conoco Phillips 83 194 6 ,39 0 ,11 16 ,0 % 52 ,8 % 12 Valero Energy Corp., 72 294 4 ,13 0 ,09 18 ,2 % 59 ,0 % 13 General Electric Co., 66 936 0 ,45 0 ,14 13 ,9 % 39 ,0 % 14 AK Steel Holding 66 290 0 ,30 0 ,00 18 ,4 % 6 ,4 % 15 Dow Chemical Co., 59 907 11 ,69 17 ,19 14 ,4 % 43 ,0 % 16 Alcoa Inc., 59 771 10 ,40 0 ,13 10 ,8 % 19 ,5 % 17 Duke Energy 58 765 75 ,74 0 ,00 10 ,2 % 19 ,9 % 18 BASF 57 071 7 ,65 2 ,99 15 ,7 % 34 ,2 % United Sates Steel 19 54 813 1 ,71 0 ,21 17 ,4 % 46 ,1 % Corp., Public Service Enter- 20 54 171 6 ,20 0 ,00 17 ,9 % 60 ,4 % prise Group (PSEG) Source : Calculs des auteurs.
- 92. 90 Michael Ash et James K. Boyce Bien que les résultats ne soient pas présentés ici, l'analyse permet aussi d'identifier les établissements à fort impact toxique et la répartition des produits chimiques au sein des entreprises3, ce qui rend l'outil très utile pour les gestionnaires de l'environnement. 4. Limites du TRI et des IDRE et données manquantes Les principales lacunes de l’approche IDRE pour mesurer la pollution atmosphérique sont liées aux propres limites du TRI. Les données du TRI permettent de rendre compte des pollutions les plus importantes provenant de sources fixes aux États-Unis, mais elles ne reflètent pas les émissions provenant de sources mobiles, tels que les camions, voitures, navires et avions. Le TRI exclut également les établissements qui ne sont pas tenus de faire rapport en vertu de leur petite taille ou d’une appartenance à des secteurs industriels qui ne sont pas recensés. Font partie de ces sources non couvertes des pollueurs potentiellement importants comme les stations-service, les pressing et les garages automobiles et magasins de pièces détachées. Par ailleurs, les données du TRI sont calculées sous la forme de totaux annuels et ils sont fondés, pour la plupart, sur des estima- tions des rejets provenant de procédés industriels. Le TRI est limité aux quelque 600 produits chimiques inscrits et ne comprennent pas certains polluants qui menacent pourtant gravement la santé et l'environnement. Parmi les six polluants majeurs visés par le Clean Air Act comme devant faire l’objet de normes régionales et par établissement, le TRI n’en recense qu'un seul (le plomb) et omet d'inclure les cinq autres (particules, dioxyde de soufre, ozone, oxydes d'azote et monoxyde de carbone). Le TRI ne comprend pas davantage le dioxyde de carbone et les autres gaz à effet de serre. Un tableau complet de la pollution de l'air et des risques sanitaires afférents devrait inclure tous ces produits chimiques. Les sources industrielles fixes de pollution, les sources mobiles (et les autres émissions) sont certes prises en compte par l'évalua- tion nationale des pollutions atmosphériques (National-Scale Air Toxics Assessment4) qui est réalisée en utilisant des méthodes 3. Voir http://www.peri.umass.edu/toxic_index/ pour des informations plus détaillées 4. NATA, voir http://www.epa.gov/ttn/atw/natamain/
- 93. Justice environnementale et performance des entreprises 91 similaires aux indicateurs IDRE. Compte tenu de l'importance des sources mobiles de pollution, la NATA fournit un ensemble de données utiles pour estimer le risque sur la santé et a été utilisée dans plusieurs études (Morello-Frosch et Jesdale, 2005 ; et Pastor et al., 2006). La NATA a également conduit à la publication de données d'exposition formatées pour Google Earth qui permet une évaluation visuelle rapide des sites d'exposition. Mais les données NATA ne permettent pas pour autant d'analyse longitudi- nale. Les indicateurs IDRE sont disponibles sur une base annuelle jusqu'en 2007 tandis que la NATA n’est publiée que tous les trois ans, les données les plus récentes portant sur 2002 ayant été publiées en 2009. En outre, les données IDRE, parce qu’elles identifient précisé- ment les sources de la pollution à laquelle les populations sont exposées, permettent de lier sources et récepteurs de la pollution atmosphérique toxique. Ces données autorisent alors la construc- tion de séries longitudinales cohérentes sur l'exposition à la pollution sur la base d’un ensemble homogène au cours du temps de produits chimiques et de secteurs industriels (alors que la NATA écarte explicitement l’analyse longitudinale en raison de sa procé- dure de collecte de données). Autrement dit, alors que les données NATA constituent une ressource importante pour l'analyse trans- versale de l'exposition aux substances toxiques dans l'air, les données IDRE sont particulièrement adaptées au suivi de la pollu- tion industrielle au cours du temps, et permettent d’analyser les différences selon la race, le niveau d'éducation et la géographie qui pourraient être attribuables à des flux d'information ou des phéno- mènes de pouvoir politico-économique, de même que d'identifier les relations entre certaines entreprises et leur pollution. Les besoins en données supplémentaires et à jour sont pour autant évidents. En intégrant plus de secteurs industriels et en améliorant les méthodes de collecte, on comblerait des manques importants. Les États-Unis ont ainsi besoin de mettre à jour leurs bases de données chimiques et toxicologiques. Les résultats présentés dans cet article (et en grande partie ceux de la littérature sur l'exposition réelle des populations et non leur proximité spatiale par rapport aux établissements polluants) portent sur la pollution de l'air. Bien que les rejets dans l'eau soient inclus dans le TRI, l'exposition aux substances toxiques industrielles déversées
- 94. 92 Michael Ash et James K. Boyce dans l'eau a fait l’objet d’une attention bien moindre. Certaines données IDRE s’appuient sur un modèle d'exposition aux rejets dans les eaux de surface et aux rejets post-traitement des installa- tions de traitement, mais l'analyse de l'exposition brute et la répartition de l'exposition aux substances toxiques dans l'eau ne fait que commencer. Le TRI rend également compte des déchets terrestres, mais en raison de la complexité du confinement de ceux-ci et de la migration de ces substances à partir des décharges, l’approche IDRE n'a pas encore tenté de modéliser ces voies d'exposition. Bien qu'il existe un champ « parent » dans le TRI pour l'enregis- trement du propriétaire de l'installation, celui-ci est souvent vide, obsolète, ou erroné, et l'EPA ne possède aucun identifiant des propriétaires des installations. Le Projet d’information sur les produits toxiques des entreprises (Corporate Toxics Information Project) du Political Economy Research Institute de l'Université du Massachusetts, Amherst, a construit et mis à jour sa propre base de données recensant la propriété des installations polluantes, mais le processus de création et d’entretien de cette base de données est fastidieux et chronophage. Des changements relativement simples mais politiquement sensibles dans les exigences de déclaration permettraient d’améliorer grandement cet appariement « proprié- taire-installation », par exemple en exigeant l’identification d’un propriétaire actuel ultime pour chaque installation, par le recours à son numéro d'identification de contribuable/employeur attribué par le gouvernement fédéral. Une autre voie d’amélioration consisterait à établir la corres- pondance entre les données sur les permis de pollution et sur les quantités de rejets polluants. Les installations ne sont pas en l’état actuel identifiées de manière uniforme dans les bases de données de permis et de rejets, notamment parce que les unités de mesure diffèrent entre les bases de données. Il est donc pratiquement impossible de déterminer si un rejet polluant rapporté dans le TRI est permis ou interdit. Une meilleure intégration de ces données doit donc être un objectif pour les régulateurs de l'environnement. Une nouvelle frontière de première importance pour la collecte des données concerne enfin le processus de surveillance, à la fois surveillance des concentrations ambiantes et surveillance biolo- gique. Le contrôle a l'avantage de se fonder sur l'exposition réelle –
- 95. Justice environnementale et performance des entreprises 93 de la zone géographique ou des personnes – et peut dès lors renvoyer une image précise des risques humains et environnemen- taux. Pourtant, cette surveillance, à la différence de la modélisation, n’associe pas directement les sources avec les récep- teurs, sauf si la source locale de la substance chimique est indiscutable. Une orientation connexe pour la collecte de données supplémentaires est la collecte et la synthèse des données codées géographiquement des effets des pollutions sur la santé. Certaines études récentes ont ainsi examiné l’impact sur la santé infantile de l'exposition à des toxiques atmosphériques (Currie et Schmieder, 2009), mais la bio-surveillance et les données épidémiologiques géocodées ouvrent de nouvelles possibilités pour des analyses plus approfondies. 5. Résumé et implications pour les initiatives de justice environnementale dans l’Union européenne En somme, les données employées dans l'analyse de la justice environnementale et des performances des entreprises aux États- Unis comprennent : le PRTR, les données du recensement de la population et du logement, des données sur le climat, la géogra- phie et les procédés industriels, les données chimiques et toxicologiques. L'intégration spatiale de ces données permet l'analyse des caractéristiques des communautés récepteurs en rela- tion avec les entreprises polluantes et leurs installations. En 2007, l'Union européenne s’est dotée d’un PRTR unique, agrégeant les rapports harmonisés de tous les pays membres. Le registre européen des rejets et des transferts de polluants (European Pollutant Release and Transfer Register ou E-PRTR), qui remplace l’ancien registre européen des rejets polluants (EPER), a été mis en œuvre suivant les termes de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement. Il comprend moins de produits chimiques que le TRI, mais des substances importantes qui ne figurent pas dans le TRI, par exemple, les gaz à effet de serre et les pesticides. L'Union européenne a en outre développé un meilleur système d'évaluation du risque toxicologique des substances chimiques que le système qui prévaut actuellement aux États-Unis. Les données
- 96. 94 Michael Ash et James K. Boyce provenant du règlement de l’Union européenne sur l'enregistre- ment, l’évaluation, l’autorisation et la restriction des substances chimiques (REACH), couplé aux données américaines existantes sur la toxicité pourraient constituer une base efficace de pondéra- tion de toxicité. La disponibilité des données sociales, économiques et démogra- phiques codées spatialement est en revanche moindre en Europe qu’aux États-Unis. Certains pays, notamment la France, ont des limites strictes à la collecte de données raciales ou ethniques par les pouvoirs publics. Et pour les données qui sont recueillies dans les recensements ou enquêtes par sondage, la protection liée à la confidentialité s'applique. Le défi le plus important est sans doute que le concept de justice environnementale en est encore à ses débuts en Europe en raison de la complexité des modes d'habitat et d’une exclusion ethnique dont la dimension spatiale est un peu moins marquée que dans l'espace américain où la ségrégation est un fait central. En Grande- Bretagne, néanmoins, la recherche a été lancée avec les travaux de Julian Agyeman (voir, par exemple, Agyeman et Evans, 2004) et Gordon Mitchell (voir par exemple, Mitchell et Dorling, 2003) sur le lien entre exclusion sociale, vulnérabilité démographique, pauvreté et différence ethnique. En Europe centrale et orientale, l'exclusion sociale des Roms a été examinée du point de vue envi- ronnemental par un groupe commun à l'Université d'Europe centrale (Central European University) et l'Université du Massa- chusetts à Amherst (Steger et al., 2008 ; Steger et Filcak, 2008 ; et Antypas et al., 2008). En France, le concept de justice spatiale (Soja, 2009 et Marcuse, 2009) peut fournir un point d'entrée pour des discussions sur la justice environnementale. L’adaptation de la notion de justice environnementale présentera certainement des défis intéressants pour les chercheurs européens (voir dans ce numéro l’article de Laurent). Les données elles-mêmes peuvent faire partie de la solution en stimulant l’engagement des citoyens et des entreprises et en renfor- çant la légitimité des régulateurs et des communautés touchées. Les consommateurs, les résidents et les employés peuvent réagir aux informations sur la pollution en incitant les entreprises à interna- liser, au moins partiellement, des coûts précédemment externalisés. Les actionnaires et les gestionnaires peuvent égale-
- 97. Justice environnementale et performance des entreprises 95 ment réagir du fait de leur inquiétude concernant le cours de leurs actions, leur responsabilité juridique, l’effet sur leur réputation auprès de consommateurs soucieux de l'environnement, ou le risque d’action publique ou citoyenne. L’information peut donc, en la matière, s’avérer un levier capital pour le changement. Références bibliographiques Agyeman J. et B. Evans, 2004, « ‘Just sustainability’: the emerging discourse of environmental justice in Britain », The Geographical Journal, 170: 155-164. doi:10.1111/j.0016-7398.2004.00117.x Aldhous P. et P. McKenna, 2010, « Hey green spender: The truth about eco-friendly brands », The New Scientist, 2748, 17 février. Anderton D. L., A. B. Anderson, J. M. Oakes et M. Fraser, 1994b, « Environ- mental equity: The demographics of dumping », Demography, 31(2): 221-240. Antypas A., C. Cahn, R. Filcak et T. Steger, 2008, « Linking Environmental Protection, Health, and Human Rights in the European Union : An Argument in Favour of Environmental Justice Policy », Journal of Envi- ronmental Law and Management, 20(1):8-21. Ash M. et T. R. Fetter, 2004, « Who lives on the wrong side of the environ- mental tracks? Evidence from the EPA’s Risk-Screening Environmental Indicators Model », Social Science Quarterly, 85(2), 441-462. Ash M., J. K. Boyce, G. Chang, M. Pastor, J. Scoggins et J. Tran, 2009, Justice in the Air: Tracking Toxic Pollution from America’s Industries and Compa- nies to Our States, Cities, and Neighborhoods, Amherst: Political Economy Research Institute, avril. Ash M. et J. K. Boyce, 2010, The 2006 Toxic 100 Air Polluters, (http:// www.peri.umass.edu/ctip, 17 mars 2011). Ash M. et J. K. Boyce, 2010, Measuring corporate environmental justice perfor- mance. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, doi: 10.1002/csr.238. Bouwes N. W., S. Hassur, M. Shapiro, 2003, « Information for empower- ment: The EPA’s risk-screening environmental indicators project », In Natural Assets: Democratizing Environmental Ownership, Boyce J. K., Shelley B. G. (eds), Island Press: Washington, DC; 135-150. Bowen W. M., 2000, Environmental Justice Through Research-Based Decision- Making, New York: Garland Publishers, Inc. Boyce J. K., 2002, The Political Economy of the Environment, Aldershot: Edward Elgar.
- 98. 96 Michael Ash et James K. Boyce Bullard R. D., 1990, Dumping in Dixie: Race, Class, and Environmental Quality, Boulder, CO: Westview. Chakraborty J, Armstrong M. P., 1997, « Exploring the use of buffer analysis for the identification of impacted areas in environmental equity assessment », Cartography and Geographic Information Systems, 24(3): 145-157. Currie J. et J. F. Schmieder, 2009, « Fetal Exposures to Toxic Releases and Infant Health », American Economic Review, Vol. 99(2), pp. 177-183, mai. Garcia G., 2011, « Settlement and Geographic Redistribution Patterns », Mexican American and Immigrant Poverty in the United States, Vol. 28, pp. 33-43, DOI: 10.1007/978-94-007-0539-5_3. Garner R., B. H. Hancock et K. Kim, 2007, « Segregation in Chicago », The Tocqueville Review/La Revue Tocqueville, XXVIII(1): 41-74. Grant D., M. N. Trautner, L. Downey et L. Thiebaud, 2010, « Bringing the Polluters Back In: Environmental Inequality and the Organization of Chemical Production », American Sociological Review August, Vol. 75, n° 4, pp. 479-504, (http://asr.sagepub.com/content/75/4/479.abstract) Hagen J. von, 2002, Empirical studies of environmental policies in Europe, printemps. Hamilton J. T., 1995, « Pollution as News: Media and Stock Market Reac- tions to the Toxics Release Inventory Data », Journal of Environmental Economics and Management Vol. 28, n° 1, janvier, pp. 98-113. Hird J. A. et M. Reese, 1998, « The Distribution of Environmental Quality: An Empirical Analysis », Social Science Quarterly, 79(4):693-716. Khanna M., 2001, « Non-Mandatory Approaches to Environmental Protec- tion », Journal of Economic Surveys, Vol. 15, n° 3. Koval J. P., L. Bennett, M. I. J. Bennett, F. Demissie, R. Garner et K. Kim, Editeurs, 2006, The New Chicago: A Social and Cultural Analysis, Temple University Press. Marcuse P., ANNEE, 2009, « Spatial Justice: Derivative but Causal of Social Injustice », Justice spatiale/ Spatial Justice, n° 1, septembre. Mitchell G. et D. Dorling, 2003, An environmental justice analysis of British air quality Environment and Planning A 2003, Vol. 35, pp. 909-929, DOI:10.1068/a35240. Mohai P. et B. Bryant, 1992, « Environmental racism: Reviewing the evidence », in B. Bryant et P. Mohai, eds., Race and the Incidence of Envi- ronmental Hazards: A Time for Discourse. Boulder, CO: Westview, pp. 163-176. Mohai P. et R. Saha, 2007, « Racial inequality in the distribution of hazar- dous waste: A national-level reassessment », Social Problems, 54(3): 343–370.
- 99. Justice environnementale et performance des entreprises 97 Morello-Frosch R., M. Pastor, C. Porras et J. Sadd, 2002, « Environmental Justice and Regional Inequality in Southern California: Implications for Future Research. Environmental », Health Perspectives 110(2), 149-154. Morello-Frosch R. et B. M. Jesdale, 2006, « Separate and Unequal: Residen- tial Segregation and Estimated Cancer Risks Associated with Ambient Air Toxics in U.S. Metropolitan Areas », Environmental Health Perspec- tives, Vol. 114, n° 3, mars, http://www.ehponline.org/docs/2005/8500/ abstract.html Office of Pollution Prevention and Toxics, 2004, Risk-Screening Environ- mental Indicators, U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC, http://www.epa.gov/oppt/rsei, Visited 17 mars 2011. Parrado E. A. et W. A. Kandel, 2010, « Hispanic Population Growth and Rural Income Inequality », Social Forces, Vol. 88, n° 3, mars, pp. 1421- 1450, DOI: 10.1353/sof.0.0291. Pastor M. Jr, J. L. Sadd, et R. Morello-Frosch, 2002, « Who's Minding the Kids? Pollucion, Public Schools, and Environmental Justice in Los Angeles », Social Science Quarterly, Vol. 83, n° 1, pp. 263-280, mars. Pastor M., Sadd, J. et J. Hipp, 2001, « Which came first? Toxic facilities, minority move-in, and environmental justice », Journal of Urban Affairs, 23, pp. 1-21. Pastor M, J. Sadd et R. Morello-Frosch, 2006, « The air is always cleaner on the other side: Race, space, and air toxics exposures in California », Journal of Urban Affairs, 27(2). Saha R. et P. Mohai, 2005, « Historical context and hazardous waste faci- lity siting: Understanding temporal patterns in Michigan », Social Problems. Sicotte D. et S. Swanson, 2007, « Whose Risk in Philadelphia? Proximity to Unequally Hazardous Industrial Facilities », Social Science Quarterly, Vol. 88, n° 2, pp. 515-534. Soja E. W., 2009, « The city and spatial justice », Justice spatiale/Spatial Justice, n° 1, septembre. Steger T., K. Harper et R. Filcak, 2008, « Environmental Justice and Roma Communities in Central and Eastern Europe », Slavic Review, Illinois: University of Illinois. Steger T et R. Filcak, 2008, « Articulating the Basis for Promoting Environ- mental Justice in Central and Eastern Europe», Environmental Justice, 1. United Church of Christ Commission for Racial Justice, 1987, Toxic Wastes and Race in the United States: A National Report on the Racial and Socio- Economic Characteristics of Communities with Hazardous Waste Sites, New York: United Church of Christ Commission for Racial Justice. U.S. General Accounting Office (GAO), 1983, Siting of Hazardous Waste Landfills and Their Correlation with Racial and Economic Status of
- 100. 98 Michael Ash et James K. Boyce Surrounding Communities. Washington, DC: GAO/RCED, pp. 83-168, 1er juin. Vidovic M. et N. Khanna, 2007, « Can voluntary pollution prevention programs fulfill their promises? Further evidence from the EPA's 33/50 Program », Journal of Environmental Economics and Management, Vol. 53, n° 2, mars, pp. 180-195. Wolverton A., 2009, « Effects of Socio-Economic and Input-Related Factors on Polluting Plants' Location Decisions», The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy, Vol. 9, n° 1 (Advances), Article 14.
- 101. POUR UNE JUSTICE ENVIRONNEMENTALE EUROPÉENNE LE CAS DE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE Éloi Laurent OFCE, Observatoire français des conjonctures économiques Le débat scientifique et démocratique sur la justice environnementale et sur l'articulation des politiques sociales et environnementales, vieux de plus de deux décennies outre-Atlantique, ne fait que commencer en Europe. L'État providence ne peut plus faire l'impasse dans l'Union européenne sur l'environnement dans lequel vivent les individus (travail, résidence, loisirs) dès lors que celui-ci détermine en partie les facteurs affectant leur santé et plus largement leur bien-être. Il s'agit donc pour les pays membres et les instances de l'UE à la fois d'adopter et d'adapter l'exigence de justice envi- ronnementale. Cet article propose des pistes en vue de cette adaptation et, après avoir défini différentes catégories d'inégalités environnementales, en éclaire plus particulièrement un aspect : la précarité ou pauvreté énergé- tique. La situation du Royaume-Uni et de la France sont passées en revue avant d'aborder les enjeux et modalités d'une politique européenne de lutte contre la précarité énergétique. Mots clés : justice environnementale, Union européenne, inégalités environnementales, précarité énergétique, pauvreté énergétique. Revue de l’OFCE / Débats et politiques – 120 (2011)
- 102. 100 Éloi Laurent 1. De la justice environnementale en Europe Apparue comme une préoccupation dans le discours public dès 1820, l'idée de « justice environnementale » est vraiment née aux États-Unis à la fin des années 1970, dans le contexte du combat pour l'égalité raciale et plus généralement de l'activisme civique. Elle servit à désigner à la fois les inégalités dans l'exposition aux risques environnementaux (pollutions, déchets, inondations, etc.) et la mise à l'écart des minorités raciales, en particulier des Afri- cains-Américains, des Hispaniques et des Indiens (native Americans), dans la conception et la mise en œuvre des politiques environnementales au plan local et national. Il s'agissait alors en particulier de dénoncer la pratique visant à déverser des déchets chimiques toxiques dans les quartiers africains-américains pauvres (voir Ash et Boyce dans ce numéro). À la lumière des nombreuses études de ce dynamique courant juridique, académique et politique américain se fait jour l'idée fondamentale qui sous-tend l'exigence de justice environnemen- tale : des politiques publiques visant l'équité qui ne prendraient pas en compte la dimension environnementale manqueraient un aspect essentiel de la question sociale. En d'autres termes, il est inéquitable que les pouvoirs publics fassent l'impasse sur l'environ- nement dans lequel vivent les individus (travail, résidence, loisirs) dès lors que celui-ci détermine en partie les facteurs affectant leur santé et plus largement leur bien-être. La perspective des inégalités environnementales permet de rendre opératoire cet enchaînement essentiel – environnement, santé, bien-être – dans les sociétés contemporaines. Le débat scientifique et démocratique sur la justice environne- mentale et sur l'articulation des politiques sociales et environnementales, vieux de plus de deux décennies outre-Atlan- tique, ne fait que commencer en Europe et dans les instances de l'Union européenne1. Les balbutiements de cette nouvelle 1. Voir par exemple la conférence « Social Fairness in Sustainable Development – A Green and Social Europe » organisée en février 2009 par la Commission européenne.
- 103. Pour une justice environnementale européenne 101 approche peuvent être datés de la rédaction de la Convention de la CEE sur « l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environne- ment », adoptée le 25 Juin 1998 à Aarhus, lors de la quatrième Conférence ministérielle du processus « Un environnement pour l'Europe », dite Convention d'Aarhus. L'article premier de cette Convention « garantit les droits d'accès à l'information sur l'envi- ronnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement ». Le courant de la justice environnementale s'est diffusé en Europe par l'entremise des pays anglo-saxons et on en voit aujourd'hui les prolongements les plus aboutis au Royaume-Uni et en Ecosse. Deux discours ont marqué cette nouvelle orientation. Le premier a été prononcé en 2002 par Jack McConnell, alors premier ministre de l'Ecosse : « les gens qui sont le plus préoccupés par l'environnement en Ecosse sont ceux qui, chaque jour, font face aux conséquences d'une mauvaise qualité de vie, et vivent dans un environnement malsain – à proximité de la pollution industrielle, au contact des échappements des voitures et camions, dans des rues remplies d'ordures et dont les murs sont couverts de graffitis »2. Pour McConnell, dès lors que « combler l'écart en matière de qualité de vie parmi les citoyens exige aussi la justice environnementale », il fallait développer de nouvelles politiques publiques pour répondre à cette exigence. Tony Blair reprit cette idée dans un discours de 2003, faisant valoir que « c'est par l'éléva- tion du niveau général de notre environnement local que nous avons le plus grand impact sur les régions les plus pauvres »3. Le pouvoir exécutif écossais définit en 2005 une nouvelle stra- tégie de développement soutenable dans laquelle la justice environnementale fut reconnue comme une priorité4, affirmant l'idée que : « les communautés les plus démunies peuvent aussi être plus vulnérables à la pression de médiocres conditions environnementales » et « ne doivent pas assumer un fardeau [envi- ronnemental] disproportionné ». La nouvelle stratégie britannique de développement soutenable national, « Securing the future – deli- 2. McConnell (2002). 3. Pour de plus amples développements, voir Laurent (2011a) et Laurent (2011b). 4. Voir sur ce point la Section 8 de Choosing our future: Scotland's sustainable development strategy, The Scottish Executive, Edinburgh, 2005.
- 104. 102 Éloi Laurent vering UK sustainable development strategy » (2005), affirme elle aussi que l'un de ses objectifs consiste à « assurer un environnement décent pour tous » et assigne à l'exécutif la tache de lutter contre les inégalités environnementales. L'agence environnementale du Royaume-Uni considère d'ailleurs que l'injustice environnementale est un « problème essentiel » et a dressé un état des lieux et des mesures destinées à la combattre dans une série de rapports publiés en 20075. À la lumière de ces deux expériences nationales, les similitudes et les différences entre les approches américaine et européenne paraissent relativement claires : alors que les aspects procédural et distributif de la justice sont bien distingués dans les deux cas, les Européens mettent l'accent sur les conditions sociales qui produi- sent les injustices environnementales alors que les Américains insistent sur la dimension raciale des discriminations et de l'exclu- sion du processus décisionnel dont souffrent les minorités ethniques. L'approche américaine reconnaît en effet traditionnellement l'universalité des droits naturels accordés aux particuliers et vise à réduire les discriminations auxquelles ils sont confrontés dans l'exercice de ces droits, tandis que les pays d'Europe continentale se concentrent plutôt sur la correction des processus sociaux qui produisent des situations d'inégalité6. Dans le cas des politiques développées en Ecosse et en Angleterre, il y a donc une « européanisation » – au sens, paradoxal pour ces deux pays, de l'Europe continentale – de la notion de justice environnementale. Développer cette conception « à l'européenne » de la probléma- tique des inégalités environnementales ailleurs dans l'Union européenne apparaît possible et même légitime, mais à deux conditions. La première consiste à reconnaître que l'Europe, autant que les États-Unis, est confrontée au défi de la justice environnementale (les politiques sociales européennes ne peuvent plus ignorer l'impact sur la santé et le bien-être résultant de la dégradation des conditions environnementales de certaines populations). Le parti- 5. Rapports issus du projet « Addressing Environmental Inequalities Project (2005-7) » et notamment Walker et al. (2006). 6. Sur ce point, voir Laigle (2006).
- 105. Pour une justice environnementale européenne 103 cularisme européen consiste ici simplement dans le retard accumulé depuis deux décennies. Retard d'autant plus surprenant que les Européens sont (réputés) plus sensibles que les Américains à la question des inégalités sociales. La deuxième condition est que cette notion se déploie dans l’arsenal des politiques publiques non pas en termes raciaux, mais en termes de catégories sociales. Cela ne signifie pas que les inéga- lités environnementales n'ont pas, en Europe, de dimension « raciale » ou « ethnique » (au sens américain de ces termes) : c'est le cas de toutes les inégalités sociales dans des sociétés diverses. Des travaux européens ont d'ailleurs été développés dans cette direc- tion par exemple dans le contexte français (Viel et al. 2010) et sur la question de la vulnérabilité environnementale des communautés Rom en Europe centrale (Steger and Filcak, 2008 et Harper et al., 2009). Mais les contextes culturels et juridiques des politiques publiques aux États-Unis et en Europe se distinguent sur cette ques- tion comme sur d'autres. Il y a des explications historiques à cette différence : la justice environnementale étant née aux États-Unis dans le contexte de la lutte pour les droits civiques, elle a été d'emblée « racialisée ». Le facteur institutionnel joue également. Seules les minorités raciales sont reconnues comme des groupes par la loi fédérale américaine, pas les catégories sociales. La « race » constitue donc le socle de l'action en justice sur la question envi- ronnementale car le niveau de revenu ne peut pas en être un motif (voir Pastor, 2007)7. Une fois ce cadre général posé, il s'agit de pouvoir repérer les inégalités environnementales. On peut en distinguer quatre types (Laurent, 2011) : — Les inégalités d'exposition et d'accès : cette catégorie désigne l'inégale répartition de la qualité de l'environnement entre les individus et les groupes. Définition négative (l'exposition à des impacts environnementaux néfastes) ou positive (l'accès à des aménités environnementales telles que les espaces verts et les paysages). Dans cette catégorie d'inégalités sont inclus la vulnérabilité aux catastrophes social-écologiques et le risque d'effet cumulatif des inégalités sociales et environne- 7. Pastor (2007).
- 106. 104 Éloi Laurent mentales – les inégalités environnementales n'étant ni indépendantes les unes des autres ni indépendantes des inégalités sociales (revenu, statut social, etc.) ; — Les inégalités distributives des politiques environnementales : il s'agit de l'inégal effet des politiques environnementales selon la catégorie sociale, notamment l'inégale répartition des effets des politiques fiscales ou réglementaires entre les individus et les groupes, selon leur place dans l'échelle des revenus ; — Les inégalités d'impact environnemental : les différentes catégo- ries sociales n'ont pas le même impact sur l'environnement. Certains chercheurs qualifient cette catégorie « d'inégalités écologiques » (voir Emelianoff, 2006) ; — Les inégalités de participation aux politiques publiques : il s'agit de l'accès inégal à la définition des politiques environnemen- tales qui déterminent les choix touchant à l'environnement des individus. Les travaux menés par Patrick Morency et ses co-auteurs à la Direction de la santé publique de Montréal montrent bien comment certaines de ces inégalités environnementales, en parti- culier celles qui ont trait à l'exposition au risque, s'inscrivent dans l'espace urbain (cf. Annexe I). Le cas de la précarité énergétique8 va nous permettre d'incarner la question des inégalités environnementales en Europe et de montrer en quoi une approche européenne de la justice environne- mentale pourrait consister. 2. Le cas de la précarité énergétique La précarité énergétique (ou pauvreté énergétique) est un des fléaux majeurs auxquels sont soumises les populations des pays en développement : un rapport récent de l'Agence internationale de l'énergie (AIE, 2010) estime à 1,4 milliards le nombre de personnes sans accès à l'électricité (soit une personne sur cinq dans le monde, la proportion atteignant 85 % parmi les populations rurales) et à 2,7 milliards le nombre de personnes qui dépendent de la biomasse pour leurs besoins énergétiques. 8. Pour d'autres illustrations, voir Laurent (2011 b).
- 107. Pour une justice environnementale européenne 105 Mais les enjeux de justice environnementale concernent autant les inégalités entre pays riches et pauvres qu'entre individus riches et pauvres au sein de tous les pays et la précarité énergétique ne fait pas exception. Sans exagérer, on peut considérer que celle-ci est en train de devenir une question sociale majeure pour les pays déve- loppés et notamment pour ceux de l'Union européenne, dont la dépendance à l'égard d'énergies fossiles importées de plus en plus coûteuses n'a fait que se renforcer depuis deux décennies (le taux de dépendance énergétique des pays membres de l'Union euro- péenne a augmenté en moyenne d'environ dix points de pourcentage ces quinze dernières années pour atteindre 53 % en 2007, dont 82 % pour le pétrole et 60 % pour le gaz, qui représen- tent à eux deux 60 % de toute l'énergie consommée dans l'UE) . Les inégalités énergétiques au sein des pays européens pren- nent donc désormais le visage de la précarité énergétique (appelée « fuel poverty » dans le monde anglo-saxon), véritable bombe sociale à retardement dès lors qu'elle dépend de la combinaison de trois facteurs qui s'aggravent dans la période actuelle : la faiblesse du revenu, de mauvaises conditions de logement et des prix élevés de l'énergie. « La spirale de la précarité énergétique » remarque un rapport français récent, « outre son origine financière, se renforce à partir d'un second point d'appui important : un logement en mauvais état et mal chauffé se dégrade, devenant de plus en plus difficile et onéreux à chauffer, entraînant plus de difficultés sanitaires et sociales pour l'occupant, etc. »9. Un adulte européen passant en moyenne 12 heures dans son logement, le lien entre précarité énergétique, morbidité et morta- lité apparaît évident (et il est bien établi empiriquement, notamment par des études britanniques10), ce qui explique que l'Organisation mondiale de la santé se soit intéressée précocement à ce sujet (pour une étude récente, voir WHO, 2007). Si l'enjeu social que représente la précarité énergétique en Europe gagne en visibilité, il ne gagne pour autant pas en lisibilité 9. Philippe Pelletier et al. (2009). 10. La surmortalité hivernale liée à la précarité énergétique se situerait entre 20 000 et 50 000 morts en excès par an, essentiellement d'origine cardiovasculaire (Wilkinson et al., 2004 cité par Ezratty, 2009).
- 108. 106 Éloi Laurent et en cohérence : la Commission européenne (2010) remarque qu'il n'existe pas aujourd'hui parmi les pays de l'UE de consensus sur la notion de précarité énergétique ni sur une définition opératoire. Cette hétérogénéité n'est pas problématique en soi : les différences de définition peuvent refléter des contextes nationaux eux-mêmes divers et il importe pour l'efficacité des politiques publiques que l'un et l'autre correspondent. Mais ces écarts entre pays européens sont surtout le signe d'un retard pris par certains, tandis que d'autres font figure de pionniers tant en matière de définition que de disponibilité de données se rapportant à la précarité énergétique (tableau 1). La situation respective du Royaume-Uni et de la France illustre bien cet état de fait. Tableau 1. Existence de données officielles relatives à la précarité énergétique dans les trois plus grands pays de l'UE France Allemagne Royaume-Uni Efficacité énergétique des logements Oui Oui Oui Surmortalité hivernale Non Non Oui Sur-morbidité hivernale Non Non Non Définition de la précarité énergétique Non Non Oui Nombre ou pourcentage de ménages Non Non Oui affectés par la précarité énergétique Nombre ou pourcentage de ménages Non Non Non déconnectés des réseaux d’énergie Source : WHO, 2007. 3. Le Royaume-Uni : l'explosion de la fuel poverty Au Royaume-Uni, où les travaux sur la précarité énergétique ont commencé dès le début des années 199011, un ménage est consi- déré comme en situation de « pauvreté énergétique » (fuel poverty) si son ratio de pauvreté énergétique12 dépasse 0,1, autrement dit s'il dépense plus de 10 % de son revenu pour maintenir un « niveau adéquat de chaleur » dans son logement, soit une pièce à vivre à 21 degrés et les autres pièces de son logement à 18 degrés (on inclut le coût en énergie du chauffage de l'eau et de l'éclairage). 11. Voir par exemple Boardman (1991). 12. Le ratio de pauvreté énergétique britannique est calculé selon la formule : ratio de pauvreté énergétique = coûts de l'énergie (usage requis pour une chaleur adéquate × prix)/ revenu.
- 109. Pour une justice environnementale européenne 107 Il s'agit de la définition la plus précise de la pauvreté énergétique qui existe à ce jour dans l'Union européenne et elle dépend de l'efficacité énergétique du logement, du coût de l'énergie et du revenu du ménage. Il y aurait en 2009, selon ce mode de calcul, 4 millions de ménages pauvres en énergie au Royaume-Uni (soit 18,4 % des ménages). Depuis 2003, la précarité énergétique a littéralement explosé au Royaume-Uni. Après être descendu à 1,2 millions en 2003, le nombre de ménages en situation de pauvreté énergétique a été multiplié par un facteur 3, la proportion de ménages pauvres en énergie passant de 5,9 à 18,4 % (graphique 1). Graphique 1. Précarité énergétique au Royaume-Uni, 2003-2009 4 500 20 N b de m énages pauv res en énergie (en m illiers , éch. gauche) 4 000 18 % de m énages pauv res en énergie (éch. dro ite) 3 500 16 14 3 000 12 2 500 10 2 000 8 1 500 6 1 000 4 500 2 0 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Source : UK Department of Energy and Climate Change. Sur l'échelle des revenus, si la proportion de ménages pauvres en énergie a augmenté pour tous les déciles, elle atteint désormais 85 % pour le premier décile, 50 % pour le deuxième et 26 % pour le troi- sième (tableau 2). Le gouvernement britannique attribue cette évolu- tion principalement au doublement de l'indice des prix de l'énergie domestique de 2003 à 2009 qui ont largement surpassé l'effet de l'amélioration de l'efficacité énergétique acquise entre 1996 et 2003. Le Royaume-Uni a reconnu la nécessité de lutter contre la pauvreté énergétique dès 2000, en mettant notamment en place le programme « Warm Front » qui a pour but d'accorder des prêts (limités à 3 500 £ pour les installations au gaz et 6 000 £ pour le
- 110. 108 Éloi Laurent pétrole et les autres sources d'énergie) à des ménages modestes pour améliorer l'isolation de leur logement et l'efficacité de leur système de chauffage (2 millions de ménages en ont bénéficié depuis 2000 et 235 000 foyers étaient concernés en 2008-2009, au total 20 milliards de £ ont été dépensées pour les différents programmes de lutte contre la pauvreté énergétique). Tableau 2. Évolution de la proportion de ménages pauvres en énergie au Royaume-Uni pour les trois premiers déciles de revenu de 2003 à 2009 2003 42,1 2004 43,2 2005 48,1 1er décile 2006 68,1 2007 73,9 2008 77,4 2009 85,2 2003 9,8 2004 9,1 2005 12 2e décile 2006 25,9 2007 32,2 2008 40,5 2009 50 2003 4,6 2004 4,3 2005 6,2 3e décile 2006 12,4 2007 14,1 2008 18,1 2009 25,9 Source : UK Department of Energy and Climate Change. 4. Inégalités et précarité énergétiques en France Selon les données issues des comptes nationaux de l'INSEE, la part de la consommation des ménages consacrée à l'énergie a en apparence peu évolué depuis quatre décennies : elle est aujourd'hui ce qu'elle était en 1974. Elle avait augmenté pour atteindre 9,1 % avec le premier choc pétrolier, puis 11,8 % en 1985 après le second, elle chute avec le contre-choc pétrolier entre 1986 et 1989, demeure autour de 9 % ensuite pour s'établir finalement à 8,9 % en 2008 (graphique 2).
- 111. Pour une justice environnementale européenne 109 Graphique 2. Taux d'effort énergétique moyen (part de l'énergie dans la consommation en moyenne) pour la population française, 1970-2008, en % 12 11,5 11 10,5 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 70 72 74 76 78 80 82 84 86 988 990 992 994 996 998 000 002 004 06 08 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1 1 1 1 1 1 2 2 2 20 20 Source données : INSEE, Comptes nationaux. En réalité, les inégalités énergétiques se sont creusées en France depuis vingt ans. L'INSEE note à ce sujet que « le rapport entre l'effort énergétique des 20 % des ménages les plus pauvres et celui des 20 % les plus aisés est passé de 1,22 en 1985 à 1,36 en 2006 »13. L'effort énergétique diffère ainsi sensiblement aujourd'hui entre le centre des zones urbaines et leur périphérie d'une part, et entre ménages riches et modestes de l'autre. Ce dernier écart s'explique surtout par le facteur logement : l'effort énergétique consacré au logement des 20 % des ménages les plus modestes en France est de 40 % supérieur à celui des ménages les plus aisés (graphique 3). La loi du 12 juillet 2010 dite « Grenelle 2 » reprend la définition de la précarité énergétique proposée par le rapport du groupe de travail du Plan Bâtiment Grenelle publié en 2009 : « Est en situa- tion de précarité énergétique… une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'habitat ». 13. L'INSEE ajoute que « les progrès énergétiques ont davantage profité aux ménages aisés pour lesquels le poids de la facture énergétique dans la consommation a baissé d'un tiers depuis 1985, contre un quart pour les ménages les plus pauvres ».
- 112. 110 Éloi Laurent En France, le groupe d'experts précité a estimé à 13 % le nombre de ménages dans cette situation, soit environ 3,4 millions de ménages, soit encore près de 8 millions de personnes. En matière de politiques publiques, les « Fonds sociaux d'aide aux travaux de maîtrise de l'énergie » fonctionnent, avec le concours de l'ADEME, selon la même logique que le programme britannique, mais sont insuffisamment développés au regard des besoins. Le ministère de l'Écologie et du Développement durable a néanmoins relancé cet axe des politiques publiques en prenant en janvier 2010 un « engagement national contre la précarité énergétique ». et un observatoire de la précarité énergétique a récemment été installé. Graphique 3. Taux d'effort énergétique moyen (part moyenne de l'énergie dans la consommation) par quintile de revenu (Q5 = 20 % les plus riches), 2006, en % 10 T rans po rt 9 Lo gem ent 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Source données : INSEE, Enquête Budget des ménages. Même si ce nouveau front de l'inégalité sociale fait désormais l'objet en France d'une reconnaissance par les pouvoirs publics (dix ans après le Royaume-Uni), les politiques publiques ne sont en l'état ni adaptées à l'ampleur du problème, ni même coordonnées. Les aides financières (au titre des aides à l'énergie du Fonds de soli- darité logement) ne concerneraient en 2008 que 306 000 familles. La rénovation thermique des logements mise en chantier par le Grenelle est loin du compte (le fonds national d'aide à la rénova-
- 113. Pour une justice environnementale européenne 111 tion thermique des logements privés géré par l'Agence nationale de l'habitat vise 300 000 logements de propriétaires occupants modestes et très modestes d'ici à 2017 et « l'éco-prêt logement social », dont l'objet est la rénovation thermique du parc de loge- ments sociaux les plus consommateurs en énergie, concernent 800 000 « logements énergivores »). Enfin, les tarifs sociaux de l'énergie sont mal connus des bénéficiaires potentiels (En 2009, 940 000 foyers ont bénéficié de ces tarifs pour l'électricité alors que 2 millions sont éligibles et 298 000 en ont bénéficié pour le gaz alors qu'un million sont éligibles). Beaucoup reste donc à faire en France pour lutter contre ce fléau social-écologique dont on commence seulement à prendre la mesure. 5. Quelle politique européenne ? 5.1. La question des indicateurs communs Pour le programme de recherche European fuel Poverty and Energy Efficiency (EPEE, 2005), une définition opératoire au niveau de l'Union européenne consisterait à définir « la précarité énergé- tique comme [touchant] un foyer qui éprouve des difficultés, voire se trouve dans l'impossibilité, de chauffer correctement son loge- ment à un prix raisonnable qui dépend de ses revenus ». La Commission européenne (2010) propose pour sa part une méthode quantitative à partir des données Household Budget Survey (HBS) d'Eurostat. Il s'agit de comptabiliser pour les diffé- rents pays de l'UE le nombre de ménages qui dépensent davantage qu'un niveau donné de leur revenu en matière d'énergie, générale- ment le double de la moyenne nationale. On obtient ainsi un indicateur de « proportion des ménages dépensant une part consi- dérable de leur revenu en énergie », comparable entre les différents pays de l'UE (graphique 4). Selon ces estimations14, il y aurait 27 millions de ménages euro- péens (65 millions d'individus) dépensant de l'ordre du double de la moyenne du pays dans lequel ils résident pour leur approvision- nement en énergie, soit en moyenne 13 % des ménages des États 14. Qui fixent entre 7 % et 8 % la proportion en moyenne des dépenses en énergie des ménages européens.
- 114. 112 Éloi Laurent membres de l'Union européenne15. La France se situe au-dessus de cette moyenne (à 16 %, soit également au-delà du chiffre de 13 % calculé par Pelletier et al. 2009). Le Comité économique et social européen (2011) a récemment lui aussi proposé trois périmètres possibles de la question de la précarité énergétique dans l'Union européenne : l'incapacité des ménages à maintenir leur logement bien chauffé (qui concernerait 21 % des ménages de l'UE-27 selon les données Eurostat), le pour- centage de la population en retard dans le paiement de ses factures d'énergie (7 % des ménages de l'UE-27 en 2007) ; et enfin le nombre de logements avec des fuites, des fissures ou d'autres problèmes affectant l'isolation du bâtiment (18 % des ménages dans l'UE-25 en 2007, selon l'enquête EU-SILC de 2007). Graphique 4. Estimation de la proportion des ménages dépensant une part considérable de leur revenu en énergie dans les pays de l'UE (en %) 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 CZ E K LU IR L IT E PT T FR MA Y BE PL AT N V LIT RO DK L ES BG GR HO L RU 27 UE I L F SU LE AL SL GR C N SL Source : Commission européenne. 15. Une autre méthode proposée par la Commission européenne consiste à calculer le nombre de ménages éprouvant des difficultés à régler leur facture d'énergie. Selon cette méthode, la proportion tombe à 8 % en moyenne.
- 115. Pour une justice environnementale européenne 113 5.2. La question des politiques communes Comme le remarquent Bouzarovski, Sarlamanov, Petrova (2011), le terme de pauvreté énergétique a fait son entrée dans le vocabulaire des institutions européennes à l'occasion des débats entourant l’adoption du troisième paquet énergie, les Directives 2009/72/EC et 2009/73/EC reconnaissant « un problème croissant de pauvreté énergétique » dans l'Union européenne et avançant la notion de « consommateurs vulnérables » du marché de l'énergie. Mais, d'une part, le périmètre de la notion de pauvreté énergé- tique de ces textes est problématique : comme le reconnaît la Commission européenne (2010), les sources d'énergie visées par les instances européennes ne sont que celles du marché unique (élec- tricité et gaz) à l'exclusion des produits pétroliers, du charbon et sources alternatives. D'autre part, en l'état actuel de sa réflexion, la Commission européenne ne juge pas utile d'approfondir le rappro- chement entre États européens ou le développement de politiques communes spécifiques pour répondre à l'urgence de la précarité ou pauvreté énergétique et s'en tient à des recommandations géné- rales comme la création d'instances de protection du consommateur (Commission européenne, 2010). Le Comité économique et social européen (CESE, 2010) va plus loin et en appelle à une approche plus intégrée et cohérente entre États membres. Il remarque que de nombreux États de l'UE ne répondent pas au défi de la précarité énergétique faute d'obliga- tions légales et d'approche commune de la question. Le CESE recommande ainsi d'abord à l'UE d'adopter la définition de l'OMS du chauffage adéquat (21 degrés C dans la salle de séjour et 18 degrés C dans les autres pièces). Il propose également de déter- miner des méthodes de mesures cohérentes de sorte que « l'évaluation la plus rigoureuse possible puisse être faite de la situation de pauvreté énergétique en Europe ». Par ailleurs, le comité recommande la création d'un Centre européen de suivi de la pauvreté énergétique, chargé notamment d'évaluer les pratiques des États membres et d'identifier parmi elles les meilleures politiques publiques mais aussi de conduire « une évaluation objective et précise des effets de la libéralisation du marché de l'énergie sur les consommateurs vulnérables ». Enfin, l'avis du CESE insiste sur l'urgence du problème compte tenu de
- 116. 114 Éloi Laurent l'augmentation du prix de l'énergie et du ralentissement écono- mique récent. Il souligne à cet égard que « la réaction des États membres a été inadéquate. À titre d'exemple, malgré l'obligation découlant des directives relatives au marché commun sur le gaz et l'électricité (2003/54/CE et 2009/72/CE), seulement 10 des 27 États membres ont mis en place des tarifs sociaux pour les consomma- teurs vulnérables ». L'enjeu de la précarité ou de la pauvreté énergétique touche en effet directement deux questions centrales pour l'Union euro- péenne. La première a trait à l'ouverture du marché de l'énergie à la concurrence et à ses effets potentiellement néfastes sur les ménages les plus vulnérables socialement. Il convient d'évaluer précisément cet impact et le cas échéant d’y remédier. Elle est en second lieu étroitement liée à la question des inégalités sociales liée à la lutte contre le changement climatique et à la taxation de l'énergie que celle-ci implique de développer. Harmoniser les efforts au plan européen pour développer une véritable politique sociale clima- tique permettrait notamment de contourner l'exigence de l'unanimité en matière fiscale16. 6. Conclusion : de la précarité énergétique à la précarité écologique La reconnaissance de la notion de précarité énergétique ne fait que commencer dans l'Union européenne, ce qui souligne le retard plus général pris par la région sur les questions d'inégalités envi- ronnementales, alors même que les États membres de l'UE sont historiquement attachés à la justice sociale et à l'État providence. Il faut non seulement développer l'analyse et renforcer les poli- tiques publiques en la matière, mais on pourrait en outre étendre cette logique de pauvreté ou de précarité énergétique au coût du transport et à celui de l'approvisionnement en eau : on calculerait et on appliquerait alors des seuils de « pauvreté écologique » (ou de « précarité écologique ») à partir desquels on pourrait prévoir 16. Bouzarovski, Sarlamanov, Petrova (2011) notent cependant qu'un certain nombre de textes européens traitent indirectement de la question, notamment les Directive 2010/31/EU, 2010/ 30/EU et 2006/32/EC portant respectivement sur la performance énergétique des bâtiments, l'étiquetage et les standards en matière de consommation d'énergie et l'efficacité énergétique et les services énergétiques.
- 117. Pour une justice environnementale européenne 115 d'instituer de nouveaux types de minima sociaux ou de moduler les minima et tarifs existants. C'est ainsi que l'État providence euro- péen s'adaptera aux nouveaux défis sociaux-écologiques qui se posent désormais à lui. Références bibliographiques Agence Internationale de l'énergie, 2010, Energy Poverty: How to make modern energy access universal, World Energy Outlook, IEA. Boardman B., 1991, Fuel poverty: from cold homes to affordable warmth, London : Belhaven Press. Bouzarovski S., R. Sarlamanov et S. Petrova, 2011, « The Governance of Energy Poverty in Southeastern Europe », Europe du Sud-Est, n° 4, IFRI, mars. Comité économique et social européen, 2011, « Opinion of the European Economic and Social Committee on 'Energy poverty in the context of liberalisation and the economic crisis' (exploratory opinion) », Official Journal of the European Union, C 44/53, 11.2.2011. Commission européenne, 2010, Commission Staff Working Paper: An Energy Policy for Consumers, Brussels, novembre. Dougherty G., B. Plesset et R. Wilkins, 1990, « Social Class and the Occur- rence of Traffic Injuries and Deaths in Urban Children », Can J Public Health, 81: 204-209. Dumbaugh E. et R. Rae, 2009, « Safe Urban Form: Revisiting the Rela- tionship Between Community Design and Traffic Safety », Journal of the American Planning Association, 75: 309-329. European Fuel Poverty et Energy Efficiency (EPEE), 2005, Diagnosis of causes and consequences of fuel poverty in Belgium, France, Italy, Spain and United Kingdom. EPEE project WP2-Deliverable 5. Ewing R. et E. Dumbaugh, 2009, « The Built Environment and Traffic Safety: A Review of Empirical Evidence », Journal of Planning Literature, 23: 347-367. Ezratty V., 2009, « Précarité énergétique et Santé : 'To heat or to eat ' ? », Environnement, Risques et Santé Vol. 8, n° 1, janv.-fév. Federal Highway Administration FHWA, 2004, Signalized Intersections: Informational Guide. Report No. FHWA-HRT-04-091. U.S. Department of Transportation. Hamel D. et R. Pampalon, 2002, Trauma and deprivation in Quebec. Québec : Institut national de santé publique du Québec. Harper K., T. Steger et R. Filcak, 2009, « Environmental justice and Roma communities in Central and Eastern Europe », Environmental Policy and Governance, 19: 251-268.
- 118. 116 Éloi Laurent Laflamme L., S. Burrows et M. Hasselberg, 2009, Socioeconomic differences in injury risks; A review of findings and a discussion of potential countermea- sures, World Health Organization, 136 p. Laigle L., 2006, Les inégalités écologiques de la ville : caractérisation des situa- tionset de l'action publique, Rapport final, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, Paris. Laurent É., 2011a, Social-écologie, Flammarion. Laurent É., 2011b, « Issues in environmental justice within the European Union », Ecological Economics, Volume 70, Issue 11, 15 September 2011, Pages 1846-1853. doi:10.1016/j.ecolecon. 2011.06.025. Lyon, C. et B. Persaud, 2002, « Pedestrian Collision Prediction Models for Urban Intersections », Transportation Research Record, 1818: 102-107. McConnell J., 2002, « Speech of 18 February 2002 given at Our Dynamic Earth », accessible en ligne http://www.scotland.gov.uk/News/News- Extras/57 Miranda-Moreno LF, Morency P, Geneidy A. 2011, “The link between built environment, pedestrian activity and pedestrian-vehicle collision occurrence at signalized intersections”. Accid Anal Prev, 2011 Sep;43(5):1624-34. Morency C., 1998, Traffic volume estimates for Montreal hierarchical street network, derived from the Montreal 1998 Origin-Destination (O-D) survey. Unpublished data. Pastor M., 2007, « Environmental Justice: Reflections from the United States », in James K. Boyce, Sunita Narain, and Elizabeth A. Stanton, Editors, Reclaiming Nature: Environmental Justice and Ecological Restora- tion. London: Anthem Press. Pelletier P. et al., 2009, Plan Bâtiment Grenelle – Groupe de travail Précarité énergétique, ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la mer, décembre. Steger T. et R. Filcak, 2008, « Articulating the Basis for Promoting Environ- mental Justice in Central and Eastern Europe », Environmental Justice, mars, Vol. 1, n° 1: 49-53. Viel J.-F., M. Hägi, E. Upegui, L. Laurian, 2010, « Environmental justice in a French industrial region: Are polluting industrial facilities equally distributed? », Health and Place, 257-262. Walker G., K. Burningham, J. Fielding, G.Smith, D. Thrush et H.Fay, 2006, Addressing Environmental Inequalities: Flood Risk, Science Report: SC020061/SR1, Environment Agency, Bristol. Wier M., J. Weintraub, E. H. Humphreys,, E. Seto et R. Bhatia, 2009, « An area-level model of vehicle-pedestrian injury collisions with implica- tions for land use and transportation planning », Accid Anal Prev, 41: 137-145.
- 119. Pour une justice environnementale européenne 117 Wilkinson P., S. Pattenden, B. Armstrong et al, 2004, Vulnerability to winter mortality in elderly people in Britain: population-based study, BMJ; 329 : 647. World Health Organization Regional Office for Europe, 2007, Housing, Energy and Thermal Comfort, A review of 10 countries within the WHO European Region, World Health Organization.
- 120. 118 Éloi Laurent ANNEXE Contribution des facteurs environnementaux aux inégalités socio-économiques observées dans la distribution géographique des blessés de la route à Montréal par Patrick Morency * CONTEXTE. Depuis longtemps, au Québec, les taux de personnes blessées à la suite d’une collision routière ont été associés au revenu moyen des ménages et à la pauvreté matérielle (Dougherty, 1990 ; Hamel, 2002). La position relative occupée dans la société peut influencer l’exposition au risque de collision et le risque de blessures associé à une telle exposition (Laflamme, 2009). La hiérarchie routière et le nombre d’approches aux intersec- tions représentent deux dimensions distinctes du risque de collision associé aux aménagements routiers. Les routes majeures (« artères ») comptent généralement davantage de voies de circula- tion et des chaussées plus larges, deux caractéristiques fortement associées à la vitesse des véhicules (Ewing, 2009). Les intersections constituées de quatre branches offrent davantage d’opportunités de collision, de points de conflit potentiels entre les usagers de la route, que les intersections en forme de T ou que les ronds-points (FHWA, 2004). Les artères et les intersections à quatre branches ont été associées à un risque accru de collisions et de blessures, pour les piétons et pour l’ensemble des usagers de la route (Dumbaugh, 2009 ; Wier, 2009 ; Ewing, 2009 ; Lyon, 2002 ; Miranda, 2010). Nos recherches visent à explorer le lien entre la position socioé- conomique des quartiers et les aménagements routiers associés au risque de collisions et de blessures. Cette brève annexe décrit sommairement l’association entre, d’une part, la position socioéco- nomique des arrondissements montréalais et, d’autre part, le nombre de personnes blessées aux intersections et les caractéris- tiques des intersections et des arrondissements habituellement associées à la distribution géographique des blessés de la route en milieu urbain. * Patrick Morency, MD, PhD. Médecin spécialiste en santé communautaire. Direction de santé publique de Montréal, Équipe Environnement urbain et santé, 1301, rue Sherbrooke Est, Montréal (QUE) H2L 1M3. Tél : (514) 528-2400 poste 3327. [email protected]
- 121. Pour une justice environnementale européenne 119 MÉTHODOLOGIE. Notre perspective conceptuelle est novatrice car elle adopte une approche populationnelle, incluant l’ensemble des intersections de l’île de Montréal. Les données utilisées proviennent des services ambulanciers d’Urgences-santé pour les années 1999 à 2003 (nombre et localisation des blessés de la route), des systèmes d’information géographique décrivant le réseau routier (hiérarchie routière, nombre de branches aux intersec- tions), de l’enquête origine-destination de 1998 (estimés du volume de circulation automobile; Morency, 2006) et du recense- ment canadien de 2001 (densité de population, revenu des ménages, moyen de transport utilisé pour se rendre au travail). Les analyses présentées se limitent à la description des caractéristiques des 17 636 intersections et des 27 arrondissements, en fonction de la position socio-économique des arrondissements. RÉSULTATS. Aux intersections des arrondissements du premier tercile de revenu (plus pauvres), il y a davantage de circulation automobile (2,5 fois plus) et d’artères (2,4 fois plus), et une quatrième branche est plus fréquente (2,3 fois plus) (tableau). Dans les arrondissements les plus pauvres, la densité de popula- tion et les proportions de travailleurs qui marchent ou utilisent le vélo ou les transports collectifs pour se rendre au travail tendent à être plus élevées, ce qui indique – indirectement – que le nombre de piétons et de cyclistes est plus élevé dans les rues de ces arrondis- sements. Par contre, l’utilisation de la voiture est moins fréquente chez les travailleurs habitant les arrondissements les plus pauvres. DISCUSSION. Les résultats de nos recherches, seulement esquissés dans cette annexe (voir Miranda-Moreno LF, Morency P, Geneidy A., 2011 pour une analyse complète), confirment l’expo- sition différentielle des quartiers au risque de collisions et de blessures en fonction de la position socioéconomique. Dans les quartiers à faible revenu (premier tercile), les indicateurs indirects suggèrent qu’il y a davantage de piétons et de cyclistes. De plus, on y observe davantage de circulation automobile, d’artères et d’inter- sections à quatre branches, ce qui suggère un risque accru de collisions et de blessures. Il est plausible que les environnements, et plus spécifiquement les aménagements routiers, contribuent aux inégalités observées.
- 122. 120 Éloi Laurent Tableau Annexe. Caractéristiques des intersections (n=17 636) et des arrondissements de l’île de Montréal (n=27), en fonction de la position socioéconomique des arrondissements Revenu moyen des ménages Tous les (terciles) Arrondis- Ratio sements Pauvre Moyen Riche p Pauvres Riches Intersections (n) 17 636 6 478 6 744 4 414 Nombre moyen de blessés à 100 intersections Piétons, 17,6 27,7 16,3 4,8 ** 5,7 Intersections Cyclistes 15,2 23,1 14,5 4,8 ** 4,8 Occupants de véhicules à moteur 80,7 120,5 75,2 30,7 ** 3,9 Traffic à l’intersection (moyenne) 4 825 6 257 4 985 2 480 ** 2,5 Traffic à l’intersection (médiane) 1 088 1 421 1 259 476 3,0 Présence de route majeure (en %) 18 23 18 9 ** 2,4 e 41 54 39 24 ** 2,3 Présence d’un 4 branches (en %) Arrondissements (n) 9 9 9 Revenu moyen des familles 62 308$ 40 173 52 651 94 100$ ** 0,4 Densité de population (/km2) 4 422 6 897 3 300 3 071 * 2,2 Arrondissements Population active rapportant aller au travail… 7,8 ... à pied (en %) 9,0 9,0 5,3 NS 1,7 7,8 1,3 ... à vélo (en %) 2,0 1,0 1,0 NS 2,1 1,3 ... en transport en commun (en %) 27,7 36,8 27,9 18,2 ** 2,0 ... en voiture (en %) 62,4 51,3 61,4 74,5 ** 0,7 Khi carré pour tendance linéaire : * p<0.01 ** p<0.001 Sources : Urgences-santé, 1999-2003. C Morency, enquête O-D 1998. Géobase de la Ville de Montréal. Recensement canadien 2001.
- 123. Part. 2 ÉCONOMIE DU CLIMAT Une évaluation macroéconomique et sectorielle de la fiscalité carbone en France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Gaël Callonnec, Frédéric Reynès et Yasser Yeddir-Tamsamani Pourquoi l’Europe a besoin d’une banque centrale du carbone. . . . 155 Christian de Perthuis L’ajustement aux frontières, condition de la crédibilité d’une politique européenne du climat ambitieuse . . . . . . . . . . . . . 177 Olivier Godard Revue de l’OFCE / Débats et politiques – 120 (2011)
- 125. UNE ÉVALUATION MACROÉCONOMIQUE ET SECTORIELLE DE LA FISCALITÉ CARBONE EN FRANCE Gaël Callonnec* ADEME, Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie Frédéric Reynès IVM, Institute for Environmental Studies, VU University Amsterdam OFCE, Observatoire français des conjonctures économiques Yasser Y. Tamsamani OFCE, Observatoire français des conjonctures économiques CERAM, Centre de recherche sur l’Afrique et la Méditerranée, EGE Rabat Cet article évalue l’impact macroéconomique et sectoriel d’une taxe carbone en France en utilisant le modèle Three-ME qui combine deux caractéristiques importantes pour cette analyse. (1) Le modèle possède une structure sectorielle détaillée avec une fine description du système fiscal français, en particulier de la fiscalité appliquée à l’énergie. (2) Il a les principales propriétés des modèles d’inspiration néo-keynésienne car il tient compte de la lenteur des processus d’ajustement des prix et des quantités. Les modèles d’équilibre général d’inspi- ration walrasienne mettent souvent en évidence les conséquences à long terme d’une taxe carbone sur l’économie mais ils négligent les effets à court et moyen terme notamment sur l’emploi et sur la compétitivité des entreprises. Or l’accep- tabilité des réformes environnementales dépend souvent de leurs répercussions sur la sphère économique et sociale à court terme. Ayant des propriétés néo- keynésiennes, Three-ME permet de mesurer ces répercussions. Nos résultats confirment sous certaines conditions la possibilité d’un double dividende économique et environnemental autant à court terme qu’à long terme. L’amélioration de la situation économique dépend néanmoins des mesures d’accompagnement mises en œuvre telles que les exonérations et les modalités de redistribution de la taxe. Il apparaît aussi que ces mesures d’accom- pagnement réduisent sensiblement l’ampleur du dividende environnemental. Mots clés : taxe carbone, modèle macroéconomique néo-keynésien, analyse sectorielle. * Les auteurs remercient Éloi Laurent et Henri Sterdyniak pour leurs remarques et leurs propositions d’amélioration de ce travail, ainsi que l’ADEME pour son support financier (convention de recherche 0910C0132). Revue de l’OFCE / Débats et politiques – 120 (2011)
- 126. 124 Gaël Callonnec, Frédéric Reynès et Yasser Y. Tamsamani E n 2007, les concertations du Grenelle de l’environnement ont confirmé la volonté des autorités françaises de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 par rapport au niveau de 1990. Pour atteindre cet objectif, le Grenelle souligne, entre autres, le rôle incitatif que pourrait jouer la fiscalité environnementale pour influencer les comportements des ménages et améliorer l’effi- cacité énergétique des processus de production. Le projet de loi sur la Contribution climat énergie (CCE), qui prévoyait d’introduire une fiscalité carbone1, était un des éléments phares issus de ces discussions. Il a été censuré par le Conseil constitutionnel au motif que l’exemption totale des secteurs soumis au marché européen de quotas de CO2 constitue une rupture de l’égalité devant l’impôt. Le Conseil considère en effet que la gratuité des allocations rend le dispositif trop peu contrai- gnant2. Le gouvernement français a finalement renoncé à soumettre un autre projet, de crainte de se heurter à l’opposition des ménages et de porter atteinte à la compétitivité française. La présente étude évalue l’impact macroéconomique et sectoriel d’une fiscalité carbone en France conforme au projet de CCE voté dans la loi de finance pour 2010. Elle apporte des éléments de réponse aux questions suivantes. Quelle serait l’effet de l’instaura- tion d’une fiscalité carbone sur le pouvoir d’achat des ménages ? Dans quelle mesure une telle réforme est susceptible de générer un double dividende, environnemental et économique ? Une taxe carbone permet-elle de concilier l’efficacité économique et la soutenabilité écologique ? Quelle ampleur de réduction des émis- sions de CO2 peut-on attendre d’une taxe carbone ? L’amélioration de la facture énergétique compense-t-elle les éventuelles dégrada- tions de compétitivité ? La taxe carbone engendre t-elle un cercle économique vertueux notamment par le transfert de chiffre 1. Le terme « fiscalité carbone » fait référence à toutes les mesures fiscales dont les taux d’imposition sont explicitement reliés aux quantités de CO2 émises par un secteur ou pour la fabrication d’un produit, ainsi que les évolutions futures de ces taux, le mode de recyclage des recettes et les éventuelles conditions de dérogations. 2. Pour plus de détails sur les raisons de la censure voir Laurent et Le Cacheux (2010).
- 127. Une évaluation macroéconomique et sectorielle de la fiscalité carbone en France 125 d’affaires des secteurs énergivores (production et distribution des énergies fossiles, transport routier, etc.) vers ceux qui combinent une faible intensité énergétique et une forte intensité en main- d’œuvre (bâtiment, construction de matériel ferroviaire, transport collectif et fluvial) ? Les mesures d’exonération sont-elles efficaces à court et long terme pour réduire les effets économiques négatifs de la taxe ? Nous utilisons le modèle Three-ME (Multi-sector Macroeco- nomic Model for the Evaluation of Environmental and Energy policy) développé conjointement par l’ADEME, l’OFCE et IVM. Three-ME semble bien adapté pour ce genre d’exercice du fait de ses propriétés néo-keynésiennes, de sa structure sectorielle détaillée et de sa fine description du système fiscal français, en particulier la fiscalité appliquée à l’énergie. Les modèles d’équilibre général d’inspiration walrasienne mettent souvent en évidence les inci- dences à long terme d’une taxe carbone sur l’économie (Bernard et Veille, 1998 ; Al Amin et al., 2009) mais ils estiment mal les réper- cussions à court et moyen terme, notamment sur l’emploi et la compétitivité des entreprises. Or les raisons mises en avant lors du refus des États-Unis d’adhérer au protocole de Kyoto ou lors de l’abandon du projet de loi de la taxe carbone en France confirment que l’acceptabilité des réformes environnementales dépend souvent de leurs répercussions sur la sphère économique et sociale à court et moyen terme. Seul un modèle ayant des caractéristiques néo-keynésiennes prenant explicitement en compte la dynamique d’ajustement à court et moyen terme permet d’évaluer l’impact à court et moyen terme d’une politique environnementale. Nos résultats suggèrent que les conséquences socio-écono- miques et environnementales d’une taxe carbone dépendent largement de l’ampleur du choc initial, de son évolution, des conditions de redistribution et des modalités d’exonération prévues. Ils confirment la possibilité d’un double dividende écono- mique et environnemental autant à court terme qu’à long terme. À court terme, l’amélioration de la situation économique dépend néanmoins des mesures d’accompagnement mises en œuvre telles que les exonérations et les modalités de redistribution de la taxe. Il apparaît aussi que ces mesures d’accompagnement réduisent sensi- blement l’ampleur du dividende environnemental. Cela illustre le dilemme auxquels les pouvoirs publics sont confrontés : d’un côté
- 128. 126 Gaël Callonnec, Frédéric Reynès et Yasser Y. Tamsamani l’efficacité à long terme, et de l’autre les coûts socio-économiques de court terme. La deuxième section présente les principales caractéristiques de Three-ME, en particulier les hypothèses importantes qui détermi- nent les effets de la taxe carbone. La troisième section décrit la mesure fiscale simulée alors que la quatrième présente les résultats concernant l’impact macroéconomique, sectoriel et environne- mental d’une telle réforme. La dernière section conclut et explicite les limites de cet exercice de simulation. 1. Le modèle Three-ME La spécification complète de Three-ME ainsi que ses principales propriétés sont détaillées dans Reynès et al. (2011). Nous présen- tons ici brièvement ses caractéristiques générales. Three-ME est un modèle macroéconomique multisectoriel d’inspiration néo-keyné- sienne. Il reprend donc les caractéristiques standards des modèles macroéconomiques unisectoriels néo-keynésiens : — le niveau de l’offre (production et importations) est déter- miné par la demande ; — les prix, rigides à court terme, sont déterminés dans un cadre de concurrence imparfaite par maximisation du profit : le prix de chaque bien s’ajuste lentement à un prix désiré qui correspond à un taux de marge sur les coûts unitaires de production. Les salaires sont déterminés selon une courbe de Phillips augmentée ; — la quantité de facteurs de production désirée est aussi déter- minée par la maximisation du profit. Du fait de coûts d’ajustement, la quantité effective de chaque facteur s’ajuste progressivement au niveau désiré ; — le taux d’intérêt est déterminé au niveau de la zone euro selon une fonction de réaction à la Taylor qui tient compte du poids de chaque pays. Comparé à la plupart des modèles d’équilibre général appliqués (MEGA) qui souvent postulent une parfaite flexibilité des prix, Three-ME a pour objectif de représenter de manière plus réaliste le fonctionnement de l’économie en tenant compte explicitement de
- 129. Une évaluation macroéconomique et sectorielle de la fiscalité carbone en France 127 l’ajustement lent des prix et des quantités, autorisant ainsi des équilibres de sous-emploi permanents ou transitoires. Par rapport à la plupart des modèles macroéconomiques d’inspi- ration néo-keynésienne de l’économie française, Three-ME a l’avantage d’être multisectoriel à un niveau relativement détaillé. Cela est important pour l’analyse de toute politique économique ayant pour objectif de faire évoluer les comportements de produc- tion et de consommation, en modifiant les prix relatifs entre secteurs et produits, comme la taxe carbone. Ainsi, Three-ME compte 24 secteurs de production et distingue explicitement cinq types de transports et quatre types d’énergie. À court et moyen terme, les propriétés de Three-ME sont large- ment déterminées par le bloc demande, en particulier par les mécanismes multiplicateur et accélérateur (investissements, consommations intermédiaires, consommations des ménages). La dynamique endogène du modèle est assurée par les équations d’accumulation (capital productif, logement, automobile), l’inertie des prix, la spécification des anticipations (adaptatives versus rationnelles), et l’ajustement des variables effectives à leur niveau désiré. Les hypothèses d’inertie et de coûts d’ajustement entraînent des écarts entre les prix et les quantités effectifs et désirés. En consé- quence, l’allocation des facteurs de production est sous-optimale. À long terme, les ajustements sont terminés, les anticipations réalisées, les quantités et les prix effectifs atteignent leur niveau optimal, déterminé par la productivité et la quantité des facteurs de production disponibles, dans la mesure des règles de politique monétaire retenues. À long terme le modèle est stable et l’économie évolue à la Solow (1956) : les variables réelles croissent au rythme du progrès technique et de la population, les variables nominales croissent au rythme de l’économie réelle plus l’inflation (elle-même déterminée par l’inflation étrangère), le taux de chômage est à son niveau d’équilibre et les prix sont ajustés au niveau qui équilibre l’offre et la demande. Three-ME distingue plusieurs mécanismes d’influence des prix sur la consommation d’énergie : les effets de substitution, de sobriété et d’efficacité. Le niveau relativement élevé de désagréga- tion est important pour saisir de manière réaliste la complexité des mécanismes de substitution entrant en jeu à la suite d’un
- 130. 128 Gaël Callonnec, Frédéric Reynès et Yasser Y. Tamsamani changement du prix relatif entre les énergies. Par exemple, une augmentation du prix du pétrole entraîne une substitution entre le pétrole et les autres énergies par deux canaux. Le premier est direct : les producteurs et les consommateurs réduisent leur consommation de pétrole au profit d’une autre énergie. Le deuxième est indirect et passe par l’augmentation du coût de production des secteurs inten- sifs en pétrole qui entraîne une substitution des consommations intermédiaires et finales en produits de ces secteurs par celles de secteurs moins intensifs. Un exemple typique est la baisse de l’utili- sation du transport routier à la suite d’une augmentation du prix du pétrole. Par ailleurs, pour surmonter la restriction imposée par des fonctions CES imbriquées, une forme flexible de la fonction de production est retenue. Par conséquent, l’élasticité de la substitu- tion n’est pas nécessairement commune entre tous les facteurs de production (travail, capital, énergie et autres consommations inter- médiaires). Cette forme flexible est également adoptée pour représenter la substituabilité entre les différentes sources d’énergie et entre les différents biens de consommation. Les choix énergétiques des ménages sont endogènes et modé- lisés de façon détaillée. Les particuliers ont la possibilité de réduire leur consommation d’énergie, soit en réalisant des travaux d’effica- cité énergétique, soit en adoptant des comportements de sobriété énergétique. Par exemple, ils peuvent choisir de baisser la tempéra- ture intérieure de leur logement ou de limiter leurs déplacements en automobile pour compenser une éventuelle hausse de leur facture énergétique. La sobriété peut conduire à une diminution du bien-être, si elle se traduit par une baisse du confort thermique ou une réduction subie de la mobilité. En revanche, dans le cas de l’efficacité, le même niveau de bien-être est atteint mais avec une quantité d’énergie plus faible. L’efficacité énergétique implique nécessairement un investissement dans une technologie plus effi- cace, par exemple l’achat d’une voiture ayant une plus faible consommation de carburant ou l’isolation du logement. Afin de modéliser au mieux l’amélioration potentielle de l’efficacité éner- gétique des parcs immobiliers et automobiles, Three-ME distingue les investissements de rénovation énergétique des autres formes de rénovation immobilière, et différencie les acquisitions de véhicules sobres (c’est-à-dire les classes énergétiques A, B et C+, qui sont
- 131. Une évaluation macroéconomique et sectorielle de la fiscalité carbone en France 129 « bonussées »3) des achats de véhicules énergivores (de classes C-, D, E, F et G). Par construction, les indices de prix dans le modèle sont calculés comme des moyennes pondérées. Ainsi, ces phénomènes d’efficacité et de sobriété diminuent le prix à la consommation, car la part de l’énergie dans la consommation diminue. Certaines études microéconomiques observent que cela pouvait conduire à un « effet rebond » (Bentzen, 2004 ; Sorrell et al., 2009). On parle d’effet rebond ou de « paradoxe de Jevons » lorsque les économies d’énergie ex-post d’un investissement en efficacité énergétique sont inférieures aux économies d’énergie espérées ex-ante parce que le consommateur utilise une partie de la réduction de sa facture éner- gétique pour augmenter sa consommation d’énergie. Les ménages à faibles revenus vivant dans des logements mal isolés sont particu- lièrement concernés car ils ont tendance à abaisser la température de chauffage, à la limite du supportable afin de maîtriser leurs dépenses énergétiques. À la suite d’un investissement d’isolation, ils privilégient souvent l’amélioration de leur confort thermique à la baisse de leur facture. Cet effet est explicitement pris en compte dans le modèle : un investissement d’efficacité énergétique réduit les prix à la consommation et augmente ainsi le revenu réel qui conduit à un niveau de consommation (en particulier énergétique) plus élevé. Enfin, il est important de mentionner que l’énergie est modé- lisée ici comme un bien de première nécessité : sa part dans le revenu diminue lorsque le revenu augmente. Formellement, cela signifie que l’élasticité entre la consommation énergétique et le revenu est inférieure à l’unité. D’après l’enquête « Budget des familles 2006 », cette élasticité, calibrée à partir des consomma- tions énergétiques des 1er et 5e quantile de revenu, est de 0,18. Cette hypothèse est particulièrement importante s’agissant de l’évolution des émissions dans le cas où la taxe carbone générerait un dividende économique. En effet, tout enrichissement écono- mique entraîne une hausse de la consommation énergétique. L’hypothèse standard d’une élasticité unitaire aurait tendance à 3. Dispositif fiscal entré en vigueur le 1er janvier 2008, le « bonus-malus » automobile octroie une subvention (un bonus) aux véhicules les moins polluants et pénalise d’une taxe (d’un malus) l’achat des voitures fortement émettrices de CO2.
- 132. 130 Gaël Callonnec, Frédéric Reynès et Yasser Y. Tamsamani sous-estimer la baisse de la consommation et donc des émissions de CO2, voire à générer une augmentation des émissions. 2. Simulation d’une taxe carbone de 20 euros par tonne de CO2 Nous supposons que la taxe carbone est introduite de façon unilatérale par la France et sans aucun ajustement aux frontières. Elle est mise en place à partir de 2012 selon les conditions prévues dans le projet de loi de finances de 20104. Nous avons cependant retenu des taux d’exonérations sectoriels différents qui pourraient ainsi échapper à la censure du Conseil constitutionnel. Et afin de mesurer séparément les effets de la taxe carbone de la tendance croissante du prix de pétrole telle qu’elle est prévue par l’Agence internationale de l’énergie, nous considérons que les prix à l’importation des énergies fossiles évoluent au rythme du taux d’inflation tendancielle. Le taux de la taxe est calculé sur la base du contenu en carbone de chaque type d’énergie et de l’usage qui en est fait (consomma- tions finales et intermédiaires, exportations) pour un prix de 20 euros par tonne de CO25. Les prix des combustibles étant diffé- renciés selon leur destination, la variation ex-ante en pourcentage du prix due à une taxe sur le contenu en CO2 sera aussi différente. Le tableau 1 fournit l’augmentation en pourcentage des prix des énergies fossiles en 2012 pour les ménages et les entreprises. La mise en place de la taxe est simulée sur la période 2012-2050 et l’évolution du taux d’imposition suit le schéma indiqué dans le rapport Quinet (2008), qui prévoit une valeur d’une tonne de CO2 à 56 euros en 2020, 100 euros en 2030, pour se stabiliser à 200 euros en 2050. Ce schéma correspond à un accroissement du taux nominal de la taxe de 14 % par an entre 2012 et 2020, de 6 % entre 2020 et 2030 et enfin de 4 % entre 2030 et 2050. 4. Pour une description détaillée de la mesure, consulter le « Rapport sur les prélèvements obligatoires et leur évolution » du projet de loi de finances pour 2010 qui y consacre un dossier entier. 5. Le projet de loi de finances 2010 prévoyait une taxe carbone sur les prix de l’énergie hors taxes correspondant à 17 €/t de CO2 , ce qui correspond à 20 €/t de CO2 appliquée à des prix TTC.
- 133. Une évaluation macroéconomique et sectorielle de la fiscalité carbone en France 131 Tableau 1. Le taux de la taxe carbone en % du prix TTC en 2012 par destination et type d’énergie * Ménages Entreprises Charbon 13 60 Pétrole 5 8 Gaz 7 14 * Ces taux sont calculés sur la base d’une valeur de 20 €/t de CO2 en 2006 en appliquant un taux d’inflation de 2 % entre 2006 et 2012. L’augmentation du prix de l’énergie des entreprises à la suite de la taxe est plus élevée du fait que les prix industriels de l’énergie sont plus bas que les prix domestiques. Source : Calcul des auteurs à partir des données de l’Observatoire de l’énergie. Une taxe carbone correspondant à 20 euros/tonne de CO2 en 2012 renchérit le prix du charbon des ménages d’environ 13 % et celui des entreprises de 60 % (tableau 1). Avec une taxe carbone qui atteint 200 euros/tonne en 2050, le prix du charbon domes- tique est multiplié par 1,63 entre 2012 et 2050 et celui destiné aux entreprises par 3,8. L’évolution de ce multiplicateur des prix pour les trois types d’énergie est donnée dans le tableau suivant : Tableau 2. Multiplicateurs des prix de l’énergie fossile à la suite de l’instauration de la taxe carbone * 2020 2030 2050 Ménages Entreprises Ménages Entreprises Ménages Entreprises Charbon 1,32 2,42 1,47 3,08 1,63 3,8 Pétrole 1,13 1,19 1,19 1,28 1,25 1,38 Gaz 1,17 1,34 1,25 1,50 1,33 1,67 * Ce sont des multiplicateurs ex ante calculés en faisant l’hypothèse que l’intensité carbone reste constante durant la période de simulation, comme si la taxe n’avait aucun effet incitatif en faveur des technologies propres. Source : Calcul des auteurs à partir des données de l’Observatoire de l’énergie. La taxe carbone a pour principal objectif de réduire les émis- sions de dioxyde de carbone et donc la demande en énergie fossile. Cela se traduit par un rétrécissement de l’assiette fiscale de la taxe, ce qui réduit le montant des recettes recyclées et l’éventuel cercle vertueux de croissance et d’emploi enclenché par le dividende économique. Dans le cas présent, l’effet d’érosion de l’assiette fiscale sur les recettes de la taxe est plus que compensé par la trajec- toire croissante du taux de la taxe. Les revenus fiscaux continuent de croître même au-delà de 2050, date à laquelle le taux réel de la CCE serait stabilisé (graphique 1).
- 134. 132 Gaël Callonnec, Frédéric Reynès et Yasser Y. Tamsamani Graphique 1. Évolution des recettes fiscales de la taxe carbone en milliards d’euros de 2012 140 P ar t des ent r epr i s es 120 P ar t des m énages T o t al des r ec et t es de l a t axe 100 80 60 40 20 0 2012 2022 2032 2042 2052 2062 2072 2082 2092 Source : modèle TRHEE-ME. Le produit de la taxe est évalué en 2012 à 8,24 milliards d’euros, dont environ 35 % est à la charge des ménages (soit 2,88 milliards) et le reste est supporté par les entreprises, notamment le tertiaire (soit 5,36 milliards). En 2050, les recettes passeraient à 50,85 milliards d’euros constants, avec une baisse de 10 points de la contribution des ménages contre une augmentation de celle des entreprises qui atteindrait 75 %. Cette altération dans la réparti- tion de la charge de la taxe entre les agents est due à la fois aux modalités de réinjection des recettes et au degré de sensibilité des ménages aux variations du prix de l’énergie fossile. Les deux tiers des recettes de la taxe étant redistribués aux entreprises (le mode précis de redistribution des recettes est décrit plus loin), leur acti- vité s’en trouve stimulée et leur compétitivité-prix renforcée, limitant ainsi l’effet direct de la taxe. Du côté des ménages, la montée du prix de l’énergie fossile les incite à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments et à recourir à des moyens de transport plus sobres (soit par substitution avec les transports collectifs ou par plus d’investissements dans l’automobile propre), ce qui stabi- lise à terme leurs efforts de réduction des émissions de CO2 et donc leur contribution aux recettes totales de la taxe. Au cours des premières années qui suivent l’introduction de la taxe, le taux de croissance des recettes est nettement plus élevé que
- 135. Une évaluation macroéconomique et sectorielle de la fiscalité carbone en France 133 celui du revenu national, avec un taux qui se situe autour de 11,5 % jusqu’en 2020, puis à 4,5 % entre 2020 et 2030, et à 2,6 % jusqu’en 2050. Au-delà de 2050, le taux de croissance du produit de la taxe rejoint progressivement le taux de croissance tendanciel de l’économie. Concernant la répartition des recettes de la taxe entre les trois énergies fossiles (graphique 2), les produits pétroliers arrivent en tête avec une part de 79 %, suivi du gaz à 19 % et du charbon à 2 %. En 2050, la contribution du charbon s’annule et celle des produits pétroliers passe à 84 % et celle du gaz baisse à 16 %. Graphique 2. Le poids par source d’énergie dans les recettes totales de la taxe en 2012 et 2050 2012 2050 Charbon 2 % Gaz Gaz 19 % 16 % Pétrole Pétrole 79 % 84 % Source : Modèle Three-ME, calcul des auteurs. Conformément aux ambitions du projet initial qui visait la neutralité budgétaire, nous supposons que l’intégralité des recettes de la taxe carbone est réinjectée dans le circuit économique. Plusieurs modalités de recyclage ont été traitées dans la littérature comme condition préalable à l’obtention d’un « double divi- dende » (cf. encadré) selon la nature des distorsions fiscales spécifiques à chaque économie. Certains travaux de modélisation des effets d’une taxe environnementale sur l’économie américaine ont donné la priorité en matière de recyclage des recettes à la réduction des prélèvements sur le capital (Shackleton et al., 1993), tandis qu’en Europe et en France en particulier, l’allègement des coûts du travail a été privilégié par différentes études (CGP, 1993 ; Beaumais et Zagamé, 1993 ; Detemmerman et al., 1993 ; Beaumais et Godard, 1994 ; Chiroleu-Assouline et Fodha, 2011).
- 136. 134 Gaël Callonnec, Frédéric Reynès et Yasser Y. Tamsamani Dans notre simulation de la fiscalité carbone, le recyclage des recettes tient en trois volets : i) la baisse du coût du travail d’un tiers des sommes récoltées, ii) le versement direct aux ménages du deuxième tiers, iii) la répartition du reliquat entre les secteurs du transport ferroviaire et du bâtiment sous forme d’une subvention d’exploitation6. Tableau 3. Les taux d’exonération de la taxe carbone par secteur Index Secteurs Taux d'exonération 1 Agriculture, sylviculture et pêche 90 2 Industrie agro-alimentaire 56 3 Automobile 21 4 Fabrication de verre et d’articles en verre 100 5 Fabrication de produits céramiques 100 6 Papier et carton 100 7 Industrie chimique minérale 81 8 Industrie chimique organique 98 9 Transformation des matières plastiques 8 10 Sidérurgie et première transformation de métaux ferreux 100 11 Production de métaux non ferreux 53 12 Autres secteurs industriels 29 13 Bâtiment et travaux publics 0 14 Transports ferroviaires 0 15 Transport routier de voyageurs 0 16 Transport routier (ou par conduites) de marchandises 0 17 Transports par eau 0 18 Transports aériens 0 19 Services marchands 0 20 Services non marchands 0 21 Extraction et agglomération de la houille (Charbon) 100 22 Raffinage de pétrole 100 23 Production et distribution d’électricité 100 24 Production et distribution de gaz 100 Source : calculs de l’ADEME à partir des données du CEREN (Centre d’études et de recherches économiques sur l’énergie). 6. Nous supposons que cette subvention finance les mesures prévues par la loi Grenelle 2 de rénovation des lignes de chemin de fer et la montée en puissance du prêt à taux zéro.
- 137. Une évaluation macroéconomique et sectorielle de la fiscalité carbone en France 135 Du côté des exonérations sectorielles, les taux retenus pour cette simulation sont calculés par l’ADEME sur la base du principe de l’exonération des entreprises soumises au marché de quotas euro- péen, des énergies fossiles non utilisées à des fins de combustibles, ou à « double usage » 7 et des émissions liées à la décarbonation 8. 3. Résultats de la simulation de la fiscalité carbone 3.1. De l’évaluation de l’impact macroéconomique… L’instauration de la taxe carbone sans redistribution des recettes ni exonération entraîne une élévation du prix de l’énergie fossile dont les effets macroéconomiques et sectoriels sont proches d’une hausse du prix du pétrole. Toutefois, à la différence de cette dernière, l’instauration de la taxe réduit le déficit public et sa prévi- sibilité renforce la capacité d’adaptation et de réaction des assujettis. Avec le dispositif décrit précédemment prévoyant des redistri- butions ciblées et des dérogations sectorielles spécifiques, les retombées macroéconomiques et sectorielles peuvent au contraire fortement différer d’un choc pétrolier. Les résultats macroécono- miques de la simulation d’une telle réforme par le modèle Three- ME sont résumés dans le tableau 4. Lors de la première année de la mise en place de la réforme, le taux d’inflation augmente de 0,07 point et la valeur ajoutée des secteurs marchands baisse de 0,08 %. Cette légère dégradation de la valeur ajoutée est due à une contraction de la production marchande (-0,09 %) plus importante que celle des consommations intermédiaires et de l’énergie qui s’ajustent avec retard à une variation du revenu. La baisse de la production provient pour sa part de la contraction des investisse- ments productifs, dont l’ampleur éradique l’impact positif de la réforme sur la consommation et l’investissement des ménages. 7. « C’est-à-dire lorsqu’ils sont utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible. Sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage », Art. 265 C I 2° du Code des douanes. 8. La décarbonation désigne les rejets du carbone contenu dans les produits minéraux non métalliques (verre, céramique, chaux, ciment et plâtre) qui s’opèrent lors de leur cuisson. Elle est indépendante du type d’énergie utilisée pour produire de la chaleur.
- 138. 136 Gaël Callonnec, Frédéric Reynès et Yasser Y. Tamsamani Tableau 4. Résultats macroéconomiques de la fiscalité carbone (en % en écart au compte central) 2012 2013 2014 2015 2020 2030 2040 2050 PIB en volume 0,34 0,59 0,80 0,96 1,67 2,35 2,55 2,66 PIB marchand 0,40 0,70 0,96 1,14 1,99 2,81 3,04 3,18 Valeur ajoutée -0,08 0,20 0,43 0,58 1,14 1,75 1,93 1,99 Production -0,08 0,03 0,16 0,27 0,71 1,22 1,40 1,44 Production marchande -0,09 0,04 0,19 0,30 0,80 1,38 1,58 1,62 Production non marchande 0,00 0,01 0,01 0,01 0,03 0,05 0,05 0,06 Consommation finale 0,10 0,21 0,32 0,43 0,84 1,19 1,30 1,45 Investissement des ménages 0,32 0,75 0,91 0,78 0,38 -0,20 -0,67 -1,01 en voiture Investissement en voiture propre 0,99 1,55 1,83 1,81 2,11 2,32 2,24 2,26 Investissement des ménages 0,11 0,54 0,71 0,60 0,49 0,53 0,35 0,02 en logement Investissement en isolation 1,31 1,98 2,36 2,43 3,55 4,99 5,48 5,85 des logements Investissement des secteurs -1,24 -0,55 0,00 0,21 0,82 1,31 1,46 1,55 Investissement marchand -1,31 -0,53 0,12 0,40 1,00 1,42 1,52 1,61 Investissement non marchand -0,78 -0,69 -0,90 -1,19 -0,50 0,54 0,99 1,11 Exportation -0,03 0,03 0,14 0,26 0,72 1,34 1,52 1,41 Importation -0,27 -0,29 -0,30 -0,32 -0,39 -0,51 -0,54 -0,50 Emploi 0,06 0,13 0,23 0,35 0,93 1,60 1,77 1,78 Taux de chômage (% point) -0,03 -0,08 -0,13 -0,20 -0,53 -0,90 -1,00 -1,00 Taux d'inflation (% point) 0,07 -0,32 -0,26 -0,17 -0,17 -0,11 -0,03 0,01 Salaire brut moyen déflaté -1,47 -1,38 -1,35 -1,37 -1,43 -1,94 -1,39 -1,02 par le prix de la valeur ajoutée Revenu disponible nominal 0,25 0,13 0,07 0,09 0,15 1,08 2,12 3,40 Taux d'intérêt (% point) 0,02 -0,05 -0,07 -0,05 -0,02 0,07 0,11 0,12 Déficit public (% du PIB) -0,02 -0,03 -0,06 -0,07 -0,07 -0,26 -0,38 -0,56 Dette publique (% du PIB) 0,02 0,08 0,14 0,18 0,20 -1,01 -3,25 -6,33 Déficit commercial (% du PIB) -0,10 -0,06 -0,02 0,01 0,03 0,20 0,22 0,19 Source : modèle Three-ME. La consommation finale affiche en 2012 une légère améliora- tion de 0,1 %, imputable à l’augmentation du pouvoir d’achat des ménages, dont le revenu disponible nominal augmente du fait de la redistribution d’une partie des recettes de la taxe, mais aussi parce que la mesure a des effets positifs sur l’emploi : l’allègement du coût du travail et le renchérissement des coûts des autres facteurs de production stimulent la demande en main-d’œuvre
- 139. Une évaluation macroéconomique et sectorielle de la fiscalité carbone en France 137 dans les secteurs marchands. Ainsi, la baisse marquée du salaire brut moyen (exprimé en termes réels) d’environ un point et demi se traduit par une substitution en faveur du facteur travail. De son côté, l’investissement des ménages réagit de la même manière que leur consommation finale puisqu’il dépend également de l’évolu- tion du revenu disponible. Cette amélioration de la demande finale reste néanmoins insuf- fisante pour renverser les effets négatifs de la mesure à très court terme sur la valeur ajoutée induits par le recul de l’investissement productif, d’autant plus que le prix à la consommation augmente, limitant l’appréciation du pouvoir d’achat. L’effet sur le PIB est tout de même positif en 2012 par un simple effet de comptabilité de la taxe qui compense la légère baisse de la valeur ajoutée. Le PIB augmente de 0,4 % par rapport à la tendance, résultat comparable à celui donné par certains modèles appliqués à l’économie française (Beaumais et Zagamé, 1993 ; Hourcade et al., 2009 ; Epaulard, 2009). Encardré. La question du « double dividende » Depuis les premiers travaux sur les gains potentiels en efficacité économique engendrés par la substitution d’une taxe environnemen- tale à d’autres taxes distordantes (Terkla, 1984 ; Baumol et Oates, 1988 ; Pearce, 1991), la notion de « double dividende » a fait l’objet d’un large débat et de nombreuses controverses entre les économistes. Elle est réfutée dans les travaux basés sur un cadre d’analyse en équilibre général Walrasien (Bovenberg et Mooij, 1994 ; Bovenberg et Goulder, 1996), tandis qu’elle est confirmée dans les modèles macroéconomiques d’inspiration néo-keynésienne (Lemiale et Zagamé, 1998). Le modèle Three-ME, s’inscrivant dans ce deuxième courant, peut conduire à l’apparition d’un « double dividende » : un premier dividende environ- nemental est lié à la réduction des émissions de CO2, le second à l’amélioration de la situation macroéconomique reflétée par la hausse de l’activité économique et de l’emploi. Alors que le premier dividende provient exclusivement de la baisse de la demande en énergie fossile, le deuxième dépend de plusieurs facteurs. Il est largement lié aux effets de substitution : les entreprises privilégient le facteur travail au détriment de l’énergie ; les ménages ont intérêt à utiliser plus de services et moins d’énergie. Il est par ailleurs lié à la hausse de la taxation de l’énergie fossile, qui dans le cas de la France, s’avère moins récessive qu’une augmentation de la TVA par exemple, dans la mesure où elle porte essentiellement sur les importations, la production française étant moins intensive en énergie fossile que celle de ses concurrents commerciaux. Il est aussi le résultat du mode de
- 140. 138 Gaël Callonnec, Frédéric Reynès et Yasser Y. Tamsamani redistribution des recettes. Un recyclage des recettes par un allégement du coût du travail présente un double avantage : (1) il permet de réduire les prix à la production et donc de stimuler la demande et l’activité ; (2) il favorise le travail au détriment des autres facteurs de production, ce qui limite la baisse du revenu disponible réel induite par la taxe et stimule la consommation et l’investissement des ménages. Selon Pearce (1991), le deuxième dividende dépend par ailleurs de l’écart entre le coût social du système fiscal avant et après l’instauration de la taxe carbone. Les recettes de la taxe carbone servant à réduire des taxes plus distordantes permettent en même temps d’améliorer l’efficacité du système fiscal. Indépendamment des bienfaits de la redistribution des recettes, la taxe carbone est source de régulation de certaines défaillances du système productif et social. D’abord, elle permet de réduire des distor- sions entre producteurs en fixant un prix commun aux émissions de CO2. En absence d’une telle taxe, les producteurs soucieux des consé- quences environnementales de leur activité et utilisant une technologie moins polluante sont lésés car les technologies propres sont encore rela- tivement chères. Dans ce sens, la taxe favorise les conditions d’une concurrence loyale compatible avec une utilisation soutenable des moyens de production. Au niveau social, la taxe carbone valorise et donc favorise les comportements de consommation vertueux en pénali- sant les externalités négatives liées aux émissions résultant du comportement des citoyens les plus pollueurs. À partir de 2014, les effets positifs de la redistribution s’accen- tuent et un cercle vertueux de croissance et de baisse du chômage s’amorce. En écart à la tendance, l’investissement et la production des secteurs deviennent positifs. Le PIB progresse plus vite que dans le scénario central du fait des effets multiplicateur et accéléra- teur. Il atteint un niveau de 3,18 % supérieur à celui du compte central à l’horizon de notre simulation en 2050. Dans le modèle, les ménages s’adaptent à un renchérissement du prix de l’énergie lié à l’instauration de la taxe carbone en inves- tissant davantage dans les automobiles sobres et dans l’isolation des bâtiments. En 2050, ces investissements augmenteraient respectivement de 2,26 % et 5,85 %. La forte baisse des importations à la suite de l’instauration de la taxe carbone reflète le fait que la France est un importateur net d’énergies fossiles. Cette baisse est durable avec un rythme plus soutenu au début de la période, mais qui tend à se stabiliser autour
- 141. Une évaluation macroéconomique et sectorielle de la fiscalité carbone en France 139 de -0,5 % dans les vingt dernières années de la simulation. En revanche, les exportations baissent légèrement la première année de mise en œuvre de la mesure, lorsque l’inflation augmente. Dans les années suivantes, les prix à l’exportation croissent moins vite que le compte central et les produits domestiques sont donc plus compétitifs sur le marché international, ce qui stimule les exporta- tions pour une demande mondiale inchangée. Cette dynamique des exportations, conjuguée à la baisse des importations et l’augmentation du PIB, permet de réduire le déficit commercial en points du PIB durant les trois premières années de la mesure. Par la suite, le déficit commercial se creuse légèrement du fait de la baisse des prix à l’exportation due à la baisse des coûts de production liée à la redistribution des recettes de la taxe. Avec une élasticité prix à l’exportation inférieure à l’unité, l’améliora- tion de la compétitivité-prix des produits domestiques n’entraîne pas une augmentation du volume des exportations suffisante pour annuler l’effet de la baisse des prix sur la valeur des exportations. Au total, les exportations en valeur baissent et le déficit de la balance commerciale se creuse. Du fait de l’hypothèse de neutralité budgétaire, la fiscalité carbone est ex-ante sans effet sur l’équilibre budgétaire des adminis- trations publiques. L’impact ex-post est quasi nul à court terme. Par contre à moyen et long terme, un cercle vertueux de croissance et d’emploi s’enclenche, entraînant une amélioration des comptes publics. À l’horizon 2050, le déficit budgétaire et la dette publique baissent par rapport au scénario central respectivement de 0,56 point et 6,33 points. La mesure entraîne également une modi- fication de la structure des recettes fiscales à l’horizon de 2050 : le poids de la TVA baisse légèrement à cause de l’effet désinflation- niste de la politique redistributive. 3.2. …aux répercussions sectorielles En général, toute hausse des prélèvements obligatoires sur des produits domestiques a un effet récessif et conduit à une hausse conjointe du chômage et de l’inflation. Dans le cas de la mise en place d’une taxe carbone accompagnée d’un scénario de redistribu- tion ciblé et d’un schéma d’exonérations sectorielles tels que précédemment décrits, cet effet récessif peut être compensé et un cercle vertueux de croissance et d’emploi peut s’amorcer dans la
- 142. 140 Gaël Callonnec, Frédéric Reynès et Yasser Y. Tamsamani plupart des secteurs. Toutefois, les secteurs ne réagissent pas de la même manière à cette réforme (tableau 5). En particulier, trois groupes se distinguent : (1) les secteurs caractérisés par des taux de croissance (en écart à la tendance) de la production et de l’emploi positifs dès la première année de la mise en place de la fiscalité carbone, et qui ont tendance à augmenter dans les périodes suivantes. Il s’agit de l’agriculture, sylviculture et pêche, de l’industrie agro- alimentaire, de la fabrication de verre et d’articles en verre, de l’industrie du papier et carton, de la transformation des matières plastiques, des transports ferroviaires, du transport routier de voyageurs et de la production et distribution d’électricité ; (2) les secteurs dont la production est négativement affectée et dont l’emploi n’est que marginalement dégradé du fait de la lenteur des délais d’ajustement. Ce groupe est composé des secteurs : d’automobile, de fabrication de produits céramiques, d’indus- trie chimique minérale, d’industrie chimique organique, de la sidérurgie et de première transformation de métaux ferreux, de production de métaux non ferreux, de bâtiment et de travaux publics, du transport routier de marchandises, des services marchands et d’autres secteurs industriels. À moyen et long terme, les réactions dans ces secteurs convergent vers celles du premier groupe ; (3) les secteurs qui pâtissent de la mesure à court comme à long terme, ce sont : la production et distribution du charbon, la production et distribution du pétrole, la production et distribu- tion de gaz naturel, les transports par eau et transports aériens. L’analyse des retombées sectorielles de la taxe carbone montre que c’est moins l’effet direct sur les prix des inputs énergétiques de chaque secteur qui détermine la manière dont un secteur est touché que l’interdépendance sectorielle via les consommations intermédiaires et l’investissement en produit. Le secteur des produits céramiques illustre bien cette interdépendance. Bien qu’il bénéficie d’une exonération totale, sa production recule du fait de la contraction de l’activité dans les secteurs demandeurs de son produit. Ce résultat confirme que les modèles d’équilibre partiels ou uni-sectoriels faisant abstraction de l’effet de contagion entre secteurs lié au bouclage macroéconomique sont mal adaptés à l’évaluation de ce genre de mesure.
- 143. Une évaluation macroéconomique et sectorielle de la fiscalité carbone en France 141 Tableau 5. Résultats sectoriels de la fiscalité carbone Secteurs Variables 2012 2013 2014 2015 2020 2030 2050 Production Agriculture, sylviculture 0,04 0,14 0,28 0,43 1,04 1,78 2,17 (Y) et pêche Emploi (L) 0,11 0,23 0,38 0,54 1,42 2,52 2,97 Y 0,09 0,20 0,34 0,48 1,09 1,75 2,10 Industrie agro-alimentaire L 0,08 0,18 0,30 0,44 1,17 2,07 2,41 Y -0,09 0,15 0,37 0,51 1,01 1,57 1,63 Automobile L 0,00 0,08 0,22 0,37 1,02 1,78 1,84 Fabrication de verre et Y 0,06 0,20 0,39 0,58 1,34 2,23 2,54 d’articles en verre L 0,09 0,21 0,36 0,54 1,48 2,72 3,16 Fabrication de produits Y -0,12 -0,06 0,09 0,21 0,67 1,29 1,44 céramiques L 0,02 0,06 0,14 0,25 0,83 1,69 1,90 Y 0,03 0,12 0,27 0,44 1,17 2,05 2,40 Papier et carton L 0,06 0,14 0,26 0,40 1,24 2,40 2,81 Y -0,02 0,02 0,13 0,26 0,89 1,69 1,85 Industrie chimique minérale L 0,03 0,06 0,13 0,23 0,89 1,88 2,08 Industrie chimique Y -0,02 0,00 0,06 0,14 0,55 1,10 1,24 organique L 0,00 0,02 0,05 0,10 0,50 1,14 1,24 Transformation des matières Y 0,00 0,11 0,26 0,43 1,09 1,88 2,13 plastiques L 0,08 0,19 0,33 0,49 1,39 2,59 3,01 Sidérurgie et première trans- Y -0,01 0,05 0,18 0,32 0,93 1,73 2,00 formation de métaux ferreux L 0,02 0,06 0,13 0,24 0,89 1,84 2,07 Production de métaux Y -0,01 0,04 0,13 0,23 0,70 1,32 1,49 non ferreux L 0,02 0,05 0,10 0,19 0,71 1,47 1,60 Y -0,05 0,11 0,31 0,49 1,19 1,98 2,22 Autres L 0,04 0,13 0,26 0,42 1,28 2,38 2,73 Y -0,38 -0,02 0,18 0,17 0,46 0,84 0,82 BTP L -0,05 0,02 0,14 0,24 0,66 1,28 1,31 Y 0,81 1,89 2,83 3,57 6,52 10,38 13,30 Transports ferroviaires L 0,47 1,18 2,03 2,91 6,87 11,99 15,48 Transport routier Y 0,10 0,21 0,31 0,42 0,84 1,21 1,42 de voyageurs L 0,10 0,22 0,34 0,47 1,09 1,78 2,14 Transport routier (ou par Y -0,10 -0,06 0,04 0,15 0,59 1,08 1,10 conduites) de marchandises L 0,08 0,16 0,27 0,39 1,10 2,03 2,31 Y -0,19 -0,31 -0,36 -0,34 -0,25 -0,12 -0,47 Transports par eau L -0,02 -0,08 -0,13 -0,15 -0,06 0,13 -0,25
- 144. 142 Gaël Callonnec, Frédéric Reynès et Yasser Y. Tamsamani Tableau 5 (suite). Résultats sectoriels de la fiscalité carbone Secteurs Variables 2012 2013 2014 2015 2020 2030 2050 Production -0,19 -0,31 -0,36 -0,34 -0,25 -0,12 -0,47 Transports par eau (Y) Emploi (L) -0,02 -0,08 -0,13 -0,15 -0,06 0,13 -0,25 Y -0,10 -0,21 -0,25 -0,24 -0,14 -0,11 -0,65 Transports aériens L 0,02 0,01 0,00 0,00 0,18 0,39 -0,09 Y -0,06 0,05 0,19 0,31 0,81 1,37 1,67 Services marchands L 0,09 0,20 0,34 0,50 1,32 2,25 2,57 Extraction et agglomération Y -12,24 -14,63 -16,15 -16,98 -20,34 -23,03 -26,09 de la houille (Charbon) L -3,84 -7,58 -10,60 -12,86 -18,61 -22,48 -25,99 Y -1,23 -1,71 -2,01 -2,21 -3,40 -4,68 -6,03 Raffinage de pétrole L -0,37 -0,81 -1,21 -1,55 -2,84 -4,36 -5,91 Production et distribution Y 1,40 1,69 1,98 2,25 3,80 5,72 7,72 d’électricité L 0,45 0,89 1,29 1,66 3,32 5,51 7,51 Production et distribution Y -2,44 -3,12 -3,61 -3,97 -5,97 -8,10 -10,28 de gaz L -0,73 -1,52 -2,22 -2,80 -5,01 -7,55 -10,02 Source : modèle Three-ME. Par ailleurs, le changement technologique induit par l’augmen- tation du prix de l’énergie et son impact à moyen et long terme sur la structure de production au sein de chaque secteur affecte égale- ment la sensibilité des secteurs vis-à-vis de la taxe carbone. Ne pas le prendre en compte revient à limiter la capacité des secteurs à s’adapter à la nouvelle situation. C’est une des limites de la version actuelle de Three-ME où le progrès technique et le gain d’efficacité énergétique tendanciel sont exogènes. Cela tend à surestimer les effets négatifs d’une taxe carbone. Les résultats présentés ici sous- estiment donc l’ampleur des effets vertueux à moyen et long terme de la taxe sur le plan économique et environnemental. Malgré cette hypothèse conservatrice, il est intéressant de voir qu’une taxe carbone peut tout de même avoir des effets favorables sur l’économie. Dans tous les secteurs du groupe 1, la baisse des coûts salariaux fait plus que compenser le renchérissement du coût du capital et des autres inputs à la suite de l’instauration de la fiscalité carbone (graphique 3). La baisse des coûts se transmet aux prix à la produc- tion, ce qui stimule la production et l’emploi. Cet effet est plus marqué dans le secteur des transports ferroviaires qui a bénéficié
- 145. Une évaluation macroéconomique et sectorielle de la fiscalité carbone en France 143 des mesures de redistribution avantageuses abaissant son prix à la production de 3,5 %. Par ailleurs, l’effet de substitution en faveur du travail vient renforcer la dynamique de la création d’emploi dans les secteurs de ce groupe en général, tandis que la substitution entre les énergies profite au secteur électrique comme le montre ses performances en termes de production (+1,4 %) et d’emploi (+0,45 %). À moyen et long terme, cette dynamique de baisse des prix et d’accélération de la production s’accentue au fur et à mesure que les ajustements sont réalisés et que le taux de la taxe augmente. Graphique 3. L’effet de la fiscalité carbone sur le coût du travail et la production dans les secteurs du groupe 1 en 2012 (en % en écart au compte central) P r ix à la pr o duc t io n Production et distribution d’ électricité C o ût du t rav ail Papier et carton Industrie agro-alimentaire Fabrication de verre et d’ articles en verre Agriculture, sylviculture et pêche Transformation des matières plastiques Transports ferroviaires Transport routier de voyageurs -4,5 -4 -3,5 -3 -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 Source : modèle Three-ME. Quant aux secteurs du deuxième groupe (graphique 4), la redis- tribution des recettes de la taxe n’efface pas totalement les effets négatifs de la réforme sur la production et l’emploi, du moins à court terme. La légère baisse des prix à la production dans ces secteurs est insuffisante pour stimuler leur activité comme dans les secteurs du premier groupe. Malgré une redistribution favorable permettant de baisser sensiblement le prix à la production, le secteur de BTP pâtit le plus dans ce groupe avec une contraction conjointe de la production et de l’emploi de respectivement 0,38 % et 0,05 %. Ceci s’explique par la baisse de la demande des secteurs producteurs et distributeurs de l’énergie en biens d’investissement adressée à ce secteur, et par l’orientation de son marché exclusive- ment domestique qui ne lui permet pas de bénéficier de la baisse de
- 146. 144 Gaël Callonnec, Frédéric Reynès et Yasser Y. Tamsamani ses coûts de production sur le plan extérieur. À moyen et long terme, ces effets négatifs sont compensés par un effet de propaga- tion entre secteurs de la dynamique favorable de croissance et d’emploi. Graphique 4. L’effet de la fiscalité carbone sur le coût du travail et de la production dans les secteurs du groupe 2 en 2012 (en % en écart au compte central) P r i x à l a pr o duc t i o n Production de métaux non ferreux C o ût du t rav ail Sidérurgie et première transformation de métaux ferreux Industrie chimique organique Industrie chimique minérale Automobile Fabrication de produits céramiques Autres industries BTP Services marchands Transport routier (ou par conduites) de marchandises -4 -3,5 -3 -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 Source : modèle Three-ME. Dans les secteurs du groupe 3 (graphique 5), la contraction de la production est plus marquée. La baisse de l’emploi est de moindre ampleur à court et moyen terme du fait des rigidités sur le marché du travail. Cette baisse de la production est due à la montée des prix à la production et à la baisse sensible de la demande des entre- prises et des ménages pour ces produits. La baisse des coûts salariaux est insuffisante pour empêcher cette dynamique récessive qui se renforce au fur et à mesure que les ménages améliorent leur efficacité énergétique en investissant dans l’achat des automobiles sobres et dans l’isolation des bâtiments. Au-delà de 2050, date à partir de laquelle le taux réel de la taxe est maintenu constant, les mécanismes stabilisateurs inhérents à la structure du modèle (effets d’éviction induits par l’évolution des prix et du taux d’intérêt et convergence du chômage vers son niveau d’équilibre) conjugués aux contraintes de long terme (stabi- lité du ratio de la dette intérieure sur la richesse financière des ménages et la réalisation des anticipations) font converger
- 147. Une évaluation macroéconomique et sectorielle de la fiscalité carbone en France 145 l’économie vers son sentier de croissance équilibré. À ce stade, les effets vertueux de la réforme sur la croissance et l’emploi tendent à s’estomper, puisqu’on a supposé par commodité que le taux de chômage d’équilibre était égal au taux de chômage de l’année de base (2006). Les résultats auraient été positifs même à long terme si l’on avait simulé un choc en situation d’équilibre de sous-emploi, en postulant l’existence d’un taux de chômage initial supérieur au taux d’équilibre pris en compte par la politique monétaire de la Banque centrale. Graphique 5. L’effet de la fiscalité carbone sur le coût du travail et de la production dans les secteurs du groupe 3 en 2012 (en % en écart au compte central) P r i x à l a pr o duc t i o n Extraction et agglomération C o ût du t rav ail de la houille (Charbon) Raffinage de pétrole Production et distribution de gaz Transports par eau Transports aériens -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 Source : modèle Three-ME. 3.3. Les émissions de CO2 Les différents mécanismes de substitution consécutifs à la mise en œuvre de la fiscalité carbone jouent au détriment de la demande de l’énergie fossile. En 2012, les émissions de CO2 baissent de 7,6 Mt (Millions de tonnes) (1,7 %) par rapport au sentier de référence. Les entreprises y participent à hauteur de 63 % (graphique 6). Cet effort de réduction s’accentue progressivement du fait de l’évolution haussière du taux de la taxe et des ajustements des agents. En 2050, la baisse des émissions passe à plus de 40 Mt, soit une réduction de 5 % par rapport au compte central. Pour les ménages, la baisse est de 14,4 Mt, soit une réduction de 9 % par rapport au compte central. Notons que la répartition de cet effort reste quasi inchangée par rapport à l’année de l’introduction de la réforme (64 % pour les entreprises et 36 % pour les ménages en 2050).
- 148. 146 Gaël Callonnec, Frédéric Reynès et Yasser Y. Tamsamani Graphique 6. Évolution de l’effort de réduction des émissions de CO2 par acteur économique 2012 2013 2014 2015 2020 2030 2040 2050 0 -5 -10 -15 -20 Em i s s i o ns des m énages -25 Em i s s i o ns des ent r epr i s es -30 Em i s s i o ns t o t al es -35 -40 -45 Source : modèle Three-ME. La plus grande partie (65 %) de la baisse des émissions des ménages en 2012 provient de la consommation des produits pétroliers. Cet effort est rendu possible essentiellement par leurs dépenses d’investissement en automobiles sobres9. La baisse de la consommation de gaz contribue quant à elle à l’effort de réduction des émissions à hauteur de 33 %, et la part du charbon ne dépasse pas 2 %. Tous les secteurs enregistrent une baisse de leurs émissions de CO2 dès l’année de la mise en place de la fiscalité carbone, mais avec des proportions différentes. Du fait du schéma des exonéra- tions adoptées, la contraction des émissions est plus marquée dans les secteurs non ou partiellement exonérés, tels que les secteurs des services marchands, de la production de plastique, d’automobile et du BTP. Les émissions liées à la décarbonation enregistrent aussi une légère baisse due à la contraction de l’activité dans les secteurs concernés (secteurs des verres et de la céramique). Le tableau 6 présente les résultats en termes de réductions sectorielles des émis- sions de CO2 et leur évolution dans le temps. 9. Ce résultat est obtenu sous l’hypothèse d’un effet durable du système bonus-malus sur l’élasticité-prix de la demande des voitures sobres.
- 149. Une évaluation macroéconomique et sectorielle de la fiscalité carbone en France 147 Tableau 6. Évolution des émissions sectorielles de CO2 secteurs 2012 2013 2014 2015 2020 2030 2040 2050 Agriculture, sylviculture -0,73 -0,76 -0,77 -0,78 -0,75 -0,67 -0,46 -0,14 et pêche Industrie agro-alimentaire -8,18 -8,29 -8,40 -8,51 -9,07 -10,17 -10,40 -10,61 Automobile -2,91 -2,88 -2,84 -2,80 -2,53 -1,65 -0,13 1,32 Fabrication de verre et d’articles -4,27 -4,30 -4,34 -4,37 -4,59 -4,95 -5,05 -5,22 en verre Fabrication de produits -7,28 -7,38 -7,47 -7,57 -8,07 -8,85 -8,74 -8,61 céramiques Papier et carton -3,30 -3,32 -3,35 -3,39 -3,60 -4,00 -4,28 -4,61 Industrie chimique minérale 0,83 0,85 0,86 0,86 0,87 0,88 0,64 0,35 Industrie chimique organique -4,13 -4,18 -4,24 -4,30 -4,64 -5,20 -5,39 -5,62 Transformation des matières -9,86 -9,98 -10,11 -10,24 -10,95 -12,19 -12,51 -12,84 plastiques Sidérurgie et première 1,86 1,89 1,91 1,93 1,96 1,97 1,58 1,12 transformation de métaux ferreux Production de métaux -3,26 -3,29 -3,33 -3,37 -3,62 -4,08 -4,33 -4,66 non ferreux Autres 1,78 1,81 1,84 1,86 1,91 1,92 1,56 1,12 BTP -2,78 -2,80 -2,83 -2,87 -3,13 -3,71 -4,10 -4,59 Transports ferroviaires 0,78 0,80 0,81 0,82 0,82 0,73 0,47 0,14 Transport routier de voyageurs -13,24 -13,38 -13,53 -13,69 -14,54 -15,98 -16,22 -16,52 Transport routier (ou par 1,03 1,06 1,08 1,09 1,12 1,10 0,86 0,55 conduites) de marchandises Transports par eau -3,03 -3,05 -3,09 -3,14 -3,42 -4,00 -4,30 -4,68 Transports aériens -16,38 -16,52 -16,67 -16,82 -17,62 -18,98 -19,24 -19,53 Services marchands -17,24 -17,43 -17,62 -17,82 -18,85 -20,57 -20,68 -20,83 Services non marchands 8,57 8,67 8,76 8,85 9,29 10,15 9,22 8,28 Raffinage de pétrole -2,59 -2,62 -2,66 -2,70 -2,91 -3,21 -3,31 -3,41 Production et distribution -1,60 -1,62 -1,64 -1,67 -1,86 -2,26 -2,59 -2,96 d’électricité Production et distribution -3,86 -3,90 -3,95 -4,00 -4,33 -5,05 -5,35 -5,70 de gaz Decarbonation Fabrication de verre et d’articles -2,96 -3,00 -3,04 -3,10 -3,41 -4,11 -4,50 -4,92 en verre Fabrication de produits -19,07 -19,21 -19,35 -19,50 -20,25 -21,44 -21,55 -21,67 céramiques Source : modèle Three-ME.
- 150. 148 Gaël Callonnec, Frédéric Reynès et Yasser Y. Tamsamani Dès la première année de la réforme, le premier dividende envi- ronnemental apparaît pour l’ensemble de l’économie. Ce résultat a tendance à s’amplifier avec le temps dans quasiment tous les secteurs, traduisant le recours progressif à une technologie de production moins intensive en énergie fossile. Une exception notable dans les secteurs du transport ferroviaire et de l’électricité qui tirent profit de la mesure et connaissent une hausse de leur activité et donc de leurs émissions (qui cependant étaient initiale- ment relativement faibles). En 2050, leurs émissions sont respectivement supérieures de 10 % et 7 % par rapport au scénario de référence sans taxe. Le secteur électrique profite d’un effet de substitution en sa faveur tandis que le secteur des transports ferro- viaires, en plus de l’effet de substitution, bénéficie d’une redistribution des recettes qui lui est avantageuse. Au niveau de la répartition de l’effort de réduction des émis- sions sectorielles totales de CO2 entre les trois sources d’énergie fossile, le gaz vient en tête avec la moitié des émissions évitées en 2012 au niveau national, suivi du pétrole avec 33 % et du charbon à 18 % (graphique 7). Graphique 7. Évolution de la réduction des émissions de CO2 par source d’énergie fossile 2012 2050 Charbon Charbon 2 % Gaz 18 % Gaz 49 % 57 % Pétrole 41 % Pétrole 33 % Source : modèle Three-ME. Cette simulation des effets d’une taxe carbone débouchent sur des baisses relativement modestes des émissions. Ce résultat a deux explications. La première provient de la spécification du choc : — conformément au projet de loi, nous avons supposé des mesures d’accompagnement (redistribution des recettes et
- 151. Une évaluation macroéconomique et sectorielle de la fiscalité carbone en France 149 exonérations) qui d’une part réduisent l’impact de la taxe sur les prix relatifs et d’autre part favorise la demande. Une variante de la taxe carbone de même ampleur mais sans redistribution des recettes conduit à une baisse des émissions deux fois supérieure à long terme. Par contre, le dividende économique disparaît à court terme. Une autre variante avec redistribution des recettes mais sans mesure d’exonération, conduit à un double dividende plus marqué pour tous les horizons, et ce malgré la dégradation de la situation écono- mique dans les secteurs concernés par les exonérations. Ces variantes révèlent le dilemme auquel les pouvoirs publics sont confrontés concernant la mise en œuvre d’une taxe carbone et de ses modalités : d’un côté, l’efficacité environ- nementale à long terme, et d’un autre les coûts socio- économiques à court terme ; — pour cette variante, nous avons retenu des hypothèses très optimistes au regard des développements récents sur les marchés pétroliers concernant l’évolution du prix des éner- gies fossiles qui progressent au rythme de l’inflation. Lorsque nous supposons un prix du pétrole à 150 euros constant le baril en 2020, la réduction des émissions de CO2 est 2,25 fois supérieure et le dividende économique est en revanche moins important. La deuxième explication provient des hypothèses relatives aux propriétés de long terme du modèle qui tendent à sous-estimer l’efficacité environnementale de la taxe carbone. En particulier, les résultats obtenus à long terme font apparaître un effet rebond très important : la hausse de l’activité économique induite par le regain d’investissements verts, l’augmentation de l’emploi les branches bâtiments et transports ferroviaires et l’amélioration de la balance commerciale entraînent une augmentation de la consommation d’énergie qui compense très largement la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Cet effet est moindre dans les modèles multisec- toriels d’inspiration néoclassique, qui négligent les effets d’entraînement sur la demande et le PIB de la redistribution des recettes, font généralement apparaître des gains de CO2 beaucoup plus conséquents. Ici, ce résultat découle en grande partie des hypothèses retenues dans le modèle :
- 152. 150 Gaël Callonnec, Frédéric Reynès et Yasser Y. Tamsamani — l’industrie et l’agriculture sont très largement exonérées. Seuls les ménages et le secteur tertiaire sont réellement mis à contribution ; — les élasticités de substitution entre énergie et autres facteurs de production, entre énergies, entre le transport ferroviaire et le transport routier sont supposées faibles et constantes durant toute la période de simulation, contrairement à ce qu’on trouve dans la littérature et qui prévoit plutôt une trajectoire croissante de ces valeurs (OECD, 2006) ; — les sensibilités des parts de marchés des diverses classes de véhicules et du rendement énergétique du parc immobilier au coût du carbone ont été estimées de manière assez pessi- miste ; — le progrès technique en matière énergétique n’est pas modé- lisé et ne dépend donc pas de l’évolution du prix de l’énergie, ce qui devrait limiter la capacité d’adaptation des agents suite une taxe carbone ; — le modèle ne prévoit pas encore de substitutions possibles entre l’énergie fossile et les énergies renouvelables. Cette lacune est préjudiciable puisque le contenu carbone du Kwh électrique 10 reste stable dans notre simulation. Or la part des énergies renouvelables devrait augmenter sous l’effet de la hausse du prix des combustibles, ce qui devrait améliorer le bilan environnemental de la taxe carbone. En outre, il n’a pas encore été prévu de substitution possible entre les combustibles fossiles, la biomasse (bois énergie, agro-carbu- rants, méthanisation) et la géothermie. Cette hypothèse réduit considérablement les résultats obtenus en termes de baisse d’émissions ; — les besoins en chauffage et mobilité des ménages ne sont pas plafonnés puisque l’on suppose qu’ils dépendent positive- ment du revenu disponible. Ceci n’est pas satisfaisant : un examen sur données de panel montre que le nombre d’auto- mobiles pour 1 000 habitants ne dépasse jamais 700 unités 10. Le contenu carbone du Kwh électrique est estimé par l’ADEME à 80gCO2/Kwh en moyenne. Il est de 200gCO2/Kwh pour les besoins de chauffage car il existe encore une dizaine de centrales au charbon qui produisent essentiellement en période de pointe pour les besoins du chauffage électrique. A titre de comparaison, le contenu carbone du gaz est égal à 206g/KWh et le contenu carbone du fioul domestique s’élève à 275gCO2/Kwh.
- 153. Une évaluation macroéconomique et sectorielle de la fiscalité carbone en France 151 même dans les pays les plus riches. Le nombre de kilomètres parcourus par les véhicules n’a jamais franchi la barre des 16 000 kilomètres, et l’on peut douter que les conducteurs aient envie de passer plus de 2 heures en moyenne par jours dans les transports. Il serait donc judicieux d’introduire de tels plafonds dans le modèle pour éviter que la hausse du revenu disponible des ménages n’entraîne une explosion de la consommation de carburant par tête et du nombre d’auto- mobiles dans le parc. Il en va de même pour les besoins de chauffage. On peut supposer à court terme qu’une hausse du revenu incite les ménages défavorisés à augmenter la tempé- rature intérieure de leur logement. Cependant cet effet devrait s’atténuer à mesure que le revenu moyen augmente puisque l’on considère que le confort thermique diminue lorsque la température excède 21°C. En l’état actuel du modèle, la hausse de l’activité économique engendre une hausse surestimée de la consommation de chauffage au regard de l’amélioration de l’efficacité énergétique du parc. L’introduction de plafonds réalistes de mobilité et de chauf- fage devrait donc considérablement améliorer les résultats de la future version du modèle en termes de baisse des émis- sions de CO2. 4. Conclusion Cette évaluation des effets économiques et environnementaux de l’introduction d’une fiscalité carbone en France à l’aide du modèle Three-ME conclut à une amélioration de la situation macro-économique dès les premières années de la réforme, que ce soient en termes de croissance, d’emploi et de déficit public, et à une baisse modérée des émissions de CO2. De plus, la réforme enclenche un cercle vertueux qui s’amplifie au cours du temps. À long terme (au-delà de 2050), les mécanismes stabilisateurs du modèle font converger l’économie vers son sentier de référence et les effets positifs en termes de taux de croissance tendent progressi- vement à s’annuler. Cependant, les répercussions de la mesure sur les niveaux des variables socio-économiques et environnementales sont permanentes et l’intensité énergétique de l’économie (ratio de l’énergie fossile sur le PIB) est durablement moins élevée par rapport à 2012.
- 154. 152 Gaël Callonnec, Frédéric Reynès et Yasser Y. Tamsamani La baisse des émissions apparaît modeste mais cela provient en grande partie de nos hypothèses relatives à la réaction des agents économiques et à leur capacité d’adaptation face à une modifica- tion des prix relatifs. Ces dernières tendent à sous-estimer les bienfaits économiques et environnementaux d’une fiscalité carbone à long terme. Leur modification, en particulier l’inclusion de plafonds énergétiques conformes aux observations empiriques, ou d’un progrès technique en matière énergétique endogène, amplifierait très vraisemblablement l’impact environnemental positif à long terme. Il est toutefois intéressant de voir que, malgré ces hypothèses conservatrices, la mise en œuvre d’une taxe carbone peut avoir des effets bénéfiques sur l’économie française à court comme à long terme. Références bibliographiques Al Amin Siwar, C., et , A. Hamid, 2009, « Computable General Equilibrium Techniques for Carbon Tax Modeling » American Journal of Environne- mental Sciences, n° 5 (3). Baumol W.J. et W.E. Oates, 1988, « The Theory of Environmental Policy » Cambridge University Press, 2nd edition. Beaumais O. et P. Zagamé, 1993, « Economic Models for Analysing Envi- ronmental Problems » in Carraroet Siniscalo, Ed.-Carbon Tax Adjustment in Europe- Kluwer Academic Publishers. Beaumais O. et O. Godard, 1994, « Economie, croissance et environne- ment : De nouvelles stratégies pour de nouvelles relations » Revue économique, hors série « Perspectives et réflexions stratégiques à moyen terme ». Bentzen J., 2004, « Estimating the rebound effect in US manufacturing energy consumption », Energy Economics, n° 26 (1). Bernard A. et M. Veille, 1998, « GEMINI-E3, un modèle d’équilibre général national-international économique, énergétique et environnemental » Économie et Prévision, n° 136 (5). Bils M., 1987, « The Cyclical Behaviour of Marginal Cost and Price » American Economic Review, n°77. Bovenberg, A.L. et R.A. de Mooij, 1994, « Environmental Levies and Distortionary Taxation » American Economic Review, 84 (4). Bovenberg A.L. et L.H. Goulder, 1996, « Optimal Environmental Taxation in the Presence of Other Taxes: General Equilibrium Analysis » American Economic Review, n° 86( 4).
- 155. Une évaluation macroéconomique et sectorielle de la fiscalité carbone en France 153 Chiroleu-Assouline M. et M. Fodha, 2011, « Verdissement de la fiscalité : à qui profite le double dividende ? », Revue de l’OFCE, n° 116, pp. 409-432. CGP, 1993, « l’économie face à l’écologie » Commissariat Général du Plan, Éditions La Découverte, La Documentation française. Detemmerman V., E. Donni, P. Zagamé, 1993, « Increase on Energy Taxes as a way to Reduce CO2 Emissions : Problems and Mechanism », in Lesourd J.B., Percebois J. and Valette F., Models for Energy Policy, Chapman and Hill. Epaulard A., 2009, Quels sont les impacts macroéconomiques de la mise en œuvre de la Contribution Climat-Énergie, conférence d’experts sur la Contribution Climat-Énergie. Hourcade J.C., F. Ghersi et E. Combet, 2009, « taxe carbone, une mesure socialement régressive ? Vrais problèmes et faux débats » Document de travail, CIRED, n° 120. Lemiale L. et P. Zagamé, 1998, « Taxation de l’énergie, efficience énergé- tique et nouvelles technologies : les effets macroéconomiques pour six pays de l’Union européenne » in Schubert K. et Zagamé P., L’environne- ment - Une nouvelle dimension de l’analyse économique, Vuibert, Paris, 1998. Laurent É., J. Le Cacheux, 2010, « Taxe(s) carbone : et maintenant ? », Lettre de l’OFCE, n° 316, 5 février. Martins J. O. et S. Scarpetta, 2002, « Estimation du comportement cyclique des taux de marge : une note technique » Revue économique de l’OCDE, n° 34 (1). Ministère de l’économie de l’industrie et de l’emploi, 2010, Rapport sur les prélèvements obligatoires et leur évolution, Projet de loi de finances, Paris. OECD, 2006, The Political Economy of Environmentally Related Taxes, OECD, Paris. Pearce D.W., 1991, « the Role of Carbon Taxes in Adjusting to Global Warming » The Economic Journal, n° 101. Quinet A., 2008, « La valeur tutélaire du carbone », La Documentation fran- çaise, Centre d’Analyse Stratégique. Reynès F., Y. Y. Tamsamani et G. Callonnec, 2011, « Presentation of Three- ME: Multi-sector Macroeconomic Model for the Evaluation of Environ- mental and Energy policy », Document de travail OFCE 2011-10. Rotemberg J. et M. Woodford, 1991, « Mark-ups and the Business Cycle » NBER Macroeconomic Annual, MIT press. Sorrell S., J. Dimitropoulos et M. Sommerville, 2009, « Empirical esti- mates of the direct rebound effect: A review » Energy Policy, n° 37 (4). Solow R. M., 1956, « A Contribution to the Theory of Economic-Growth », Quarterly Journal of Economics 70 (1), 65-94.
- 156. 154 Gaël Callonnec, Frédéric Reynès et Yasser Y. Tamsamani Shacklet R., M. Shelby, A. Cristofaro, R. Brinner, J. Yanchar, L. Goulder, D. Jorgenson, P. Wilcoxen, P. Pauly et R. Kaufmann, 1993, « The Effi- ciency Value of Carbon Tax Revenues », Working Paper, 12.8, Energy Modeling Forum, Stanford University. Terkla D., 1984, « The Efficiency Value of Effluent Tax Revenues » Journal of Environmental Economics and Management, n° 99 (1).
- 157. POURQUOI L’EUROPE A BESOIN D’UNE BANQUE CENTRALE DU CARBONE Christian de Perthuis Université Paris-Dauphine, Chaire Économie du climat Dans cette contribution, nous examinons les voies d’un renforcement de la régulation du marché européen du carbone, outil central retenu par l’Union européenne pour atteindre ses objectifs climatiques et à ce jour premier système d’échange de permis au monde. Un tel renforcement implique une harmonisation et une centralisation plus poussées des fonc- tions classiques de surveillance d’un marché (sécurité des infrastructures, transparence de l’information, traque des positions dominantes, …), diffi- ciles à mettre en œuvre dans le contexte institutionnel européen. Mais pour envoyer un signal permettant d’orienter l’économie sur la cible d’une réduction par cinq des émissions européennes à l’horizon 2050, il faudrait aller plus loin : créer un organisme indépendant sur le modèle d’une banque centrale avec une capacité d’intervention et une crédibilité suffi- santes pour modifier les anticipations des industriels afin qu’ils réalisent aujourd’hui les investissements nécessaires pour mettre l’économie euro- péenne sur la voie de la décarbonation. Mots-clés : marchés du carbone, Union européenne, banque centrale du carbone. Revue de l’OFCE / Débats et politiques – 120 (2011)
- 158. 156 Christian de Perthuis C omment abuser le fisc de 5 milliards d’euros ou subtiliser pour 50 millions de marchandise avant de disparaître dans la nature ? Simplement en utilisant le marché européen du carbone ! Le développement rapide de ce marché, plus rigoureusement dénommé système européen de plafonnement et d’échange de quotas de CO2, a attiré de nombreux professionnels qui ont contribué à son succès, mais également des malfrats dont la convoitise a contraint la Commission à interrompre les transac- tions au comptant pendant plusieurs semaines en janvier 2011. Un exemple supplémentaire rappelant à quelles dérives peut conduire le développement des marchés en l’absence d’instance forte de régulation. Dans cette contribution, nous examinons les voies d’un renforcement de la régulation du marché européen du carbone, outil central retenu par l’Union européenne pour atteindre ses objectifs climatiques et à ce jour premier système d’échange de permis au monde. Un tel renforcement implique une harmonisa- tion et une centralisation plus poussées des fonctions classiques de surveillance d’un marché (sécurité des infrastructures, transpa- rence de l’information, traque des positions dominantes, …), difficiles à mettre en œuvre dans le contexte institutionnel euro- péen. Mais pour envoyer un signal permettant d’orienter l’économie sur la cible d’une réduction par cinq des émissions européennes à l’horizon 2050, il faudrait aller plus loin : créer un organisme indépendant sur le modèle d’une banque centrale avec une capacité d’intervention et une crédibilité suffisantes pour modifier les anticipations des industriels afin qu’ils réalisent aujourd’hui les investissements nécessaires pour mettre l’économie européenne sur la voie de la décarbonation. 1. Mettre un prix au carbone : de la théorie aux travaux pratiques Pour intégrer le risque du changement climatique dans le fonc- tionnement des économies, il y a un consensus très large parmi les économistes pour recommander l’introduction d’un nouveau prix pour modifier l’échelle de priorités des agents : un prix qui révèle la
- 159. Pourquoi l’Europe a besoin d’une banque centrale du carbone 157 rareté de l’atmosphère, ou plus exactement sa capacité à absorber sans risque pour le système climatique les quantités croissantes de gaz à effet de serre que les hommes continuent d’y rejeter. On appelle communément ce prix le « prix du carbone ». Deux voies sont praticables pour introduire ce prix, toutes deux dépendantes d’une décision d’autorité publique : la taxe ou le marché de permis. Si notre monde fonctionnait en situation de concurrence pure, avec une parfaite information et pas d’incerti- tude, ces deux voies seraient absolument équivalentes. Notre consensus entre économistes tiendrait encore : il suffirait à la corporation de demander à la science du climat toutes les informa- tions requises pour connaître la quantité globale d’émission à ne pas dépasser compte tenu de l’évaluation des dommages encourus. Une fois ce plafond connu, il lui suffirait, soit de calculer le « bon » prix du carbone compte tenu des coûts de réduction des émissions et de le communiquer à l’autorité publique pour lever la taxe, soit de transmettre le plafond à l’autorité publique, à sa charge d’orga- niser le marché des permis pour révéler le « bon » prix. Restons dans ce monde très schématique des économistes et levons l’hypothèse d’information parfaite. Nous commençons alors à nous rapprocher de la situation des décideurs publics qui font face à une grande incertitude tant pour évaluer les coûts des dommages que ceux des réductions d’émission : — Le lien entre le montant des émissions et celui les dommages encourus est en premier lieu très incertain. Il suffit de parcourir l’un des rapports du Groupement international d’expert sur le climat (GIEC) pour immédiatement comprendre que la science du climat nous alerte sur les risques qu’encourent les sociétés humaines à dégrader l’atmosphère, cette fine pellicule gazeuse entourant notre planète qui stabilise le système climatique. Cette science se présente-t-elle comme porteuse de certitudes ? Ce serait là totalement méconnaître les travaux du GIEC dont tous les rapports d’évaluation insistent au contraire sur les incertitudes « au carré » avec lesquelles doit compter le décideur politique. En effet, le lien entre l’accumulation des émissions de gaz à effet de serre et le rythme du réchauffement à venir est très difficile à appréhender du fait des multiples rétroactions possibles au sein du système climatique dont certaines accélè- rent le réchauffement, par exemple l’augmentation de la vapeur
- 160. 158 Christian de Perthuis d’eau induite par le réchauffement, mais d’autres le freinent, par exemple la transformation d’une partie de cette vapeur d’eau en nuages. À cette première incertitude s’ajoute celle du lien entre le rythme du réchauffement et les capacités d’adaptation des écosystèmes et des sociétés humaines. — Sommes-nous mieux lotis du côté de l’évaluation des coûts des actions de réduction des émissions ? Il existe certes pléthore de modélisations sur les courbes de coûts d’abattement et autres calculs de comités d’experts sur la « valeur tutélaire » du carbone qu’il faudrait viser pour réduire plus ou moins rapide- ment nos trajectoires d’émission. L’information tirée de l’évaluation ex post des expériences réussies de tarification du carbone conduira le praticien à beaucoup de prudence. L’instau- ration d’un prix du carbone déclenche souvent des réductions d’émissions là où on ne les attendait pas, par exemple celles obtenues sur les gaz industriels grâce au Mécanisme pour un Développement Propre introduit par le protocole de Kyoto, ce qui signifie que la courbe de coût marginal anticipée par les experts n’était pas la bonne. Elle déclenche parfois des réduc- tions importantes dans certains secteurs pourtant réputés totalement insensibles au prix du carbone comme le révéla la taxe carbone suédoise dans le transport routier en déclenchant la distribution de biogaz dans les stations services. Elle révèle en général que les coûts d’émission sont bien plus faibles que ne l’anticipent les pouvoirs publics, ce qui a conduit à des sur-allo- cations regrettables de permis dans les systèmes de plafonnement et d’échanges de quotas de CO2 mis en place en Europe et dans les États du nord-est des États-Unis. Dans son article fondateur de 1974, Prices versus Quantities, Weitzman introduit l’incertitude et se pose la question de la bonne stratégie à suivre dans ce nouveau contexte par l’autorité publique. En situation d’incertitude, l’autorité publique doit faire des paris sur d’un côté le rythme d’accroissement des coûts qu’il faut accepter pour réduire les émissions, en langage plus technique la courbe marginale d’abattement, et de l’autre le montant des dommages auquel on s’expose en augmentant les émissions, autre- ment dit la courbe marginale des dommages. Sa conclusion, bien connue, est que dans le cas où les dommages progressent lente- ment et les coûts rapidement, l’autorité publique minimise son
- 161. Pourquoi l’Europe a besoin d’une banque centrale du carbone 159 risque d’erreur d’anticipation en instituant une taxe plutôt qu’un marché de permis. L’analyse de Weitzman conduit à une fissure dans le consensus initial des économistes dont un certain nombre, mais pas tous, recommandent l’utilisation de la taxe plutôt que d’un marché de permis, pour atténuer les risques du changement climatique. Notre recommandation sera un peu différente : mettre en place une « banque centrale du carbone » pour aider l’autorité publique et la société à découvrir graduellement le « bon » prix du carbone, c'est-à-dire celui qui déclenche les investissements et les abattements nécessaires pour atteindre les objectifs finaux de la politique climatique. 2. Le rôle pivot du marché européen du carbone Observons maintenant ce qui se passe dans le monde réel. Dans ce monde, les débats d'économistes n'ont en vérité guère pesé sur le choix entre taxe ou système de permis. L’option qui s’est imposée est celle qui est parvenue à déjouer l’hostilité des conservatismes et des intérêts établis en réunissant la bonne coalition d’acteurs. Et là, la sociologie politique fournit plus de clefs de lecture que la science économique. Pour mettre en place un prix du carbone, l’Europe a successive- ment tenté les deux méthodes. La Commission européenne a déposé en 1992 un projet de taxe harmonisée sur les émissions industrielles de CO2, en espérant pouvoir utiliser les dispositions du Marché unique permettant de prendre des décisions à la majorité qualifiée en matière environnementale. Ce projet se heurta à une forte hostilité des lobbies industriels et à celle d’une majorité de pays opposés à l’idée d’abandonner une parcelle de leur droit régalien de lever l’impôt. Face à cette levée de boucliers, les ambitions du projet de grande taxe carbone furent d’abord ramenées à des discussions d’experts pour harmoniser les seuils d’imposition de la fiscalité indirecte sur les carburants. Ces discussions s’enlisant assez rapide- ment, la Commission retira formellement son projet de directive début 1998. Il en resta cependant quelques résultats intéressants : un certain nombre de pays nordiques ont saisi cette opportunité, à l’instar de la Suède, pour verdir leur système fiscal durant cette décennie en introduisant des taxes carbone domestiques.
- 162. 160 Christian de Perthuis Dans l’intervalle, l’Union européenne avait signé en décembre 1997 le protocole de Kyoto dont certaines dispositions prévoient l’utilisation de mécanismes de marché de permis au plan interna- tional, d’inspiration américaine. Contrainte de changer son fusil d’épaule, la Commission abandonna le projet de la taxe euro- péenne et se convertit au système de marché en introduisant en 2005 un système de plafonnement et d’échange (cap and trade) de quotas de CO2 dont les caractéristiques principales sont décrites dans l'encadré. Encadré1. La genèse du marché européen des quotas de CO2 Le système européen d'échanges de quotas de CO2 plafonne les émissions de 11 000 sites industriels responsables d'environ 50 % des émissions de CO2 et 40 % des émissions de gaz à effet de serre européennes. Leurs émissions sont limitées à un plafond, initialement fixé à environ 2 milliards de tonnes de CO2 par an via l'allocation d'un montant équivalent de quotas. Cette allocation s'effectue sur des comptes dédiés inscrits dans des registres nationaux interconnectés, sur le même modèle que des comptes bancaires. L'achat et la vente de quotas sont autorisés, de même que les transactions de crédits Kyoto, dont une utilisation limitée est possible depuis 2008. Ces transactions doivent permettre aux sites industriels de s'assurer chaque année de pouvoir restituer aux autorités autant de quotas ou de crédits que leurs émissions de l'année précédente. Ce système, encadré par une directive européenne, est organisé en 3 périodes. La première période (2005-2007) a servi de phase pilote. Les alloca- tions ont été distribuées de manière gratuite pour la plupart (99 %), sur la base des émissions passées des installations industrielles. Le niveau réel des émissions couvertes par le système était mal connu au départ, du fait de l'absence de comptabilisation préexistante. Par ailleurs il était impossible de conserver des quotas non utilisés pour la phase suivante. Les quotas excédentaires n'ayant plus de valeur après 2007, leur prix a logiquement chuté à des niveaux quasi-nuls dès lors qu'il est apparu qu'il y avait plus de quotas disponibles que d'émissions à couvrir sur la fin de période. La période 2 (2008-2012) correspond à la période d'engagement du protocole de Kyoto. Trois modifications majeures ont été introduites. D'abord la quantité de quotas alloués a été réduite de 10 %, tout en conservant le principe d'une allocation essentiellement gratuite (96 % des quotas). Ensuite, les quotas non utilisés ont été autorisés à être conservés pour plus tard (dispositif dit de banking), apportant une incita- tion supplémentaire à réduire les émissions. Enfin, il est devenu possible d'utiliser des crédits carbone issus de mécanismes de projets Kyoto,
- 163. Pourquoi l’Europe a besoin d’une banque centrale du carbone 161 jusqu'à un montant correspondant à 13,5 % de l'allocation en moyenne. En 2012, le système européen d'échange de quotas a été élargi aux émis- sions des compagnies aériennes au cours de leurs vols européens. Période 3 (2013-2020) : En avril 2009, l'Union européenne a adopté un paquet législatif dit « paquet énergie-climat » qui l'engage unilatéra- lement à réduire de 20 % ses émissions entre 1990 et 2020. Le marché de quotas doit jouer un rôle primordial pour atteindre ces objectifs à moindre coût. En matière d'allocation, le plafond de quotas distribués, défini au plan communautaire, se réduira progressivement pour être ramené à 21 % en dessous du niveau de 2005 en 2020. De plus la quasi-totalité de l'alloca- tion des quotas au secteur de la production d'électricité s'effectuera par mise aux enchères dès 2013 ; les autres secteurs recevront une part crois- sante de leurs quotas par enchères, sauf s'ils sont considérés comme étant soumis à une compétition internationale. Dans ce cas, leur alloca- tion reste gratuite mais basée sur des facteurs de référence (benchmarks). La couverture du marché sera élargie aux émissions de gaz non CO2 de l'industrie chimique et de la transformation d'aluminium. Le CO2 stocké de manière durable dans des réservoirs géologiques pourra de plus être exempté de l'obligation de restituer des quotas. Enfin la surveillance du marché sera accrue et centralisée, la traçabilité des quotas étant renforcée par la mise en place d'un registre unique se substituant aux 27 registres des États membres. La Banque mondiale tient depuis quelques années un suivi systématique des marchés carbone fonctionnant dans le monde. D’après ses évaluations, les échanges sur le marché européen ont représenté en 2011 la part du lion, avec plus de 80 % de la valeur globale des transactions. Le second pilier des échanges de droits d’émission a concerné les crédits émis au titre des deux méca- nismes de projet mis en place par le protocole de Kyoto, les autres marchés réglementaires de quotas (Japon, États du nord-est des États-Unis, Australie, Nouvelle Zélande) et ceux de la compensa- tion volontaire restant très marginaux. Mais les deux piliers des marchés du carbone ne sont pas indépendants : le système euro- péen des quotas de CO2 assure la grande majorité des débouchés des crédits Kyoto que les industriels peuvent utiliser, dans la limite de certains plafonds, pour leur conformité. En réalité, le marché européen du carbone est devenu le véritable pivot de la tarification du carbone dans le monde, commandant le prix que peuvent
- 164. 162 Christian de Perthuis espérer obtenir les développeurs de projets réducteurs d’émission à partir de leur crédit carbone. Le premier mérite de ce marché est de fournir un prix, désor- mais intégré dans les coûts de production des industriels sous quotas. Ce prix fluctue en fonction de plusieurs paramètres dont les plus importants sont le niveau du plafond initialement fixé par la Commission européenne, les possibilités techniques de réduc- tion d’émission, le rythme de l’activité économique, les prix relatifs de l’énergie et les conditions météorologiques. L’une des conditions politiques du lancement de ce marché a été la grande décentralisation de sa gouvernance, la Commission se concentrant sur ce qui lui semblait essentiel en laissant une large autonomie aux États membres en matière d’allocation des quotas aux entre- prises, de gestion des registres, d’organisation des échanges. Cette décentralisation n’a pas posé de problème jusqu’à ce qu’apparais- sent des dysfonctionnements majeurs à partir de fin 2008. 3. Fraudes, vols, cybercriminalité : où est le gendarme du marché ? Au moment du lancement du système d’échange de quotas, les principales craintes de dysfonctionnement portaient sur le comparti- ment des produits dérivés de ce marché, lieu de prédilection des acteurs financiers qui fluidifient les échanges par leur fonction d’intermédiation, proposent des produits de couverture à leurs clients et spéculent également pour compte propre. De fait, à l’instar des autres marchés de matière première, on a rapidement vu la finan- ciarisation du marché du carbone, où de 80 à 85 % des transactions s’effectuent sur produits dérivés. Pourtant, aucun dysfonctionne- ment n’est apparu sur ce compartiment du marché initialement jugé à risque. Ceci s’explique par le fait que les échanges de produit dérivés portant sur des contrats à terme ou des options, sont de facto sous les régulations financières nationales existantes qui sont assez largement harmonisées en Europe sous l’égide d’un régulateur commun. En revanche les échanges au comptant ont été fortement perturbés par la fraude à la TVA, le recyclage de crédits carbone et la montée en régime de la cybercriminalité.
- 165. Pourquoi l’Europe a besoin d’une banque centrale du carbone 163 Figure. principaux dysfonctionnements sur le marché européen des quotas Janvier 2011 Fin 2008 Eté 2009 Mars 2010 Vol d’EUA estimé à au moins Début de la fraude à Fraude à la TVA Recyclage de CER 50 millions d’euros. la TVA, détectée par estimée à 5 provenant du La Commission européenne ferme l’augmentation des milliards d’euros registre hongrois temporairement les registres et volumes échangés suspend les transactions d’EUA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Avril 2010 Mai 2010 Avril 2011 2013 La Commission La Commission La Commission Début de la troisième européenne amende européenne amende européenne autorise phase du système le règlement sur les méthode de collecte la réouverture de tous européen des quotas registres pour éviter de la TVA les registres nationaux le recyclage de CER Source : Climate Economics Chair, adapté de CERA (2011) La fraude, ou « carrousel » à la TVA, n’a pas été inventée sur le marché carbone. Consistant à acheter un produit importé hors taxe puis à le revendre en facturant la TVA à l’acheteur local sans la reverser au Trésor public, elle est estimée par Interpol à environ 100 milliards d’euros par an en Europe. Elle est d’autant plus facile à pratiquer que la marchandise assujettie peut se déplacer rapide- ment. Or, quoi de plus rapide qu’un quota de CO2 qui se déplace à la vitesse du numérique par simple jeu d’écriture entre deux comptes sur les registres ? C’est ce qui a permis à des malfaiteurs de s’introduire sur ce marché pour y soustraire au fisc une somme de l’ordre de quelques cinq milliards d’euros entre fin 2008 et l’été 2009 en Europe. Ce type de fraude se détecte par l’observation des échanges de quotas transfrontaliers, leur rotation s’accélérant comme dans un carrousel. Du fait de la décentralisation du dispositif, la réaction de l’auto- rité publique s’est faite en deux temps. Les États membres les plus directement visés par la fraude ont été les premiers à réagir, en modifiant ou en annulant les régimes de TVA applicables aux échanges de quotas de CO2. La Commission a adopté le 16 mars 2010 une directive réorganisant le mode de perception de la TVA sur les quotas de CO2 dont la stricte application devrait faire dispa- raître les quelques havres résiduels pour les fraudeurs à la TVA au sein de l’espace européen : certains cas de fraude avaient encore été détectés en Italie en décembre 2010.
- 166. 164 Christian de Perthuis Le recyclage de crédits Kyoto, s’est traduit par la réapparition sur le marché européen du carbone, de crédits Kyoto déjà utilisés par des installations du registre hongrois pour leur conformité mais ensuite revendus par l’État hongrois sur le marché international. Pour contrecarrer cette fraude, très spécifique au marché du carbone, la Commission a modifié la réglementation des registres en introduisant en avril 2010 des « comptes de retrait » permettant de définitivement bloquer l’usage des crédits après leur utilisation pour la conformité. Les vols de quotas sur les registres, résultent de mécanismes bien connus de cybercriminalité consistant à se faire passer pour un autre dans l’univers numérique (phishing) ou à procéder à des attaques directes par un virus du type « cheval de Troie ». Ces vols ont sans doute dépassé 3 millions de tonnes de CO2 en janvier 2011, soit 0,15 % du plafond global d’émission, et une valeur de l’ordre de 50 millions d’euros. La détection de ces vols s’effectue par les titulaires de comptes qui déjouent les attaques ou réalisent ex-post les avoir subies. Pour bloquer ces attaques, la Commission a été amenée à geler toute transaction entre registres en janvier 2011, en fermant de facto le marché au comptant pendant quelques temps. La réouver- ture s’est ensuite opérée graduellement, sans que les transactions au comptant ne retrouvent leur niveau antérieur. L’arrivée en force de la cybercriminalité sur ce marché a en effet profondément miné la confiance de ses participants. Ceux-ci ont alors découvert qu’en l’absence de règles communes et d’un gendarme européen pour les faire appliquer, il fallait faire face à un empilage de législations nationales parfois contradictoires. Par exemple, les risques liés à la détention de quotas volés sont susceptibles de poursuites pénales pour recel dans certains pays comme la France, mais pas dans d’autres comme l’Allemagne. Comme pour les fraudes à la TVA, la lutte contre la cybercriminalité appelle d’évidence des mesures à l’échelle européenne pour renforcer la surveillance. 4. Les trois dimensions du renforcement de la surveillance du marché En décembre 2010, la Commission a publié une communica- tion sur le renforcement de la surveillance du marché dont les
- 167. Pourquoi l’Europe a besoin d’une banque centrale du carbone 165 principaux points furent discutés en mai 2011, en séance publique. Cette démarche vise à restaurer la confiance et à construire un dispositif qui soit prêt en janvier 2013 au moment du démarrage de la troisième période de marché (2013-2020). Elle concerne la sécu- rité des infrastructures, le statut juridique des quotas et la transparence du marché. 4.1. Assurer la sécurité des infrastructures de marché Le système des registres constitue l’épine dorsale de tout marché de permis. Il assure la traçabilité des droits à émettre et l’intégrité environnementale du système. Dans le système européen, les 11 000 installations sous quotas doivent ainsi ouvrir chacune un compte dans leur registre national, toute transaction au comptant donnant lieu à un double jeu d’écriture chez l’acheteur et le vendeur. Les registres nationaux sont connectés à une plateforme commune (Community Independent Transaction Log, CITL) qui vérifie et consolide toutes les informations sur les transactions au niveau européen. Malgré le resserrement des règles originelles, cette architecture décentralisée s’est avérée très fragile en termes de sécurité. C’est la raison pour laquelle il a été décidé de lui substituer un registre unique à partir de janvier 2013, géré centralement depuis la Commission. Cette migration technique sera accompagnée d’un renforcement des règles d’accès au marché : jusqu’à un passé récent, il était extraordinairement facile d’ouvrir un compte sur l’un des 27 registres, la directive initiale ayant été rédigée avec le souci de faciliter l’accès de « Monsieur tout le monde » au marché européen du carbone, pour des raisons citoyennes. Les cybercriminels furent les principaux bénéficiaires de ce principe quelque peu naïf. 4.2. Harmoniser la qualification juridique des quotas de CO2 La question de l’harmonisation du statut juridique du quota de CO2 a fait l’objet de longs débats dans les consultations euro- péennes. Elle oppose deux visions : — la première qui a les faveurs de la Commission européenne, consiste à qualifier le quota de CO2 au comptant comme un produit financier. Ce choix a déjà été retenu dans certains pays comme le Luxembourg. Il a un corolaire immédiat : il entraîne-
- 168. 166 Christian de Perthuis rait l’application de la régulation financière existante à l’ensemble des compartiments du marché du carbone. Très simple en apparence, ce choix exigerait cependant des aménage- ments importants pour les acteurs industriels qui sont contraints de participer à ce marché pour des raisons de conformité et ne sont pas prêts à se conformer à l’ensemble des obligations s’appliquant aux intermédiaires financiers. Il est de plus douteux que cette option ait les faveurs de l’opinion publique plutôt rétive face au fonctionnement des marchés financiers. — L’autre voie, développée dans un rapport français coordonné par Michel Prada, prend le parti de définir le quota de CO2 comme une « autorisation administrative cessible » et préco- nise une régulation ad hoc, susceptible de s’appliquer dans le futur à d’autres actifs de conformité pouvant résulter de la mise en œuvre de marché de droits pour gérer des contraintes envi- ronnementales du type : épuisement des ressources halieu- tiques, rationalisation de l’usage de l’eau, protection de la biodiversité, … Ses détracteurs trouvent cette voie trop compli- quée. Avec une célérité aussi remarquable qu’inhabituelle, le rapport Prada a pourtant déclenché la mise en place d’une régulation française du marché du carbone partagée entre l’Autorité des marchés financiers et la Commission de régula- tion de l’énergie suggérant que ce schéma est applicable assez vite si on s’en donne les moyens. 4.3. Transparence du marché et traitement de l’information Assurer la transparence du marché et se prémunir contre les manipulations d’information ou les positions dominantes est le volet le plus stratégique du renforcement de la surveillance du marché. Sur un marché financier, ce sont les émetteurs qui sont responsables de l’information diffusée aux participants, sous le contrôle très serré de l’autorité de régulation qui doit éviter toute dissymétrie d’information susceptible de conduire à des prises de risque inconsidérées de la part des investisseurs. Sur un marché du carbone, c’est l’autorité publique qui est l’unique émetteur. Elle doit en conséquence assumer un rôle essentiel et impartial dans la diffusion et le traitement de l’information. On en est très loin. Du fait de sa posture d’émetteur unique, l’autorité publique a de fait accès à une information exhaustive sur la totalité des transac-
- 169. Pourquoi l’Europe a besoin d’une banque centrale du carbone 167 tions au comptant qui sont toutes tracées dans le système des registres. Aucun autre marché ne bénéficie d’un tel gisement d’informations en temps réel ! Malheureusement l’immense majo- rité de cette information reste dormante dans les registres : d’après les règles en vigueur, elle ne peut être communiquée au public avant un délai de cinq ans. Par contre, jusqu’à un passé récent, on pouvait trouver les coordonnées Internet des 11 000 installations sous quotas en accès libre sur l’ensemble des registres. Une infor- mation qui a grandement facilité le travail des hackers ! Dans les règles actuelles, la Commission européenne n’a qu’une obligation en matière de diffusion d’information : celle de rendre publiques une fois pas an les données exhaustives relatives aux émissions de l’ensemble des installations industrielles, aux permis qui leur ont été distribués et à ceux qu’elles ont rendus. Cette information, habituellement rendue publique en avril est de loin celle qui est la plus attendue et regardée par les acteurs de marché. C’est par exemple elle qui provoqua le retournement du marché du carbone au printemps 2006 en révélant que les antici- pations antérieures des professionnels étaient erronées (voir graphique). La transparence du marché implique que son régulateur ait le mandat de fournir à l’ensemble des participants des informations sur les fondamentaux du marché. Ceci concerne aussi bien les informations en provenance du registre sur la distribution des permis et celle des émissions par installation que les informations pre et post-trade actuellement fournies par les places de marché privées. La mission du régulateur devrait aussi consister à réunir les compétences requises pour rendre publiques ses propres analyses des conditions de marché et ses anticipations. Relever ce défi de l’information sera essentiel pour le régulateur du marché du carbone, comme c’est le cas pour une banque centrale sur le marché monétaire : toutes les banques centrales du monde partagent le droit régalien d’imprimer la monnaie et de fixer le taux d’intérêt au jour le jour. Ce qui fait la différence en termes de crédibilité d’une banque centrale, c’est sa capacité à influencer les anticipations des participants au marché grâce à la longueur d’avance que lui donne sa capacité à collecter, interpréter et diffuser une plus grande masse d’informations.
- 170. 168 Christian de Perthuis 5. Comment se crée la « monnaie carbone » Par certains aspects, un quota de CO2 s’apparente à une nouvelle monnaie qui présente une grande singularité : elle ne peut être utilisée que pour acheter un seul bien, le droit de rejeter une tonne de CO2 dans l’atmosphère. Il en résulte une certaine parenté entre le fonctionnement du marché du carbone et celui du marché monétaire. Chaque année, la mise en circulation de la monnaie carbone (l’offre de monnaie primaire) est effectuée via le processus d’alloca- tion gratuite des quotas de CO2 aux installations du système ou via les enchères qui vont devenir sa modalité principale à partir de 2013. Son montant global est fixé par le plafond d’émissions qu’il ne faut pas dépasser. Une fois émise, cette monnaie peut circuler librement, généralement pendant un an. Elle est retirée de la circu- lation lorsque les installations doivent restituer à l’autorité publique autant de quotas qu’elles ont émis de CO2. Dans le cas d’une « sur-allocation », la valeur de la monnaie carbone est érodée. Il se développe une sorte « d’inflation carbone ». De même que l’inflation affaiblit l’économie, la sur-allocation amenuise la capacité du prix du carbone à déclencher les réductions d’émissions visées. Symétriquement, en cas de crise de liquidité, l’assèchement de la circulation monétaire risque de provoquer une crise systé- mique : si la banque centrale ne joue pas son rôle de prêteur en dernier ressort, le système financier peut s’effondrer et avec lui le niveau de l’activité macro-économique. De même, si le régulateur du marché de permis ne dispose pas de moyens pour contrecarrer une pénurie de monnaie carbone, l’envolée du prix du carbone pourrait en théorie provoquer pas mal de casse économique. Depuis 2008, les industriels sous quotas peuvent utiliser des crédits carbone qu’ils importent de l’extérieur pour assurer une partie de leur conformité. Ces crédits sont l’équivalent de devises dont l’utilisation peut affecter la valeur ou la stabilité de la monnaie domestique. Ceci soulève la question très classique du degré de convertibilité de la monnaie domestique et de la gestion du taux de change. Le parallèle tient toujours entre marché du carbone et marché de la monnaie.
- 171. Pourquoi l’Europe a besoin d’une banque centrale du carbone 169 Tableau. Comparatif entre une banque centrale « standard » et une banque centrale du carbone Marché monétaire Marché du carbone Stabilité monétaire sur Réductions d’émissions au plus bas coût Objectif final le long terme sur le court et le long terme Intégrité et liquidité Surveillance du marché Intégrité et liquidité des transactions des transactions Instrument de prix Taux d’intérêt Prix du carbone Régulation quantitative Marché primaire Offre de monnaie centrale Mise aux enchères des allocations – Vente et achat d’actifs carbone – « Open market » (Vente et – Liens avec autres marchés (compensa- Marché secondaire achat d’actifs monétaires) tion, autres marchés de permis d’émis- - Taux de change sion, etc.) Offre d’allocations supplémentaires Crise de liquidité Prêteur de dernier ressort empruntées sur le futur (borrowing) comme « soupape de sécurité » – Rapport annuel sur le prix du carbone – Rapports annuels et trimes- Rapportage aux autorités et sur la trajectoire de long-terme des triels sur la situation moné- publiques (Conseil réductions d’émission + auditions taire et économique européen, Parlement et – Rapports trimestriels sur le marché – Auditions publiques au Par- Commission européens) européen du carbone et sur le prix lement européen du carbone Source : C. de Perthuis (2011) Au vu de ces similarités, on peut tracer un parallèle entre le mandat d’une banque centrale sur le marché monétaire et celui que pourrait avoir un organisme indépendant que nous appelons par commodité de langage « banque centrale du carbone » sur le système d’échange de quotas. Pour la régulation du marché à court terme, les instruments et les objectifs sont assez convergents, surtout dans le cas de figure où la majorité des quotas est vendue aux enchères. Comme la directive organisant les enchères prévoit explicitement un organisme indépendant de supervision, on pour- rait au demeurant y voir l’embryon de la future banque centrale du carbone. Il existe cependant une différence de fond entre la banque centrale standard et celle du carbone qui concerne l’objectif ultime de chacune des deux institutions : — une banque centrale standard doit assurer la stabilité monétaire en visant le meilleur sentier de croissance non inflationniste à long terme. C’est à elle de décider des montants de monnaie à mettre en circulation en veillant à ce que les moyens de paie- ment s’élargissent suffisamment pour irriguer la croissance,
- 172. 170 Christian de Perthuis mais ne se perdent pas trop dans les marchés d’actif où risquent de se former des bulles spéculatives. — l’objectif ultime de la banque centrale du carbone est de veiller à ce que le marché du carbone mette l’économie sur la bonne trajectoire de réduction d’émission. Mais c’est à l’autorité publique de fixer le niveau visé d’émission compte tenu des objectifs de la politique climatique et, ce faisant, le montant global de la monnaie carbone qui sera mise en circulation. Le rôle de la banque centrale est alors d’instiller cette monnaie dans le système pour trouver, par tâtonnements successifs, le prix du carbone permettant d’emprunter la bonne trajectoire : celle dans laquelle les industriels réalisent à chaque période, d’une part les abattements requis, d’autre-part les investisse- ments nécessaires pour préparer ceux des périodes suivantes. On retrouve ici Weitzman et son analyse de l’incertitude : le mandat de la banque centrale du carbone est d’aider l’autorité publique à découvrir le « bon » prix du carbone en situation d’incertitude et de réagir de façon crédible et indépendante aux chocs qui n’ont pas été anticipés. Voyons maintenant comment cela pourrait fonctionner concrètement. 6. La feuille de route de la banque centrale du carbone L’une des critiques les plus souvent faites au marché du carbone est qu’il ne permet pas de faire apparaître le « bon » prix. La formule recouvre deux types de reproches de nature assez diffé- rente : le prix est trop volatile ; il est trop bas. Pour y remédier, il est souvent préconisé des solutions limitant ex ante les variations de prix à l’intérieur d’un corridor prédéfini comme le fit l’Union euro- péenne avec le fameux « serpent monétaire » destiné à limiter les marges de fluctuation des taux de change. Sur le marché du carbone, il est très facile d’instituer un prix- plafond : il suffit de modifier une ligne dans la directive, en indi- quant que la pénalité pour non restitution d’un quota de CO2 devient libératoire. Sitôt que le prix du marché atteindrait ce montant (actuellement 100 euro la tonne de CO2), les industriels paieraient la pénalité qui agirait alors comme une taxe. Facile à mettre en place, ce dispositif présente un inconvénient majeur : s’il
- 173. Pourquoi l’Europe a besoin d’une banque centrale du carbone 171 est utilisé, il permet aux industriels sous quotas d’émettre au-delà du plafond d’émissions en payant la pénalité. La cible environne- mentale risque donc de ne plus être atteinte. Un prix plancher peut symétriquement être institué, soit par un mécanisme d’achat illi- mité des quotas par l’autorité publique sitôt que le prix s’en approche, soit par l’institution d’un système hybride avec une taxe différentielle venant s’ajouter au prix de marché en cas de chute des cours. Ces dispositifs présentent deux défauts majeurs. Primo, au lieu de limiter les fluctuations des prix ils risquent d’attiser la spécula- tion en lui fixant des seuils prédéterminés. Ce fut l’un des enseignements majeurs du serpent monétaire européen sur le marché des changes. Secundo, ils occultent la question de fond : qui, et par rapport à quels critères, va définir le « bon » corridor de prix du carbone ? Si l’autorité publique dispose des informations lui permettant de calculer ex ante ce prix, il serait dès lors plus simple de mettre en place une taxe. De même, si les industriels ont un besoin impérieux de connaître à l’avance le prix exacte du carbone pour leurs choix d’investissement, la réponse adaptée n’est pas le système de permis, mais la taxe. Le mandat de la banque centrale du carbone est précisément de s’assurer que le marché délivre un prix du carbone qui reflète l’évolution des conditions de marché de court terme et envoie simultanément le bon signal pour les investissements de long terme. Pour le premier volet, son principal instrument est la super- vision des enchères dont les règles actuelles devraient évoluer pour donner plus de marge de manœuvre à un organisme de régulation du type banque centrale. Celui-ci devrait assurer la fluidité du marché. En cas de choc imprévu comme la récession de 2009, son rôle ne serait pas d’empêcher la baisse du prix de marché tout à fait souhaitable au regard des conditions de court terme (voir graphique). Il serait de s’assurer que le mouvement ne modifie pas l’anticipation des industriels et leurs programmes d’investissement bas carbone. En cas de risque d’envolée du prix par insuffisance de monnaie carbone, la banque centrale du carbone ne pourrait jouer le rôle de « prêteur en dernier ressort » en créant indéfiniment de la monnaie comme sa consœur du marché monétaire, mais elle pour- rait mettre par anticipation sur le marché des quotas prévus pour une période future.
- 174. 172 Christian de Perthuis Graphique. Prix du quota de CO2 sur le marché européen du carbone 40 35 Annonce des objec fs 30 climat-énergie 2020 de l'UE Récession économique 25 €/t 20 Fukushima 15 Publica on des Nouvel équilibre de 10 émissions Surplus de prix dans un Proposi on vérifiées quotas sur la contexte de reprise de Direc ve 2005 phase 1 économique lente Efficacité 5 énergé que 0 mai -05 mai -06 mai -07 mai -08 mai -09 mai -10 mai -11 janv. -05 janv. -06 janv. -07 janv. -08 janv. -09 janv. -10 janv. -11 sept. -05 sept. -06 sept. -07 sept. -08 sept. -09 sept. -10 Phase 1 (spot) Phase 2 (DEC12) Source : Chaire Economie du Climat Une faiblesse du marché européen du carbone a jusqu’à présent été son absence de profondeur temporelle. Dans les secteurs sous quotas, le stock de capital immobilisé est lourd et les décisions d’investissement conditionnent pour plusieurs décennies le montant des émissions futures. On ne peut donc se satisfaire d’un objectif à l’horizon 2020 pour le marché, comme c’est le cas actuel- lement. Fort heureusement, à la suite de l’engagement du Conseil européen de viser une réduction d’émission d’au mois 80 % en 2050 (relativement à 1990), la Commission a engagé de multiples réflexions sur la meilleure façon d’atteindre cette cible. Dans son mode d’organisation actuel, il est très difficile de faire entrer cet horizon long dans le fonctionnement du marché européen. Ce devrait être le mandat principal de la banque centrale européenne, qui devrait convertir cet objectif long et les cibles intermédiaires de 2020 et 2030 en une évolution crédible du plafond d’émission sur le marché. Pour être crédible après des industriels qui auraient alors connaissance du plafond d’émissions sur 40 ans, un certain nombre de clauses de révisions possibles devrait être prévu, en fonction des évolutions futures et très imprévisibles des technolo- gies, des prix des énergies, de la négociation climatique internationale et des conditions économiques.
- 175. Pourquoi l’Europe a besoin d’une banque centrale du carbone 173 L’une des conditions clefs de réussite de ce processus itératif est que la future banque centrale ait des obligations strictes en matière de reporting à l’égard de l’autorité publique. Ceci exige qu’elle réunisse les compétences nécessaires pour comprendre et anticiper aussi bien les dynamiques du fonctionnement du marché du carbone que celles des trajectoires de réduction d’émissions. L’indépendance de son mandat est en effet subordonnée à cette compétence technique qui seule doit guider ses choix et lui permettre d’acquérir sa crédibilité vis-à-vis des acteurs de marché. Dernier volet du partage des rôles entre l’autorité publique et la banque centrale du carbone : l’affectation du produit des enchères. Il va de soi que l’intégralité de ce produit doit être restituée à l’auto- rité publique dont la prérogative est de fixer l’objectif de la politique climatique et de percevoir les impôts ou quasi-impôts. Toute affectation d’une partie, même minime, du produit des enchères à la banque centrale du carbone serait génératrice de conflits d’intérêt et totalement dépourvue de justification. En revanche, en délégant à la banque centrale du carbone le mandat de supervision du marché du carbone, l’autorité publique lui confère des prérogatives susceptibles d’avoir des retombées impor- tantes sur le montant des enchères qu’elles sont susceptibles d’engranger. Et dans le contexte budgétaire des années à venir, ce type de délégation donnerait un contenu très fort au mot « indé- pendance ». 7. Conclusion Que le bon fonctionnement des marchés exige une régulation forte est une règle générale qui se décline de façon différenciée suivant les marchés considérés. Si un dysfonctionnement majeur apparaît sur le marché européen du blé ou du gaz, c’est évidem- ment ennuyeux. Mais tout le monde sait bien qu’on aura besoin d’un marché aussi longtemps qu’on échangera du blé et du gaz en Europe. On discute ici de l’organisation du marché, pas de son exis- tence. Il en va différemment du marché du carbone qui est une construction artificielle, introduite par une autorité publique pour agir avec efficacité face aux risques de dérèglement climatique. Cette construction peut disparaître. Derrière la discussion sur la régulation de ce marché, c’est l’existence même de l’instrument
- 176. 174 Christian de Perthuis qui est donc en jeu. La crédibilité du marché européen du carbone repose à court terme sur un renforcement de sa régulation au plan européen. Elle serait accrue par le déploiement d’un organisme indépendant pouvant ajuster l’offre de quotas disponibles aux contraintes de fluidité du marché et s’assurer que les anticipations de prix des industriels déclenchent bien les investissements néces- saires. Elle requiert surtout un engagement fort de la part des élus et dirigeants européens pour maintenir l’ambition de la politique climatique commune. Or, cet engagement semble parfois vaciller avec la morosité du climat économique et le poids des dettes qui anémient les ressorts de l’économie. Le rôle d’une banque centrale du carbone indépendante serait aussi de montrer qu’une stratégie climatique ambitieuse va de pair avec plus de dynamisme écono- mique : la croissance d’abord, le climat ensuite ? Non : le climat bien sûr, et la croissance avec ! Références bibliographiques Climate Economics Chair, 2011, Failings of the European CO2 emissions trading market, minutes of the special meeting, www.chaire economieduclimat.org Ellerman D., 2008, The EU Emission Trading Scheme: A Prototype Global System? The Harvard project on Climate Agreements Discussion, Discussion paper 08-02. Ellerman D., F. Convery, C. de Perthuis, 2010, Carbon Pricing: the European Union Emission Trading Scheme, Cambridge University Press (traduction française chez Pearson sous le titre Le prix du carbone) Edenhofer O., C. Flachsland, R. Marschinski, 2007, Towards a global CO2 market An economic analysis, Potsdam Institute for Climate Impact Research, mai. European Commission, 2010, Towards an enhanced market oversight framework for the EU Emission Trading Scheme, Communication, décembre. Jickling M., L. Parker, 2010, Regulating a Carbon Market: Issues Raised by the European Carbon and US Sulfur Dioxide Allowance Markets, Congressional Research Service, février. Perthuis C. de, 2011, Carbon market regulation : the case for a CO2 central Bank, Les cahiers de la Chaire Economie du Climat, Série Information & Débats, n°10, août.
- 177. Pourquoi l’Europe a besoin d’une banque centrale du carbone 175 Perthuis C. de, 2010, Et pour quelques degrés de plus, 2° édition, Pearson (version internationale chez Cabridge University Press sous le titre Economic Choices in a Warming World). Pew Center 2010, Carbon Market Design & Oversight: a short overview, février, http://www.pewclimate.org/ Prada M., 2010, CO2 Markets Regulation, www.minefe.gouv.fr Prada M., 2011, How to regulate carbon markets ?, Communication at the workshop on carbon and energy markets regulation at the European Institute of Florence. Sartor O., 2011, Closing the door to fraud in the EU ETS, Climate Brief n° 4, www.cdcclimat.com Sustainable Prosperity, 2011, A Carbon Bank: Managing Volatility in a Cap- and-Trade system, University of Ottawa, Policy Brief, août. Vassipoulos P., S. Knell, 2011, Fraud paralyzes European carbon trade, IHS CERA Insight, février. Weitzman M. L., 1974, Prices versus Quantities, Review of Economic Studies, vol.41, octobre.
- 178. 176 Christian de Perthuis
- 179. L’AJUSTEMENT AUX FRONTIÈRES, CONDITION DE LA CRÉDIBILITÉ D’UNE POLITIQUE EUROPÉENNE DU CLIMAT AMBITIEUSE Olivier Godard Polytechnique, CNRS Cet article entend évaluer la pertinence, les modalités et la faisabilité de l'institution d'un ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne visant à restaurer l'intégrité économique et environnementale de la poli- tique climatique européenne. Il s'agit de créer un « sas de décompression » ou une « écluse » entre produits étrangers et produits européens afin de ne pas altérer la politique climatique européenne et d'éviter les « fuites de carbone ». Les effets attendus d'un tel dispositif se situe de façon imbriquée sur le terrain environnemental et sur le terrain économique : il s'agit tout à la fois de préserver l'intégrité environnementale des politiques climatiques et, ce faisant, d'enrayer les pertes artificielles de parts de marché pour les producteurs européens, tant sur les marchés intérieurs que sur les marchés internationaux. Après avoir étudié les conditions légales d'entrée en vigueur de cette mesure, l'article conclut que sous certaines conditions un ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne contribuerait à renforcer la cohérence et la crédibilité de l'engagement européen en matière climatique. Mots-clés : ajustement carbone, fuites de carbone, Union européenne, OMC. Revue de l’OFCE / Débats et politiques – 120 (2011)
- 180. 178 Olivier Godard L a conclusion de la Conférence de Copenhague en décembre 2009, confirmée par la Conférence de Cancun en décembre 2010, a accentué l’une des caractéristiques de la scène des politiques climatiques : la dualité existant entre les politiques souveraines, nationales ou régionales, comme dans le cas de l’Union euro- péenne, et le régime international en formation. Depuis le sommet de Rio en 1992, avait prévalu une dynamique d’intégration inter- nationale forte, prenant la forme à Kyoto en 1997 d’un calendrier d’objectifs quantifiés de réduction des émissions par pays, assorti de la possibilité d’échanger les quotas correspondants. Copen- hague a déplacé le curseur en sens inverse. La coordination internationale est maintenant proche du modèle de l’auberge espa- gnole : chaque État définit lui-même de façon indépendante la nature et le niveau de son engagement en fonction de sa situation politique intérieure, en communique la teneur à ses partenaires et se soumet à un processus de vérification de ses réalisations qui doit préserver la souveraineté de chaque État. Alors que la conférence de Durban en décembre 2011 doit stabi- liser le nouveau régime, et notamment les avancées périphériques sur le terrain du financement de la lutte contre la déforestation et des transferts de technologies, la nouvelle donne introduite par la bifurcation de Copenhague valide une grande hétérogénéité des ambitions, des efforts et des coûts. Cela aura nécessairement des implications économiques puisque, dans une économie mondia- lisée, des producteurs en concurrence se verront exposés à des contraintes sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’inten- sité sensiblement différente d’un pays à l’autre, et donc à des coûts de réduction des émissions ou d’achats de quotas de GES eux- mêmes très hétérogènes. Cela ne manquera pas d’affecter les coûts de production d’entreprises en concurrence sur les mêmes marchés de biens. Pour la plupart des produits élaborés proposés au consommateur final, pour lesquels le contenu en énergie fossile est faible, voire négligeable, l’incidence ne sera pas sensible. Il en ira autrement pour les matériaux de base dont la production est tech- nologiquement intensive en énergie et pour des produits de
- 181. Condition de la crédibilité d’une politique européenne du climat ambitieuse 179 première transformation si aucune mesure particulière n’est adoptée pour rétablir des conditions de concurrence saines, le leveled playing field des anglo-saxons. Ayant été marginalisée dans la négociation alors qu’elle se croyait leader, l’Europe se trouve renvoyée à l’appréciation souve- raine de son devenir et de son positionnement dans un monde que l’approvisionnement énergétique et le changement climatique vont durablement bouleverser. Cela fait plusieurs années que la crainte des effets pervers de cette hétérogénéité économique inter- nationale des politiques climatiques a conduit certains experts (Ismer et Neuhoff, 2007 ; Godard, 2007 ; Monjon et Quirion, 2010) et responsables politiques, en particulier en France (Wiers, 2008), à proposer de compléter les dispositifs nouvellement mis en place (marché européen du carbone depuis janvier 2005) par des méca- nismes d’ajustement économique aux frontières centrés sur les émissions de GES des industries de base grandes émettrices (acier, ciment, aluminium, verre, raffinage). Il s’agit de créer un « sas de décompression » ou une « écluse » entre produits étrangers et produits européens afin de ne pas altérer la politique climatique européenne et d’éviter les « fuites de carbone »1. Sans exclure formellement cette option, mentionnée dans le paquet climat- énergie européen, la Commission et la plupart des États membres se sont tenus à distance de ces idées autant qu’ils l’ont pu, crai- gnant de compromettre les efforts diplomatiques ou de déclencher des mesures de représailles. Refoulée, la question ne peut que revenir sur le devant de la scène si l’Union européenne veut retrouver un minimum de crédibilité dans l’affirmation d’une ambition sur la question climatique, que marquerait l’adoption d’un objectif de -30 % d’émissions de GES en 2020 par rapport à 1990, objectif rendu accessible et, aux yeux de certains, souhaitable pour de strictes raisons économiques, par le contexte de la crise financière et économique amorcée dans les économie occidentales en 2007. 1. Voir Godard (2011) pour une présentation plus approfondie à la fois des mécanismes envisageables et de leur recevabilité par les règles de l’OMC.
- 182. 180 Olivier Godard 1. De quoi s’agit-il ? 1.1. Les fuites de carbone Ce qu’on appelle les « fuites de carbone » (carbon leakage) désigne l’augmentation des émissions de GES dans les pays sans politique climatique entraînée par les politiques de réduction opérées dans la zone des pays proactifs. Le « taux de fuite », ou « ratio fuites/émissions » est défini comme le rapport entre l’augmentation des émissions des premiers et les réductions des seconds par comparaison avec la situation prévalant avant l’intro- duction d’une politique climatique. Ces fuites relèvent de plusieurs mécanismes. Le premier et le plus important passe par l’abaisse- ment relatif des prix des ressources fossiles sur les marchés internationaux : du fait d’une contraction relative de la demande en énergie fossile des pays « vertueux », les autres pays devraient pouvoir accéder à ces ressources pour un moindre prix, ce qui entraînerait une hausse de leur demande. S’il s’agit des pays en développement, on peut considérer qu’il s’agit là d’une forme indi- recte d’aide prise en charge par les pays développés. Il en va autrement pour des pays comme la Chine ou la Corée du Sud, la première ayant atteint un niveau d’émission par tête équivalent à celui de la France et la seconde presque le double. La seconde voie des fuites est la redistribution internationale d’une partie de la production des industries très intensives en émissions, du fait de la transformation des conditions de concurrence à la fois sur les marchés intérieurs des pays vertueux et sur les marchés internatio- naux. Une troisième voie est celle de la substitution de certains produits énergétiques « intensifs en carbone » par des produits importés, comme dans le cas des agro-carburants produits dans les pays en développement et indirectement et partiellement respon- sables des émissions de la déforestation en cours dans certains de ces pays. Le problème des fuites est surtout concentré sur certains secteurs ou sous-secteurs, contrairement à ce que laisse supposer la liste étendue des secteurs exposés à un risque de compétitivité retenue fin 2009 par l’Union européenne (European Commission, 2010). La production d’acier, d’aluminium ou de ciment, le raffi- nage pétrolier comptent parmi les plus touchés, mais d’une façon qui va être affectée par la localisation géographique : les activités
- 183. Condition de la crédibilité d’une politique européenne du climat ambitieuse 181 les plus affectées sont celles situées sur le littoral ; les activités éloi- gnées des côtes sont davantage protégées par les coûts de transports terrestres, élevés pour des produits pondéreux2. 1.2. Visée et signification d’un ajustement aux frontières de l’Europe Certains responsables politiques ont parlé, sans doute un peu hâtivement, de « taxes aux frontières » qui seraient ciblées sur les pays refusant de prendre des engagements climatiques compa- rables ou de se joindre à un nouvel accord sur le climat. Les solutions envisagées dans les milieux européens prenaient en fait surtout la forme de l’instauration d’une obligation des importa- teurs de se procurer des quotas de GES sur le marché européen du carbone afin de les restituer aux autorités, de la même façon que les producteurs européens soumis à ce marché le font depuis 2005. Les effets attendus de tels dispositifs se situent de façon imbri- quée sur le terrain environnemental et sur le terrain économique : il s’agit tout à la fois de préserver l’intégrité environnementale des politiques climatiques reposant sur l’introduction d’un prix pour le carbone, menacée par la non-transmission du prix du carbone de l’amont à l’aval des filières jusqu’au consommateur final et, ce faisant, d’enrayer les pertes artificielles de parts de marché pour les producteurs européens, tant sur les marchés intérieurs que sur les marchés internationaux. Les deux dimensions sont imbriquées car si la production européenne devient carbo-vertueuse du fait de la politique climatique européenne, préserver ses parts sur le marché européen et mondial est un moyen efficace de contribuer à une limitation globale des émissions de GES d’origine industrielle. Les accusations selon lesquelles les projets d’ajustement aux frontières ne seraient que l’expression d’un vil protectionnisme commercial sans réalité environnementale sont en porte-à-faux avec les méca- nismes économiques de base, autrement dit sont idéologiques, quelle que soit la pondération des objectifs dans la tête des respon- sables qui prônent un tel ajustement. Il ne faut pas se tromper. Sans négliger la dimension de la compétitivité, mais en la replaçant dans le contexte d’une stratégie de développement durable de la région Europe, c’est bien l’inté- 2. Voir Ponssard et Walker (2008) pour le cas du ciment.
- 184. 182 Olivier Godard grité économique et environnementale de la politique climatique européenne qui est le premier enjeu d’un ajustement aux fron- tières. En effet sans ajustement aux frontières la pression des prix internationaux sur tous les marchés, étrangers comme européens, érodera, voire annulera, l’effet attendu de la transmission du signal-prix sur le carbone en aval de la production des matériaux de base. Dans un monde économique où les prix implicites des émis- sions de carbone sont fortement hétérogènes, le simple « laissez- faire, laissez- passer » des échanges commerciaux internationaux, sans mécanisme d’ajustement, aurait pour effet, dans tous les pays, d’imposer peu ou prou des prix internationaux ignorant le coût du carbone. Les installations situées dans des pays à politique clima- tique ambitieuse ne pourraient guère répercuter le prix du carbone qu’elles supportent ou son coût d’opportunité dans la détermina- tion du prix de vente de leurs produits ; ce qu’on appelle le taux de pass-through serait tendanciellement nul ou faible. Cela signifierait que la transmission du signal-prix du carbone vers l’aval des filières serait interrompue ou fortement altérée. Certes, selon les branches, cette tendance délétère pourrait être limitée par d’autres facteurs comme les coûts de transports, l’effet qualité ou la spécificité des circuits de distribution, jouant inégalement selon les branches et la géographie3, mais la poursuite de la mondialisation ne pourra qu’accentuer son influence à l’avenir. Or l’efficacité économique globale demande que soit transmise en aval l’incidence pleine du coût des émissions de GES imputé à une branche ou à une entre- prise sur les prix des produits proposés tout au long des filières, idéalement jusqu’au consommateur final. C’est que la politique climatique n’a pas pour seul ressort une modification des techniques de production d’un maillon pour une demande à la structure demeurant inchangée. Elle doit également provoquer, à travers la transformation des prix relatifs, une modifi- cation des demandes adressées à différents produits. Corrigé par la politique climatique, le mécanisme économique doit inciter les consommateurs finaux à accroître leur demande pour des biens à bas profil en carbone et à la réduire pour les biens intensifs en carbone. Certaines activités doivent régresser ou céder la place 3. Ainsi, pour le ciment, les prix en France et en Allemagne sont aujourd’hui sensiblement différents, sans s’égaliser, du fait du poids des coûts de transports terrestres et d’autres obstacles aux échanges.
- 185. Condition de la crédibilité d’une politique européenne du climat ambitieuse 183 devant d’autres, davantage en phase avec les exigences d’une économie à bas profil en carbone. La défense de « la compétiti- vité » ne peut raisonnablement pas justifier de vouloir conserver à tout prix les équilibres concurrentiels d’avant la politique clima- tique. Cela touche en particulier les matériaux de construction : ciment, aluminium, acier et bois se concurrencent dans la construction, via les choix de conception architecturale et de maté- riaux. Si les conditions de la concurrence en viennent à refléter pleinement les nouvelles contraintes carbone, un coup de fouet important serait ainsi donné à l’utilisation du bois, qui permet de fixer durablement du carbone. 2. Le design Selon la proposition française d’un mécanisme d’inclusion carbone des importateurs, ces derniers auraient à restituer un volume de quotas correspondant à la quantité que le producteur européen devra acquérir en moyenne pour la même quantité de produits, sauf si le producteur étranger peut prouver des émissions inférieures. Cette solution évite les complications du recueil des données sur les émissions réelles de chaque producteur étranger. Techniquement, l’importateur aurait alors deux options. Selon la première, forfaitaire, il aurait à restituer des quotas équivalents à la différence entre les émissions moyennes de la branche de produc- tion concernée en Europe et le niveau du benchmark retenu par la Commission européenne pour accorder une allocation gratuite de quotas. Avec la seconde, l’importateur choisirait d’apporter la preuve que ses produits sont moins intensifs en émissions de carbone que la moyenne européenne ; il devrait alors restituer des quotas à la hauteur de la différence entre ces émissions prouvées et le benchmark européen. Ismer et Neuhoff (2007) et Godard (2007) avaient pour leur part proposé de se fonder sur les émissions des meilleures technologies disponibles employées en Europe pour déterminer le niveau de quotas à restituer par les importateurs en admettant la fiction que les producteurs étrangers avaient des émissions à la hauteur des meilleures technologies. Ainsi un avantage concurrentiel serait concédé systématiquement aux importateurs par rapport aux producteurs européens. Cette solution reposait sur l’idée que le
- 186. 184 Olivier Godard calibrage du mécanisme devait se situer entre deux bornes. D’un côté il devait demeurer favorable aux pays tiers par rapport à la situation concurrentielle qui prévaudrait si l’Europe renonçait à tout objectif de réduction de ses émissions en donnant la priorité à sa compétitivité économique. Cette première borne était retenue afin qu’il ne puisse pas être dit que les concurrents étrangers soient désavantagés ou discriminés par le dispositif proposé. De l’autre côté il devait réduire l’avantage concurrentiel indu que les produc- teurs des pays tiers retireraient d’un engagement unilatéral de l’Europe dans une politique climatique ambitieuse qui ne serait accompagnée d’aucune mesure pour rééquilibrer les conditions de concurrence dans les secteurs exposés ; outre le désavantage commercial et industriel subi et l’effet négatif mécanique sur les émissions globales de GES, un tel avantage pourrait en effet inciter les pays tiers à ne pas vouloir rejoindre une coalition internatio- nale engagée dans une politique ambitieuse du climat symbolisée ces dernières années par l’objectif des 2°C d’augmentation maxi- male de la température moyenne du globe par rapport aux débuts de l’ère industrielle. Pour Godard (2007, 2011), le mécanisme devrait également inclure, par symétrie, la réattribution de quotas aux producteurs européens pour leurs exportations hors l’Union afin de leur permettre de se positionner correctement sur les marchés étran- gers. Selon une formule alternative, les autorités européennes détermineraient à la fois les obligations de restitution de quotas des entreprises européennes et l’allocation primaire des quotas gratuits qui doivent leur revenir au prorata de la part de la production destinée au seul marché intérieur européen ; cela pourrait alors se faire en deux temps : d’abord une allocation ex ante à partir de la répartition des ventes entre le marché européen et le marché inter- national telle qu’elle a été constatée dans le passé le plus récent ; ensuite une régularisation opérée ex post pour tenir compte des données réelles de partage des marchés. Avec ses deux faces, l’une sur l’importation, l’autre sur l’expor- tation, le dispositif d’ajustement évoqué rapprocherait la régulation européenne d’une orientation centrée sur la consomma- tion opérée sur le territoire tout en régulant la production destinée à cette consommation-là en fonction du niveau d’ambition de la politique climatique de ce territoire. Les deux sources d’approvi-
- 187. Condition de la crédibilité d’une politique européenne du climat ambitieuse 185 sionnement de la consommation sur le territoire européen (production intérieure et importation) seraient symétriquement exposées à une régulation économique des émissions. Une telle approche aurait le grand avantage d’être généralisable comme solu- tion potentiellement universelle dans le respect de l’appréciation souveraine par chaque État du niveau d’ambition de sa politique climatique. 3. La compatibilité avec les règles de l’OMC Le régime de l’OMC comporte un régime général et un régime d’exceptions, notamment pour des objectifs environnementaux (Article XX). La compatibilité de l’introduction unilatérale d’ajus- tements aux frontières doit donc être appréciée au regard de ces deux ensembles de règles. Contrairement à des vues couramment exposées (Abbas, 2008), il existe de bonnes raisons pour défendre la compatibilité d’un système complet d’ajustement aux frontières, portant à la fois sur les importations et sur les exportations, pour les émissions de GES (Godard, 2011). Elle serait acquise pour le régime général dès lors que l’obligation faite aux importateurs d’acquérir des quotas d’émission serait assimilée à une charge pécuniaire équivalente à une charge portant sur un intrant consommé dans le processus de production de « produits simi- laires » destinés au marché intérieur. L’incertitude porte encore actuellement, faute d’un arbitrage clair sur ces points de la part de l’Organe de règlement des différends, sur l’assimilation de l’instru- ment des quotas négociables à une taxe indirecte, tel un droit d’accise, et sur l’acceptation d’un ajustement pour des charges pesant sur des intrants qui, bien qu’avérés, sont seulement consommés ou utilisés dans la production, et non physiquement incorporés (le CO2 émis ne se retrouve pas dans le produit vendu). Le régime des exceptions est l’objet de l’Article XX du GATT de 1994, à la fois pour l’alinéa b) qui écarte l’interdiction des mesures « nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux » et pour l’alinéa g) celle des mesures « se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjoin- tement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationale ». Cet article est introduit par un chapeau qui définit les
- 188. 186 Olivier Godard conditions de mise en œuvre de ces alinéas, une fois réunies les conditions de fond : une mesure d'ajustement affectant le commerce international ne doit pas « constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international ». Les conditions de fond mises pour l’acceptation d’exceptions ne prêtent guère à discussion, s’agissant des objectifs visés par la poli- tique climatique : tant les idées de préservation de la vie et de la santé des hommes et des animaux et de préservation des végétaux que celle de conservation de ressources naturelles épuisables recou- pent les préoccupations sous-tendant l’action internationale de protection du climat. Tout comme d'autres régions du monde, l'Europe a un intérêt direct à éviter une évolution dangereuse du climat mondial, son territoire devant être touché soit de façon directe (remontée du niveau de la mer et érosion des côtes, altéra- tion des régimes de précipitations, invasions biologiques et diffusion de nouveaux pathogènes, événements extrêmes) soit de façon indirecte (pressions migratoires non choisies, conflits inter- nationaux, nouvelles obligations de solidarité internationale envers les victimes d’événements catastrophiques) si un niveau dangereux de changement climatique était atteint. Il y a davantage matière à discuter sur le degré de nécessité de mesures d’ajustement aux frontières pour l’objectif visé. Il faut en passer par des raisonne- ments économiques sur le rôle des prix dans la régulation des comportements et les niveaux d’émission de GES qui en résultent, reconnaître l’insertion d’une mesure dans une politique d’ensemble (chose admise par l’ORD) et mettre en évidence le besoin de préserver l’intégrité économique de la politique clima- tique pour assurer son intégrité environnementale. Un ajustement sur les exportations serait compatible avec l’Accord sur les Subventions et les Mesures Compensatoires dans les différents cas de figure : a) si le statut de charge pécuniaire sur un intrant est reconnu comme éligible à un ajustement, alors ce dernier est compatible avec le régime général qui autorise un ajustement symétrique sur les exportations ;
- 189. Condition de la crédibilité d’une politique européenne du climat ambitieuse 187 b) si le statut de charge pécuniaire est retenu, mais non éligible car cette charge concernerait des intrants non-incorporés, les quotas d’émission tombent, du fait de leur organisation actuelle, dans la catégorie des impositions en cascade, qui ouvrent droit à ajustement ; c) si l’obligation de restituer des quotas aux autorités publiques à hauteur des émissions de référence n’est finalement pas considérée comme une charge pécuniaire, alors son exonération partielle pour la production destinée à l’exportation ne peut pas être considérée comme une subvention, c’est-à dire une contribution financière, d’autant qu’elle ne confère aucun avantage nouveau, se contentant d’effacer un désavantage imposé volontairement. L’unilatéralisme des mesures d’ajustement aux frontières auquel il peut être nécessaire de recourir est-il abusif et incompatible avec la recherche de l’équilibre des droits que recherche l’OMC ? À la différence d’une mesure hypothétique d’exclusion de certains importateurs de matériaux de l’accès au marché européen, qui démarquerait la mesure américaine prise contre les importations de crevettes malaisiennes dans le but de préserver les tortues marines dont l’espèce était menacée d’extinction, l’obligation des importateurs de se procurer des quotas d’émission sur le marché ou auprès des autorités publiques est une mesure flexible qui n’impose rien qui puisse porter atteinte à la souveraineté des pays exporta- teurs ou contrevenir aux conditions particulières régnant dans ces pays, conditions qui rendraient particulièrement difficile pour eux de se soumettre à cette obligation. En principe l’Union ne pourrait adopter ces mesures sans avoir chercher à négocier avec les pays tiers un accord international visant les objectifs de protection qu’elle poursuit. La vingtaine d’années de négociation et de propo- sitions faites à ses partenaires par l’Union depuis la création du Comité international de négociation qui a préparé la Convention de Rio en 1992 apporte à cet égard un témoignage de grande richesse et peu contestable. Deux restrictions doivent néanmoins être prises en compte. Si un pays exportateur a adopté une politique à l’efficacité compa- rable, du point de vue de l’objectif environnemental, à celle du pays importateur, ce dernier ne peut pas lui imposer d’ajustement aux frontières au titre de l’Article XX. Dans la mesure où l’objectif premier d’un tel ajustement est la préservation de l’intégrité écono-
- 190. 188 Olivier Godard mique et environnementale de la politique climatique, la comparabilité doit s’apprécier branche par branche, c’est-à-dire là où opère la concurrence et se joue la répartition des parts de marché. Il incombe donc au pays importateur de démontrer, en cas de différend, que la politique adoptée par les plaignants n’a pas une efficacité comparable à la sienne au regard des objectifs clima- tiques dans les branches concernées. Ensuite, les pays placés dans des conditions semblables doivent être traités de façon semblable, ce qui exclut a priori l’introduction d’une différence de traitement entre les signataires d’un accord multilatéral sur le climat et d’autres pays semblables qui n’en seraient pas signataires. Par contre rien n’interdit, dans le cadre de l’article XX, que des pays au niveau de développement différents soient traités de façon différente, par exemple en instaurant une exemption pour les pays les moins avancés. Toutefois l’article XX ne crée aucune obligation en ce sens. Les tests de comparabilité à réaliser par le pays importateur diffèrent selon que la mesure est examinée au regard des règles du régime général ou au regard de l’Article XX. Si l’examen se fait dans le cadre du régime général, le principe de destination demande seulement que soit évalué le traitement des produits importés dans le pays importateur afin de vérifier qu’il n’est pas moins favorable que celui des produits nationaux. L’obligation faite à des importa- teurs de se procurer des quotas d’émission dans les mêmes conditions que celles faites aux producteurs européens assurerait l’absence de traitement moins favorable, sans qu’il soit besoin de prendre en compte le niveau de taxation ou les coûts supportés dans les pays exportateurs. Si l’examen est effectué dans le cadre de l’Article XX, la comparaison doit porter sur le seul niveau de la performance environnementale des politiques respectives des pays en présence, performance appréhendée au niveau d’agrégation approprié où s’exerce la menace pour l’intégrité de la politique du pays importateur, c'est-à-dire en l’occurrence la branche qui abrite les produits similaires en concurrence. Les règles de l’OMC n’obli- gent en rien à entreprendre une comparaison généralisée des coûts entre les conditions de production à travers le monde.
- 191. Condition de la crédibilité d’une politique européenne du climat ambitieuse 189 4. Pour une approche intégrée de la politique européenne du climat Du point de vue géopolitique l’enjeu de l’instauration d‘ajuste- ments aux frontières de l’Europe pour les émissions de GES est de se donner les moyens d’asseoir la crédibilité d’engagements ambi- tieux de maîtrise des émissions de GES et son refus de rester passive après sa mise à l’écart de la négociation de l’Accord de Copen- hague. L’initiative devrait d’autant plus être prise sur ce terrain qu’elle peut constituer la clé du dénouement de deux autres problèmes : l’assainissement réel des règles de l’ETS puisque les bons principes retenus par la Directive d’avril 2009 perdent beau- coup en réalité pour ce qui concerne les activités industrielles du fait du régime des exceptions maintenant la gratuité des quotas pour les secteurs dits exposés ; le dégagement de sources nouvelles et vérifiables de financement des transferts financiers promis aux pays en développement à Copenhague. Une des avancées résultant de l’Accord de Copenhague s’est faite sur le terrain des engagements financiers pris collectivement par les pays industriels envers les pays en développement. Des montants ont été avancés. Un Fonds de démarrage rapide de 30 G$ pour la période 2010-2012 devait être mis sur pied et, à partir de 2020, ce sont 100 G$ qui doivent être annuellement apportés par les pays industriels. L’Union européenne s’est ainsi engagée pour 10,4 G$ sur les trois années 2010-2012 (soit plus du tiers du Fonds et 0,021 % du PIB européen), les États-Unis pour 1,3 G$ en 2010 et 1,7 en 2011, et la France pour 1,74 G$ au total sur les trois années, soit 5,8 % du total à financer4 (WRI, 2010). Les pays en développe- ment tiennent à ce que ces financements soient nouveaux, additionnels, mesurables et vérifiables afin d’éviter le renouvelle- ment d’expériences antérieures où des engagements financiers n’étaient pas tenus ou donnaient simplement lieu à des transferts à partir d’autres budgets existants d’aide au développement et de coopération, sans additionnalité globale5. 4. Sur la base du même pourcentage de contribution, ce sont environ 6 G$ que la France devrait dégager annuellement à compter de 2020 au titre des transferts aux pays en développement pour motif climatique. 5. L’affaire est juridiquement compliquée car il n’existe actuellement aucune définition reconnue de la base de référence à adopter pour déterminer l’additionnalité. Certains gouvernements sont tentés de considérer comme additionnel tout financement de projets nouveaux, sans s’engager sur les sources de ce financement.
- 192. 190 Olivier Godard D’où peut venir cet argent ? Sur le papier on peut envisager d’accroître les impôts payés par les contribuables ou de tailler dans d’autres dépenses publiques à due concurrence ou encore d‘instaurer une taxe internationale (sur les transports, sur les tran- sactions financières). Du fait des difficultés des finances publiques dans de nombreux pays, un projet d’augmentation de la fiscalité générale ayant pour seule fin de financer des transferts internatio- naux représentant, en fonction de l’évolution des négociations, entre 0,02 % (engagements actuels) et 0,5 % (borne plus proche des demandes des PMA) de leur PIB risque de rencontrer des obstacles politiques sérieux dans les pays développés. Ces obstacles ne risquent guère de disparaître alors que, par ailleurs, des pays comme la Chine, l’Inde et le Brésil deviennent largement perçus par l’opinion comme la source de la crise de l’emploi industriel et de la régression du revenu des classes moyennes dans les vieux pays industriels… La procédure de mise aux enchères de quotas d’émission de GES pourrait jouer un rôle important pour rendre politiquement possible l’apport des ressources financières recherchées. Toutefois la généralisation sans dérogation de la procédure d’enchères impli- querait des transferts financiers des entreprises vers des budgets publics qui ne sont pas envisageables sans la mise en place d’un ajustement aux frontières pour presque toutes les activités indus- trielles soumises à l’ETS6, afin de préserver conjointement l’intégrité de la politique climatique et la viabilité économique de ces activités. À l’échelle de l’Union européenne, les installations industrielles qui, en l’état actuel des règles du jeu, doivent bénéficier du main- tien dérogatoire d’une allocation gratuite représentent un quart des émissions couvertes par l’ETS. Le renoncement aux enchères pour ces secteurs pourrait conduire à faire échapper aux prélève- ments entre 200 à 400 MtCO2 en 2020, selon l’écart entre les émissions moyennes et celles des benchmarks sectoriels retenus par la Commission pour l’attribution gratuite de quotas. Cela pourrait représenter, à 30 euros/tCO2 – valeur adoptée par la Commission 6. La production d’électricité n’est pas concernée par l’ajustement aux frontières car, en l’état du réseau de distribution, l’électricité ne s’échange, pour l’essentiel, qu’au sein de l’Union européenne.
- 193. Condition de la crédibilité d’une politique européenne du climat ambitieuse 191 européenne pour identifier les secteurs exposés –, une enveloppe annuelle comprise entre 6 et 12 G€, soit entre 8 et 16 G$ pour un taux de change euro/dollar de 1,35. Ce montant est à rapprocher des 33 G$ à dégager par les États membres pour contribuer au Fonds de Copenhague de 100 G$ en 2020, s’ils maintiennent le même taux de participation que dans le Fonds de démarrage rapide. En mettant également au pot en tant que de besoin le produit des enchères de quotas destinés au secteur électrique, c’est la totalité des ressources nécessaires aux transferts financiers à assumer dans la durée vis-à-vis des pays en développement qui pourrait être trouvée dans la mise aux enchères des quotas. Cette analyse montre l’intérêt qu’il y aurait pour l’UE à lier quatre aspects de la politique climatique souvent disjoints ou mal articulés : — les règles d’allocation interne de quotas de GES aux producteurs européens dans les secteurs industriels intensifs en émission ; — la réduction des risques de fuite de carbone et d’atteinte à l’inté- grité de la politique climatique européenne créé par le jeu d’un commerce international ignorant le prix du carbone des pays les plus avancés ; — la prise en charge par l’UE de transferts financiers au bénéfice des pays en développement en conformité avec les engage- ments internationaux pris à Copenhague et confirmés à Cancun ; — la définition d’accords sectoriels internationaux, multi ou bila- téraux, entre l’UE et des pays émergents comme la Chine et l’Inde pour les secteurs de la production électrique et des indus- tries de matériaux (Meunier et Ponssard, 2011). Créer un lien organique entre ces quatre aspects, en les propo- sant comme un paquet d’ensemble dans le cadre de la négociation internationale permettrait de mieux résoudre des problèmes que des solutions séparées résolvent mal. Par ailleurs, le monde indus- triel ne pourrait plus plaider la perte artificielle de compétitivité et les conditions d’une concurrence inégale pour garder à son profit l’essentiel de la rente de rareté associée à la contrainte carbone (Perthuis, 2009). Enfin, l’établissement de ce lien contribuerait à la pacification des relations géopolitiques dans la mesure où les pays bénéficiaires des transferts financiers n’auraient de manière
- 194. 192 Olivier Godard évidente guère intérêt à remettre en cause le dispositif et à en faire une source de contentieux, puisque le succès de leur entreprise reviendrait à tarir la source des financements dont ils bénéficieraient. Au total l’ensemble des partenaires de l’UE devraient pouvoir comprendre que le paquet ainsi formé serait une contribution posi- tive et équilibrée au développement durable des pays en développement comme à celui des pays industriels. Bien conçu, le mécanisme d’ajustement aux frontières n’est ni une sanction ni un acte hostile envers les pays tiers, mais un élément essentiel de cohérence et de crédibilité de l’engagement européen. Références bibliographiques Abbas M., 2008, Trade policy and climate change: options for a European border adjustment measure, Paris, Fondation pour l’innovation poli- tique, Working Paper 3, septembre. European Commission, 2010, « Commission Decision of 24 December 2009 determining, pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council, a list of sectors and subsectors which are deemed to be exposed to a significant risk of carbon leakage », Offi- cial Journal of the European Union, L 1, 5 janvier, pp. 10-18. Godard O., 2007, « Unilateral European Post-Kyoto climate policy and economic adjustment at EU borders », Cahiers de la Chaire Développe- ment durable X-EDF, DDX-07-15, octobre, (41 p.). http://chaire-edf-ddx.polytechnique.fr/accueil/recherche/cahiers-2007 Godard O., 2011, « Intégrité environnementale des politiques climatiques et ajustement aux frontières : les enjeux pour l’Union européenne », in O. Godard et J.P. Ponssard (dir.), Économie du climat – Pistes pour l’après- Kyoto. Palaiseau, Ed. de l’École polytechnique, pp. 177-240. Ismer R. and K. Neuhoff, 2007, « Border tax adjustments: a feasible way to support stringent emission trading », European Journal of Law Economics, 24, pp. 137–164. Monjon S. et P. Quirion, 2010, « How to design a border adjustment for the European Union Emissions Trading Systems », Energy policy, 38, pp. 5199-5207. Meunier G. et J.-P. Ponssard, 2011, « Les approches sectorielles et les enjeux d’équité et de compétitivité », in O. Godard et J.-P. Ponssard (dir.), op. cit., pp. 243-262. Perthuis C. de (2009), Et pour quelques degrés de plus ... Paris, Pearson.
- 195. Condition de la crédibilité d’une politique européenne du climat ambitieuse 193 Ponssard J.-P. et N. Walker, 2008, « EU Emissions Trading and the Cement Sector: a Spatial Competition Analysis », Climate Policy, 8, pp. 467-493. http://www.earthscanjournals.com/cp/008/05/default.htm Wiers J., 2008, « French Ideas on Climate and Trade Policies », Climate and Carbon Law Review, (1), pp. 18-32. World Resource Institute, 2010, Summary of Developed Country Fast-Start Climate Finance Pledges. Washinton DC, 2 octobre. http://pdf.wri.org/ climate_finance_pledges_2010-10-02.pdf
- 196. 194 Olivier Godard
- 197. Part. 3 ÉCONOMIE DE LA SOUTENABILITÉ Agriculture mondiale et européenne : défis du XXIe siècle . . . . . . . 197 Jacques Le Cacheux Faut-il décourager le découplage ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Éloi Laurent L’épargne nette ré-ajustée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Céline Antonin, Thomas Mélonio et Xavier Timbeau La mesure de la soutenabilité : les antécédents, les propositions et les principales suites du rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi . . . . . . . . . 287 Didier Blanchet Nouvelles réflexions sur la mesure du progrès social et du bien-être . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 Jean-Paul Fitoussi et Joseph E. Stiglitz Revue de l’OFCE / Débats et politiques – 120 (2011)
- 199. AGRICULTURE MONDIALE ET EUROPÉENNE : DÉFIS DU XXIe SIÈCLE Jacques Le Cacheux OFCE, Observatoire français des conjonctures économiques L’agriculture mondiale est parvenue, au cours des décennies passées, à nourrir une population mondiale en forte croissance ; elle a également fourni des quantités croissantes de matières premières industrielles. Mais, alors même que l’essor de la population mondiale ralentit, l’augmentation de la production agricole soulève, dans la plupart des régions du monde, des difficultés, liées à la manière dont les hausses des volumes ont été obtenues – mise en culture de terres nouvelles prises sur les milieux naturels sauvages, notamment la forêt, intensification de l’usage des intrants (eau, engrais minéraux, pesticides), et des prélèvements sur les ressources halieutiques, etc. Dans un contexte dominé par le changement climatique, la dégradation de l’environnement naturel, la perte de biodiversité, et la raréfaction de certaines ressources, notamment fossiles, l’agriculture mondiale est confrontée à de nombreux défis. Elle devra, au cours des prochaines décennies, améliorer, en quantité et en qualité, l’offre alimen- taire, tout en fournissant des matières premières industrielles, et en réduisant sa pression sur l’environnement naturel. Les politiques agricoles doivent, pour ce faire, être infléchies partout dans le monde, qu’il s’agisse de celles menées dans les pays en développement, des politiques de libéralisation des échanges inter- nationaux au sein de l’OMC, ou de la Politique agricole commune (PAC), dont la réforme est actuellement discutée. Mots-clés : agriculture, alimentation. Revue de l’OFCE / Débats et politiques – 120 (2011)
- 200. 198 Jacques Le Cacheux D ans le courant de l’été 2011, les nouvelles alarmantes sur l’extension de la famine dans la Corne de l’Afrique sont venues rappeler que, parmi toutes les crises qui affectent l’économie mondiale depuis quelques années, celle de l’alimentation prend, dans certaines régions du globe, un tour particulièrement drama- tique. L’évolution des cours mondiaux des matières premières, notamment des denrées agricoles, est jugée si préoccupante que la présidence française du G20 a inscrit la régulation de ces marchés à l’agenda des discussions du prochain sommet, à Cannes en novembre 2011. Mais dans le même temps, les revenus de la majo- rité des agriculteurs européens se contractent et plusieurs gouvernements – dont celui de la France – font jouer à leur profit des dispositifs de solidarité nationale. Les paradoxes de la situation agricole mondiale sont ainsi très nombreux et les évolutions obser- vées en apparence difficilement conciliables : partout les prix à la consommation des produits alimentaires connaissent une progres- sion bien supérieure à l’inflation moyenne, ce qui pose, partout, un problème de pouvoir d’achat frappant de manière dispropor- tionnée les franges les moins aisées ou les plus pauvres des populations – celles pour lesquelles l’alimentation représente la part prépondérante du budget de consommation ; simultanément pourtant, nombre de producteurs agricoles des pays développés, et singulièrement dans l’Union européenne, voient les prix de vente de leur production s’effondrer et l’avenir de leurs exploitations menacé. L’augmentation tendancielle de la population mondiale, et son accélération dans les années 1950-1960 ont longtemps focalisé l’attention sur le défi alimentaire : nourrir la planète a été, pendant des décennies, l’objectif prioritaire des politiques publiques et des aides au développement en direction des pays les moins favorisés. Le « productivisme » qui a caractérisé les politiques agricoles des pays développés, notamment dans les décennies qui ont suivi la fin de la Seconde guerre mondiale, mais aussi les « révolutions vertes » mises en œuvre dans nombre de pays émergents par la suite, a pu apparaître une réponse efficace et suffisante face à l’augmentation
- 201. Agriculture mondiale et européenne : défis du XXIe siècle 199 de la population mondiale et à la persistance d’une insuffisance de l’offre alimentaire dans de nombreuses régions du monde. Mais aujourd’hui encore, même si la famine n’est plus endémique nulle part, environ 1 milliard d’êtres humains disposent, selon les insti- tutions internationales, d’une alimentation insuffisante, en quantité et en qualité, pour être en bonne santé. Et la croissance démographique se poursuit dans de nombreuses régions du monde, comme l’indiquent les plus récentes projections démogra- phiques de l’ONU (2011). Pourtant, les défis auxquels doit faire face l’agriculture mondiale en ce début de XXIe siècle sont plus divers et plus complexes que la simple nécessité de « nourrir la planète », dont l’expérience des dernières décennies montre qu’elle est, en termes purement quantitatifs, à portée de main : la disponibilité des terres, les progrès techniques – notamment dans les méthodes culturales, l’irrigation, la sélection et les biotechnologies – permet- tent assurément de produire beaucoup plus, et les marges de progression sont, dans bon nombre de régions du monde – notam- ment en Afrique sub-saharienne – considérables. Néanmoins, la question de la sécurité alimentaire apparaît moins univoque : il ne s’agit pas seulement d’assurer des approvisionnements globale- ment suffisants, mais souvent aussi, pour chaque pays ou chaque région, de préserver une certaine autonomie et d’éviter une trop grande dépendance à l’égard du reste du monde pour les denrées agricoles considérées comme vitales. La notion de sécurité alimen- taire recouvre également l’idée d’une alimentation saine, dans une perspective de santé publique, c’est-à-dire à la fois équilibrée en nutriments essentiels et ne risquant pas de menacer, directement ou indirectement, la santé des populations – notamment du fait des méthodes de production et des intrants utilisés. En outre, ces préoccupations se doublent de plus en plus de considérations écologiques : empiétant sur le milieu naturel, utilisant des méthodes de production et des intrants – engrais minéraux pesti- cides notamment, mais aussi, plus récemment organismes généti- quement modifiés (OGM) – qui en modifient les caractéristiques physiques ou biologiques et rejetant des déchets – émissions de gaz à effet de serre, effluents des élevages, etc. –, l’activité agricole moderne porte atteinte de diverses manières à l’environnement ; déforestation, pollutions diverses, risques de contamination des
- 202. 200 Jacques Le Cacheux milieux naturels par des espèces invasives ou génétiquement modi- fiées, réduction de la biodiversité et menaces sur de nombreux écosystèmes naturels sont ainsi des conséquences non désirées des activités productives, agricoles comme industrielles. Réciproque- ment, de nombreuses évolutions de l’environnement naturel pour- raient mettre en péril certaines productions agricoles dans plusieurs régions : le changement climatique, bien sûr, qui affecte notamment les températures et la disponibilité de l’eau douce, mais aussi la montée des eaux dans les zones côtières, l’érosion et la dégradation des sols, la disparition ou la raréfaction de certaines espèces animales indispensables – les insectes pollinisateurs, notamment. La grande complexité des enjeux et la nécessité fréquente pour les politiques publiques d’opérer des arbitrages obligent ainsi à analyser les mécanismes économiques à l’œuvre en matière agri- cole, de manière à concevoir un cadre réglementaire et des instruments d’intervention publique, de tout temps et en tout lieu observée, qui s’avère indispensable : à la fois parce que l’alimenta- tion est vitale, et parce que l’agriculture est source d’innombrables effets externes, sur les paysages, sur les eaux, douces et marines, sur l’atmosphère, etc. Après un prologue rappelant, à grands traits, la place de l’agri- culture dans l’histoire longue des activités humaines, la première partie de cet article est consacrée à une brève caractérisation de l’agriculture mondiale contemporaine, de manière à délimiter les contours du secteur et d’en évaluer l’importance économique. La deuxième partie analyse les principales caractéristiques naturelles et contraintes environnementales du secteur. Dans la troisième partie, les tendances lourdes des déterminants de la demande et de l’offre de produits agricoles et alimentaires sont étudiées en détail. La quatrième partie est consacrée aux principaux outils des poli- tiques agricoles et à l’analyse du processus de libéralisation des échanges internationaux de produits agricoles dans le cadre des négociations commerciales internationales menées au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et au sein de l’Union européenne (UE), lors des réformes successives de la Poli- tique agricole commune (PAC). Enfin, la conclusion offre quelques réflexions prospectives sur l’agriculture mondiale et la place de l’Europe dans cet ensemble.
- 203. Agriculture mondiale et européenne : défis du XXIe siècle 201 Prologue Comme tous les êtres vivants, l’Homme tire de la Nature tous les éléments nécessaires à sa subsistance, et bien davantage. A l’instar des autres animaux, il a longtemps vécu de cueillette, prélevant dans son environnement naturel sa nourriture et y trouvant le gîte. Mais à partir du néolithique, une lente évolution technologique s’est amorcée, qui a radicalement modifié son rapport à l’environ- nement naturel : l’invention de l’agriculture, c’est-à-dire de modes d’exploitation systématique et raisonnée des ressources offertes par la terre, a engendré des bouleversements profonds dans le mode de vie, la socialisation, l’alimentation, etc., dont les prolongements sont aujourd’hui encore perceptibles. Avec la culture raisonnée de certaines espèces végétales – en premier lieu les céréales – et l’élevage de certaines espèces animales, les apports caloriques se sont enrichis et régularisés, mais les atteintes à la biodiversité se sont faites plus intenses ; la sédentarisation a suscité des modes d’organisation sociale divers et plus complexes, mais aussi des besoins de matériaux pour le vêtement, le logement, et la cuisson ou la conservation des aliments. Pendant des millénaires, et jusqu’à la Révolution industrielle apparue en Angleterre au milieu du XVIIIe siècle, l’humanité a tiré de l’agriculture la quasi-totalité de ses « subsistances »1 : la nourri- ture bien sûr, même si les prélèvements de type « cueillette » se sont maintenus jusqu’à ce jour, sous forme résiduelle en ce qui concerne les subsistances terrestres, mais beaucoup plus massive- ment pour les prélèvements dans les mers et les océans ; mais également les fibres dont sont tissés les vêtements – la laine, le lin, le chanvre, le coton et bien d’autres –, les matériaux de construc- tion des logements – et avant tout le bois –, et le combustible utilisé pour se chauffer en hiver et cuire les aliments – le bois, à nouveau, mais aussi les déjections des animaux d’élevage, dans nombre de régions du monde. Parce que la terre fournissait ainsi tous les ingré- dients nécessaires à la subsistance, le contrôle et la propriété du 1. C’est le terme générique qu’utilisent les économistes classiques pour désigner l’ensemble des biens nécessaires à la vie humaine. Il va de soi que l’agriculture a aussi, de tout temps, façonné les paysages et fourni des biens non indispensables à la vie, des biens de « luxe », qu’il s’agisse des « luxes ordinaires », pour reprendre l’expression par laquelle Kenneth Pomeranz (2001) désigne les consommations exotiques qui se diffusent en Europe occidentale à partir de la colonisation (cacao, thé, café, sucre, coton, etc.), ou de véritables luxes réservés à l’élite économique et politique (soie et sucre, par exemple, pendant des millénaires).
- 204. 202 Jacques Le Cacheux territoire, notamment des terres fertiles les plus aptes à la produc- tion des denrées agricoles, ont toujours constitué un enjeu majeur, source de conflits. Et sur la quantité limitée de cette ressource rare contrôlée par chaque groupe humain – tribu, village ou nation –, la concurrence entre les usages du sol a longtemps été le principal déterminant des spécialisations économiques et des prix relatifs, en même temps que le principal moteur de l’innovation et du progrès technique2. La rupture suscitée par la Révolution industrielle, et sa diffusion progressive à l’ensemble de la planète est de portée considérable : non seulement parce qu’une nouvelle source d’énergie – fossile et, de ce fait, non renouvelable – est désormais utilisée pour épargner à l’homme les efforts physiques – dans la production des biens, dans le transport, etc. –, mais aussi parce que les matières minérales vont se substituer aux matières végétales ou animales dans la fourniture de fibres textiles – synthétiques –, dans la construction, et dans la production agricole même – avec les engrais minéraux, les pesti- cides de synthèse, etc. Dans le domaine des productions agricoles, les applications de la Révolution industrielle se sont diffusées plus lentement que dans l’industrie. Mais la mécanisation a peu à peu gagné du terrain, en Europe et en Amérique du Nord, et elle a connu une accélération fulgurante avec l’introduction du tracteur et des machines équipées de moteur à explosion, utilisant les carburants dérivés du pétrole. La véritable rupture projetant l’agri- culture dans un régime de croissance industrielle est l’invention en 1909 du procédé Haber-Bosch permettant la production massive de nitrates : en 1940, le monde utilisait environ 4 millions de tonnes de fertilisants chimiques, 40 millions en 1965 et 150 millions en 1990 (McNeill, 2000). Bouleversant, comme l’ont bien montré les travaux du GIEC sur le changement climatique3, le cycle du carbone sur la planète, les évolutions technologiques entamées avec la Révolution industrielle ont aussi profondément transformé 2. C’est encore aux travaux de Pomeranz (2001), et à la manière dont il rend compte des facteurs et incitations menant à la Révolution industrielle en Angleterre – notamment le prix élevé du bois, dû à sa rareté relative, donc l’incitation à développer d’autres sources de combustible et d’énergie – qu’il est fait référence ici. 3. Sur cette importante question, qui ne sera abordée ici qu’en ce qu’elle concerne l’agriculture, voir les rapports du Groupe international d’experts sur le climat (GIEC) des Nations Unies, notamment le plus récent (quatrième) (2007). Les prochains rapports devraient être publiées en 2012-2013. Voir également Banque mondiale (2008).
- 205. Agriculture mondiale et européenne : défis du XXIe siècle 203 l’agriculture et altéré d’autres cycles naturels : celui de l’azote et des phosphates, avec les apports d’engrais minéraux, l’élevage intensif, etc. ; celui aussi de la reproduction de nombreuses espèces animales et végétales. Et parmi les conséquences majeures de ces évolutions, notons que l’agriculture est devenue, à l’image des acti- vités industrielles, un secteur générateur de pollutions diverses et de déchets, ce qu’elle n’était pas – ou si peu – avant de recourir aux intrants extérieurs au secteur. Pour importante que soit la rupture de la Révolution indus- trielle, elle a été précédée par des évolutions dont les conséquences économiques et sociales ne sont pas moindres. L’accroissement de la productivité agricole, sous différentes latitudes et à diverses époques, grâce au progrès technique – irrigation, drainage, sélec- tion des espèces animales et végétales, amélioration des techniques culturales, etc. – générateur d’amélioration des rendements, a permis aux agriculteurs de produire plus qu’il était nécessaire à la subsistance de leur famille. L’apparition et l’accroissement de ce « surplus » agricole a, de tout temps, constitué un moteur essentiel du développement économique, permettant l’urbanisation, indui- sant le développement des échanges et favorisant la spécialisation dans la production. Ainsi, dès l’An Mil, en Europe occidentale, mais aussi en Orient (Chine, Inde et Japon, notamment)4, l’augmentation des rendements agricoles favorise-t-elle la multipli- cation des villages et petites villes, et l’essor d’une population urbaine faite de marchands, de banquiers et d’artisans, qui, à leur tour, engendreront la progression des niveaux de vie, l’accumula- tion de richesses et de connaissances, scientifiques et techniques, débouchant sur la Révolution industrielle. 1. Productions agricoles et alimentaires : de quoi parle-t-on ? Ainsi, bien avant même la Révolution industrielle, mais de manière accélérée depuis, le poids économique du secteur 4. Pourquoi l’An Mil ? Parce qu’apparemment la productivité agricole avait plutôt stagné en Asie, et même franchement régressé en Occident, au cours du premier millénaire de notre ère. Sur ces questions, de nombreuses contributions ont apporté des éclairages utiles à l’analyse économique. Citons, outre les grands historiens français – en particulier Le Goff (2005) –, les travaux de cliométrie de Maddison (2001), Crouzet (2000), Pomeranz (2001), notamment.
- 206. 204 Jacques Le Cacheux agricole – qu’il soit mesuré à l’aune de la part dans le PIB ou dans l’emploi total d’un pays – a eu tendance à décroître considérable- ment au fil des ans dans toutes les régions du monde, de sorte qu’il paraît presque négligeable aujourd’hui dans la plupart des pays développés et même chez certains émergents. C’est ignorer, cepen- dant, que, s’il est vrai que la population mondiale est de plus en plus urbanisée, près de 3 des 7 milliards d’habitants du monde vivent dans des zones rurales, dont près de 2,5 milliards de l’agri- culture (Banque mondiale, 2008) ; c’est ignorer aussi la part des très nombreuses activités productives qui sont, directement ou indirec- tement, liées à l’agriculture, sans parler du caractère littéralement vital que revêt l’alimentation – tant en quantité qu’en qualité. Conformément au découpage traditionnel des activités écono- miques en grands secteurs et à celui des domaines de compétence des institutions internationales – singulièrement la FAO5 –, notre champ d’analyse inclut, outre l’agriculture au sens strict (produc- tions végétales et élevage), l’exploitation forestière (du bois, bien sûr, mais aussi de nombreux autres produits issus de la forêt), la pêche et l’aquaculture6. 1.1. L’importance relative du secteur agricole Dans l’édition de son rapport annuel sur le développement consacrée à l’agriculture, la Banque mondiale (2008) analyse prin- cipalement les pays émergents et en développement, et distingue trois catégories d’économies nationales : celles qui sont principale- ment agricoles, encore nombreuses ; celles dans lesquelles la place de l’agriculture est « intermédiaire », et généralement en recul ; enfin celles qui ont déjà développé des activités industrielles et de services importantes, dans lesquelles la part de l’agriculture est faible (tableau 1). Dans les premiers pays, la part de l’emploi agri- cole dans l’emploi total peut atteindre 90 % et la part de la valeur ajoutée agricole avoisiner 50 % (en Ethiopie, par exemple). Dans les pays émergents, les deux parts se sont très rapidement réduites au cours des dernières décennies : ainsi en Chine, la part de l’emploi agricole est passée de 80 % à 60 % entre 1960 et 2005 ; et 5. Food and Agriculture Organisation, agence spécialisée des Nations Unies. 6. Les similitudes entre les activités de cueillette, certaines modalités d’exploitation forestière et la pêche, d’une part, l’agriculture, la sylviculture et l’aquaculture de l’autre, rendent un tel regroupement assez naturel.
- 207. Agriculture mondiale et européenne : défis du XXIe siècle 205 au Brésil, de 60 % à environ 18 % au cours de la même période. Les économies développées sont, évidemment, plus proches de la troi- sième catégorie : la part des activités agricoles dans le PIB y est généralement inférieure à 5 %, voire beaucoup moins dans certains cas ; et l’emploi agricole – exploitants et salariés agricoles – repré- sente aussi une part très faible, et le plus souvent décroissante, de l’emploi total (Banque mondiale, 2008, et tableau 2). En outre, dans de nombreux pays en développement et émergents, et notam- ment parmi les moins avancés, les exportations agricoles et agro- alimentaires représentent une part très élevée des exportations totales : plus de 90 % en Sierra Leone, plus de 80 % au Bénin, au Burkina Faso, en Ethiopie, au Malawi, au Panama, environ 50 % en Argentine, en Côte-d’Ivoire, au Ghana, au Honduras, etc. ; alors que leur importance est bien moindre dans les pays les plus avancés (environ 3,9 % pour l’Allemagne, 20 % pour le Danemark, 8,8 % pour la France et 8,5 % pour les États-Unis, par exemple)7. Bien que moins facilement évaluée, l’importance économique des activités sylvicoles et de pêche est, elle aussi, très variable selon les pays, mais souvent essentielle du point de vue des populations les plus pauvres, pour lesquelles elles sont sources d’apports nutri- tionnels non négligeables et, dans le cas de la forêt, de combustible (FAO, 2010b et 2011). Les seuls usages marchands des produits de la forêt (bois de construction, pâte à papier, etc.) ont, dans certaines parties du monde, un poids économique non négligeable (tableau 3). Quant aux activités de pêche et aquaculture, elles emploient un nombre croissant de personnes (tableau 4) et les produits de la pêche et de l’aquaculture sont l’une des exportations les plus importantes et les plus dynamiques des pays en développement8. 7. Données moyennes 2003-2005 compilées par la Banque mondiale (2008). Encore convient- il d’ajouter que, dans cette part, les produits transformés, à haute valeur ajoutée, représentent-ils une fraction plus importante dans les pays avancés, alors que les exportations agricoles des pays les plus pauvres sont en général des produits bruts. 8. Selon la FAO (2010b), la valeur des exportations nettes de poissons et crustacés des pays en développement est passée de 8,5 à près de 25 milliards de dollars US entre 1987 et 2007, tandis que celle de leurs exportations nettes de café passait de 8,5 à 11 milliards de dollars US, celle de leurs exportations nettes de caoutchouc de 2,5 à un peu plus de 6 milliards de dollars US.
- 208. 206 Jacques Le Cacheux Tableau 1. Population rurale et production agricole dans trois groupes de pays en développement Économies Économies en voie Économies essentiellement de transformation urbanisées agricoles Population rurale 417 2 220 255 (2005, en millions) Part de la population rurale dans 68 63 26 la population totale (2005, en %) PIB par habitant 379 1 068 3 489 (2005, en dollars constants 2000) Part de l’agriculture dans le PIB 29 13 6 (2005, en %) Taux de pauvreté rurale (2002, 51 28 13 en % de la population rurale) Source : Banque mondiale (2008). Tableau 2. Parts de l’agriculture dans le PIB et de l’emploi agricole dans l’emploi total de quelques pays (2003-2005, en %) Part dans le PIB Part dans l’emploi Allemagne 2,4 1,0 Brésil 20,8 6,6 Cambodge 60,3 33,7 Chine 44,1 12,7 États-Unis 1,9 1,3 France 4,2 2,4 Madagascar 78,0 28,7 Pakistan 42,1 22,7 Vietnam 59,9 21,7 Source : Banque mondiale (2008). Tableau 3. Parts des activités sylvicoles dans le PIB et l’emploi (2006, en %) Part dans le PIB Part dans l’emploi Afrique 1,3 0,1 Amérique Nord et centre 1,0 0,7 Amérique du Sud 2,1 0,8 Asie 0,9 0,3 Europe 1,0 1,1 Océanie 1,0 0,8 Monde 1,0 0,4 Source : FAO, 2011.
- 209. Agriculture mondiale et européenne : défis du XXIe siècle 207 Tableau 4. Pêcheurs et aquaculteurs (en milliers) Pêcheurs Aquaculteurs 1990 2000 2008 1990 2000 2008 Afrique 1 832 3 857 4 187 1 78 123 Amérique Nord 385 343 337 – – – Amérique latine et Caraïbes 1 104 1 250 1 287 68 187 443 Asie 23 736 35 242 38 439 3 698 6 647 10 143 Europe 646 726 641 14 66 80 Océanie 55 49 56 1 5 4 Monde 27 737 41 287 44 946 3 783 6 983 10 793 Source : FAO, 2010b. Les pays les moins avancés sont donc clairement dépendants, pour l’amélioration du niveau de vie de leurs habitants, des acti- vités agricoles, sylvicoles, de pêche et d’aquaculture (Banque mondiale, 2008) ; mais c’est beaucoup moins vrai dans la plupart des autres. 1.2. Amont et aval de l’agriculture dans les économies développées contemporaines Pourtant, cette comptabilité relève d’une acception étroite de l’agriculture et de son impact sur l’ensemble de l’activité écono- mique. Comme le souligne le rapport de la Banque mondiale (2008), les activités économiques –commerce et artisanat – en zone rurale dans bon nombre de pays en développement sont directe- ment dépendantes de la prospérité de l’agriculture. Et dans les pays développés, les statistiques officielles en sous-estiment également considérablement le poids économique réel, du fait de l’insertion du secteur agricole dans des filières de production dont l’amont et, plus encore, l’aval, contribuent beaucoup à la formation de la valeur ajoutée : l’agriculture utilise en effet de nombreux intrants d’origine industrielle – engrais, pesticides, semences OGM, maté- riels agricoles, énergies fossiles, etc. – et de nombreux services – bancaires, de protection sociale, de conseil, etc. – ; et elle est, pour l’essentiel, devenue une activité de production de matières premières pour les industries transformatrices, qu’elles soient agro- alimentaires ou autres (textiles, fabrication de matériaux pour le bâtiment, d’agro-carburants, etc.).
- 210. 208 Jacques Le Cacheux Avec les progrès de l’urbanisation, qui constitue l’une des tendances lourdes des évolutions démographiques mondiales, le modèle de production alimentaire des pays développés, caractérisé, très schématiquement, par une agriculture intensive, très consom- matrice d’intrants en provenance des autres secteurs et d’énergie – essentiellement fossile – et d’un très important secteur aval, constitué d’une longue chaîne d’intermédiaires assurant la collecte, la transformation, le conditionnement, le transport et la distribu- tion des produits alimentaires, pour la plupart très transformés, tend à se diffuser à l’ensemble des pays. Outre les conséquences en termes environnementaux et d’intensité énergétique de la produc- tion alimentaire (cf. infra), cette évolution a deux grandes implications économiques : en premier lieu, la part de la valeur ajoutée agricole dans la valeur totale des produits agro-alimentaires consommés dans ces pays est faible, comparable, en moyenne, à celle des industries extractives dans la valeur ajoutée des produits manufacturés ; et, pour les mêmes raisons, les variations de prix des produits agricoles n’affectent que faiblement les prix à la consom- mation des produits alimentaires, beaucoup plus dépendants des évolutions des coûts salariaux et des prix de l’énergie. 2. Les usages concurrents des ressources : la rareté de la ressource foncière et de l’eau douce S’il est vrai que toutes les activités humaines s’inscrivent dans l’espace, cela vaut particulièrement pour l’agriculture, dont l’usage des terres entre en concurrence directe avec d’autres finalités possibles, qu’il s’agisse des espaces naturels vierges – forêts, prai- ries, etc. – ou des différentes formes d’artificialisation des sols – urbanisation, infrastructures de transport, etc. L’agriculture est également consommatrice – souvent en très grandes quantités – d’eau douce, en partie pluviale bien sûr, mais parfois aussi prélevée dans les ressources en eau douce terrestres – fleuves, lacs et nappes phréatiques –, dont une partie est non renouvelable, ou difficile- ment renouvelable. 2.1. Terres agricoles, autres usages des sols et pratiques culturales L’emprise foncière de l’agriculture n’a cessé de progresser au cours des siècles passés, et cette progression devrait, selon les
- 211. Agriculture mondiale et européenne : défis du XXIe siècle 209 projections de la FAO (2002), se poursuivre au cours des prochaines décennies. Pour l’essentiel, cette extension des terres cultivées ou livrées au pâturage a été faite au détriment de la forêt, dont la surface recule à l’échelle mondiale – même si elle progresse, au contraire, sur le continent européen et en Asie (tableau 5)9. Dans le même temps, l’artificialisation des sols, du fait de l’urbanisation et de l’emprise croissante des infrastructures, notamment de trans- port – autoroutes, lignes ferroviaires à grande vitesse, aéroports, etc. – réduit la disponibilité des terres agricoles10 dans de nombreuses régions, qu’il s’agisse des pays développés ou des pays émergents. Tableau 5. Surfaces boisées, 1990-2010 (en milliers d’ha.) Surfaces boisées En % de la Variation Variation en 2010 surface totale 1990-2000 2000-2010 Afrique 674 419 23 - 4 064 -3 414 Amérique Nord et Centre 705 393 33 - 289 - 10 Amérique Sud 864 351 49 - 4 213 - 3 997 Asie 592 512 19 - 595 2 235 Europe 1 005 001 45 877 676 Océanie 191 384 23 - 36 - 700 Monde 4 033 060 31 - 8 323 - 5 211 Source : FAO, 2011. Plus grave cependant, les pratiques culturales et d’élevage ont tendu, dans la plupart des régions du monde, à dégrader les sols, menaçant la soutenabilité des activités agricoles de ces régions. La déforestation et le pâturage intensif engendrent fréquemment des phénomènes d’érosion des sols, qui aboutissent à la disparition de la couche fertile – dite « terre végétale » – du sol ou au lessivage des éléments nutritifs nécessaires aux végétaux qu’elle contient. L’usage intensif des engrais minéraux et des pesticides débouche, dans les régions de grandes cultures, sur des dégradations et pollu- tions des sols dont les effets sur l’environnement et la santé 9. La FAO (2011) souligne que l’essentiel des réserves foncières actuellement couvertes de forêt est situé dans les zones subtropicales africaines et sud-américaines. Il s’agit de « forêt primaire », importante réserve de biodiversité, alors que la forêt européenne, bien que non dénuée d’intérêt de ce point de vue, est loin de présenter une telle diversité biologique. 10. Il faut, en outre, souligner que l’artificialisation concerne, le plus souvent, des terres agricoles particulièrement fertiles, dans la mesure où les villes elles-mêmes ont généralement été implantées dans les zones les plus favorables à l’agriculture.
- 212. 210 Jacques Le Cacheux humaine peuvent être très persistants. En outre, dans certains pays émergents notamment, les pollutions industrielles – aux métaux lourds, en particulier –, parfois à très grande échelle, ont rendu des surfaces considérables totalement impropres à tout usage agricole, du moins à des fins de production alimentaire. 2.2. L’eau, ressource renouvelable ou épuisable ? Les apports en eau douce sont une nécessité vitale pour tous les animaux et les végétaux, même si les besoins varient selon les espèces et les variétés, ce qui autorise certaines adaptations aux conditions locales en matière de disponibilité de l’eau. L’agricul- ture pluviale – celle qui ne dépend que de l’apport d’eau sous forme de pluie – constitue, aujourd’hui encore, la plus grande part des activités agricoles dans le monde (FAO, 2002 ; Banque mondiale, 2008 et tableau 6). Toutefois, les pratiques d’irrigation, soit par prélèvement sur les eaux douces de surface – rivières, lacs et bassins de retenue –, soit par pompage des nappes phréatiques, connais- sent, depuis plusieurs années, un essor considérable dans la plupart des régions du monde, ce qui permet d’augmenter les rendements des cultures, mais engendre également des problèmes de concur- rence entre usages de l’eau et de soutenabilité. Certes une partie importante de l’eau absorbée par les végétaux est ensuite rejetée dans l’atmosphère sous forme de transpiration et se retrouve donc en pluie quelque part ; mais d’une part les prélèvements sur les rivières et les lacs engendrent des effluents susceptibles de contenir des polluants et finissent souvent par épuiser les retenues natu- relles – comme l’illustrent les quasi-disparitions du Lac Tchad ou de la Mer d’Aral – ; et d’autre part, une fraction importante de l’eau douce est, dans de nombreuses régions, prélevée dans des aquifères fossiles, qui ne se régénèrent pas du tout, ou très peu, et sont donc épuisables. Il est vrai que la sélection et le recours aux biotechnolo- gies peuvent permettre de réduire les besoins en eau de certaines pratiques agricoles, et que la désalinisation de l’eau de mer est de plus en plus utilisée dans les régions côtières pour procurer de l’eau douce ; mais ces technologies présentent, elles-mêmes, des risques environnementaux et suscitent des consommations supplémen- taires d’énergie.
- 213. Agriculture mondiale et européenne : défis du XXIe siècle 211 Tableau 6. Terres arables, surfaces cultivées et surfaces irriguées dans les pays en développement (en millions d’ha.) Surfaces arables Surfaces cultivées Surfaces irriguées 1997-1999 956 885 257 2015 1 017 977 306 2030 1 076 1 063 341 Source : FAO, 2002. Tableau 7. Agriculture irriguée, intrants de synthèse et usage d’eau douce dans quelques pays, 2003-2005 Prélèvements Part des surfaces Apports Apports de pesti- d’eau douce par irriguées dans le d’engrais cides l’agriculture total cultivé (%) (kg/ha cultivé) (kg/ha cultivé) (% du prélèvement total) Allemagne 4,0 217 21,3 20 Bangladesh 54,3 198 3,7 96 Chili 82,4 249 nd 64 Chine 47,5 395 nd 68 Egypte 100 572 nd 86 États-Unis 12,5 114 nd 41 France 13,3 204 45,5 10 Inde 32,4 107 nd 86 Ouzbékistan 87,4 nd nd 93 Pakistan 81,1 167 6,1 96 Pays-Bas 60,0 564 85,2 34 Source : Banque mondiale (2008). 3. Le « grand banquet de la nature » : la revanche de Malthus ? Comme l’avait anticipé le Révérend Malthus, dans son célèbre Essai sur la population (1798), les deux principaux déterminants de la demande de produits agricoles sont l’accroissement de la popula- tion et son enrichissement. Le rôle du premier est aisément compréhensible : il représente le nombre de « bouches à nourrir ». Son évolution exponentielle au cours du XXe siècle a pu laisser croire que les sombres prédictions de Malthus finiraient par avoir raison de l’optimisme « scientiste » : après tout, alors que la popu- lation mondiale atteignait à peine le milliard d’habitants lorsque Malthus publia son Essai, elle a, depuis peu, dépassé les 7 milliards sans que la rareté des ressources naturelles, notamment des subsis-
- 214. 212 Jacques Le Cacheux tances vitales, ait semblé se manifester plus brutalement ; bien au contraire, si l’on en croit les chiffres de la FAO, la proportion de la population survivant avec un apport calorique quotidien inférieur au seuil considéré comme nécessaire à une vie en bonne santé (2 200 kcal par jour) n’a cessé de baisser, notamment au cours du XXe siècle, passant ainsi de 57 % au milieu des années 1960 à environ 10 % au début du XXIe siècle, ce qui, il est vrai, représente encore plus de 800 millions de personnes. Pour tous ceux qu’inquiète la perspective malthusienne de la surpopulation mondiale – dont la pression s’exerce, non seulement sur l’agriculture, mais plus généralement sur l’ensemble des ressources naturelles de la planète –, les évolutions démogra- phiques mondiales observées depuis quelques décennies et les perspectives tracées par l’ONU devraient constituer des éléments rassurants : la croissance de la population mondiale ralentit, depuis la fin des années 1960, d’un rythme annuel moyen de 2,1 % à 1,5 % pour la décennie 1990, puis à moins de 1 % au cours de la première décennie du XXIe siècle ; et ce ralentissement devrait se poursuivre au cours des décennies à venir, en raison de la diffusion progressive de la « transition démographique » à l’ensemble des régions du globe11. Mais dans le même temps, les modes de développement et de consommation alimentaire qui se diffusent avec l’enrichissement de nombreuses régions dites émergentes sont tels que la demande adressée à l’agriculture ne ralentit que très modérément, voire augmente : la composition des apports caloriques se modifie et les usages non alimentaires des produits agricoles se développent ; parallèlement, certains des facteurs qui freinent l’augmentation de l’offre de produits agricoles se font plus prégnants. Et les crises alimentaires semblent se faire plus fréquentes (FAO, 2009). 3.1. La demande de produits agricoles : une nouvelle pression L’agriculture est aujourd’hui pensée comme fournissant princi- palement des denrées alimentaires, alors qu’elle produit également, 11. Les plus récentes projections démographiques de l’ONU (mai 2011) sont, toutefois, un peu plus prudentes que les précédentes sur l’ampleur du ralentissement de la population mondiale : elle pourrait dépasser 9 milliards en 2050 et poursuivre sa croissance, encore ralentie, au moins jusqu’à la fin du siècle.
- 215. Agriculture mondiale et européenne : défis du XXIe siècle 213 et même dans des proportions croissantes, des matières premières destinées à l’industrie. Dès lors, analyser l’équilibre économique des marchés agricoles oblige à élargir le champ d’investigation, pour y inclure des usages autres qu’alimentaires, usages dont l’importance s’accroît et qui viennent concurrencer l’alimentation dans l’utilisation des ressources rares que constituent les terres agri- coles. Leur influence sur les évolutions de prix des denrées agricoles est, de ce fait, considérable. 3.1.1. La demande alimentaire : un monde sans cesse plus carnivore Bien qu’en phase de ralentissement, grâce à la décélération de la démographie mondiale, la demande alimentaire demeure forte- ment orientée à la hausse, et devrait continuer de croître à un rythme soutenu au cours des prochaines décennies. La principale raison de cette hausse persistante est l’enrichissement d’une frac- tion sans cesse plus large de la population mondiale, notamment au sein des économies dites émergentes, souvent très peuplées – le Brésil, la Chine et l’Inde en particulier12. Selon les données compi- lées par la FAO, la ration alimentaire moyenne d’un Chinois est ainsi passée de 1500 kcal par jour en 1960 à un peu plus de 3000 kcal en 2000 ; pour l’ensemble de la population mondiale, la moyenne journalière est passée d’un peu plus de 2200 kcal en 1960 à environ 2800 kcal en 2000 et devrait, selon la FAO, atteindre environ 3000 kcal en 2030, soit le niveau moyen observé dans les pays développés à la fin des années 1960. Toutefois, même si la croissance de la population mondiale ralentit encore sensiblement dans les décennies à venir, même si l’augmentation de la ration calorique moyenne est, elle aussi, asymptotiquement moindre, la hausse des niveaux de vie des populations s’accompagne d’une modification importante de l’alimentation qui contribue à soutenir la croissance de la demande adressée à l’agriculture mondiale : la part des produits animaux – viande et produits laitiers – dans la ration alimentaire augmente tendanciellement avec le revenu, selon des modalités certes variables selon les pays et les traditions13, mais assez sensiblement 12. Rappelons à ce propos que, sur une population mondiale d’environ 7 milliards, les pays développés ne regroupent qu’un peu plus d’un milliard d’habitants. Et encore ces derniers ne mangent-ils pas tous à leur faim !
- 216. 214 Jacques Le Cacheux partout. Or si cette hausse peut être le symptôme favorable d’un meilleur équilibre alimentaire – avec notamment des apports plus importants en protéines –, la production d’une calorie de nourri- ture d’origine animale nécessite entre 4 et 12 calories d’origine végétale – et en moyenne 7 calories végétales par calorie de viande produite ; autrement dit, une part croissante de la production végé- tale – de céréales et de protéagineux, notamment – est utilisée pour produire de la viande – principalement de volailles et de porc (« blanche »), relativement moins gourmande en calories végétales, mais aussi de bœuf (« rouge »), plus intensive en intrants végétaux – et du lait, intensifiant ainsi la pression sur les ressources foncières utilisées dans l’agriculture. Il résulte en effet de cette déformation de la consommation alimentaire au profit des apports de protéines animales – viandes, poisson et produits laitiers – que la part des productions végétales allant à la nourriture des animaux d’élevage ne cesse de croître : elle représente désormais plus de la moitié des quantités produites dans les pays développés, et une part croissante dans les pays émer- gents et en développement. 3.1.2. Les demandes industrielles hors alimentation : la pression des agro-carburants L’agriculture a, de tout temps, fourni des matières premières autres qu’alimentaires, transformées par l’artisanat ou, plus tard, l’industrie : elle a notamment été longtemps la seule source de fibres textiles destinées à la fabrication des vêtements, parfois en produc- tion jointe avec des produits alimentaires (laine, avec le lait et la viande de mouton, par exemple), parfois en production spécifique (le lin, le chanvre, le coton et la soie). Ces spéculations agricoles perdurent, bien évidemment, en dépit du développement massif des fibres dites synthétiques ; notamment la culture du coton, qui occupe dans les régions chaudes – en Afrique, en Turquie, mais aussi dans le Sud des États-Unis – une place considérable. 13. Ainsi par exemple l’augmentation de la consommation de viande est-elle bien moindre en Inde que dans les pays ayant connu un développement économique comparable, tandis qu’au contraire celle de produits laitiers y connaît un essor beaucoup plus rapide qu’en Chine. La FAO souligne également que la part des fruits et légumes dans l’alimentation augmente avec le niveau de vie, au détriment des céréales.
- 217. Agriculture mondiale et européenne : défis du XXIe siècle 215 L’essor, en réponse à la hausse des prix des carburants fossiles et à des politique publiques d’encouragement actif – notamment au nom de la lutte contre le changement climatique, en Europe et aux États-Unis14 – de la production d’agro-carburants (« bio-éthanol » et « bio-diesel ») constitue cependant une inflexion sensible, de ce point de vue, en ce qu’il vient directement concurrencer les usages alimentaires de certaines productions végétales – sucre de canne et maïs, pour l’éthanol, oléo-protéagineux pour le diesel –, entrete- nant la tension sur certains marchés mondiaux. Or, la plupart des analyses existantes indiquent que l’usage de ces denrées pour la production d’énergie renouvelable n’est actuellement pas économi- quement viable – sauf l’éthanol à base de sucre de canne au Brésil –, les États-Unis et l’Union européenne le subventionnant massive- ment15, et ne présente pas un bilan environnemental particulière- ment favorable – notamment en raison des engrais et pesticides utilisés dans ces grandes cultures – et que cette demande indus- trielle accrue a bien joué un rôle important dans les hausses de prix observées en 2008 et en 2010 (voir FAO, 2009 et INRA, 2008)16. 3.2. Un potentiel d’offre agricole illimité ? Comme le soulignent les analyses de la FAO (2002), trois types d’évolutions se sont conjuguées pour accroître, jusqu’à ce jour, l’offre de produits agricole : une extension des surfaces cultivées, une plus grande fréquence des récoltes sur les parcelles cultivées, et une amélioration des rendements, grâce notamment à l’irrigation, à l’usage d’intrants de synthèse, à la sélection et, plus récemment, aux biotechnologies. S’appuyant sur des hypothèses – relativement 14. Les incitations financières au développement des filières d’agro-carburants et de production de méthane à partir des effluents agricoles se sont multipliées dans les pays les plus avancés. Dans le cadre de son « paquet énergie-climat » de 2009, l’Union européenne encourage l’incorporation de « bio-éthanol » et « bio-diesel » en proportions croissantes dans les carburants des véhicules automobiles. La part des carburants consommés atteint ainsi 7,8 % en France en 2009. Aux États-Unis, près de la moitié de la production de maïs en 2010 a été orientée vers la production de « bio-éthanol ». 15. Selon la FAO (2009), les subventions publiques pour le « bio-éthanol » et le « bio-diesel » ont atteint 5,8 milliards de dollars aux États-Unis pour la seule année 2006, tandis que l’UE leur consacrait 4,7 milliards de dollars US cette même année. 16. De nouvelles techniques de production de carburants à partir de déchets des productions végétales agricoles ou sylvicoles (biomasse), d’effluents des productions animales, et de cultures hors-sol (algues ou bactéries) sont apparues ces dernières années. Parce qu’elles n’entrent pas en concurrence directe avec les finalités alimentaires de l’agriculture et permettent la valorisation des déchets des, ces productions d’agro-carburants de « deuxième génération » ne sont pas sujettes aux mêmes critiques.
- 218. 216 Jacques Le Cacheux optimistes – de poursuite des tendances observées au cours des dernières décennies, les projections réalisées par la FAO brossent un tableau somme toute rassurant de l’avenir de l’agriculture mondiale, dans lequel la croissance de l’offre globale est suffisante pour faire face à celle, prévue, de la demande mondiale. Dans ces projections, et plus encore dans des travaux plus récents (FAO, 2009, notamment), la FAO souligne aussi les problèmes liés à la persistance de la sous-alimentation et les risques de crises alimen- taires comparables – voire plus graves – à celle observée en 2008 dans de nombreux pays en développement lors de la flambée des cours mondiaux des denrées alimentaires. Pourtant, la poursuite de ces tendances pourrait être remise en cause par différents facteurs. 3.2.1. L’extension des surfaces et la pression environnementale Face à une tendance longue à la déprise agricole (recul de surfaces consacrées à l’agriculture) dans les pays les plus déve- loppés, l’augmentation constante des surfaces cultivées a caractérisé la plupart des pays émergents et en développement au cours des récentes décennies : ainsi, de 1960 à 2000, près de 50 % de l’accroissement des quantités produites en Amérique latine – et près de 20 % pour l’ensemble du monde – ont-ils été attribuables à l’augmentation des surfaces cultivées (FAO, 2002). Cette progres- sion s’opère au détriment des surfaces boisées, notamment de la forêt primaire, avec des conséquences environnementales impor- tantes. En effet, les forêts sont des « puits à carbone » dont l’importance est considérable dans l’absorption des gaz à effet de serre, et elles constituent des écosystèmes dont la biodiversité est beaucoup plus grande que celle des terres exploitées par l’agricul- ture. Il est vrai que les surfaces replantées en forêt augmentent aussi, mais le solde net demeure négatif (tableau 8) ; et, si le bilan carbone de la forêt exploitée est meilleur que celui des forêts primaires, la biodiversité est bien moindre. Du seul point de vue de l’émission des gaz à effet de serre, on estime que l’agriculture est responsable de 15 % des volumes annuels émis dans le monde, et la déforestation de 11 % (Banque mondiale, 2008).
- 219. Agriculture mondiale et européenne : défis du XXIe siècle 217 Tableau 8. L’état des forêts mondiales Couvert forestier 1990 2010 Couvert (hectare) forestier mondial 4,17 milliards 4,03 milliards Superficie plantation mondiale des s forestières (hectare) 178 millions 264 millions Déforestation 1990-2000 2000-2010 Perte nette annuelle de forêts (hectares/an) 8,3 millions 5,2 millions Déforestation annuelle (hectares/an) 16 millions 13 millions Augmentation annuelle des plantations forestières (hectares/an) 3,36 millions* 5 millions Source : PNUE. 3.2.2. Le progrès des rendements : biotechnologies contre changement climatique ? Depuis des siècles, mais surtout depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, les progrès dans les méthodes culturales et d’élevage, la sélection biologique, l’irrigation, l’usage d’intrants de synthèse et, plus récemment, le recours à des variétés génétique- ment modifiées (OGM) ont permis d’obtenir une hausse continue des rendements moyens observés dans le monde, avec d’impor- tantes variations régionales il est vrai : dans les seuls pays en développement entre 1960 et 2000, les rendements du blé sont passés de 0,8 tonne/ha à 2,5 tonnes/ha, ceux du riz de 1,8 tonne/ha à 3,6 tonnes/ha, ceux du maïs de 1,2 à 2,8 tonnes/ha, ceux du soja de 0,7 à 1,9 tonnes/ha, etc. (FAO, 2002). Mais ces progrès ont été obtenus par une intensification des méthodes culturales et au moyen d’un usage croissant d’eau et d’intrants. En outre, des travaux récents semblent (Académie de l’agriculture, 2010) indi- quer une inflexion dans les rythmes de croissance des rendements, sans doute attribuable au changement climatique – du fait notam- ment de la moindre pluviosité dans certaines régions, mais aussi de la plus grande variabilité des températures et de valeurs extrêmes plus élevées – et à des évolutions éco-systémiques – en particulier la disparition des pollinisateurs : depuis le début des années 1990, les rendements de la plupart des grandes cultures n’augmentent plus ou diminuent dans plusieurs régions du monde. La recherche agro- nomique permet, certes, d’améliorer l’adéquation entre les variétés cultivées et les conditions climatiques ; et les biotechnologies sont en mesure de proposer des variétés OGM plus résistantes à la séche- resse. Mais en dépit de ces progrès technologiques, la possibilité d’observer, dans les décennies qui viennent, des rythmes
- 220. 218 Jacques Le Cacheux d’augmentation des rendements aussi élevés qu’au de la seconde moitié du XXe siècle est mise en question. 3.2.3. L’épuisement des ressources halieutiques et les risques liés à l’aquaculture Le dernier inventaire de la FAO (2010b) note que « la propor- tion de stocks de poissons de mer sous-exploités ou exploités modérément est passée de 40 % au milieu des années 1970 à 15 % en 2008 ; inversement, la proportion de stocks surexploités, épuisés ou en phase de reconstitution a augmenté, passant de 10 % en 1974 à 32 % en 2008. La proportion de stocks pleinement exploités est restée relativement stable depuis les années 1970 et se situe à environ 50 % ». Ces données, résumées dans le tableau 9, soulignent la précarité des ressources halieutiques des océans et l’urgence d’une inflexion dans les tendances observées depuis des décennies dans les prélèvements. Le renouvellement de nom- breuses espèces marines est, en effet, menacé à très brève échéance par la surexploitation des ressources halieutiques. Tableau 9. Statut des stocks mondiaux de poisons en 2008 (en %) En % Sous-exploités 3 Modérément exploités 12 Pleinement exploités 53 Surexploités 28 Épuisés 3 En voie de régénération 1 Source : FAO 2010b. Dans le même temps, il est vrai, l’essor considérable de l’aqua- culture (cf. supra) a permis de développer une offre de poissons et crustacés d’élevage dont la part dans la consommation alimentaire humaine totale n’a cessé de croître : selon la FAO (2010b), la production aquacole a cru au rythme annuel moyen de 8,3 % de 1970 à 2008 et la quantité moyenne annuelle produite par habi- tant est passée, au cours de la même période et en dépit de l’augmentation massive de la population mondiale, de 0,7 kg/habi- tant à 7,8 kg/habitant. Mais l’extension des fermes aquacoles engendre des problèmes environnementaux dans de nombreuses
- 221. Agriculture mondiale et européenne : défis du XXIe siècle 219 régions, qu’il s’agisse d’installations côtières ou d’élevage en eau douce, et soulève le problème des intrants utilisés – protéines d’origine animale, antibiotiques, etc. –, difficultés semblables à celles que soulève l’intensification agricole. 4. La libéralisation, horizon indépassable des politiques agricoles ? Le rôle majeur que joue l’activité agricole dans le développe- ment économique et la réduction de la pauvreté est avéré par les expériences historiques des économies les plus avancées. Il est aujourd’hui mis en avant par les grandes organisations internatio- nales, notamment la Banque mondiale (2008) et l’ONU, dans le cadre des « Objectifs du millénaire » qui visent notamment la réduction de la pauvreté. Dans un tel contexte, le lancement, en 2000, d’un nouveau cycle de négociations commerciales interna- tionales, le « Cycle de Doha » ou « Cycle du Développement », a marqué le triomphe d’une idée apparue lors du cycle précédent – dit de « l’Uruguay », qui avait abouti, en 1994, aux Accords de Marrakech et à la création de l’OMC (Organisation mondiale du commerce) : l’idée selon laquelle la libéralisation des échanges internationaux de produits agricoles, couplée à la libéralisation interne des secteurs agricoles dans les pays – notamment la baisse des soutiens publics aux secteurs agricoles dans les pays déve- loppés, celle de leurs subventions à l’exportation et celle des subventions à la consommation de ces produits dans les pays en développement –, était susceptible d’engendrer des gains d’effi- cience économique considérables pour l’ensemble de la planète, et particulièrement pour les pays en développement. D’où l’objectif d’un démantèlement des barrières tarifaires et non tarifaires aux échanges qui constitue le cœur du nouveau « Cycle du développe- ment », censé permettre à ces pays, notamment les moins avancés, d’accroître leurs exportations de produits agricoles et accéder ainsi au développement par le commerce. 4.1. Un problème de répartition Les échanges internationaux de produits agricoles, bruts ou transformés, ont longtemps constitué l’essentiel du commerce international. Mais leur croissance a été, au cours des cinq
- 222. 220 Jacques Le Cacheux dernières décennies, bien moindre que celle des échanges de produits manufacturés. Pendant des millénaires, les échanges de denrées ont, pour l’essentiel, été guidés par l’existence d’avantages absolus ou l’échange de différences, qui répond à la demande de variété des consommateurs, cercle longtemps restreint aux plus fortunés. Si ces déterminants demeurent, notamment pour les principaux pays développés, les forces qui poussent à présent au développement des échanges internationaux de produits agricoles et agro-alimentaires sont, en partie, d’une autre nature et, d’une certaine manière, plus profondes. Indépendamment des gains que l’on peut en attendre en termes de variété et d’efficacité écono- mique (cf. infra), la libéralisation des échanges internationaux de produits agricoles et l’essor des échanges répondent à une nécessité impérieuse, qui résulte d’un désajustement géographique croissant entre les dynamiques de la demande et les potentiels de production des différentes régions du monde : très schématiquement, la crois- sance de la population et des niveaux de vie est forte dans des régions dont le potentiel de production agricole est relativement faible, ou dont la croissance future de l’offre agricole est probléma- tique, tandis qu’à l’inverse d’autres régions du monde ont des potentialités de développement de l’offre agricole probablement supérieures à leur demande potentielle locale. Ces désajustements géographiques sont, en grande partie, attribuables aux dynamiques démographiques et aux conditions naturelles (climat, nature des sols, disponibilité en eau, etc.). 4.1.1. Dynamiques régionales de la demande et de l’offre Les différences dans les dynamiques démographiques des princi- pales région du monde et les changements dans les habitudes alimentaires observés dans les pays émergents et en développement (cf. supra) se traduisent par des tendances différentes de la demande de produits agricoles dans les diverses régions du monde, tandis que dans le même temps, la production agricole de ces régions connaît des évolutions liées aux conditions de production dans ces régions. Il en est résulté, au cours des décennies récentes, des diver- gences sensibles entre dynamiques de la demande et de l’offre régionales, qui ont été accommodées par un accroissement des échanges mondiaux de produits agricoles. Sur la base des projec- tions réalisées par la FAO (2002), ce moteur majeur des échanges
- 223. Agriculture mondiale et européenne : défis du XXIe siècle 221 internationaux devrait continuer d’’alimenter le commerce mondial au cours des prochaines décennies, notamment entre pays industrialisés et en transition d’une part, et l’ensemble des pays émergents et en développement de l’autre (tableau 10). Tableau 10. Évolutions de la demande et de l’offre alimentaire par région (Taux de croissance annuels moyens, en %) 1969-1999 1999-2015 2015-2030 Demande 1,0 0,7 0,6 Pays industrialisés Production 1,3 0,8 0,6 Demande -0,2 0,5 0,4 Économies en transition Production -0,4 0,6 0,6 Pays émergents et Demande 3,7 2,2 1,7 en développement Production 3,5 2,0 1,7 Demande 4,5 1,8 1,3 Dont Asie de l’Est Production 4,4 1,7 1,3 Demande 3,5 2,0 1,7 Asie de l’Est hors Chine Production 3,3 1,9 1,8 Demande 2,9 2,1 1,7 Amérique latine Production 2,8 2,1 1,7 Demande 2,4 2,2 1,8 Amérique latine hors Brésil Production 2,3 2,1 1,8 Note : Les deux dernières colonnes sont des projections, sous l’hypothèse que la demande et la production mondiale croîtront au même rythme jusqu’en 2030.. Source : FAO, 2002. Au sein même de ce second ensemble, de loin le plus peuplé et le plus dynamique du point de vue démographique, les évolutions tendancielles de la demande et des potentiels de production sont tout aussi inégales selon les pays, ce qui devrait induire la crois- sance des échanges agricoles et agro-alimentaires Sud-Sud17. 4.1.2. Les coûts de transport, déterminants majeurs de la localisation des productions La plupart des denrées et matières premières agricoles étant des produits pondéreux et de valeur unitaire relativement faible, la manière dont les échanges internationaux de produits agricoles et agro-alimentaires se sont développés au cours des années récentes et 17. Au cours des années récentes, la multiplication des investissements directs étrangers dans le foncier agricole en Europe orientale, de la part d’investisseurs ouest-européens, et en Afrique sub-saharienne, notamment de la part d’investisseurs d’Asie orientale, participe de cette internationalisation et contribue à gonfler les flux d’échanges, notamment Sud-Sud.
- 224. 222 Jacques Le Cacheux les choix de localisation de certaines activités de production18 sont fortement influencés par la relative faiblesse des coûts de transport qui a caractérisé les décennies récentes – dont on peut considérer qu’elle perdure, en dépit des augmentations du prix des carburants fossiles depuis quelques années. Pour bon nombre de produits agri- coles échangés sur des distances longues – et singulièrement pour les produits frais qui, outre le transport, nécessitent de la réfrigéra- tion –, la part que représente le coût des intrants énergétiques dans le prix sur le marché importateur est relativement élevée, de sorte que les augmentations futures prévisibles de ces coûts, qu’elles résultent de la raréfaction des énergies fossiles sur les marchés mondiaux, ou de politiques publiques volontaristes d’augmenta- tion des taxes sur ces sources d’énergie – par exemple sous forme de taxe carbone – dans le cadre des stratégies de conversion vers des économies bas carbone, sont susceptibles de modifier profondé- ment les flux d’échanges internationaux de produits agricoles. 4.2. Doha ou l’impossible accord Lancé en 2000 avec l’objectif de conclure avant la fin de l’année 2008, le Cycle de Doha, survenant après une longue série d’accords qui avaient, depuis les Accords de la Havane (1947), dans le cadre du GATT, permis une libéralisation progressive du commerce mondial de produits manufacturés, et une baisse spectaculaire des droits de douane moyens appliqués à ces produits, a donné la priorité à l’objectif de libéralisation des échanges agricoles, tant par l’ouver- ture des marchés nationaux aux importations que par la réduction et la réorientation des soutiens financiers publics de l’agriculture, singulièrement dans les pays développés, où ceux-ci sont particuliè- rement élevés. Les négociations commerciales précédentes – Cycle de l’Uruguay, conclu en 1994 –, avaient déjà permis, sous la pression du gouvernement américain, de faire un premier pas dans le processus de libéralisation des échanges agricoles en abaissant un peu et en simplifiant les barrières douanières, en imposant un accès minimum aux importations sur les marchés intérieurs, et en interdi- 18. Pas uniquement la production de fleurs coupées, destinées aux marchés des pays développés, dans plusieurs pays d’Afrique de l’Est et en Amérique latine, mais aussi les implantations d’élevages industriels – de volailles, de porcs ou de bovins – dans des régions à bas coût de main-d’œuvre et où les exigences environnementales sont plus faibles que dans les pays où est située la demande de ces produits.
- 225. Agriculture mondiale et européenne : défis du XXIe siècle 223 sant ou en limitant fortement le recours aux aides financières sous forme de soutien aux prix de marché des produits agricoles. 4.2.1. Les marchés mondiaux, entre tendances lourdes et spéculation Ce que l’on désigne sous le terme de « marchés mondiaux » des denrées agricoles ne concerne, dans les faits, qu’une très faible part des volumes produits échangés dans l’agriculture mondiale : l’essentiel des quantités de denrées produites dans chaque pays ou chaque région est, en effet, consommé ou transformé dans le même pays ou la même région – UE, par exemple ; en outre, une part importante – mais malaisément évaluable – des échanges interna- tionaux de denrées fait l’objet de contrats bilatéraux négociés entre gouvernements ou de dons sous forme d’aide alimentaire. Il existe néanmoins de marchés mondiaux, sur lesquels s’échangent les excédents de quelques pays gros producteurs et sur lesquels se forment les prix mondiaux, parfois mus par des interventions spéculatives19. Le nombre de pays offreurs sur ces marchés et les quantités échangées sont, toutefois, faibles au regard des volumes totaux produits dans le monde (tableau 11). Tableau 11. Demande, production et échanges internationaux de quelques produits agricoles par des groupes de pays (millions de tonnes par an) Pays émergents et Pays industrialisés Pays en transition en développement D P C D P C D P C Blé 1997-1999 142,3 215,9 66,0 101,8 100,8 -0,3 338,4 280,2 -61,8 2015 158,6 262,5 103,9 109,9 113,5 3,6 461,8 358,1 -103,7 Riz 1997-1999 23,3 24,3 2,1 2,6 1,2 -1,4 552,6 371,0 -43,2 2015 23,7 24,1 0,4 3,4 1,5 -1,9 679,8 539,4 -89,4 Produits laitiers 1997-1999 225,8 245,8 19,7 94,5 96,6 2,2 239,1 219,3 -19,8 2015 240,4 268,5 28,1 96,9 100,4 3,5 375,8 346,2 -29,6 D = demande, P =production, C = flux commerciaux nets. Source : FAO, 2002. 19. Les marchés futurs de denrées agricoles, ainsi que toute une gamme de « produits dérivés », se sont considérablement développés depuis quelques années, notamment en réponse aux besoins de couverture – contre les variations des cours – des gros producteurs et des négociants, ce qui a accru encore les possibilités de spéculation. Cette question, qui n’est pas développée ici, fait l’objet des attentions de la présidence française du G20. Elle est abordée dans l’étude de la FAO (2009).
- 226. 224 Jacques Le Cacheux Graphique. Les prix mondiaux des denrées alimentaires (Indice FAO des prix mondiaux réels des denrées agricoles, 1998-2000 = 100) 250 200 150 100 50 0 1970 1980 1990 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (déc.) (juin) Source : FAO, 2009. Sur ces marchés, qui dictent les prix intérieurs, les fortes augmentations de prix observées en 2008, puis à nouveau depuis 2010, pour bon nombre de denrées agricoles – céréales, notamment –, ont eu une incidence majeure sur les prix alimen- taires et sur le pouvoir d’achat, surtout dans les pays les moins avancés où les dépenses d’alimentation représentent une part importante des budgets des ménages et où les produits sont faible- ment transformés (cf. supra). Ces hausses constituent une rupture dans des tendances longues à la baisse et suscitent des interroga- tions sur l’avenir : depuis le début des années 1960, en effet, les prix des denrées agricoles ont cru moins rapidement que l’inflation moyenne, de sorte que les prix relatifs ont été presque constam- ment orientés à la baisse, comme ceux de la plupart des matières premières, mais de manière plus marquée (graphique et Banque mondiale, 2008). Des hausses temporaires ont eu lieu dans le passé, notamment au début des années 1970, et il est donc malaisé de prévoir si celles observées récemment sont durables. Néanmoins, les projections disponibles, même celles fondées sur des hypothèses optimistes de progression des rendements et des surfaces cultivées (FAO, 2002), suggèrent que l’offre mondiale de denrées ne devrait pas connaître une croissance aussi soutenue que celle de la demande, dans les décennies à venir, et que la situation devrait, dès lors, rester tendue sur les marchés mondiaux, en proie aux consé- quences des aléas climatiques et des variations de la demande.
- 227. Agriculture mondiale et européenne : défis du XXIe siècle 225 4.2.2. Gagnants et perdants d’une éventuelle libéralisation du commerce agricole mondial L’ambition de libéralisation des échanges internationaux de produits agricoles et de réduction des interventions publiques dans le secteur agricole est, à ce jour, demeurée vaine : au terme d’une décennie de négociations, et en dépit de nombreuses tentatives de compromis entre positions nationales antagoniques – avec, le plus souvent, une opposition entre économies développées (États-Unis et Union européenne) et pays émergents et en développement –, aucun accord n’est en vue. Fondée sur l’hypothèse de l’existence d’importants gains économiques potentiels en cas de développe- ment des échanges internationaux de ces produits, cette ambition se heurte notamment à l’opposition de tous ceux qui sont suscep- tibles d’enregistrer des pertes, qu’il s’agisse des lobbys de producteurs des pays développés ou de bon nombre de pays en développement dont l’intérêt à la libéralisation n’est pas établi. Comme l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la Banque mondiale (2008) met l’accent sur les gains potentiels qu’engendrerait une libéralisation pour les pays en développe- ment, notamment les moins avancés. Le raisonnement s’appuie sur l’hypothèse de marchés agricoles concurrentiels dont les distor- sions que constituent les barrières – notamment tarifaires – aux échanges et les interventions publiques dans les secteurs agricoles seraient démantelées, permettant l’émergence de prix mondiaux d’équilibre concurrentiel. Il s’agit notamment de permettre un meilleur accès des produits agricoles en provenance de pays émer- gents et en développement sur les marchés intérieurs des pays les plus riches, généralement assez protectionnistes en matière agri- cole, de bannir les subventions sur les exportations agricoles – qui ne sont autres que du dumping – et d’interdire les soutiens publics passant par les prix, qui faussent la concurrence en donnant un avantage artificiel de coût aux pays les plus développés : ce faisant, les quantités produites dans les pays développés devraient se réduire, les prix mondiaux augmenter, et les producteurs agricoles des pays en développement profiter de cette hausse de prix et accroître leur production. Mais outre les difficultés suscitées par l’imparfaite transmission des hausses de prix aux producteurs (Banque mondiale, 2008) et les imperfections de la concurrence sur les marchés des produits
- 228. 226 Jacques Le Cacheux alimentaires et de la distribution (Laborde et Le Cacheux, 2002), il apparaît que ces hausses de prix, bénéfiques pour les producteurs agricoles des pays en développement, vont amputer le pouvoir d’achat des ménages urbains de ces pays, et peser lourdement sur les équilibres extérieurs des pays les plus dépendants à l’égard des importations de denrées (cf. supra)20. Bloquées depuis plus de trois ans en dépit de plusieurs tenta- tives de compromis et des efforts de l’OMC pour les relancer, les négociations commerciales internationales ne sont guère suscep- tibles, dans ces conditions, d’aboutir à un horizon prévisible. Ni les grands pays émergents – à l’exception notable du Brésil, principale puissance exportatrice de produits agricoles dans le monde –, ni les pays les plus avancés ne sont, en effet, désireux de libéraliser beau- coup plus les secteurs agricoles et les échanges internationaux. Depuis le lancement du Cycle de Doha, la situation a changé, et les enjeux sont perçus différemment : dans un contexte de prix agri- coles très volatiles et souvent élevés, de nombreux pays sont davantage préoccupés par la sécurité des approvisionnements et la maîtrise des prix alimentaires ; les accords régionaux prennent le pas sur le grand dessein de libéralisation multilatérale ; les défis environnementaux et climatiques remettent en question la vision d’une agriculture mondialisée, requérant des techniques de production intensives en intrants de synthèse et en énergies fossiles, émettrice d’effluents et de déchets polluants, et reposant sur de bas coûts de transport. Le « verdissement de la révolution verte » que la Banque mondiale appelle de ses vœux implique sans doute une moindre internationalisation des secteurs agricoles, et un plus grand recours aux ressources locales ou régionales, que les consommateurs des pays les plus avancés semblent également souhaiter21. 20. L’augmentation de la production intérieure permettrait, pour une part, d’améliorer la situation de ces pays. Mais elle n’est pas toujours possible, en raison notamment des conditions naturelles (disponibilités en eau douce, climat, etc.). 21. La multiplication des initiatives de relocalisation des productions agricoles – mouvement des ANAP, en France, des « locavores » aux États-Unis, rayons consacrés aux produits régionaux dans les magasins de grande distribution, etc. – est un signe du renforcement de ces aspirations, dont les effets ne peuvent toutefois que demeurer limités sans politique volontariste agissant sur les incitations à produire et à consommer.
- 229. Agriculture mondiale et européenne : défis du XXIe siècle 227 4.3. L’Europe : exportateur ou importateur? Pendant des siècles, l’Europe a été, avec les grandes puissances d’Extrême Orient, l’une des principales puissances agricoles du monde. Il est vrai que la diffusion précoce sur son sol, au XIXe siècle, de la Révolution industrielle a, plus tôt qu’ailleurs, amoindri l’importance relative de cette activité ; mais à l’exception du Royaume-Uni, résolument libre-échangiste dès le milieu du XIXe et tourné vers le Commonwealth pour ses approvisionne- ments agricoles et alimentaires, la quasi-totalité des pays européens est demeurée très agricole et a mené des politiques agricoles actives jusqu’à nos jours. Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, dans un contexte particulier de pénurie alimentaire et alors que la coupure en deux blocs hermétiques du continent européen isolait l’Allemagne – elle-même divisée et amputée de sa partie orientale, celle des exploitations de grande culture – de ses fournisseurs tradi- tionnels de céréales – la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, l’Ukraine, etc. –, la volonté d’assurer l’autonomie et la sécurité alimentaire de l’Europe de l’Ouest a constitué l’un des moteurs essentiels des premières étapes de la construction européenne ; la perte des empires coloniaux y a également joué un rôle. Mais au cours des deux dernières décennies, les orientations de la politique agricole européenne se sont profondément modifiées, en réponse au coût budgétaire croissant de la Politique agricole commune (PAC) et des effets pervers du productivisme qui l’a longtemps caractérisée. Au terme de deux décennies de retrait progressif de l’interventionnisme public dans l’agriculture, l’Union européenne est aujourd’hui confrontée à des choix, à la veille d’une nouvelle réforme de la PAC qui doit être adoptée avant 2013, date à laquelle expire l’actuelle programmation budgétaire européenne. 4.3.1. Le démantèlement progressif de la Politique agricole commune Inscrite dans le traité de Rome de 1957 qui fonde la Commu- nauté économique européenne (CEE) à 6 – Allemagne (de l’Ouest), Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas –, la Politique agri- cole commune (PAC) européenne a occupé une place centrale au cours des trois premières décennies de la construction européenne. Empruntant une voie inspirée de la modernisation du secteur agri- cole américain au cours des décennies qui ont suivi la crise agricole des années 1920 et la Grande Dépression, elle est assez embléma-
- 230. 228 Jacques Le Cacheux tique des politiques de « révolution verte », notamment celles mises en œuvre par la suite dans plusieurs pays en développement (Inde notamment). Conçue dans un contexte de relative pénurie alimentaire et de dépendance forte de l’Europe des Six à l’égard des approvisionnements en provenance du reste du monde, son orien- tation était résolument productiviste. Les deux objectifs prioritaires qui lui avaient été assignés étaient l’augmentation des quantités produites et la hausse des revenus et niveaux de vie des agriculteurs, alors sensiblement inférieurs, en moyenne, à ceux des ménages urbains. Outre une politique active de soutien technique et financier public à la modernisation des exploitations agricoles – remembrement foncier, encouragement à l’adoption de tech- niques culturales et d’élevage « modernes », recourant à des intrants industriels (engrais minéraux, pesticides, semences sélec- tionnées, aliments composés du bétail, etc.) –, la PAC s’appuyait, dès ses origines, sur des organisations communes de marché (OCM) pour les principales productions agricoles (lait, céréales, viande bovine) – par la suite étendues à d’autres productions – et recourait aux instruments de soutien direct des marchés : fixation d’un prix-plancher et interventions de retrait du marché (stockage, exportations subventionnées ou destruction de produits), finan- cées sur fonds publics du budget européen, pour soutenir le prix ; protection contre les importations du reste du monde, avec la « préférence communautaire » et le prélèvement variable aux fron- tières de la CEE, assurant que le prix des importations agricoles en provenance du reste du monde n’était jamais inférieur au prix européen (voir notamment Bourgeois et Pouch, 1993). Le soutien direct des prix de marché présentait ainsi le double avantage d’encourager à l’accroissement des quantités produites et de faire croître les revenus des exploitants agricoles. Cette politique, initialement peu coûteuse pour les finances publiques européennes parce que la production intérieure était inférieure à la demande – ce qui maintenait des prix élevés sans intervention permanente – et que les prélèvements sur les importa- tions du reste du monde en assuraient le financement, a permis aux revenus agricoles d’atteindre, en moins de deux décennies, la parité avec ceux des urbains, et à la CEE d’atteindre l’autosuffisance agricole dans les principales productions, puis de devenir exporta- trice, dès le début des années 1970 pour le lait, la fin de la même
- 231. Agriculture mondiale et européenne : défis du XXIe siècle 229 décennie pour les céréales (Le Cacheux et Mendras, 1992). Mais, maintenant des prix intérieurs élevés dans un contexte de baisse tendancielle des prix mondiaux des principales denrées agricoles (FAO, 2010), victime de son succès, la PAC est, à partir de ce moment, devenue une charge financière considérable pour le budget européen (Le Cacheux, 2009) : les mesures de retrait du marché ont impliqué des volumes croissants et leur coût budgé- taire s’est fortement accru ; et les recettes prélevées sur les importations se sont taries avec le dépassement des seuils d’auto- suffisance et la montée des exportations agricoles de l’Europe. Les réformes entreprises à partir de 1992, en partie pour répondre à la contestation croissante de certains gouvernements européens – au premier rang desquels le gouvernement britannique –, en partie pour satisfaire aux nouvelles exigences des accords commerciaux internationaux, et poursuivies jusqu’à présent, ont, en plusieurs étapes, radicalement transformé les modes de régula- tion du secteur agricole européen, désormais presque purement marchands, et sensiblement réduit le coût budgétaire de la PAC, qui demeure toutefois le premier poste de dépenses du budget euro- péen avec environ 50 milliards d’euros annuels, soit un peu plus de 40 % du total. Au terme de ces réformes, les politiques d’interven- tion directe sur les marchés agricoles et de soutien des prix ont été pratiquement complètement démantelées et remplacées par des aides directes au revenu des exploitants, « découplées » – c’est-à- dire indépendantes des quantités produites – tandis que les protec- tions douanières et les subventions à l’exportation ont été réduites ou complètement supprimées : les prix intérieurs fluctuent donc désormais au gré des marchés mondiaux, de même que les revenus agricoles, à qui l’on garantit un montant fixe annuel, quels que soient les productions choisies, les quantités produites et les recettes des ventes. Un « second pilier », agro-environnemental, de la PAC, fait dépendre quelques aides directes publiques de critères écologiques ou des spécificités de l’environnement régional (zones de montagne, par exemple). Au fil des réformes, l’abandon progressif des dispositifs de soutien des prix et le découplage, désormais presque complet, des aides publiques par rapport au type de production et aux quantités produites, ont transformé la PAC en un mécanisme de pur soutien aux revenus. Or cette redistribution, basée pour l’essentiel, sur les
- 232. 230 Jacques Le Cacheux surfaces exploitées, a la nature d’une rente foncière, qui ne béné- ficie pas uniquement à l’exploitant, mais aussi aux propriétaires du foncier agricole ; et sa répartition est de plus en plus contestée, dans la mesure où l’essentiel des subsides profite à un nombre restreint d’exploitants – l’ordre de grandeur au cours des années récentes étant que 80 % des montants distribués vont aux 20 % les plus aisés parmi les agriculteurs européens. 4.3.2. Les options pour une réforme À l’approche de l’échéance de 2013, terme de l’actuelle program- mation budgétaire pluriannuelle européenne22, la Commission européenne a lancé la réflexion sur une nouvelle réforme de la PAC, dont les implications financières devraient être inscrites dans le prochain cadre financier couvrant la période 2014-2020. Le projet récemment dévoilé par le Commissaire Ciolos ne comporte que des inflexions relativement mineures (renforcement des aides conditionnelles du « second pilier », et plafonnement des aides directes pour les plus grosses exploitations, avec redistribution aux « petites fermes »), les ambitions semblant se cantonner à réduire le coût budgétaire total de la PAC et à rendre son dispositif redistri- butif moins franchement inégalitaire, tout en tentant d’infléchir la tendance à la disparition très rapide des petites exploitations dans de nombreuses régions d’Europe. Pour louables que soient ces objectifs, ils ne peuvent tenir lieu de politique agricole et alimentaire pour l’Union européenne, qui demeure le premier marché alimentaire mondial, le premier expor- tateur de produits agro-alimentaires (transformés) et l’une des premières régions de production agricole du monde. L’absence de stratégie européenne, face aux nombreux défis mondiaux, apparaît, en effet, préoccupante. D’importantes questions liées à l’avenir des modes de production agricoles et alimentaire en Europe, telles que leur intensité énergétique, l’usage intensif et croissant de l’irriga- tion, d’intrants de synthèse, et des OGM, ne sont pas abordées ; le choix de l’ouverture, qui engendre inéluctablement une plus forte dépendance à l’égard des approvisionnements en provenance du reste du monde, bien que fondée sur la logique de l’avantage 22. Pour davantage de précisions sur le processus budgétaire européen et la part de la PAC dans les dépenses, voir notamment : Le Cacheux, 2009.
- 233. Agriculture mondiale et européenne : défis du XXIe siècle 231 comparatif et de la spécialisation – l’Amérique du Sud (Brésil et Argentine en particulier) étant, actuellement, la région qui béné- ficie le plus, du point de vue purement pécuniaire, de l’essor des importations européennes – n’est pas sérieusement analysé, alors qu’il soulève de sérieuses objections, notamment parce qu’il repose sur l’hypothèse de la persistance de bas coûts de transport et engendre des pressions environnementales fortes sur les pays four- nisseurs. De même, les questions liées à la sécurité alimentaire, dans ses diverses acceptions – sécurité des approvisionnements à des prix « raisonnables », qualité organoleptique et sanitaire des aliments – devraient faire l’objet d’une réflexion et de choix politiques euro- péens. En outre, le rôle de l’agriculture – et de l’aquaculture – dans la gestion de l’environnement et des ressources renouvelables – eau et biodiversité, notamment –, de même que dans la production d’énergies nouvelles – notamment à partir de la biomasse – n’est pas géré de manière adéquate par le « second pilier » de la PAC et néces- siterait des instruments plus résolument incitatifs et des aides à la modernisation comparables à ce qu’était la section « orientation » du Fonds européen de l’ancienne PAC (Bourgeois et Pouch, 1993). Bien que des progrès aient été accomplis vers une « agriculture raisonnée », moins gourmande en intrants de synthèse et moins agressive à l’égard de l’environnement, les agricultures euro- péennes ont, pour l’essentiel, maintenu les orientations productivistes qui les caractérisaient au cours des décennies passées ; les tendances à la concentration des exploitations et à la déprise agricole dans de nombreuses régions se poursuivent égale- ment23 ; et les dérives de la qualité alimentaire – tant en termes sanitaires que gustatifs – ne présentent pas d’inflexion notable, en dépit des aspirations exprimées par les consommateurs et les auto- rités sanitaires. En particulier, les méthodes de production respectueuses de l’environnement et l’agriculture biologique ne connaissent qu’un essor modeste. L’option non-interventionniste – le souci de ne pas interférer avec les incitations données par des mécanismes de marché « non faussés » – repose sur l’hypothèse que les marchés agricoles et alimentaires sont efficaces, au sens classique que les économistes 23. Pour ce qui concerne la France, on peut en lire les conséquences dans les scénarios prospectifs élaborés par l’INRA (2008).
- 234. 232 Jacques Le Cacheux donnent à ce terme – qu’ils sont raisonnablement concurrentiels, ne souffrent pas de problèmes d’information et ne sont pas distordus par la présence d’externalités. Or il apparaît, à l’analyse, que ces hypothèses sont moins vérifiées encore dans ce domaine que dans beaucoup d’autres, ce qui devrait encourager les pouvoirs publics à mettre en œuvre des politiques plus directives et modi- fiant plus résolument les incitations, notamment pour le développement d’une agriculture de proximité, moins gourmande en intrants minéraux et fossiles, produisant moins de déchets et les valorisant mieux, articulant plus harmonieusement production alimentaire de qualité et production d’énergies renouvelables – la photosynthèse apparaissant bien, à ce jour, comme le mode le plus efficace de transformation de l’énergie solaire, abondante, et des oxydes de carbone présents dans l’atmosphère en carbone orga- nique – : autrement dit, viser, selon les termes de la Banque mondiale (2008), un « verdissement de la révolution verte ». 5. Conclusion : la soutenabilité de l’agriculture mondiale La formidable croissance de la production agricole et alimen- taire au cours des dernières décennies, et notamment de la seconde moitié du XXe siècle, a permis d’accroître sensiblement la quantité et les qualités nutritionnelles moyennes de la nourriture pour la très grande majorité des populations. Il et vrai que l’accès à une alimentation suffisante pour couvrir les besoins vitaux demeure insuffisant, et que près d’un habitant de la planète sur 7 ne mange toujours pas à sa faim ; mais l’augmentation de l’offre agricole a été plus que suffisante pour compenser l’extraordinaire croissance démographique observée au cours des décennies récentes. Et, selon les projections de la FAO, il devrait en aller de même au cours des prochaines décennies, car la croissance démographique mondiale ralentit et le potentiel d’augmentation de la production agricole est encore important. C’est toutefois dans la manière dont l’agriculture mondiale a pu faire face à cette demande croissante que se situe la source des prin- cipaux défis auxquels elle est désormais confrontée. L’augmenta- tion des quantités produites a, en effet, été obtenue au prix d’une pression croissante des activités agricoles et des secteurs liés en amont et en aval sur l’environnement et les ressources naturelles.
- 235. Agriculture mondiale et européenne : défis du XXIe siècle 233 Les conséquences en termes écologiques – notamment sur la biodi- versité, le changement climatique et les ressources halieutiques et en eau douce – sont telles que la poursuite des tendances observées menacerait gravement l’environnement. Dès lors, les défis du XXIe siècle ne sont pas de même nature que ceux qui ont été relevés au cours des siècles passés : il ne s’agit pas seulement de produire davantage, pour « nourrir la planète », mais de produire autrement, pour minimiser ces atteintes à l’environnement et préserver le capital naturel auquel auront accès les générations futures. L’histoire longue enseigne que ces défis ne sont pas insur- montables, notamment parce que les contraintes naturelles et environnementales ont toujours suscité des innovations qui ont permis d’en repousser les limites. Mais les enjeux sont désormais plus grands, et ont souvent une dimension planétaire ; ils revêtent, en outre, un caractère d’urgence tel que les politiques agricoles doivent impérativement infléchir les incitations pour provoquer une nouvelle « révolution verte », véritablement « verte ». c'est-à- dire promouvant une agriculture soutenable. Références bibliographiques Académie de l’agriculture, 2010, Communication, 5 avril. Banque mondiale, 2008, Agriculture for Development, World Development Report 2008, Washington, DC. Bourgeois L., et T. Pouch, 1993, « La politique agricole commune : une politique réduite au marché », Revue de l’OFCE, n° 43. Crouzet F., 2000, Histoire de l’économie européenne 1000-2000, Albin Michel. FAO (Food and Agriculture Organisation), 2002, World Agriculture towards 2015/2030, Rome. FAO, 2009, The State of Agricultural Commodity Markets. High Food Prices and the Food Crisis – Experiences and Lessons Learned Crises, Rome. FAO, 2010a, The State of Food Insecurity in the World. Addressing Food Insecu- rity in Protracted Crises, Rome. FAO, 2010b, The State of World Fisheries and Aquaculture 2010, Rome. FAO, 2011, The State of World’s Forests, Rome. GIEC (Groupe international d’experts sur le climat), 2007, Climate Change. Synthesis Report, Nations Unies, http://www.ipcc.ch/pdf/assessment- report/ar4/syr/ar4_syr.pdf .
- 236. 234 Jacques Le Cacheux INRA (Institut national pour la recherche agronomique), 2008, Résultats de la prospective agricole 2013. Résultats et enseignements principaux par scénario, Paris. Le Cacheux J., 2002, Sécurité alimentaire : la dimension internationale, in François Constantin, ed., Biens publics mondiaux, L’Harmattan. Le Cacheux J., 2009, Les faiblesses du budget européen, in R. Dehousse, ed., Politiques européennes, Presses de Sciences Po. Le Cacheux J., et D. Laborde, 2003, Price and welfare effects of agricultural liberalization with imperfect competition in food industries and trade présenté à la conference Ecomod, Istanbul, juillet.. Le Cacheux J., et H. Mendras, 1992, Éléments pour une nouvelle politique agricole, Revue de l’OFCE, n° 42, octobre. Le Goff J., 2003, L’Europe est-elle née au Moyen Age ?, Seuil, Paris. Maddison A., 2001, L’économie mondiale – Une perspective millénaire, OCDE, Paris. McNeill J. R., 2000, Something New Under the Sun: An Environmental History of the Twentieth-Century World, New York: W. W. Norton. Pomeranz K., 2001, The Great Divergence, China, Europe, and the making of the Modern World, Princeton University Press.
- 237. FAUT-IL DÉCOURAGER LE DÉCOUPLAGE ? Éloi Laurent OFCE, Observatoire français des conjonctures économiques L'idée de l'impossibilité d'un découplage absolu entre la croissance économique et son impact environnemental occupe le cœur de la démons- tration de l'ouvrage récent du chercheur britannique Tim Jackson, Prospérité sans croissance. Après avoir mis en lumière certaines limites empiriques de la démonstration de Jackson, cet article insiste sur l'importance du concept de découplage comme instrument de la transition écologique des écono- mies, en particulier dans l'Union européenne. À l'aune de l'expérience européenne de découplage absolu entre croissance économique et émis- sions de gaz à effet de serre, une distinction importante est introduite, non seulement entre découplage absolu et relatif, mais surtout entre découplage brut et net. L'article élargit ensuite la question du découplage européen à l'enjeu des pollutions atmosphériques et des ressources naturelles pour conclure à la nécessité de définir et de percevoir le découplage dans toutes ses dimensions. Mots-clés : découplage, prospérité sans croissance, Union européenne. Revue de l’OFCE / Débats et politiques – 120 (2011)
- 238. 236 Éloi Laurent 1. Le « mythe du découplage » en questions Prospérité sans croissance, l’ouvrage du chercheur britannique Tim Jackson (d’abord publié sous la forme d’un rapport en 20091, puis d’un livre la même année, traduit en français en 20102) est un ouvrage important qui formule de manière originale des questions désormais centrales dans le débat économique et politique : comment réduire l’impact environnemental de l’activité écono- mique ? Comment définir et améliorer le bien-être humain ? Quels buts collectifs les sociétés contemporaines doivent-elles désormais se donner au-delà de l’accumulation matérielle ? L’écho mondial largement positif que reçut l’ouvrage est mérité et témoigne d’un appétit grandissant, dans le monde de la recherche comme dans le grand public, pour les pensées alternatives robustes à la théorie économique standard. On peut dès lors s’étonner que les analyses et les thèses présentées dans ce texte marquant n’aient été que très peu discutées et encore moins soumises à la critique jusqu’à présent. Car Tim Jackson, c’est ce qui fait la force de son livre, fonde ses recommandations sur des analyses précises et, pour certaines, quantifiées. L’idée de l’impossibilité d’un découplage absolu entre la crois- sance économique (mesurée par celle du PIB) et son impact environnemental (mesuré par les émissions de CO2 et la consom- mation des ressources naturelles) occupe le cœur de la démonstration. Les sociétés et les économies contemporaines peuvent éventuellement parvenir à un découplage relatif entre croissance et consommation/pollution, le rythme des secondes devenant moins rapide au fil des innovations technologiques que celui de la première ; mais le découplage absolu, qui verrait la crois- sance du PIB augmenter tandis que son impact environnemental recule est, selon Jackson, hors d’atteinte et constitue même une dangereuse illusion (sur la notion de découplage et les concepts voisins, voir encadré 1). 1. Rapport de la Commission du développement durable du Royaume-Uni, accessible en ligne à l’adresse http://www.sd-commission.org.uk/publications.php?id=914 et auquel cet article se réfère. 2. Jackson (2010).
- 239. Faut-il décourager le découplage ? 237 Encadré 1. Découplage et concepts associés Les réflexions et travaux sur la notion de découplage entre économie et environnement, dont l’intuition remonte à la « courbe environne- mentale de Kuznets »3, datent du début des années 2000 et se sont, au plan institutionnel, principalement développés au sein d’Eurostat (2001), de la Commission européenne (2005) et de l’OCDE (2008). Selon cette dernière4, le découplage désigne au sens large le fait de « briser le lien entre les maux environnementaux et les biens économiques ». Il y a découplage lorsque le taux de croissance d’une pression sur l’environne- ment (par exemple les émissions de CO2) devient inférieur à celui de sa force motrice (par ex. la croissance du PIB). On parle de découplage absolu si la pression sur l’environnement (par ex. le volume des émis- sions de CO2) demeure stable ou décroît tandis que la variable mesurant la force motrice augmente (par exemple le PIB réel en volume). Il y a découplage relatif lorsque la pression sur l’environnement augmente mais à un taux de croissance moindre que celui de la force motrice (taux de croissance du PIB > taux de croissance des émissions). Dans sa communication de 20055, la Commission européenne a reconnu la nécessité d’enrichir cette approche en distinguant deux formes de découplage et en évoquant la nécessité d’un « double décou- plage » : réduire l’usage des ressources naturelles dans une économie en croissance économique d’une part et réduire l’impact environnemental de cet usage de l’autre. Dans le premier cas, il s’agit d’accroître la produc- tivité en ressources naturelles de l’économie, qui peut être mesurée de différentes manières et notamment par le biais de la productivité maté- rielle de l’économie. On souhaite alors augmenter l’intensité matérielle ou l’efficacité matérielle de l’économie, autrement dit diminuer la quan- tité de ressources naturelles nécessaire à la production d’une unité de produit économique (ou de valeur ajoutée). Dans les faits, l’analyse des flux de matières ne permet de prendre en compte que certaines ressources naturelles : la Commission européenne souhaite par exemple que les États membres de l’UE accroissent leur consommation intérieure matérielle (en tonne/habitant/an) par unité de PIB, mais cette consom- mation intérieure matérielle (qui mesure selon l’OCDE « les matières 3. L’idée élémentaire de ce que les économistes de l’environnement appellent la « courbe environnementale de Kuznets » est de mettre en relation le processus de développement écono- mique (dont le niveau est mesuré par le revenu par habitant) avec les dégradations environnementales. Une relation en cloche est alors postulée : les dégradations environnemen- tales sont d’abord censées augmenter avec l’élévation du revenu par habitant avant d’atteindre un pic, puis de se réduire. L’idée qui soutient cette courbe a été introduite en 1992 dans le rapport sur le développement des Nations Unies puis formalisée et illustrée empiriquement par un article de Grossman et Krueger paru en 1995 (Grossman, Gene and Alan Krueger, 1995, « Economic growth and the environment ». The Quarterly Journal of Economics 110 (2): 353-377). 4. Voir OECD (2008). 5. European Commission, 2005, « Thematic Strategy on the Sustainable Use of Natural Resources », Communication COM 670 (2005).
- 240. 238 Éloi Laurent directement utilisées moins les exportations, c’est-à-dire l’extraction intérieure augmentée des importations et diminuée des exportations »), ne prend par exemple pas en compte les besoins en eau de l’économie (qui peuvent être mesurés à l’aide d’autres instruments). On s’en tiendra ici, pour y revenir ensuite, à deux limites bien connues de l’approche par le découplage. La première tient dans « l’effet rebond » mis en lumière par Stanley Jevons dès 18656 : l’amélioration de la productivité matérielle de l’économie peut conduire à un accroisse- ment des volumes de ressources naturelles consommées. En outre, un découplage au plan national peut résulter du déplacement vers d’autres pays de la consommation des ressources naturelles associées à la produc- tion (il faut alors distinguer, on y reviendra, entre consommation et production et entre flux apparents et flux cachés de matières) et de l’impact environnemental néfaste qui y est associé. Ce pessimisme/réalisme de Tim Jackson sur la possibilité du découplage (qu’il qualifie de « mythe » dans le chapitre central de son ouvrage) fonde ses propositions, qui entendent dépasser le cadre habituel de ce qu’il est désormais convenu d’appeler « l’économie verte » pour s’attaquer aux causes selon lui structu- relles de la question environnementale : notre conception du travail, de l’épanouissement personnel et de la réussite collective. On peut, comme c’est le cas de l’auteur de ces lignes, partager à la fois le questionnement initial de Jackson et certaines de ses conclu- sions, mais se montrer dubitatif sur la partie empirique de sa démonstration et, plus fondamentalement, sur son rejet apparent de la notion de découplage pour nous aider à penser la transition écologique de l’économie. 6. Au Chapitre VII de son ouvrage consacré à la dépendance de l’économie britannique à l’égard d’un charbon bon marché mais épuisable, The Coal Question (1865), l’économiste Stanley Jevons formule le paradoxe qui a gardé son nom : l’accroissement de l’efficacité technologique dans l’utilisation d’une ressource naturelle comme le charbon peut ne pas réduire la demande pour cette ressource, mais au contraire l’accroître. La consommation est en un sens déchaînée par l’accélération technologique du fait de la baisse des coûts que celle-ci entraîne. La demande est alors emportée dans une course qui démultiplie l’impact de la consommation sur les ressources naturelles et abrège le temps qui sépare le système économique de l’insoutenabilité et finalement, dans l’esprit de Jevons, du déclin : « le système économique multiplie la valeur et l’efficacité de notre matériau principal ; elle accroît indéfiniment notre richesse et nos moyens de subsistance et conduit à une extension de notre population, de nos productions, de nos échanges, qui est appréciable dans le présent, mais nous conduit nécessairement vers une fin prématurée ».
- 241. Faut-il décourager le découplage ? 239 L’argument clé de Jackson fait appel à l’équation IPAT7. Jackson s’explique : « l'équation d’Ehrlich nous dit tout simplement que l'impact (I) de l'activité humaine est le produit de trois facteurs : la taille de la population (P), son niveau de richesse (A), exprimé en revenu par habitant, et un facteur représentant la technologie (T), qui mesure les impacts associés à chaque dollar que nous dépen- sons. Pour autant que le facteur T décroisse, nous sommes assurés d’un découplage relatif. Mais pour atteindre un découplage absolu, nous avons besoin que la variable I décline également. Et cela ne peut arriver que si T descend assez vite pour dépasser le rythme auquel la population (P) et le revenu par habitant (A) augmen- tent. ». L’intuition de Jackson, juste, est donc celle d’une course entre deux ensembles de variables : la population et le niveau de richesse d’un côté, qui augmentent l’impact environnemental de l’activité économique ; la technologie de l’autre, qui permet de l’amoindrir. Sur la question du changement climatique, que Jackson utilise pour illustrer son propos, l'équation IPAT prend la forme de l’iden- tité de Kaya8 (que Jackson ne mentionne pas mais dont il se sert pourtant) qui décompose la croissance des émissions de gaz à effet de serre en une somme de quatre taux de croissance : celui de la population, du PIB par tête, de l’intensité énergétique (c'est-à-dire la consommation d’énergie primaire par unité de PIB) et de l’inten- sité carbonique (c'est-à-dire le niveau d’émissions de gaz à effet de serre ou GES par unité de consommation d’énergie primaire). L'identité de Kaya, en lien avec l’équation IPAT, peut ainsi s’écrire : (I) Emissions de CO2 liées à la consommation d’énergie fossiles = Population (P) * Richesse (A)* Intensité carbonique de la croissance (T) Ou encore : Emissions de CO2 liées à la consommation d’énergie fossiles = Population * PIB par habitant * intensité énergétique de la croissance * intensité carbonique de l’énergie. Si on raisonne en termes de taux de croissance, on peut écrire l’identité de Kaya comme mettant en regard le taux de croissance 7. L’équation IPAT a été popularisée par Ehrlich et Holdren (1971). 8. Kaya Y. (1990).
- 242. 240 Éloi Laurent des émissions et la somme du taux de croissance des quatre compo- santes détaillés ci-dessus. Le GIEC (2007) calcule ainsi que la croissance annuelle de 1,9 % des émissions de CO2 dans le monde de 1970 à 2004 s’explique par une croissance annuelle de la population de 1,6 %, une croissance annuelle du PIB par tête de 1,8 %, une baisse annuelle de l’intensité énergétique de 1,2 % et une baisse de l’intensité carbonique de 0,2 %. Tableau 1. Décomposition de Kaya pour l’économie mondiale (1970-2004) Monde 1970-2004 (en % de croissance annuelle) Population + 1,6 PIB par tête + 1,8 Intensité énergétique -1,2 Intensité carbonique -0,2 Effet net + 1,9 Source : GIEC. La dynamique globale des émissions de gaz à effet de serre depuis environ quatre décennies est donc la suivante : les progrès dans l’efficacité énergétique et la « décarbonisation » de l’énergie consommée n’ont pas suffi à compenser la hausse de la population et celle du revenu par habitant. Dit autrement, l’effet volume clima- tiquement néfaste de l’économie mondiale (plus d’habitants, plus riches) excède l’effet valeur bénéfique (amélioration technologique qui permet de consommer moins d’énergie par unité de croissance et d’émettre moins de carbone par unité d’énergie consommée). Le GIEC ajoute qu’à l’aune de cette dynamique passée et des projections futures de population et de revenu, le défi d’un décou- plage absolu entre croissance du PIB par habitant et émissions de gaz à effet de serre, nécessaire pour atteindre les objectifs clima- tiques que les responsables politiques ont tirés de ses travaux, apparaît tellement titanesque qu’il en est « décourageant ». « Le défi – une réduction absolue des émissions mondiales de GES – est de taille. Il suppose une réduction de l'intensité énergétique et carbonique à un rythme plus rapide que le revenu et la croissance démographique pris ensemble. Certes, il y a de nombreuses combi- naisons possibles des quatre composantes de l'identité de Kaya…
- 243. Faut-il décourager le découplage ? 241 mais les deux facteurs axés sur la technologie, l’intensité énergé- tique et carbonique, vont devoir assumer le rôle principal ». Tim Jackson conteste implicitement cette conclusion de la possibilité d’une sortie de la crise climatique par la technologie à partir d’une « arithmétique de la croissance » simple mais impla- cable : « Pour les émissions de dioxyde de carbone provenant de la combustion du carburant…les émissions totales (C) sont données par le produit de la population (P), du revenu (PIB en dollars/ personne) et de l'intensité carbonique de l'activité économique (gCO2 / $) : C = P * $ / personne * gCO2 / $. Jackson applique alors son raisonnement à l’année 2007 : « la population mondiale était d'environ 6,6 milliards d’individus, le niveau de revenu moyen en dollars constants de 2000 (prix du marché) de 5 900, et l'intensité carbonique de 760 gCO2 / $... nous constatons que les émissions de dioxyde de carbone totales (C) sont de : 6,6 x 5,9 x 0,77 = 30 milliards de tonnes de CO2. En 1990, quand la population était seulement de 5,3 milliards d’habitants et le revenu moyen de 4 700 dollars, l'intensité carbonique était de 860 gCO2 / $, le total des émissions de dioxyde de carbone C étaient alors de : 5,3 x 4,7 x 0,87 = 21,7 milliards de tonnes de CO2 ». « Ces chiffres, écrit Jackson, sont confirmés par ceux de l’Energy Information Administration…la croissance cumulée des émissions entre 1990 (année de référence de Kyoto) et 2007 a été de 39 % (30/21,7 = 1,39) avec un taux de croissance moyen des émis- sions de près de 2 % ((1,39) 1 / 17-1 = 1,96 %) ». On peut remarquer d’emblée que Jackson utilise une version agrégée de l’identité de Kaya (où l’intensité carbonique de la crois- sance remplace l’intensité énergétique de la croissance et l’intensité carbonique de l’énergie), qui ne permet pas de distin- guer entre ce qui revient dans l’ajustement à l’intensité énergétique de la croissance et à l’intensité carbonique de l’énergie. Mais surtout, son chiffrage paraît contestable. L'Energy Information Administration (2010), dans l’édition 2010 de son International Energy Outlook, effectue le même calcul que Jackson, avec des résultats très différents : « en 2007, les émis- sions de dioxyde de carbone liées à l’énergie s’élèvent à 29,7 milliards de tonnes métriques, la consommation énergétique
- 244. 242 Éloi Laurent mondiale à 495 quadrillions de Btu, le PIB mondial à 63,1 milliards de dollars, et la population mondiale totale était 6 665 millions d’individus. En utilisant ces chiffres dans l'équation de Kaya, l’EIA obtient les résultats suivants : 60,1 tonnes métriques de dioxyde de carbone par milliard de Btu d'énergie (CO2 / E), 7 800 BTU d'énergie par dollar de PIB (E / PIB), et 9 552 dollars de revenu par personne (PIB / POP). Ces chiffres conduisent à une intensité carbonique du PIB de 0,465, inférieure de près de 40 % au chiffre obtenu par Tim Jackson. La différence s’explique par l’utilisation respective d’un PIB mondial au prix du marché par Jackson et d’un PIB mondial en PPP par l’EIA, mesure qui paraît plus adéquate. La base de données en ligne de l’EIA, qui permet alternativement d’utiliser un PIB en dollars constants de 2005, aboutit à une intensité carbonique pour 2007 de 0,601, sensiblement plus faible que celle avancée par Jackson. Contrairement à ce que ce dernier écrit, ses résultats ne sont pas confirmés mais invalidés par les données de l’EIA. La base de données du FMI, autre référence internationale, donne les chiffres suivants du PIB pour 2007 : à prix courants, il s'établit à 55,615 474 dollars (ou 8 344 dollars par habitant), ce qui implique une intensité carbonique de 0,539 (un écart de 30 % avec les chiffres de Jackson) ; en PPP, il s'élève à 66,622 188 dollars, très proche de l'estimation de PPP de l’EIA. On peut donc dire, au regard de la plus grande pertinence à la fois de la mesure PPP et en dollars constants de 2005 du PIB, que Jackson a semble-t-il sous-estimé le PIB mondial, ce qui l’a conduit à sous-estimer de ce fait l’intensité carbonique de la production. Il y a là une ironie savoureuse, puisque Jackson, après d’autres et à juste raison, entend précisément minimiser l’importance du PIB comme mesure du développement humain. Cette erreur n’est cependant pas négligeable dans le fatalisme dont Jackson fait preuve à l’égard de la notion de découplage. En termes de rétrospective, Jackson propose le chiffrage suivant : « l’intensité carbonique a baissé en moyenne de 0,7 % par an depuis 1990. C'est bien, mais pas assez bien. La population a augmenté à un taux de 1,3 % et le revenu moyen par habitant a augmenté de 1,4 % chaque année (en termes réels) sur la même période. L’efficacité carbonique n'a même pas compensé la crois-
- 245. Faut-il décourager le découplage ? 243 sance de la population, sans parler de la croissance des revenus…les émissions de carbone ont augmenté en moyenne de 1,3 + 1,4 – 0,7 = 2 % par an, entraînant une augmentation de près de 40 % des émissions. Mais les données de l’EIA pour la période 1990-2007 s’établissent en moyenne comme suit (encadré 2). Ici aussi, Jackson sous-estime le PIB par habitant et par conséquent surestime l'intensité carbonique de la croissance. Encadré 2. Les composantes de l’identité de Kaya, 1990-2007 Taux de croissance des émissions de CO2 = 1,92 % = Taux de croissance de la population = 1,33 % + Taux de croissance du PIB moyen par habitant = 1,66 % + Taux de croissance de l'intensité carbonique de la production = - 1,07 % Source des données: EIA, calculs de l'auteur. En termes de projection, Tim Jackson fait remarquer que « selon l'ONU… la population mondiale devrait atteindre neuf milliards de personnes en 2050 – une croissance moyenne de 0,7 % chaque année », ce qui est juste, comme illustré dans le tableau suivant fondé sur la dernière révision du scénario population des Nations Unies : Tableau 2. Évolution de la population mondiale, 2010-2050 Taux de croissance de la population 2010-2015 1,1 2015-2020 1 2020-2025 0,89 2025-2030 0,78 2030-2035 0,69 2035-2040 0,6 2040-2045 0,52 2045-2050 0,44 Moyenne 0,75 Source : Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2010 Revision, http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm et calculs de l’auteur. Mais il n’est en revanche pas juste d'écrire comme le fait Jackson : « dans le scénario business as usual, la baisse de l'intensité carbonique compense tout juste la croissance de la population »,
- 246. 244 Éloi Laurent puisque la réduction de l'intensité carbonique a été en moyenne de 1,07 % depuis 1990, ce qui excède le rythme prévu d’accroissement démographique, même dans le nouveau scénario des Nations- Unies, moins favorable. Il n'est également pas juste d'écrire : « Pour atteindre une réduction en moyenne d'année en année des émis- sions de 4,9 %, avec une croissance démographique de 0,7 % et une croissance des revenus de 1,4 %, T doit être amélioré d'environ 4,9 + 0,7 + 1,4 = 7 % chaque année – presque dix fois plus vite qu’aujourd’hui ». L'équation exacte est en fait 4,9 + 0,7 + 1,66 = 7,26 %, soit 6,78 le taux observé de diminution de l'intensité carbonique de 1990 à 2007, ce qui est nettement inférieur à 10. Si l'objectif est la borne inférieure de la cible du GIEC (une réduction de 50 % des émissions d'ici 2050), la réduction annuelle nécessaire devient 2,1 %, ce qui signifie une accélération technologique de 2,1 + 0,7 + 1,66 = 4,46, soit 4,1 fois le taux observé de réduction de 1990 à 2007. Cette approximation arithmétique de Jackson n’est pas le cœur du problème de son livre : en niant la possibilité du découplage absolu et la pertinence pour la transition écologique du concept de découplage, il commet sa véritable erreur, élude les réels problèmes liés à cette notion et prive son lecteur d’un outil précieux d’analyse et de levier des politiques publiques pour la transition écologique de l’économie, ce qu’illustre bien le cas européen. 2. L’expérience européenne du découplage absolu croissance-carbone et la question du découplage net 2.1. La dynamique du développement européen : la question du découplage absolu Il existe au moins un exemple historique bien connu de décou- plage absolu entre croissance économique et émissions de dioxyde de carbone dans une grande économie du monde : les États-Unis, à la suite du second choc pétrolier. Comme le rappellent Lovins, Datta et al. (2004), au cours de la période 1979-1987, les États-Unis ont vu leur économie croître de 27 %, leur consommation de pétrole baisser de 17 % et l’intensité pétrolière de leur croissance baisser de 35 %. Les données historiques du Carbon Dioxide Infor- mation Analysis Center indiquent qu’au cours de cette période, les
- 247. Faut-il décourager le découplage ? 245 émissions de CO2 ont chuté de près de 10 % dans le pays. Mais il s’agit à l’évidence d’une période et d’un cas particuliers. Le véritable contre-exemple contemporain à l’argument de Tim Jackson sur l’impossibilité du découplage absolu entre croissance économique et émissions de dioxyde de carbone est l'Union euro- péenne. L’augmentation du PIB réel s’y est accompagnée au cours de la période 1996-2007 d’une baisse des émissions de dioxyde de carbone et de GES entre 1996 et 20079. Graphique 1. Le découplage absolu croissance-carbone dans l’UE 27, 1996-2007 130 125 Ta u x d e cro is s a n ce ré e l d u P IB 120 115 110 105 E m is s io n s d e C O 2 100 95 E m is s io n s d e G E S 90 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Sources : Eurostat, UNFCC et calculs de l'auteur. Si on se réfère au Protocole de Kyoto et à sa comptabilité des GES pour la seule UE 15, on parvient à la même conclusion : il y a bien eu découplage absolu croissance-carbone sur cette période (graphique 2). Pour comprendre ce qui s’est passé, on peut vouloir décomposer le taux de croissance des émissions de CO2 selon les paramètres de l’équation de Kaya (cf. supra). On obtient alors le graphique 3. 9. On choisit ici cette période pour éviter que les données ne soient parasitées par trois phénomènes : l’effondrement des émissions dans les PECO au début des années 1990, la récession de 1993 dans l’UE 15 et la crise globale après 2008.
- 248. 246 Éloi Laurent Graphique 2. Le découplage absolu croissance-carbone dans l’UE 15, 1997-2008 125 120 115 P IB p a r h a b ita n t 110 105 E m is s io n s d e G E S (K yo to ) 100 95 90 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Source: UNFCC et calculs de l'auteur. Graphique 3. Les composantes de l’identité de Kaya pour l’UE 27, 1996-2007 130 120 PIB par habitant 110 Population 100 Intens ité c arbonique de l'énergie (tonne CO2/toe) 90 Intens ité energétique de la c rois s anc e (toe/Meuro) 80 70 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Source: UNFCC et calculs de l'auteur. On observe au passage l’intérêt de décomposer les éléments de l’identité de Kaya pour percevoir que la réduction de l’intensité énergétique de la croissance a été beaucoup plus forte dans l’UE que celle de l’intensité carbonique de l’énergie. Pour certains pays de l’UE 15, ce découplage absolu s’inscrit sur une plus longue période. Les données de l'OCDE utilisées dans le tableau suivant montrent clairement que si le PIB par habitant a par exemple été multiplié par un facteur 8 en Belgique entre 1971 et 2007, les émissions de CO2 y ont baissé de près de 10 % sur cette période.
- 249. Faut-il décourager le découplage ? 247 Tableau 3. Expériences nationales de découplage absolu croissance-carbone pour quatre pays de l’UE 15 Réduction des émissions Accroissement du PIB de CO2 (en %) par habitant (facteur) Belgique (1971-2007) 9,4 8,0 Danemark (1971-2007) 9,1 8,3 France (1971-2007) 14,6 8,3 Allemagne (1991-2007) 13,8 1,7 Source : OCDE et calculs de l’auteur. Si on raisonne à présent en termes de projection et en conti- nuant d’utiliser les données de l’EIA, on constate que l’avenir européen peut également s’inscrire sous le signe du découplage absolu. Les données de l’EIA montrent en effet que sous certaines hypothèses, les évolutions futures dans l’Union européenne pour- raient être favorables, ce qui rend les perspectives de la zone OCDE également favorables du point de vue du découplage croissance- carbone. Tableau 4. Identité de Kaya pour l’OCDE (taux de croissance annuel moyen) 2005-2020 Intensité carbonique -0,5 Intensité énergétique -1,7 PIB par habitant 1,4 Population 0,6 Total -0,2 Tableau 5. Identité de Kaya pour l’Europe-OCDE (taux de croissance annuel moyen) 2005-2020 Intensité carbonique -0,6 Intensité énergétique -1,7 PIB par habitant 1,4 Population 0,4 Total -0,5 Source : EIA et calculs de l’auteur.
- 250. 248 Éloi Laurent 2.2. L’espace du développement européen : la question du découplage net La vraie question au sujet de la notion de découplage, qui n'est pas abordée par Jackson, est double : ce découplage croissance- carbone dans l’Union européenne a-t-il été réalisé au prix d’un transfert de la pollution aux pays en développement, l’effet net global sur le climat étant en réalité négatif ? Et dans l’affirmative, quelles solutions envisager pour lutter contre le phénomène des fuites de carbone vers les pays en développement et des émissions de carbone importées de ces pays en développement vers les économies développées ? On observe en effet un découplage relatif pour l’ensemble des pays de l’OCDE entre 1990 et 2008 mais une explosion concomitante des émissions des pays émergents à mesure que leur économie se développe (graphique 4). Y-a-il eu simplement transfert des émissions à compter de la fin des années 1990 d’une région à l’autre par exportation des industries polluantes ? Graphique 4. Revenu et émissions de CO2 pour les pays OCDE et les BRIICS, 1990-2008 350 300 R evenu national réel O C D E R evenu national réel B R IIC S 250 E m is s ions de C O 2 O C D E E m is s ions de C O 2 B R IIC S 200 150 100 0 8 4 6 5 2 3 7 0 8 4 1 6 9 5 2 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 Source : OCDE. Comme le montrent Davis et Caldeira (2010), lorsque les émis- sions de CO2 sont considérées non pas en termes de production mais de consommation, les pays de l'UE figurent parmi les émet- teurs les plus importants de la planète : si, en termes de production, ils sont bien parvenus à un découplage absolu croissance-carbone dans la période récente, cette performance s’évanouit quand leurs
- 251. Faut-il décourager le découplage ? 249 émissions de carbone importées sont comptabilisées. Le tableau ci- dessous donne une idée de l’écart qui peut se former entre émis- sions en termes de production et de consommation. Selon ces calculs, il faudrait rajouter 30 % aux émissions des pays membres de l’UE pour l’année 2004 (et 33 % à celles des pays de l’UE 15). Tableau 6. Emissions des pays membres de l’UE 27 et de certains pays de l’Annexe I pour l’année 2004 Part dans Emissions Différence Part dans Emissions de les émis- de entre pro- l'accroisse- consomma- sions Pays production duction et ment des tion (Mt CO2) totales de (Mt CO2) consomma- émissions l'UE 27 tion (en %) (en %) (en %) Autriche 70 108 55,4 2,0 1,1 Belgique 113 166 46,9 3,1 1,5 Chypre 7 10 30,1 0,2 0,1 République 116 98 -15,2 2,4 -0,4 tchèque Danemark 51 75 48,3 1,4 0,7 Estonie 19 17 -8,6 0,4 0,0 Finlande 68 75 10,6 1,6 0,2 France 392 562 43,4 10,7 4,6 Allemagne 822 1050 27,7 21,0 5,8 Grèce 97 117 20,2 2,4 0,5 Hongrie 58 69 19,7 1,4 0,3 Pays de l'UE Irlande 44 55 26,2 1,1 0,3 Italie 470 586 24,7 11,9 2,9 Lettonie 7 14 95,2 0,2 0,2 Lituanie 13 19 41,4 0,4 0,1 Luxembourg 11 16 41,4 0,3 0,1 Malte 3 3 24,2 0,1 0,0 Pays-Bas 179 227 26,8 4,6 1,2 Pologne 309 279 -9,7 6,6 -0,6 Portugal 63 78 23,7 1,6 0,4 Slovaquie 37 36 -3,2 0,8 0,0 Slovénie 15 18 20,1 0,4 0,1 Espagne 344 411 19,5 8,5 1,7 Suède 54 95 74,8 1,7 1,3 Royaume-Uni 555 808 45,6 15,3 7,0 Total UE 100 29 Total UE 15 32,9 Australie 341 334 -2,1 — — de l'Annexe I Autres pays Canada 554 530 -4,3 — — Japon 1310 1600 22,1 — — États-Unis 5800 6500 12,1 — — Source : Davis et Caldeira (2010) et calculs de l’auteur.
- 252. 250 Éloi Laurent La question des émissions importées, pendant de la question des fuites de carbone, est donc très sérieuse pour l’Union euro- péenne (plus d’ailleurs que pour les autres pays de l’Annexe I du Protocole de Kyoto, comme le montrent les données du tableau 6) et doit trouver une réponse adéquate. Des solutions existent pour atténuer ce problème et redonner de la cohérence à la politique climatique européenne (voir Godard dans ce numéro et Laurent et Le Cacheux, 2011). Ces solutions doivent être débattues et mises en œuvre au plus vite en particulier si la perspective d’un traité climatique international est encore lointaine. 3. L’expérience européenne du découplage croissance- pollutions et croissance-usage des ressources naturelles Qu’en est-il finalement du découplage dans l’Union euro- péenne pour d’autres formes de pollutions et plus généralement de l’usage des ressources naturelles ? Le découplage absolu européen ne concerne pas seulement les émissions de GES mais aussi d’autres formes de pollution de l’air. Ainsi l’UE 27 a-t-elle réussi à réduire le volume de quatre formes majeures de pollutions atmosphériques tout en accroissant son PIB par habitant au cours de la période la plus récente (graphique 5). Graphique 5. Le découplage absolu croissance-pollutions atmosphériques dans l’UE 27, 1995-2008 35000 30000 25000 P IB par habitant ($) 20000 E m is s ions - NM V O C - G g (1000 tonnes ) 15000 E m is s ions - NO x - G g (1000 tonnes ) 10000 E m is s ion de diox y de de s ouffre (1000 tonnes ) 5000 E m is s ions - NH3 - G g (1000 tonnes ) 0 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Sources : OCDE et AEE.
- 253. Faut-il décourager le découplage ? 251 En outre, l’expérience des Pays-Bas (voir par exemple Nether- lands Environmental Assessment Agency, 2007) montre que l’on peut simultanément accroître le revenu par habitant et réduire toutes sortes de pollutions et nuisances au-delà des seules pollu- tions atmosphériques (pollutions de l’eau, déchets, etc.). Là aussi cependant, cette performance doit être considérée au plan global. Qu’en est-il de la question plus générale du découplage entre croissance et ressources naturelles ? Pour l’économie mondiale et au cours du XXe siècle, on a assisté à un découplage relatif entre consommation intérieure matérielle (CIM) 10 totale et PIB par habi- tant : tandis qu’en moyenne la consommation matérielle par habi- tant croissait d’un facteur 2 entre 1900 et 2005, le PIB par habitant augmentait d’un facteur 5,5 (tableau 7). Comme le notent Fridolin Krausmann et ses co-auteurs (2009), on remarque un déclin dans l’intensité matérielle de l’économie mondiale, c'est-à-dire un accroissement de l’efficacité matérielle des économies de la planète considérées ensemble en moyenne. L’intensité énergétique a ainsi décliné de 0,68 % par an et l’intensité matérielle de 1 % par an de 1990 à 2005. Pour autant, la quantité d’énergie et de matériaux utilisée n’a cessé de croître (les seules périodes de dématérialisation de l’économie globale sont, selon les auteurs, les périodes de réces- sion, immédiatement après les deux guerres mondiales, durant la crise des années 1930 et juste après les chocs pétroliers). Tableau 7. Taux de croissance de la consommation matérielle et du revenu pour l’économie mondiale Production CIM/ PIB/ totale CIM Totale Population PIB habitant habitant d’énergie primaire 1900-1945 1,21 0,23 0,98 2,13 1,13 1,33 1945-1973 3,30 1,55 1,72 4,18 2,42 4,39 1973-2005 2,13 0,56 1,56 3,27 1,69 1,90 1900-2005 2,04 0,68 1,35 3,02 1,64 2,31 1900-2005 8,4 2,0 4,1 22,8 5,5 11,0 (facteur) Source : Fridolin Krausmann et al. (2009). 10. Répétons que la CIM mesure la quantité totale de matières directement utilisées par une économie : c’est la quantité annuelle de matières premières extraites sur le territoire national de l’économie concernée, plus le total des importations physiques moins le total des exportations physiques.
- 254. 252 Éloi Laurent Que peut-on dire de la situation particulière des pays européens ? Les calculs de l’EEA (2010) depuis 1970, agrégeant plusieurs bases de données, suggèrent que le découplage croissance- ressources a été relatif pour les pays de l’UE 15 pris ensemble, avec un PIB augmentant de 150 % tandis que la CIM ne progressait que de 20 % (la productivité matérielle a augmenté de près de 200 %). Selon Steinberger, Krausmann et Eisenmenger (2010), sur la période 2000-2005, six pays européens sont parvenus à une déma- térialisation absolue : la Belgique, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas et le Portugal. Mais les données d’Eurostat montrent cependant que depuis 2000 la productivité matérielle a tendance à stagner dans l’UE 27, notamment du fait des PECO (elle a progressé de 8 % de 2000 à 2007 et de seulement 5 % par habitant, soit au même rythme que la CIM). Les taux métaboliques (CIM/hab./an) des pays européens les situent certes dans une position plus favorable que les pays nord- américains (tableau 8), mais il convient là encore de nuancer cette performance en révélant les flux cachés de matières. Tableau 8. Taux métaboliques pour les pays du G7 pour l’année 2000 (CIM/hab./an) Canada EU All. France Italie Japon RU Biomasse 7,5 6,0 4,0 5,7 3,2 1,4 3,1 Energies fossiles 6,4 8,2 5,3 2,5 2,9 3,7 3,6 Minéraux industriels 4,4 2,2 0,8 1,2 1,1 1,1 0,8 Minéraux de construction 6,6 6,4 4,1 4,1 5,9 5,7 2,2 CIM Totale 24,8 22,8 14,1 13,5 13,2 11,9 9,6 Source : Steinberger, Krausmann et Eisenmenger (2010). Ainsi, l’OCDE (2011) rappelle au sujet du Japon : « il fait partie des rares pays qui avaient enregistré un découplage absolu de la consommation de ressources matérielles et de la croissance écono- mique avant même la crise financière de 2008. Entre 1980 et 2008, sa consommation de matières a baissé de plus de 20 % alors que son économie a crû de 96 %. Toutefois, si l’on tient compte de l’extraction intérieure inutilisée et des flux indirects estimés asso- ciés aux échanges, le recul de la consommation de matières est plus modeste, puisqu’il s’établit à 1 % entre 1980 et 2008. De même, en
- 255. Faut-il décourager le découplage ? 253 Allemagne, la baisse de plus de 10 % de la consommation inté- rieure de matières observée entre 1996 et 2008 est réduite de moitié après prise en considération de l’extraction inutilisée et des flux indirects. » Pour la France, selon le ministère du Développement durable (2010), « la productivité matérielle apparente (PIB/DMI) a augmenté de 24 % de 1990 à 2007… en 2007, 1 tonne de matières génère 1 490 euros de PIB. Dans le cas de la productivité matérielle totale estimée (PIB/TMR), qui prend en compte les flux cachés, 1 tonne de matières ne génère alors que 550 euros de PIB en 2007 »... : « Un découplage relatif entre la progression du PIB et la quantité de matières mobilisées par l’économie est observé. Le besoin apparent en matières (DMI) a augmenté de 11 % entre 1990 et 2007 alors que le PIB s’est accru de 38 % pendant la même période…Mais la prise en compte de l’ensemble de ces flux cachés porte le besoin total estimé en matières à environ 47 t/hab, soit près de trois fois plus que le besoin apparent ». 4. Du découplage aux découplages Au vu de ces travaux et de ces données, il ne s’agit aucunement de claironner un optimisme passif nourri d’une foi inébranlable, à la façon d’Henry George, sur l’ingéniosité inépuisable des humains. Il s’agit encore moins d’embrasser un économisme simpliste à la manière de la courbe environnementale de Kuznets, où le décou- plage mécanique entre croissance et dégradations environnemen- tales tient de la pensée magique. En revanche, il apparaît que le découplage n’est pas un « mythe » : c’est une grille de lecture utile et une feuille de route pour les économies du monde, en particulier les pays développés, pour les trente prochaines années. Il ne faut pas renoncer à la chimère que serait le découplage, mais s’en donner les moyens, c'est-à-dire développer l’effort de réduction d’intensité carbonique, énergétique et matérielle suscep- tible de réduire drastiquement l’effet de l’activité économique sur l’environnement. Il importe à cet égard de comprendre la richesse du concept de découplage, qui va bien au-delà de l’accroissement à tout prix de la croissance économique étroitement mesurée par le PIB. La figure ci-dessous donne une idée de ce que découpler veut aujourd’hui dire, en termes d’analyse et de politiques publiques.
- 256. 254 Éloi Laurent Figure. Quatre découplages Bien-être humain (croissance de l’IDH, etc.) (1) Activité économique (croissance du revenu et de l’emploi) Usage des (2) ressources naturelles (consommation intérieure (4) matérielle) (3) Impact environnemental (émissions de CO 2, pollutions, déchets, etc.) (1) Découplage économie/bien-être : découplage de l’activité économique et du bien-être humain par la conception et la mise en œuvre de nouveaux indicateurs de développement humain (voir Fitoussi et Stiglitz dans ce numéro) ; (2) Découplage économie/ressources naturelles : découplage de l’activité économique de l’usage des ressources naturelles par l’accroissement de la productivité matérielle ; on doit ici distin- guer découplage relatif ou absolu et découplage brut ou net (cf. supra) ; (3) Découplage économie/impact environnemental : le revenu et l’emploi augmentent alors que se réduisent les dégradations environnementales par le développement de l’économie verte (éco-industries, fonctionnalité, circularité, etc.); (4) Découplage bien-être/impact environnemental : le bien-être humain augmente sans pour autant dégrader l’environnement. Source : adapté de INR (2011). 5. Conclusion : découplons, et d’abord en Europe ! L’Union européenne est devenue la région économique du monde où la possibilité du découplage entre développement humain et impact environnemental est la plus tangible : la construction de régimes démocratiques garantissant les libertés civiles et les droits politiques, d’économies dynamiques capables d’accroître le revenu et l’emploi des citoyens et d’un État-provi- dence efficace à même de réduire les inégalités sociales s’y est conjugué à un usage raisonné des ressources naturelles. Mais cette raison a été dictée par la nécessité et elle connaît d’importantes limites. C’est parce l’UE ne possède que peu des ressources natu- relles du monde (13 % des réserves de charbon, 2 % des réserves de pétrole, 11 % des réserves de cuivre) qu’elle a appris, dans une certaine mesure, à les économiser. La vertu écologique européenne
- 257. Faut-il décourager le découplage ? 255 n’est pas encore un véritable choix politique, mais plutôt le fruit d’une heureuse nécessité. Ensuite, l’UE a, en contrepartie de son développement économique, transféré une partie de ses coûts écologiques ailleurs sur la planète, ce qui rend sa vertu pour le moins discutable. Ainsi par exemple, l’UE accuse-t-elle un déficit de sa balance physique avec le reste du monde de 1 262 millions de tonnes, dont 1 181 pour l’énergie et les produits miniers (avec de très fortes variations entre Etats membres, de l’Italie qui accuse un déficit physique de 227 millions de tonnes en 2007 à la Norvège qui enregistre un excédent physique de 178 millions de tonnes). Tableau 9. Commerce physique entre l’UE-27 et le reste du monde, en millions de tonnes en 2008 Importations Exportations Biomasse 193 126 Produits manufacturés 221 207 Energie/produits miniers 1 384 203 Solde 1 798 536 Source : AEE. L’Union européenne doit et peut devenir le continent du découplage soutenable en investissant massivement dans l’économie verte. Elle pourra alors transférer aux économies en développement non pas les pollutions que ce découplage apparent masque, mais les technologies qui le rendrait réellement possible dans le monde entier. Références bibliographiques Davis S. J., et K. Caldeira, 2010, « Consumption-based accounting of CO2 emissions », PNAS, mars. Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, 2007, Quatrième Rapport d’évaluation. Contribution du Groupe de travail III au quatrième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouverne- mental sur l’évolution du climat. UNEP, 2011, Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth, A Report of the Working Group on Decoupling to the International Resource Panel. Fischer-Kowalski, M., Swilling, M., von Weizsäcker, E.U., Ren, Y., Moriguchi, Y., Crane, W., Krausmann, F.,
- 258. 256 Éloi Laurent Eisenmenger, N., Giljum, S., Hennicke, P., Romero Lankao, P., Siriban Manalang, A. Jackson T., 2010, Prospérité sans croissance - La transition vers une économie durable, Préface: M. Robinson & P. Viveret, Éditions de Boeck, Collection : Planète en jeu. Ehrlich P. R et J. P. Holdren, 1971 « Impact of Population Growth », Science, mars, pp. 1212-1217. Kaya Y., 1990, Impact of Carbon Dioxide Emission Control on GNP Growth: Interpretation of Proposed Scenarios, Paper presented to the IPCC Energy and Industry Subgroup, Response Strategies Working Group, Paris. Energy Information Administration (EIA), 2010, International Energy Outlook 2010 (IEO 2010), accessible en ligne. Lovins A., E. K. Datta, et al., 2004, Winning the Oil Endgame: Innovation for Profits, Jobs, and Security, Rocky Mountain Institute, Earthscan, London. Krausmann F., et al, 2009, « Growth in global materials use, GDP and population during the 20th century », Ecological Economics, Volume 68, Issue 10, 15 August 2009, pp. 2696-2705 European Environment Agency (EEA), 2010, The European environment – state and outlook 2010, Material resources and waste, SOER 2010 thematic assessment. OCDE, 2003, Environmental Indicators: Development, Measurement, and Use, OECD, Paris. Commission of the European Communities, 2005, Thematic strategy on the sustainable use of naturalresources (Communication and Annexes). Commission of the European Communities (CEC), COM, 670 final, SEC 1684, Brussels. Steinberger J. K. et F. P. Krausmann, 2010, « What do economic resource productivities measure? », Paper presented at the International Society for Ecological Economics (ISEE) 11th BIENNIAL, conference : Advan- cing sustainability in a time of crisis, 22-25 août, Oldenburg, Bremen, Germany. OCDE, 2008, « Measuring material flows and resource productivity » (vol.1: The OECD Guide, vol.2 : The Accounting Framework, vol.3: Inventory of Country Activities, vol.4: Implementing National Material Flows Accounts, Synthesis report), OECD, Paris. OCDE, 2011, Vers une croissance verte, OECD, Paris. Eurostat, 2001, Economy-wide material flow accounts and derived indicators: a methodological guide, Luxembourg : Office des publications officielles des communautés européennes. Ministère du développement durable, 2010, « La consommation intérieure de matières par habitant est stable », Le point sur n° 41, janvier.
- 259. Faut-il décourager le découplage ? 257 Netherlands Environmental Assessment Agency, 2007, Environmental Balance 2007, Netherlands Environmental Assessment Agency (MNP), Bilthoven, the Netherlands. Steinberger J. K., F. Krausmann et N. Eisenmenger, 2010 « Global patterns of materials use: a socioeconomic and geophysical analysis », Ecological Economics, Volume 69, Issue 5, mars , pp. 1148-1158.
- 260. 258 Éloi Laurent
- 261. L'EPARGNE NETTE RÉ-AJUSTÉE Céline Antonin OFCE, Observatoire français des conjonctures économiques Thomas Mélonio Agence Française de Développement Xavier Timbeau OFCE, Observatoire français des conjonctures économiques Cet article discute de la pertinence théorique et de la validité empirique du principal indicateur de soutenabilité utilisé dans les travaux de recherche et discuté dans les forums internationaux, l'épargne nette ajustée. Après avoir rappelé le contexte de sa conception théorique et la méthodologie qui le sous- tend, l'article pointe certaines limites importantes de l'épargne nette ajustée telle qu'elle est calculée aujourd'hui par la Banque mondiale. Des innovations sont introduites dans le calcul : la dépréciation du capital éducatif, une prise en compte plus exhaustive des émissions de carbone et un prix social du carbone plus élevé. Ces changements modifient sensiblement les conclusions opti- mistes, en matière de soutenabilité globale, que l'on peut tirer des données que la Banque mondiale publie. Mots-clés : épargne nette ajustée, dépréciation du capital éducatif, emissions de carbone. Revue de l’OFCE / Débats et politiques – 120 (2011)
- 262. 260 Céline Antonin, Thomas Mélonio et Xavier Timbeau « Our problem is not one of the kind of measure to use, for we have no choice about that; it is a problem of the meaning which we can give to the measures which we have to employ » John Hicks (1958) I l y a plus de 20 ans, Atkinson et Pearce (1993) ou Repetto au World Resource Institute (1989) proposaient les premiers calculs d’un indicateur de soutenabilité. Ils soustrayaient à l’investisse- ment brut en capital produit, tel que mesuré traditionnellement par la comptabilité nationale, non seulement la dépréciation du capital fixe, pour obtenir un investissement (matériel) net mais également la dépréciation d’un capital naturel ou l’épuisement des ressources minières ou énergétiques. Le but de leur évaluation était de jauger si l’extraction des ressources ou la déforestation entraî- nait un pays sur une trajectoire de développement ou, au contraire, alimentait la consommation imprévoyante d’un stock épuisable de richesses. La notion de soutenabilité, employée par ces auteurs, qui est largement retenue aujourd’hui, dérive de l’énoncé proposé par la commission Bruntland (1987), à savoir « subvenir aux besoins de la génération actuelle sans compromettre la capacité des générations futures à en faire de même ». La transposition de cette définition dans un contexte écono- mique s’est faite à travers la notion de « soutenabilité faible » selon laquelle l’épuisement de certaines ressources et dégradation de l’environnement peuvent être compensés par l’accumulation d’autres ressources (productives) ou l’amélioration de certains aspects de l’environnement. Par opposition la « soutenabilité forte » est définie comme la préservation en l’état des ressources ou de la nature. Ce que l’on perd en environnement ne peut pas être compensé par ce que l’on gagne en prospérité, développement ou accumulation de capital physique. La mise en œuvre de ce critère de soutenabilité faible pose de nombreuses difficultés théoriques et empiriques, comme nous nous proposons de l’illustrer. La définition du prix (relatif) à appli-
- 263. L’épargne nette ré-ajustée 261 quer à la mesure du stock de capital (en volume) ou à l’état de l’environnement (concentration en CO2, pollution) ne va pas de soi. Un schéma d’équilibre général intertemporel, reliant sphère productive, sociale et environnementale est nécessaire. Dans une première partie, nous rappellerons les termes de ce schéma tel qu’il est établi aujourd’hui. Le prix permet de représenter de façon continue la « faiblesse » de la soutenabilité. Plus une ressource est substituable à d’autres qui sont disponibles en abondance, moins son prix relatif est élevé. Ce sont les coûts de production ou d’extraction qui déterminent le prix. Au contraire, lorsqu’une ressource est rare et qu’il n’en existe pas de substitut, ni dans la production ni dans la consommation, son prix transcrit sa rareté et peut devenir infini. Dans le cas général, le prix concentre toute l’information sur la trajectoire future (et donc les raretés relatives), mais cela suppose que l’on connaisse cette trajectoire. Ce dernier point est incontournable et rend la méthode fragile, puisqu’elle repose sur une chimère. Comme l’énonce le rapport de la commission Stiglitz-Sen-Fitoussi (2009), la construction d’un indicateur de soutenabilité ne peut se faire sans référence à une projection dynamique de la trajectoire des économies et de leur insertion dans la biosphère. Une représen- tation correcte de la dynamique du stock de capital ou de la ressource environnementale est ainsi nécessaire. Tout ce qui fait évoluer le stock en plus ou en moins doit être pris en compte sous peine d’une vision biaisée du futur et donc de la conformité des choix actuels à l’idéal de soutenabilité. Après avoir dans une première partie défini le cadre d’équilibre général dans lequel nous nous plaçons, nous aborderons dans la deuxième partie deux ajustements au vaste travail empirique réalisé par la Banque mondiale (Hamilton et al., 2006), illustrant à la fois les difficultés théoriques et empiriques. Ces ajustements portent sur l’évaluation du capital humain (ou plus précisément du capital éducatif, en prenant en compte la dépréciation de ce capital) et sur la mesure des dégradations liées au changement climatique (prise en compte plus exhaustive des émissions de gaz à effet de serre, imputation des émissions aux consommateurs et non aux producteurs, valorisation plus importante des dommages). Ils conduisent à revoir la conclusion optimiste de la Banque mondiale sur la compatibilité entre développement rapide et soutenabilité.
- 264. 262 Céline Antonin, Thomas Mélonio et Xavier Timbeau 1. Les conditions de la pertinence de l’épargne nette L’indicateur de soutenabilité que nous retenons est proche de la notion de « vrai revenu » définie par Hicks (1946) : la consommation maximale autorisée sans dégrader le stock de capital. Cette notion n’est pas éloignée des réflexions de Nordhaus et Tobin (1971) sur la croissance. Ils plaidaient pour que l’on ne s’attache pas à mesurer ce qui est produit, mais à prendre en compte ce qui contribue en plus ou en moins au bien-être, ce qui conduit à une mesure du bien-être (MEW, Measure of Economic Welfare). Après le MEW, un pas a été franchi en évaluant les dégradations de capital naturel, ce que Nord- haus et Tobin évoquaient, et en proposant d’étendre la notion de capital à des biens souvent publics, non produits, éventuellement dégradés par l’activité humaine. Ceci suppose une méthode pour estimer à la fois le volume des dégradations (ou des augmentations) et leur valeur. C’est ainsi que Cobb et Daly (1989) ont défini l’ISEW (Indicator of Sustainable Economic Welfare), extension du MEW de Nordhaus et Tobin. En réduisant à un indice l’évolution du capital naturel, il est alors possible de l’ajouter aux évaluations de la compta- bilité nationale et ainsi de construire une comptabilité nationale verte (Green National Accounts). En généralisant la notion de capital, la voie est ouverte à la prise en compte de façon large des facteurs contribuant au bien-être. La construction d’un indice pour évaluer la consommation courante et l’évolution de stocks de capital suppose de définir des prix relatifs. Weitzman (1976) a proposé une interprétation du concept de produit national net comme étant l’équivalent station- naire de la valeur nette des flux de consommation futurs. La construction du concept de produit national net est faite à partir d’une optimisation dynamique d’une fonction d’utilité, les prix relatifs découlant de la maximisation. En notant W(t) le flux actua- lisé d’utilité, appelée richesse, le programme de contrôle optimal est la maximisation de W sous les contraintes d’évolution du stock de capital K, nécessaire à la production du bien homogène, d’un stock d’une ressource S, exploitée de R à chaque période (en repre- nant les notations de Dasgupta (2001) : ∞ & & W(t)= ∫ U(C).e- ρ (s-t) ds ; K=f(K,R)-C ; S=g(S)-R . t
- 265. L’épargne nette ré-ajustée 263 Le hamiltonien actualisé du système s’écrit : . . H = U(C) e-ρt + pK e-ρt K + pS e-ρt S . Weiztman (2003) interprète ce hamiltonien comme le revenu actualisé. La résolution du programme indique que la richesse W en t ne dépend que des conditions initiales K(t) et S(t), R et C étant défini par le programme d’optimisation. Le hamiltonien est alors le produit du taux de préférence pour le présent de l’agent représen- tatif de toutes les générations et de la richesse, ce qui fonde son interprétation en tant que revenu (généralisé). Les prix implicites du programme d’optimisation sont les incréments marginaux de la richesse pour une augmentation marginale des stocks (ou variables d’état), c’est-à-dire les prix comptables (accounting prices) : H = ρW, ∂W ∂W . pK = ; pS = ∂K ∂S Le produit national net (de la comptabilité nationale) est alors la linéarisation du hamiltonien, lorsque S n’intervient pas et que l’utilité ne dépend que de la consommation (l’utilité étant définie à une transformation affine près, voir Weitzman, 2000). Ce hamilto- nien linéarisé est calculable dès lors que l’on connaît les volumes de consommation, les évolutions des stocks de capital (l’investisse- ment net) et les prix. Le produit national net élargi, ou ajusté, ou véritable, noté NNPa intègre le stock de la ressource naturelle S : & & & & Hlinéaris é = U '(C0 )( C − C0 ) + U ( C0 ) + p K K + pS S ⇔ H l = C + p K K + p S S & NNP = C + p K ; NNPa = C + p K + p S & & K K S Le cadre ainsi posé permet d’associer à toutes les variables d’état un prix1. Les variables d’état à chaque instant déterminent entière- ment le système, puisqu’elles sont les conditions initiales appliquées au programme d’optimisation à partir de la date t. L’écriture de leur dynamique, de la façon dont elles interviennent dans la fonction de production ou dans l’utilité définit alors le prix et permet de construire le produit national élargi (voir par exemple Dasgupta, 2001 ; Weitzman, 2003). La notion de variable d’état va 1. Selon la terminologie de l’optimisation dynamique, les variables sont les variables d’état dont la dynamique est définie par les variables de contrôle.
- 266. 264 Céline Antonin, Thomas Mélonio et Xavier Timbeau au-delà de l’accumulation matérielle de capital productif ou de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. En affectant un prix aux diffé- rentes variables d’état, il est possible de les ajouter en utilisant les prix comme des pondérations, ce qui construit le produit national net ajusté ou le stock de capital élargi. Le modèle peut inclure toute les dimensions du bien-être et pas seulement celles qui font l’objet de choix décentralisés. Les prix implicites peuvent être mesurés directement sur le marché (en considérant que les prix de marché sont bien les prix sociaux), ou indirectement par des préférences révélées en mesurant la rente (le prix moins le coût privé de production) ou en utilisant une modélisation où les coûts ou béné- fices sociaux (intégrant les externalités) sont explicitement représentés et diffèrent des prix de marché, lorsqu’ils existent. Ainsi, dans la présentation adoptée ici, l’utilité ne dépend pas du loisir2, mais cette hypothèse peut être levée. Le prix implicite du loisir correspond à l’utilité marginale de celui-ci. En spécifiant des dynamiques particulières, posant des contraintes technologiques, naturelles ou institutionnelles, il est possible de dériver de cette optimisation dynamique les prix à appliquer pour construire le revenu élargi. Hamilton (2000) et Hamilton et Clemens (1999) en donnent quelques variations selon les grandes dynamiques possibles. Pour simplifier, on a considéré implicitement que la population était constante. Dasgupta (2001) discute ce point. Il montre que si les évolutions de la population sont prévisibles, exogènes et ne modifient pas le bien-être, alors il suffit de raisonner sur les grandeurs per capita en tenant compte d’un effet de dilution de la richesse per capita lorsque la population augmente. Lorsque l’on suit une trajectoire optimale, les prix implicites intègrent toute l’information (présente et future) sur la trajectoire. Dans le cas (hypothétique, mais ici considéré comme canonique) d’une information parfaite, de l’absence d’externalité et en accep- 2. Une littérature abondante discute l’interprétation initiale de Weiztman (1976). Il considère par exemple non pas l’utilité mais la consommation, négligeant les conséquences de la convexité de l’utilité ou de la nécessité de prendre en compte le loisir ; il se limite au cas d’une économie « optimale », sans imperfections ou incertitudes ; il interprète le revenu national en niveau comme étant homothétique au bien-être, ce qui n’est en substance pas possible, les prix étant marginaux et donc sans lien avec le surplus. Dasgupta et Mäler (2000), Asheim (2000), Asheim et al. (2003) et Arrow et al. (2010) soulignent les limites de l’interprétation de Weitzman et proposent des solutions partielles à ces problèmes. Weitzman (2000) propose néanmoins une explicitation des approximations de son approche.
- 267. L’épargne nette ré-ajustée 265 tant le critère de maximisation de l’utilité entre les générations avec un taux de préférence pour le présent donné, les prix impli- cites sont égaux aux prix de marché. La contribution de Weitzman donne dans ce cadre extrême une interprétation simple de la construction comptable. Une approche peut être élargie au cas où il n’y a pas de prix de marché, mais où l’économie est contrôlée par un planificateur omniscient et bienveillant. Le prix que l’on doit appliquer est défini par la fonction d’utilité sociale que le planifica- teur applique. L’épargne nette (NS) est alors définie comme la différence entre le produit national net (NNP) et la consommation courante : & & & NS = NNP − Ct = pK K ; NSa = pK K + pS S Une trajectoire maximisant la richesse ne conduit pas nécessai- rement à une trajectoire soutenable. Formellement, une trajectoire soutenable est définie dans ce cadre comme une trajectoire où la richesse ne décroît jamais. Sur une telle trajectoire, l’épargne nette (ajustée) est positive, le stock de capital (élargi) augmente et chaque génération laisse aux suivantes plus que ce qu’elle a reçu. Lorsqu’au contraire l’épargne nette (ajustée) est négative, ce stock décroît. Cette propriété, dite « règle de Hartwick », a été analysée formelle- ment par Hartwick (1977). Dans un univers simple, elle peut paraître triviale ; l’apport de Hartwick étant de montrer qu’elle s’applique en présence d’une ressource épuisable dès lors que le prix de celle-ci suit la règle de Hotelling. Cela suppose alors que la ressource épuisable est suffisamment substituable au bien qui s’accumule afin que l’épuisement soit compensé par un stock de plus en plus grand de capital. Solow (1974), quelques années auparavant, avait justifié cette règle comme découlant d’un principe d’équité intergénération- nelle inspiré de Rawls et donc tranchant avec la maximisation de la valeur actualisée de l’utilité d’un individu représentatif de toutes les générations. Solow nous rappelle que l’individu représentatif, particulièrement des générations futures, est une fable commode mais insatisfaisante et de plus trompeuse. Les conditions pour que la notion d’épargne nette soit un indi- cateur pertinent de soutenabilité sont fortes. Il faut calculer des prix implicites pour les variables d’état pertinentes ; il faut
- 268. 266 Céline Antonin, Thomas Mélonio et Xavier Timbeau connaître la loi de leur évolution pour en apprécier les évolutions nettes ; il faut définir un taux d’actualisation qui pose des questions éthiques non résolues ; il faut établir une projection de la trajec- toire et ne pas simplement compter sur l’utilisation de l’information passée (et observée) pour nourrir le diagnostic. Ces conditions sont drastiques et découlent des éléments théoriques survolés plus haut. Dasgupta et Mäler (2000) et Dasgupta (2001) analysent ces conditions dans un cadre plus général où la trajec- toire n’est pas optimale dans un sens aussi strict que celui décrit ici. Comme le remarquent judicieusement Blanchet, Le Cacheux et Markus (2009), lorsque la trajectoire est optimale et l’information parfaite, il n’est pas nécessaire de disposer d’un critère de soutena- bilité : la connaissance parfaite de la trajectoire permet de juger si elle est soutenable ou non. En ne supposant que la cohérence dyna- mique, Dasgupta et Mäller retrouvent localement les conditions principales que l’on obtient dans le cas de « trajectoire optimale ». Une épargne nette positive dans le cas d’une information impar- faite assure que la richesse ne va pas décroître dans le futur immédiat. En l’absence d’une connaissance parfaite du futur, on ne peut conclure globalement quant à la soutenabilité du système. Blanchet, Le Cacheux et Markus (2009), à partir de simulations numériques, montrent que l’épargne nette peut être un indicateur avancé de soutenabilité dans un certain nombre de cas raison- nables en introduisant une dose d’incertitude. Après une revue détaillée de la littérature sur l’épargne ajustée et la soutenabilité, le chapitre 3 du rapport de la commission Stiglitz-Sen-Fitoussi (2009) conclut que l’appréciation de la soutenabilité suppose à la fois une approche dynamique anticipant le futur, et normative, définissant l’importance relative attribuée aux générations futures, jaugeant les risques ou les sacrifices que l’on est prêt à faire aujourd’hui à l’avantage ou au détriment des générations futures et donnant une valeur relative à tout ce qui nous entoure et nous entourera. Parmi ces choix normatifs, le pari de la substituabilité entre les ressources épuisables et les biens capitaux produits, i.e. la notion de soutena- bilité faible, est un choix important, comme l’affirme Hamilton (2000). Dasgupta et Heal (1979), parmi d’autres, ont montré qu’une trajectoire soutenable n’était pas possible sans ces substitu- tions. L’intégration des risques et de l’incertitude dans le cadre du raisonnement apparaît cependant fondamentale, mais elle est pour
- 269. L’épargne nette ré-ajustée 267 le moment embryonnaire. Les scénarios d’évolution de l’épargne nette, comme les utilisent Blanchet, le Cacheux et Markus (2009) ou Arrow et al. (2010) sont un instrument pertinent pour associer projections sur le futur et jugement sur la soutenabilité. 2. Les applications empiriques Les premières études empiriques d’Atkinson et Pearce (1993) ou Repetto et WRI (1989) concluent que les économies des pays en développement peuvent être insoutenables, n’investissant pas assez les ressources dont ils disposent, alors que les pays développés seraient sur des trajectoires soutenables, puisqu’ils épuisent moins les stocks de ressources renouvelables ou l’environnement qu’ils n’accumulent des stocks de capital physique. L’analyse de Repetto et du WRI portait sur l’Indonésie et concluait aux gaspillages des dotations en ressources naturelles du pays. Pearce et Atkinson montraient, en étudiant 13 pays, un contraste spectaculaire entre des pays non soutenables (l’Indonésie, le Mali, le Nigeria entre autres) et des pays soutenables (les États-Unis, l’Allemagne, le Japon ou le Costa Rica). On retrouve ce message favorable au développement dans l’ensemble des publications de la Banque mondiale. Au début des années 1990, la Banque mondiale a largement contribué au déve- loppement de ces indicateurs, tant empiriquement que théoriquement (Bolt, Matete et Clemens, 2002 ; Hamilton, 2000 ; Hamilton et Clemens, 1999 ; Pezzey, 1992 ; World Bank, 1995). Le volume 5 de la revue Environment and Development Economics de l’année 2000 rassemble des contributions de et autour des travaux de la Banque mondiale sur la soutenabilité (Vincent, 2000). C’est dans l’ouvrage Where is the Wealth of Nations ?, publié par la Banque mondiale (Hamilton et al., 2006) que se trouve le point d’orgue de cette approche. L’épargne nette ajustée est calculé pour 120 pays et la Banque mondiale donne accès sur son site à une mise à jour régulière des indicateurs d’épargne ajustée (http://go.world- bank.org/VLJHBLZP71). Au capital productif usuel de la comptabilité nationale, la Banque mondiale a ajouté des données sur des variables supplé- mentaires qui enrichissent notablement l’analyse. L’investisse- ment en éducation y est ainsi traité en comptant l’ensemble de la
- 270. 268 Céline Antonin, Thomas Mélonio et Xavier Timbeau dépense éducative publique, en fonctionnement comme en inves- tissement dans les structures physiques. Le prix retenu pour la dépense éducative est le prix conventionnel de la comptabilité nationale, c’est-à-dire le coût de production des services éducatifs. Ce prix est un prix d’input et non pas d’output ; il ne retranscrit pas des gains ou des pertes de qualité dans le processus éducatif. En prenant en compte la dépense éducative, l’épargne nette ajustée est largement augmentée. Nous discuterons dans la suite des limites de l’approche de la Banque mondiale en matière de capital humain et nous proposerons une alternative chiffrée. La Banque mondiale comptabilise également les consomma- tions en ressources naturelles minières ou d’énergies fossiles. Il s’agit ici des extractions brutes, sans prendre en compte les décou- vertes, et le prix de comptabilisation suit la logique évoquée en première section ; Atkinson et al. (1997), Hamilton (2000) et Hamilton et Clemens (1999) dérivent d’un programme de maximi- sation le prix à appliquer aux extractions de pétrole. Le prix appliqué est la rente unitaire, c’est-à-dire le prix de marché moins le coût d’extraction local moyen. La comptabilisation des forêts suit la même logique, à ceci près que c’est l’exploitation nette de la repousse des arbres (reforestation) qui est multipliée par la rente (le prix moins le coût de production). Le traitement différent de la repousse et des découvertes de nouvelles ressources minières tient à ce que la repousse des forêts est une dynamique soit naturelle soit nécessitant un coût bien identifié. La découverte de nouvelles ressources minières est supposée soumise à des coûts croissants. Enfin, deux sortes de pollutions atmosphériques sont prises en compte. D’une part, les émissions de CO2 liées aux combustions d’énergie fossile et à la fabrication de ciment, qui ont un impact sur le changement climatique. Celles-ci sont valorisé à 20 dollars de 1995 la tonne de carbone (soit 5,5 dollars de 1995 la tonne de CO2). D’autre part, les émissions de petites particules (moins de 10 microns de diamètre) dans les villes de plus de 100 000 habi- tants font l'objet d'une estimation par une méthode hédonique (c’est-à-dire celle du consentement à payer pour la réduction de la pollution d’une unité). Il y aurait sans doute bien d’autres types de pollution à intégrer dans l’épargne nette (souffre, oxyde d’azote, pollution des eaux, etc.). La disponibilité des données et le manque
- 271. L’épargne nette ré-ajustée 269 d’évaluations raisonnables de leur prix implicite justifie en partie qu’ils ne soient pas inclus dans l’indicateur de la Banque mondiale. Le rapport de la commission Stiglitz-Sen-Fitoussi (2009) énonce un ensemble d’éléments à ajouter pour mieux évaluer la dégrada- tion de l’environnement : des différentes formes de pollution de l’air à la pollution de l’eau ou encore d’autres types de dégâts infligés à la biosphère. Les projets de comptabilité environnemen- tale comme le SEEA (System of Environnemental Economic Accounting) devraient fournir des bases plus satisfaisantes, bien que la juste valorisation soit toujours problématique. Notons qu’Arrow et al. (2010), en calculant par une méthode différente de celle de la Banque mondiale une épargne ajustée, introduisent dans les stocks deux éléments originaux. Le premier est le progrès à venir (exogène) des techniques (suivant une idée de W. D. Nordhaus, 1995) et le second concerne la santé humaine. Dans son application numérique, ce dernier élément joue considé- rablement. Aux États-Unis, selon ces auteurs, le gain en capital santé entre 1995 et 2000 serait de plus de 50 000 dollars de 2000 par habitant, alors que la somme de tous les autres gains ou pertes en capital (capital naturel, produit, humain, CO2) serait de 5 000 dollars de 2000 par habitant sur la même période. La soutenabilité de l’économie américaine ne reposerait que sur l’amélioration majeure de l’état de santé de sa population ! Ce chiffre considé- rable masque probablement un double compte. 3. L’épargne nette ajustée selon la Banque mondiale Dans l’ouvrage Where is the Wealth of Nations ? (Hamilton et al., 2006) le monde apparaît comme globalement soutenable. L’accu- mulation nette de capital productif (issue des comptes nationaux de chacun des pays), l’accumulation de capital humain (par le biais de l’investissement dans l’éducation) compensent les dégradations environnementales, la déforestation, la consommation des ressources épuisables ou l’impact des pollutions. Les pays déve- loppés sont, quant à eux, sur une trajectoire nettement soutenable, accroissant leurs stocks de capital généralisé, par un effet d’épargne de capital productif, d’éducation, de faible consommation des ressources épuisables et de faible déforestation (voire de reforesta- tion). La pollution et les émissions de CO2 jouent négativement
- 272. 270 Céline Antonin, Thomas Mélonio et Xavier Timbeau mais faiblement et n’inversent pas le diagnostic. Le tableau 1 reprend les données de la Banque mondiale pour une sélection de pays et de zones pour l’année 2008 : Tableau 1. Épargne nette ajustée en 2008 selon la Banque mondiale 10.ENA 3.EN En % du PIB 1.EB 2.CCF 4.DE 5.CRE 6.CRM 7.CRF 8.CO2 9.PM10 =3+4-5- =1-2 6-7-8-9 France 18,7 13,9 4,9 5,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 9,8 Italie 18,5 14,0 4,5 4,5 0,2 0,0 0,0 0,2 0,1 8,5 Allemagne 25,4 13,8 11,6 4,3 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 15,4 USA 12,6 14,0 -1,4 4,8 1,9 0,1 0,0 0,3 0,1 0,9 Chine 53,9 10,1 43,8 1,8 6,7 1,7 0,0 1,3 0,8 35,1 Hauts revenus 18,5 13,8 4,7 4,6 2,0 0,2 0,0 0,2 0,1 6,8 (HIC) Revenus inter. 23,8 12,1 11,8 4,2 9,4 1,3 0,0 0,5 0,2 4,6 supérieurs (UMC) Revenus inter. 41,1 9,6 31,4 2,3 8,1 1,4 0,2 1,1 0,6 22,4 supérieurs (LMC) Faibles revenus 25,9 7,9 18,0 3,4 7,8 1,0 1,0 0,7 0,3 10,7 (LIC) Monde 20,9 13,0 7,9 4,2 3,9 0,5 0,0 0,4 0,2 7,2 Pays les moins 24,5 8,9 15,6 2,3 15,0 0,8 1,0 0,3 0,5 0,4 développés (LDC) Pays pauvres 15,7 8,4 7,3 3,0 7,7 1,5 1,1 0,3 0,4 -0,7 endettés (HPC) Source : Banque mondiale (http://go.worldbank.org/EPMTVTZOM0), version de mai 2010. EB : épargne brute, (comptes nationaux) ; CCF : consommation de capital fixe (comptes nationaux) ; EN : EB-CCF, épargne nette ; DE : dépense d’éducation ; CRE : consommation des ressources nationales en énergie fossile ; CRM : consommation des ressources nationales minérales ; CRF : déforestation nette ; CO2 : émissions de gaz à effet de serre ; PM10 : pollution atmosphérique en particules de moins de 10 microns ; ENA : épargne nette ajustée. Pour les pays en développement rapide, l’accumulation de capital physique ou humain est forte, compensant les autres postes, d’autant que les pollutions sont généralement plus faibles que dans les pays développés, puisque proportionnelles au niveau de développement. Au contraire, quelques pays (notamment l’Angola, le Congo, le Tchad, le Ghana, l’Indonésie) ont une épargne nette négative, et apparaissent comme non soutenables.
- 273. L’épargne nette ré-ajustée 271 Certains de ces pays sont pauvres et lourdement endettés ou sont pauvres et possèdent des ressources importantes, ce qui évoque la « malédiction des ressources ». En conséquence, le message de la Banque mondiale est opti- miste. La substituabilité entre le capital produit, l’éducation et les dommages environnementaux, peu nombreux et valorisés de façon « prudente », font que, à part dans le cas de quelques pays, le monde est globalement soutenable et que pratiquement tous les pays le sont. Nous proposons d’affiner le diagnostic en introduisant deux ajustements principaux au calcul de l’épargne nette de la Banque mondiale. Le premier concerne l’éducation et le calcul du capital humain ou éducatif. Le second a trait aux émissions de CO2 et leur répartition internationale. 4. La dépréciation du capital humain ou du capital éducatif Traiter l’éducation comme un capital a rencontré de nombreuses critiques. L’analogie est commode entre l’ensemble des connaissances accumulées et incorporées ou non dans les indi- vidus et un stock de capital. Prise de façon stricte, elle peut conduire à des contresens. Par exemple, ce « capital humain» n’est pas échangeable et il ne se traduit pas uniquement par une produc- tivité plus élevée. Il est également dépendant de l’état de la société et de la division des tâches à l’intérieur de celle-ci. Les bénéfices d’une meilleure éducation ne sont certainement pas à juger uniquement en fonction du niveau de productivité qu’elle permet d’atteindre. Il y aurait une dérive dangereuse à n’apprécier – et donc à n’orienter – l’éducation uniquement sous l’angle productif et non pas comme un bien en soi, un facteur d’émancipation et de réalisation personnelle ou un ingrédient nécessaire au fonctionne- ment d’une société démocratique et libre. Ces précautions étant prises, nous nous limiterons ici au point de vue productif, comme dans l’étude de Mélonio et Timbeau (2006). L’approche de la Banque mondiale, en considérant que les dépenses d’éducation sont un investissement net, aboutit à une surestimation importante de cet investissement. La Banque mondiale ne prend pas en compte la dépréciation du capital humain qui se produit lorsque les individus formés dans leur jeune
- 274. 272 Céline Antonin, Thomas Mélonio et Xavier Timbeau âge ou au long de leur vie active vieillissent, se retirent de la force de travail, émigrent ou décèdent. Comme tout individu connaît une vie active finie (de l’ordre de 40 ans) et une vie également finie, ce phénomène de dépréciation est majeur. Si l’on suit une méthode d’inventaire perpétuel pour le calcul du stock, l’investis- sement net en éducation doit tenir compte du flux brut d’investissement (la dépense en éducation) et diminué de la dépré- ciation (les retraits de la force de travail). L’oubli de la dépréciation est surprenant dans les calculs de la Banque mondiale ; dans l'ouvrage d'Hamilton et al., (2006) la ques- tion n’est pas discutée. Dans des publications antérieures, des chercheurs de la Banque mondiale (Nehru, Swanson, & Dubey, 1993) étaient conscient de ce fait. Ils utilisaient un indicateur de nombre d’années d’études initiales moyen, qui ne peut pas croître indéfiniment. Pour augmenter le nombre d’années d’études initiales moyen, il faut plus éduquer la jeune génération que les générations précédentes. À population constante, lorsque toutes les générations ont accompli le même nombre d’années d’études, le nombre moyen d’années d’études est constant, alors que la dépense d’éducation peut être substantielle (fonction du nombre d’années d’études). L’investissement brut est alors égal à la dépense d’éducation, l’investissement net étant, dans ce cas, nul. Lorsqu’au contraire les générations sortantes ont reçu peu d’éducation, l’investissement brut est proche de l’investissement net, du moins lorsqu’on considère que le niveau 0 de capital est conventionnellement attribué au capital humain des générations sortantes, c’est-à-dire celles ayant le plus bas nombre d’années d’études. Ce cas s’applique probablement aux pays en développe- ment dont on peut estimer que les niveaux d’éducation il y a 40 ans étaient faibles. Dans le cas de ces pays, l’approximation de la Banque mondiale est plus proche de la réalité. Arrow et al. (2010) utilisent une autre approche d’évaluation du capital humain. Ils l’estiment par une méthode de valeur nette actualisée appliquée à chaque individu, puis sommée sur les indi- vidus actifs. Cette méthode permet de prendre en compte correctement la dépréciation liée aux retraits du marché du travail ou aux décès. Elle présente en revanche l’inconvénient d’un risque de double compte. Les auteurs utilisent en effet le salaire moyen
- 275. L’épargne nette ré-ajustée 273 comme base du flux actualisé des revenus du capital mais le salaire qu’il faudrait utiliser est le salaire marginal à chaque âge de la vie. Il convient également de ne pas confondre capital éducatif (que nous intégrons dans notre analyse) et stock de connaissance (que nous ne considérons pas). Le premier résulte de l’investissement par la dépense en éducation et inculque aux individus les connais- sances de la société. La production de connaissances découle d’un investissement de nature différente (recherche, recherche et déve- loppement), centralisé ou décentralisé qui peut avoir un rendement très élevé. C’est un stock dans lequel chacun peut puiser pour se situer sur la frontière de production, du moins si l’on néglige la question de la propriété intellectuelle. Le stock de connaissance et le capital éducatif peuvent avoir des dynamiques complexes, marquées par la création destructrice, un rendement différé ou nécessitant des complémentarités avec le niveau d’éducation des autres ou le stock de biens capitaux physiques. Le stock de connaissances est l’objet du modèle AK de Romer (1986) alors que celui de capital éducatif incorporé correspond à celui de Lucas (1993). Le stock de connaissances ne fait pas l’objet d’une évaluation dans le travail de la Banque mondiale, mais Arrow et al. (2010) en valorisant le progrès technique (voir plus haut) en propo- sent une évaluation indirecte. Nous modifions l’estimation de la Banque mondiale en conser- vant l’accumulation annuelle de capital éducatif telle que calculée mais en déduisant également annuellement la dépréciation du capital éducatif. Celle-ci se fait en continu, chaque personne en âge de travailler voyant son capital éducatif se réduire de manière linéaire entre 20 et 62 ans. Ainsi, un individu amortit son capital éducatif de départ – valorisé par ses coûts de constitution – progres- sivement (ou brutalement s’il décède) au fur et à mesure qu’il se rapproche de la retraite. Nous n’intégrons pas dans notre évalua- tion l’effet de l’expérience professionnelle. Au premier ordre, tant que la durée de la vie active ne varie pas ou que les interruptions de carrière sont un phénomène constant, l’expérience professionnelle ne varie pas. En revanche, si, par exemple, la variation du chômage ou les modalités de la participation des femmes au marché du travail connaissent une variance dans le temps ou dans l’espace et que l’on est capable de la mesurer, il serait pertinent d’inclure un tel effet.
- 276. 274 Céline Antonin, Thomas Mélonio et Xavier Timbeau Les données de Barro et Lee (2010) nous permettent de connaître, pour l’ensemble des pays étudiés, le nombre de personnes par tranche d’âge et par niveau de diplôme en 2005 et 2010. Les données de l’Unesco indiquent le coût de chaque année de formation en pourcentage du PIB par cycle, tandis que la base de données de Cohen et Soto (2007) donne la durée exacte de chaque cycle scolaire par pays ainsi que les taux d’abandon intra-cycle. Cela permet de reconstituer pour toutes les tranches d’âge le coût total des formations reçues. En appliquant un coefficient d’amor- tissement du capital éducatif, cela permet de mesurer, en 2005 comme en 2010, le total du capital éducatif de chaque pays, mais aussi la dépréciation annuelle de ce capital, mesurée en moyenne sur cinq ans. Pour l’année 2008, nous avons donc retenu la dépré- ciation moyenne sur la période 2005-2010. La dépense éducative moins la dépréciation est la dépense éducative nette. Tableau 2. Dépréciation du capital éducatif (consommation de capital humain) DE CCH DEN En % du PIB Unesco Les auteurs Les auteurs 2008 2005-2010 2008 France 5,5 4,9 0,6 Italie 4,7 5,3 -0,6 Allemagne 4,4 4,5 -0,1 USA 5,4 5,4 -0,0 Inde 3,2 1,1 2,0 Chine* 1,9 2,2 -0,3 Hauts revenus (HIC) 4,6 4,9 -0,3 Revenus inter. supérieurs (UMC) 4,2 2,6 1,6 Revenus inter. supérieurs (LMC) 2,3 1,5 0,8 Faibles revenus (LIC) 3,4 1,3 2,1 Monde 4,2 4,3 -0,1 * La dépense éducative pubique de la Chine n’est plus publiée par l’Unesco depuis 2000 et par la Banque mondiale depuis 1999. Le chiffre indiqué est une estimation fondée sur l’évolution du nombre d’élèves sous l’hypothèse pru- dente d’une stagnation de la dépense réelle par tête. Source : Banque mondiale (http://go.worldbank.org/EPMTVTZOM0), version de mai 2010, calculs des auteurs. DE : dépense d’éducation ; CCH : consommation de capital humain ; DEN : dépense éducative nette. Dans tous les pays où la dépense éducative réelle par élève stagne, où la taille des cohortes diminue, où l’émigration est forte, ou encore où la mortalité des actifs est élevée, l’amortissement annuel de capital éducatif sera élevé, ouvrant la possibilité d’une dépense éducative nette négative, donc d’une baisse du capital éducatif du pays. Les pays de l’OCDE sont particulièrement
- 277. L’épargne nette ré-ajustée 275 concernés, notamment en raison du non-renouvellement des générations, qui conduit à investir dans l’éducation de générations moins nombreuses que celles dont le capital éducatif s’amortit. Pour un pays où la taille des générations se réduit, la dépense éducative nette sera négative sauf hausse importante de la dépense éducative par année de scolarité ou élévation rapide du niveau d’éducation. C’est pour cette raison que la dépense nette éducative de la Chine est négative dans notre évaluation (tableau 2). 5. Les émissions de CO2 et d’équivalent CO2 et le prix Dans les estimations de la Banque mondiale (Hamilton et al., 2006), les émissions de CO2 sont intégrées en multipliant les émis- sions par pays par un prix fixé à 20 dollars de 1995/tC (5,5 dollars de 1995/tCO2)3. Cette estimation pose trois problèmes qui ont déjà été soulevés par différents auteurs (Stiglitz et al., 2009 par exemple). Le premier est le prix choisi pour la tonne de carbone, le second concerne les sources de gaz à effet de serre et le troisième réside dans l’affectation des émissions de carbone. Nous proposons des alternatives pour aborder ces problèmes. La valorisation de la tonne de carbone dans le travail de la Banque mondiale provient d’une revue de la littérature de Fankhauser (1994). Le même auteur, en 2009 (Dietz et Fankhauser, 2009), estime dans une autre revue de la littérature des fourchettes larges dont les bornes supérieures sont élevées (0 à 654 dollars/tCO2 en valorisant le CO2 à son coût social, et entre 0 et 60 dollars/tCO2 en utilisant le coût marginal de réduction des émissions (abatment curve). Tol (2008) procède à une méta-analyse des estimations disponibles du coût social du carbone. La valeur de 20 dollars/tC la tonne de carbone est le mode de la distribution des évaluations revues par les pairs, le mode étant supérieur lorsqu’on intègre égale- ment les études non soumises à la revue de pairs. Tol note égale- ment le manque d’analyses robustes et approfondies. Il souligne cependant que la prise en compte de l’incertitude associée aux conséquences des émissions conduit à retenir des équivalents certains très supérieurs à 20 dollars/tC. La prise en compte d’incerti- tudes conduit ainsi, dans un cadre de contrôle optimal, Newbold et 3. Il y a autant de carbone dans une tC que dans 44/12 tCO2.
- 278. 276 Céline Antonin, Thomas Mélonio et Xavier Timbeau al. (2010) à proposer des valeurs de la tonne de CO2 supérieures à 100 dollars, soit plus de 300 dollars la tonne de carbone, ce qui est la valeur retenue par N. Stern dans le rapport de 2006. La commis- sion présidée par A. Quinet (Quinet et al., 2008) a recommandé au gouvernement français une valeur de 100 euros/tCO2 (soit 360 euros/tC) en 2030 en adoptant une règle de Hotelling pour son évolution dans le temps (4 % par an). En 2010, la valeur serait de 45 euros/tCO2 (soit 165 euros/tC) et en 2050 de 200 euros/tCO2 (soit 720 euros/tC). En 2009, le Department of Energy and Climate Change britannique a retenu des estimations proches de la commis- sion Quinet dans sa recommandation au gouvernement britan- nique (Departement of Energy and Climate Change, 2009). Les valeurs proposées à des décideurs politiques sont supérieures à celles retenues par la Banque mondiale et s’éloignent de ce que Tol considère comme « raisonnable ». Deux raisons peuvent être avancées pour comprendre de telles différences d’appréciation : la première concerne la représentation que l’on se fait de l’économie et des mécanismes de moyen terme, c’est-à-dire l’horizon temporel, la rigidité plus ou moins grande des comportements, le caractère « putty putty » ou « putty clay » du capital installé, ou la courbe des coûts de réduction des coûts en carbone. Dans les modèles mettant en avant l’équilibre idéal sans friction, la réponse à une taxe carbone même faible peut conduire à des réductions importantes des émissions par d’importantes substitutions peu couteuses dans les choix de production ou dans les modes de consommation. Dans les modèles, plus réalistes, avec une forte inertie de comportements, des coûts de transition élevés, et où les effets de dégradation du climat sont rapides et s’imbriquent avec les inerties, il faut au contraire une taxe carbone plus importante pour échapper au réchauffement climatique. L’incertitude et la non neutralité quant au risque (face au changement climatique, comment être neutre au risque ?) conduit également à choisir un prix du carbone élevé. Ce débat a été vif à la suite de la publication du rapport Stern et il a permis de clarifier les partis-pris. La seconde raison tient aux objectifs choisis ou considérés comme acceptables pour la concentration en carbone à l’équilibre : la plupart des auteurs retiennent 450 ppm (ou un réchauffement de 1,5 à 2°C par rapport à l’époque pré-industrielle). Un objectif plus drastique, tel que proposé par J. Hansen (Hansen et al., 2008), de retourner aux
- 279. L’épargne nette ré-ajustée 277 concentrations pré-industrielles correspond implicitement à une valorisation plus importante des dommages induits et donc des impulsions par les prix sociaux à appliquer. La valeur du carbone serait alors bien supérieure, y compris aux estimations hautes de la commission Quinet. Nous retiendrons dans notre exercice d’estimation alternative outre la valeur de la Banque mondiale de 5,5 dollars de 1995/tCO2 (7,1 dollars de 2007/tCO2), une estimation du prix de la tonne de CO2 10 fois plus importante, 45 dollars de 2007/tCO2 (commission Quinet). Le second point concerne la prise en compte de sources plus exhaustives d’émissions anthropogéniques de carbone. La Banque mondiale intègre les émissions liées à la combustion des énergies fossiles (y compris le gaz brûlé à l’extraction, flaring) et à la décar- bonation de la chaux pour la fabrication du ciment. On peut ajouter à cela les autres gaz à effet émis par l’activité industrielle et agricole (méthane, composés fluroés, oxyde nitrique) et le déstoc- kage du carbone par la déforestation (plus généralement pas le changement de destination des sols, Change in Land Usage). Nous utilisons les résultats de la NTNU (carbonfootprintofnations.com) tels que décrits dans l'étude de Hertwich et Peters (2009) et nous nous basons en particulier sur leur calcul d’équivalent CO2 pour les autres gaz à effet de serre. Le tableau 3 indique les disparités entre différentes évaluations des sources d’émission de gaz à effet de serre. Pour les grands pays en développement, les évaluations les plus exhaustives sont proches des évaluations limitées aux combustibles fossiles, un des effets compensant l’autre. En revanche pour les grands pays indus- trialisés, la différence peut être notable. Le troisième point consiste à affecter au consommateur final et non au producteur les émissions de gaz à effet de serre qu’il induit par sa consommation. Proops et al. (1999) avaient proposé cette imputation. Peters et Hertwich de la NTNU (2009) et Davis et Caldeira (2010) en proposent une mise en œuvre à partir des matrices input et output de la base de données GTAP (voir Minx et al., 2009). Dans beaucoup de pays développés, la délocalisation d’activités polluantes ou consommatrices d’énergie, c’est-à-dire principalement des activités industrielles, a limité les émissions de
- 280. 278 Céline Antonin, Thomas Mélonio et Xavier Timbeau polluants ou de CO2 donnant l’impression d’une vertu environne- mentale. Par exemple, Lenglart, Lesieur et Pasquier (2010) détaillent la balance des échanges « CO2 » de la France. Les émis- sions par habitant de CO2 sont estimées à 9tCO2/h/an dont 6.3tCO2/h/an émises directement sur le territoire et 2,7 tCO2/h/an importées (net des exportations). Ainsi, les émissions par habitant diffèrent de 15 % entre l’Allemagne et la France lorsqu’on intègre a) des sources de gaz à effet de serre plus exhaustives, b) une correc- tion pour la balance des échanges en CO2, alors que les émissions directes de CO2 issues des combustibles fossiles différent de presque 60 % (tableau 2). L’imputation au consommateur des émissions de CO2 se justifie d’autant plus qu’il existe une taxe carbone dans peu de pays. Le prix du CO2 est donc implicitement nul dans la plupart des pays et les échanges de biens et de services sont basés sur des coûts et des prix hors carbone. L’imputation au producteur demanderait donc d’inscrire dans les prix d’import et d’export le prix implicite du CO2 à moins de penser que les produc- teurs réduiraient leurs marges du montant d’une taxe carbone. La logique est donc de directement l’imputer au consommateur afin de prendre en compte la subvention implicite que celui-ci reçoit du fait de l’absence d’une taxe carbone payée par le producteur ou le consommateur. En ce qui concerne les produits pétroliers, le prix du pétrole sert à établir la rente et comme il correspond au prix payé par le consommateur (à quelques exceptions près), l’imputa- tion est de fait intégrée dans les comptes nationaux, parce que la rente est définie par les prix de marché. Tableau 3. Différentes évaluations des émissions annuelles de gaz à effet de serre tCO2/h IEA tCO2/h WRI tCO2/h WRI+LU teCO2GHG/h IEA WRI WRI+LU NTNU 2003 2003 2000 2001 France 6,4 6,6 5,7 13,1 Italie 7,8 8,2 7,5 11,7 Allemagne 10,2 10,5 10,4 15,1 USA 19,5 19,9 17,0 28,6 Inde 1,0 1,0 0,8 1,8 Chine 3,2 3,3 2,5 3,1 Source : International Energy Agency (IEA), World Resource Institute (WRI), Norvegian University of Science and Technology (NTNU). La colonne IEA ne compte que les émissions liées aux carburants fossiles. La colonne WRI intègre les émissions liées à la fabrication du ciment, la colonne WRI+LU intègre, en 2000, les émissions précédentes plus les changements dans la destination des terrains (LU), la dernière colonne intègre aux définitions précédentes les autres sources des autres gaz à effet de serre, notamment le méthane issu de l’agriculture. La colonne NTNU par ailleurs affecte les émissions au consommateur final.
- 281. L’épargne nette ré-ajustée 279 Nous ne couvrons que 60 pays sur les 120 que la Banque mondiale traite. La population de ces 60 pays est de 4,8 milliards, et les pays développés sont presque entièrement couverts. Le tableau 4 intègre l’ensemble des corrections que nous appor- tons ici à l’épargne nette ajustée. Nous calculons cette épargne nette réajustée pour deux valeurs de la tonne de CO2. Dans les deux cas notre estimation de l’épargne nette pour les pays déve- loppés est plus faible que dans l’estimation initiale de la Banque mondiale. Tableau 4. Epargne nette ré-ajustée, 2007-2008 ENA CO2 CO2 CO2 CCH ENrA ENrA En % du PIB BM BM AMT AMT AMT AMT AMT 7,1$/tCO2 7,1$/tCO2 45$/tCO2 7,1$/tCO2 45$/tCO2 France 6,8 0,11 0,23 1,4 4,9 2,2 1,1 Italie 4,5 0,17 0,26 1,5 5,3 -0,7 -2,0 Allemagne 11,8 0,18 0,26 1,6 4,5 7,3 6,0 USA 2,4 0,32 0,45 2,7 5,4 -2,5 -4,8 Inde 27,5 1,05 1,67 10,0 1,1 25,7 17,4 Chine 44,0 1,45 1,69 10,1 2,2 41,6 33,2 Hauts revenus 5,5 0,24 0,35 2,1 4,9 0,5 -1,2 (HIC, 30 pays) Revenus inter. supérieurs 24,1 0,87 0,69 5,7 2,6 21,7 16,7 (UMC, 20 pays) Revenus inter. supérieurs 23,1 0,90 1,45 8,7 1,5 21,0 13,8 (LMC, 6 pays) Faibles revenus 22,1 0,38 2,39 14,3 1,3 18,8 6,8 (LIC, 4 pays) Monde 9,8 0,39 0,46 3,1 4,3 5,5 2,8 (60 pays) Sources : Norvegian University of Science and Technology (NTNU), Banque mondiale, calcul des auteurs. BM : Banque mondiale ; AMT : les auteurs ; ENA : Epargne nette ajustée ; CO2 : émissions de gaz à effet de serre ; CCH consommation de capital humain ; ENrA : Epargne nette ré-ajustée, ENrA = ENA+CO2BM-CO2AMT-CCH. Les agrégats de pays sont suivant les catégories de la Banque mondiale. Les agrégats sont calculés sur les 60 pays pour lesquels nous disposons de données. La France ou l’Italie ont une épargne nette ré-ajustée très faible. Celle des États-Unis est négative. La grande consommation de capital éducatif et un poids plus lourd des émissions de CO2 expli- quent cette révision. Les pays en développement rapide (l’Inde et la Chine) conservent une épargne nette très élevée, les corrections apportées ici n’inversant pas le diagnostic d’une accumulation
- 282. 280 Céline Antonin, Thomas Mélonio et Xavier Timbeau forte de capital physique, bien que l’accumulation de capital éducatif soit plus faible que dans l’estimation de la Banque mondiale ou que la prise en compte des émissions de CO2 rappor- tées au PIB pèse plus lourdement. L’épargne nette réajustée agrégée sur le monde (en fait sur le sous-échantillon pour lequel nous disposons des données) apparaît ainsi plus faible, bien que positive, y compris pour un coût social du carbone de 45 dollars de 2007/tCO2. Il faut une valorisation de 110 dollars de 2007/tCO2 pour que l’épargne nette réajustée mondiale soit nulle. 6. Conclusion Le diagnostic de la Banque mondiale est assez largement remis en cause par les réajustements que nous proposons. En négligeant la dépréciation du capital humain, en affectant à la tonne de carbone un prix faible et en ne comptabilisant pas certaines sources de gaz à effet de serre, la Banque mondiale présentait un tableau encourageant du développement du monde, où la question de la soutenabilité ne se posait pas. Nos corrections indiquent que les économies des pays développés peuvent être beaucoup plus proches de la non-soutenabilité, voire être non-soutenables. L’accu- mulation rapide de capital dans les pays en développement rapide leur permet de justifier un sort meilleur aux générations futures. Mais qu’en sera-t-il lorsqu’ils auront rattrapé les pays développés ? Dans son ensemble, l’économie mondiale n’est plus aussi claire- ment soutenable que dans l’évaluation de la Banque mondiale. Il suffirait d’imputer à la tonne de carbone un prix social de l’ordre de 100 dollars par tonne de CO2 pour que le futur soit compromis par nos comportements actuels. Ce résultat ne choque malheureu- sement pas l’intuition commune. D’autres ajustements sont nécessaires. D’une part, l’améliora- tion de la santé humaine ou le progrès technique sont des arguments positifs à intégrer. À ce stade, les résultats d’Arrow et al. (2010) ne semblent pas vraisemblables pour l’évaluation de la santé. La prise en compte du progrès technique est difficile à justi- fier pour l’ensemble des pays, en particulier pour ceux qui se situent sur la frontière technologique. Concevoir le progrès des techniques comme une manne éternelle est difficilement justi-
- 283. L’épargne nette ré-ajustée 281 fiable. Soit on identifie les sources de ce progrès et on peut avec confiance penser que la continuation des sources alimentera un progrès continu, soit on est obliger d’intégrer une rupture possible dans le progrès des techniques. Le passage d’une économie dont la principale source d’énergie est carbonée à une économie où les sources d’énergie sont renouvelables ou reposent sur des technolo- gies difficiles à maîtriser (comme le nucléaire) peut se traduire par une régression dans la productivité globale des facteurs. Pour les pays qui ne sont pas sur la frontière de production, l’intégration progressive et la diffusion des meilleures techniques peuvent, en revanche, être valorisées positivement dans l’épargne nette ajustée. D’autre part, il existe une myriade d’effets négatifs qui sont autant de territoires inconnus pour l’évaluation économique, de la prise en compte de l’inégalité à l’évaluation des services que nous tirons des écosystèmes. La collecte systématique et l’intégration progressive de ces éléments dans des calculs d’épargne nette ajustée ne pourra que noircir un tableau déjà gris. Références bibliographiques Arrow K. J., P. Dasgupta, L. H. Goulder, K. J. Mumford et K Oleson, 2010, « Sustainability and the Measurement of Wealth », National Bureau of Economic Research, 16599. Asheim G. B., 2000, « Green national accounting: why and how? », Envi- ronment and Development Economics, 5, pp.25-48. Asheim G. B., W. Buchholz et C. Withagen, 2003, « The Hartwick rule: myths and facts », Environmental and Resource Economics, 25(2), pp. 129-150. Atkinson G. D. et D. W. Pearce, 1993, « Capital theory and the measure- ment of sustainable development: an indicator of “weak” sustainability », Ecological Economics, 8(2), pp. 103-108. Barro R. J. et J. W. Lee, 2010, « A new data set of educational attainment in the world, 1950-2010 », NBER working paper, 15902, National Bureau of Economic Research Cambridge, Mass., USA. Blanchet D., J. Le Cacheux et V. Marcus, 2009, « Adjusted net savings and other approaches to sustaibability: some theoretical background », Document de travail de la Direction des Etudes et Synthèses Economiques, G2009/10. Bolt K., M. Matete et M. Clemens, 2002, « Manual for Calculating Adjusted Net Savings », World, septembre, pp. 1-23.
- 284. 282 Céline Antonin, Thomas Mélonio et Xavier Timbeau Bruntland G. H., 1987, Our Common Future Report of the World Commission on Environment, pp. 318, New York. Cohen D. et M. Soto, 2007, « Growth and human capital: good data, good results », Journal of Economic Growth, 12(1), pp. 51-76. Daly H. et J. Cobb, 1989, For the Common Good, Boston: Beacon Press. Dasgupta P., 2001, Human Well-Being and the Natural Environment, pp. 351, Oxford: Oxford. Dasgupta, P., et G. Heal, 1979, Economic Theory and Exhaustible Resources, Cambridge, MA: Calbridge University Press. Dasgupta P. et K.-G. Mäler, 2000, « Net national product, wealth, and social well-being », Environment and Development Economics, 5, pp. 69-93. Davis S. J. et K. Caldeira, 2010, « Consumption-based accounting of CO2 emissions », Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(12), pp. 5687-92. doi:10.1073/pnas.0906974107 Departement of Energy and Climate Change, 2009, « Carbon Valuation in UK Policy Appraisal: A Revised Approach », p. 128, DECC Publications. Dietz S. et S. Fankhauser, 2009, « Environmental prices, uncertainty and learning Centre for Climate Change Economics and Policy », Centre for Climate Change Economics and Policy Working Paper, 12. Fankhauser S., 1994, « The economic costs of global warming damage: A survey », Global Environmental change, 4(4), pp. 301-309. Hamilton K., 2000, « Genuine Saving as a sustainability indicator », Frameworks to measure sustainable development: an OECD expert workshop. Publications de l’OCDE. Hamilton K. et M. Clemens, 1999, « Genuine savings rates in developing countries », The World Bank Economic Review, 13(2), 333, World Bank. Hamilton K., G. D. Atkinson et D. Pearce, 1997, Genuine Savings as an indi- cator of sustainability, CSERGE GEC WORKING. Hamilton K., G. Ruta, K. Bolt, A. Markandya, S. Pedroso-Galinato, P. Silva, M. S. Ordoubadi et al., 2006, Where is the Wealth of Nations?, p. 188, Washington: World Bank. Hansen J., M .Sat, P. Kharecha, D. Beerling, R. Berner, V. Masson- Delmotte, M. Pagani et al., 2008, « Target Atmospheric CO2: Where Should Humanity Aim? », The Open Atmospheric Science Journal, 2(1), pp. 217-231, doi:10.2174/1874282300802010217 Hartwick J. M., 1977, « Intergenerational equity and the investing of rents from exhaustible resources », The American Economic Review, 67(5), pp. 972–974, JSTOR. Hertwich E. G. et G. P. Peters, 2009, « Carbon footprint of nations: a global, trade-linked analysis », Environmental science et technology, 43(16), pp. 6414-20.
- 285. L’épargne nette ré-ajustée 283 Hicks J.R., 1958, « The measurement of real income », Oxford Economic Papers, 10(2), pp. 125-162, JSTOR. Hicks J. R., 1946, Value and Capital: An Inquiry into some Fundamental Prin- ciples of Economic Theory, 2nd ed., Oxford: Oxford University Press. Lenglart F., C. Lesieur et J.-L. Pasquier, 2010, « Les émissions de CO2 du circuit économique en France », L’économie française 2010, Paris: INSEE. Lucas Jr R. E., 1993, « Making a miracle, Econometrica », 61(2), 251-272, JSTOR. Minx J. C., T. Wiedmann, R. Wood, G. P. Peters, M. Lenzen, A. Owen, K. Scott et al., 2009, « Input-Output Analysis and Carbon Footprinting: an Overview of Applications », Economic Systems Research, 21(3), 187-216. doi:10.1080/09535310903541298 Mélonio T. et X. Timbeau, 2006, « L’immatérielle richesse des Nations », Revue de l’OFCE, n° 97, pp. 329-363. Nehru V., E. Swanson et A. Dubey, 1993, « A New Database on Human Capital Stock », World Bank Working Papers, 1124. Newbold S. C., C. Griffiths, C. Moore, A. Wolverton et E. Kopits, 2010, « The “Social Cost of Carbon” Made Simple », NCEE Working Paper Series, (Mc 1809), National Center for Environmental Economics, US Environmental Protection Agency. Nordhaus W. et J. Tobin, 1971, « Is growth obsolete? », Cowles Foundation Paper, 398. Nordhaus WD., 1995, « How should we measure sustainable income? », Cowles Foundation Discussion Paper, 1101. Pezzey J., 1992, Sustainable Development Concepts: An Economic Analysis, Environment. Proops J. L. R., G. Atkinson, Frhr. v., B. Schlothiem, et S. Simon, 1999, « International trade and the sustainability footprint: a practical crite- rion for its assessment », Ecological Economics, 28, pp. 75-97. Quinet A., L. Baumstark, J. Célestin-Urbain et H. Pouliquen, 2008, La valeur tutélaire du carbone, p. 110, doi:10.3917/esp.134.0115 Repetto R. C. et WRI., 1989, Wasting assets: natural resources in the national income accounts, p. 68, Whashington D.C.: World Resource Institute. Romer P. M., 1986, « Increasing returns and long-run growth », The Journal of Political Economy, 94(5), pp. 1002-1037, JSTOR. Solow R. M., 1974, « Intergenerational Equity and Exhaustible Resources », The Review of Economic Studies, 41(Symposium on the Economics of Exhaustible Resources), pp. 29-45. doi:10.1377/hlthaff.23.5.142 Stiglitz J. E., A. Sen, et J. P. Fitoussi, 2009, Rapport de la Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social, Rapport.
- 286. 284 Céline Antonin, Thomas Mélonio et Xavier Timbeau Tol R. S. J., 2008, « The social cost of carbon: trends, outliers and catas- trophes », Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, 2(25), pp. 1-22. Vincent J. R., 2000, « Introduction to the Special Issue Green accounting: from theory to practice », Environment and Development Economics, 5, pp. 13-24. Weitzman M. L., 1976, « On the welfare significance of national product in a dynamic economy », The Quarterly Journal of Economics, 90(1), 156. Oxford University Press. Weitzman M. L., 2000, « The linearised Hamiltonian as comprehensive NDP », Environment and Development Economics, 5, pp. 55-68. Weitzman M. L., 2003, Income, Wealth, and the Maximum Principle, Cambridge, MA: Harvard University Press. World Bank, 1995, Monitoring Environmental Progress, a report on work in progress, World Bank.
- 287. L’épargne nette ré-ajustée 285 ANNEXE Données par pays CO2 CO2 ENrA ENrA ENA CO2 (45) CCH (7.1) (7.1) (7.1) (45) BM AMT AMT BM AMT AMT AMT LIC 22,1 0,4 2,4 14,3 1,3 18,8 6,8 Bangladesh 26,5 0,4 2,1 12,8 1,4 23,4 12,8 Madagascar 6,1 0,3 2,9 17,7 NA NA NA Malawi 21,7 0,2 1,9 11,6 0,9 19,1 9,4 Mozambique -1,1 0,2 3,4 20,5 1,0 -5,2 -22,3 Tanzanie NA 0,2 3,7 22,0 1,9 NA NA Ouganda 8,4 0,2 3,6 21,5 1,3 3,7 -14,3 Zimbabwe NA NA 2,9 17,3 NA NA NA LMC 23,1 0,9 1,5 8,7 1,5 21,0 13,8 Inde 27,5 1,1 1,7 10,0 1,1 25,7 17,4 Indonésie 10,0 0,7 1,1 6,6 2,1 7,6 2,1 Maroc 22,9 0,5 0,7 4,3 3,1 19,5 15,9 Philippines 20,8 0,4 0,3 1,6 1,5 19,5 18,2 Sri Lanka 18,2 0,3 0,8 4,6 NA NA NA Vietnam 27,3 1,2 2,8 16,8 2,9 22,8 8,8 Zambie 16,8 0,2 2,6 15,7 0,7 13,7 0,6 UMC 24,1 0,9 0,7 5,7 2,6 21,7 16,7 Albanie 8,5 0,3 0,7 4,3 NA NA NA Argentine 15,7 0,5 1,0 6,0 2,7 12,6 7,6 Botswana 31,7 0,3 0,7 4,0 3,7 27,6 24,2 Brésil 6,6 0,2 0,5 3,0 2,8 3,6 1,0 Bulgarie 1,3 1,0 1,2 7,1 5,2 -4,1 -10,1 Chili 17,1 0,3 0,6 3,4 2,9 14,0 11,2 Chine 44,0 1,4 1,7 10,1 2,2 41,5 33,1 Colombie 8,5 0,2 0,6 3,9 2,9 5,3 2,0 Lettonie 5,2 0,2 0,6 3,6 4,9 0,0 -3,0 Lituanie 3,7 0,3 0,6 3,3 4,6 -1,2 -3,9 Malaisie 26,9 0,8 0,6 3,7 3,6 23,5 20,3 Mexique 14,0 0,3 0,5 2,9 3,1 10,8 8,3 Pérou 14,5 0,3 0,2 1,1 1,4 13,2 12,4 Roumanie 9,3 0,5 0,0 0,1 0,5 9,2 9,1 Russie 19,0 1,0 0,2 1,0 4,1 15,8 15,0 Afrique du Sud 2,1 1,2 0,9 5,2 2,1 0,3 -4,1 Thaïlande 22,5 0,9 0,9 5,3 2,4 20,1 15,7 Tunisie 12,4 0,5 0,8 4,6 3,8 8,4 4,6 Turquie 4,0 0,3 0,6 3,5 2,0 1,7 -1,2 Uruguay 7,8 0,2 1,0 5,7 1,5 5,5 0,8 Venezuela 23,5 0,6 0,7 4,2 1,2 22,2 18,7
- 288. 286 Céline Antonin, Thomas Mélonio et Xavier Timbeau ANNEXE : Données par pays (suite) CO2 CO2 ENrA ENrA ENA CO2 (45) CCH (7.1) (7.1) (7.1) (45) BM AMT AMT BM AMT AMT AMT HIC 5,5 0,2 0,4 2,1 4,9 0,5 -1,2 Australie 16,6 0,3 0,4 2,7 5,1 11,4 9,2 Autriche 10,2 0,1 0,3 1,5 5,9 4,2 2,9 Belgique 10,3 0,2 0,3 1,5 6,4 3,8 2,5 Canada 9,2 0,3 0,4 2,2 5,4 3,8 2,0 Croatie 9,3 0,3 0,5 3,0 2,9 6,2 3,7 Chypre -3,1 0,3 0,6 3,6 7,4 -10,8 -13,9 République tchèque 7,6 0,6 0,6 3,3 4,6 3,0 0,3 Danemark 6,9 0,1 0,2 1,3 6,6 0,1 -0,9 Estonie 8,5 0,8 0,9 5,4 5,4 3,0 -1,5 Finlande 11,4 0,2 0,3 2,0 5,3 5,9 4,2 France 6,8 0,1 0,2 1,4 4,9 1,8 0,7 Allemagne 11,8 0,2 0,3 1,6 4,5 7,2 5,9 Grèce -3,4 0,2 0,4 2,5 5,5 -9,0 -11,1 Hong Kong 20,2 0,2 0,7 4,3 NA NA NA Hongrie 2,2 0,3 0,6 3,7 6,0 -4,1 -7,2 Irlande 14,3 0,2 0,2 1,3 4,5 9,7 8,6 Italie 4,5 0,2 0,3 1,5 5,3 -0,8 -2,1 Japon 8,0 0,2 0,3 1,7 5,5 2,4 1,0 Corée du Sud 17,5 0,4 0,4 2,1 5,0 12,6 10,8 Luxembourg 17,3 0,2 0,4 2,3 5,0 12,1 10,2 Malte 2,2 0,3 0,6 3,7 0,5 1,4 -1,7 Pays Bas 15,6 0,2 0,3 1,6 5,5 10,0 8,7 Nouvelle Zélande NA 0,2 0,0 0,1 5,3 NA NA Norvège 25,8 0,1 0,0 0,0 6,0 19,9 19,9 Pologne 8,0 0,6 1,5 8,7 4,0 3,2 -4,1 Portugal -3,6 0,2 1,4 8,2 4,3 -9,0 -15,9 Singapour 32,8 0,3 0,5 3,0 2,6 30,0 27,5 Slovaquie -86,5 0,5 0,4 2,4 3,3 -89,7 -91,7 Slovénie 14,7 0,3 0,4 2,6 5,3 9,3 7,2 Espagne 6,1 0,2 0,3 1,8 4,7 1,3 -0,2 Suède 15,9 0,1 0,2 0,9 7,3 8,5 7,8 Suisse NA 0,1 0,2 1,2 6,1 NA NA Royaume-Uni 5,2 0,2 0,2 1,5 3,9 1,3 0,0 États-Unis 2,4 0,3 0,4 2,7 5,4 -3,1 -5,4 Monde 9,8 0,4 0,5 3,1 4,3 5,5 2,8
- 289. LA MESURE DE LA SOUTENABILITÉ LES ANTÉCÉDENTS, LES PROPOSITIONS ET LES PRINCIPALES SUITES DU RAPPORT STIGLITZ-SEN-FITOUSSI Didier Blanchet* INSEE Le rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi (SSF) publié à l’automne 2009 a consacré l’une de ses trois parties à la mesure de la soutenabilité. On revient sur les principaux points soulevés par cette partie du rapport : (a) nécessité de bien distinguer la mesure de la soutenabilité de celle du bien-être courant, (b) évaluation de cette soutenabilité par une approche de type « capital élargi », consistant à quantifier l’ensemble des ressources transmises d’une généra- tion à l’autre, qu’elles soient de type environnemental, économique ou social, (c) difficulté à résumer ces différentes dimensions de la soutenabilité par un indice unique, ce qui plaide pour une approche de type tableau de bord et enfin (d) besoin de prendre en compte la dimension internationale du problème, i.e. l’impact du comportement de chaque pays sur la soutena- bilité des autres pays. On examine comment ces propositions se raccordent aux conclusions d’autres initiatives internationales plus ou moins contem- poraines du rapport SSF. On indique comment se mettent en place les suites de cet ensemble de travaux, à la fois aux niveaux français, européen et pour l’ensemble des pays de l’OCDE. Mots clés : Soutenabilité. Développement durable. Rapport Stiglitz. * L’auteur remercie Claire Plateau et Éloi Laurent pour leurs remarques très utiles sur une première version de ce texte. Il reste seul responsable des erreurs ou omissions. Revue de l’OFCE / Débats et politiques – 120 (2011)
- 290. 288 Didier Blanchet L a mesure de la soutenabilité a constitué l'un des trois grands thèmes du rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi (SSF), les deux autres concernant la mesure du bien-être courant, respectivement dans ses aspects monétaires et non monétaires. Dans chacun de ces trois domaines, le rapport s'est construit à partir d'un volume considé- rable de travaux préexistants. Ceci a été tout particulièrement le cas dans ce domaine de la soutenabilité. Il s'agit d'un champ vis-à-vis duquel les lacunes du PIB ont été reconnues et discutées de longue date, y compris par les comptables nationaux (Vanoli, 2002), et beaucoup de propositions en ont découlé, qu'il s'agisse de travaux académiques isolés, de propositions plus structurées portées par des organisations non gouvernementales, ou de travaux menés sous l'égide d'organismes en charge de la coordination des produc- tions statistiques publiques. On peut dire que toute cette production a eu deux grands éléments fondateurs, les travaux de W. Nordhaus et J. Tobin au milieu des années 1970 qui avaient été les premiers à proposer un indice du bien être économique soute- nable (SMEW, pour Sustainable Measure of Economic Welfare), et le rapport Brundtland de la fin des années 1980, suivi de peu par la mise en place des agendas 21 lors du sommet de Rio, qui a stimulé la production de batteries d’indicateurs du développement durable. La figure 1 donne une cartographie sommaire de tout ce champ1, en distinguant les indices ou outils statistiques ayant effectivement vu le jour et les travaux à caractère plus programma- tique. Les travaux y sont rangés par date approximative selon l’axe horizontal et l’axe vertical a été utilisé pour distinguer trois grands courants sur lesquelles nous allons largement revenir : les approches plutôt monétaires, les approches par indices synthé- tiques non monétaires et les approches par tableau de bord pouvant combiner éléments monétaires et non monétaires. 1. On trouvera une présentation plus systématique dans le rapport lui-même et chez Gadrey et Jany-Catrice (2007).
- 291. Figure 1. Synthèse des principaux indicateurs/initiatives relatifs à la mesure du développement durable, antérieurs et postérieurs au rapport SSF 1970 1980 1990 2000 2010 Indices variés : ISEW, GPI, Green HDI, Osberg et Sharpe, ESI... Optiques agrégées non monétaires Empreinte écologique Travaux OCDE divers Measuring the well-being and La mesure de la soutenabilité progress of societies (OECD) Optiques Rapport Agenda 21 Tableaux de bord du « tableau (UN) dévelop. durable (UN, Brundtland GDP and de bord » UE et déclinaisons nationales) Beyond (UE) Sponsorship group (ESSC) Rapport SSF WGSSD (UNECE/ System of integrated Eurostat/OCDE) TFSD (UNECE/ environmental and economic Eurostat/OCDE) accounting (UN) Optiques Comptables/ Nordhaus monétaires et Tobin Épargne nette ajustée (Banque Mondiale) Tentatives de PIB vert Notes : les pavés en grisé correspondent à des indicateurs faisant ou ayant fait l’objet de productions plus ou moins régulières, les autres pavés correspondent à des travaux de synthèse ou méthodologiques non directement opérationnels. Les datations sont approximatives, les flèches représentent les principales filiations. Les items en gras correspondent aux travaux ou indicateurs qui se rattachent explicitement ou peuvent se rattacher à l’approche par le capital ou par les stocks, i.e. des tentatives d’évaluation des ressources transmises aux générations futures pour assurer leur propre bien-être. Explicitation des sigles non usuels : ESSC = European Statistical System Committee, ISEW : Index of Sustainable Economic Welfare, GNI= Genuine Progress Indicator, HDI : Human development index, ESI = Environmental Sustainabilty Indicator, WGMSD = Working Group on Statistics for Sustainable Development, TFSD = Task Force for measuring Sustainable Development 289
- 292. 290 Didier Blanchet Dans cet environnement déjà bien occupé, il ne fallait pas attendre de la commission SSF qu’elle propose des innovations radi- cales et découvre brutalement des pistes encore totalement inexplorées. Le rôle qu’elle s’est donné a plutôt été de proposer un regard à la fois critique et constructif sur cette production très abon- dante, en identifiant ce qui lui semblait être des pistes inadéquates, celles qui lui semblaient plus légitimes, et les questions qui lui semblaient encore insuffisamment explorées. Le présent article va revenir brièvement sur les grandes lignes de cet existant dont la commission est partie. Il va essayer de repréciser quelle a été son analyse de cet existant pour justifier les propositions qui en ont découlé – un sujet sur lequel ont pu exister quelques malentendus. Et on verra de quelle manière ces propositions ont commencé à être reprises, en mettant l’accent sur deux actions internationales princi- pales, qui apparaissent toutes deux à droite de notre cartographie synthétique : le volet « soutenabilité » d’un sponsorship group mis en place dans le cadre du Comité du système statistique européen, et une task force OCDE/Unece/Eurostat consacrée à la mesure de la soutenabilité. Cette dernière a pris la suite d’un groupe de travail de même composition qui avait rendu son rapport à peu près au lance- ment du rapport SSF, et dont les conclusions avaient fortement influencé ce rapport SSF. Avant tout cela, on se livrera à un premier détour conceptuel. Qu’entend-on exactement par soutenabilité ? Comment cette notion s’articule-t-elle avec la notion de bien-être courant ? À quels problèmes doit-on s’attendre lorsqu’on s’attaque à la mesure pratique de cette notion ? 1. Le développement et sa soutenabilité : mesure simultanée ou mesures séparées ? Dans cet article, on ne cherchera pas à différencier les termes de durabilité et de soutenabilité et on les utilisera alternativement sans distinction. Le point de départ rituel est la définition de la durabilité proposée par le rapport Brundtland. Ce rapport a popu- larisé la notion de développement durable comme une forme de développement qui assure le bien-être des générations présentes sans compromettre celui des générations futures. Cette définition recoupe en partie ce que les économistes entendent par soutenabi- lité : un état est soutenable s’il peut-être perpétué indéfiniment à l’identique, mais il y a une nuance importante. La définition
- 293. La mesure de la soutenabilité 291 Brundtlandienne a beaucoup été utilisée pour souligner la néces- sité de considérer à la fois le développement et sa durabilité. Cette nécessité est indiscutable, mais cela a parfois été interprété comme voulant dire que les deux choses peuvent et doivent être mesurées en bloc. Beaucoup de propositions d’indicateurs alternatifs au PIB ont suivi cette voie et tentent de donner une vision globale du développement durable, comme d’ailleurs Nordhaus et Tobin avaient cherché à le faire en leur temps. Par exemple, l’idée qu’un PIB vert pourrait constituer cet étalon acceptable du développe- ment durable s’inscrit dans cette logique. Il en va de même de nombreuses propositions d’indicateurs composites mélangeant l’information sur le bien-être courant et la pression environnemen- tale, ou aussi d’approches par tableaux de bord se refusant à faire le tri entre ce qui décrit le bien-être courant et ce qui nous indique s’il a des chances de pouvoir être perpétué. La commission a souligné les problèmes que pose ce mélange des catégories. Ils sont à leur maximum dans les cas où l’on cherche à résumer toute l’information par un indicateur unique. C’est vouloir faire tenir à la fois le présent et le futur dans un seul chiffre là où il en faudrait au moins deux : l’un qui nous indique où on se situe à chaque date en termes de développement ou de niveau de bien-être, et un deuxième qui nous indique les perspectives de développe- ment futur ou au contraire de recul de ce niveau de bien-être. On voit mal quel résumé monodimensionnel de ces deux éléments pourrait avoir une valeur informative pertinente : un indicateur unique combinant les deux dimensions est fatalement condamné à mettre sur le même plan certaines situations de bien-être élevé mais non soutenable et d’autres situations de bien-être faible mais soute- nable. De même, à supposer que des calculs de PIB vert soient possibles, ce qui reste controversé, le fait de savoir que le PIB vert d’un pays donné n’est que de 90 % de son PIB ordinaire nous informe-t-il sur la durabilité de son développement ? La réponse est négative. Le PIB vert est juste une façon de relativiser le PIB. Il peut conduire à réviser marginalement les classements de performance entre pays plus ou moins économes en ressources naturelles, mais il n’est pas par lui-même un indicateur de soutenabilité. En rupture avec cette quête illusoire de l’indice global unique, la commission a clairement arbitré pour une mesure séparée du bien- être courant et de ses perspectives d’évolution. Mais la même ques-
- 294. 292 Didier Blanchet tion pouvait ensuite être reposée pour chacune de ces deux dimensions. Bien-être courant et soutenabilité doivent être évalués séparément, mais chacun peut-il ou pouvait-il l’être de façon mono-dimensionnelle ? Figure 2. Structure et synthèse des préconisations du rapport SSF Problématique générale : mesure de la performance économique et du progrès social Bien-être courant Perspectives de Aspects monétaires Aspects qualitatifs bien-être futur Sous groupe 1 : Sous groupe 2 : Sous groupe 3 : problématiques qualité de vie environnement/soutenabilité classiques du PIB → Préconisations → Préconisations → Préconisations • Indicateurs relatifs à quelques • Mesure clairement dissociée de celle du • Valorisation des grandes dimensions : santé, bien-être courant données de la éducation, environnement, • Approche « capital » : quantification de comptabilité nationale sécurité, participation sociale ressources transmises aux générations centrées sur le revenu • prise en compte des suivantes et la consommation inégalités d’accès à ces • Approche monétaire limitée aux des ménages dimensions dimensions pour lesquelles elle constitue • Indicateurs d’inégalité • Fourniture d’instruments une approximation acceptable • Mesure de la permettant l’agrégation de • Pour la dimension environnementale, production non ces dimensions tableau de bord d’indicateurs physiques, marchande • Fourniture de données prenant en compte la dimension relatives au bien être internationale du problème subjectif (contributions à la soutenabilité globale) À cette seconde question, la réponse du rapport a de nouveau été négative. Pour ce qui concerne le bien-être courant, ceci était inscrit d’avance dans le fait d’avoir confié à deux sous-groupes séparés les deux questions des dimensions monétaires et qualita- tives du niveau de vie, posées donc dès le départ comme irréductibles l’une à l’autre (figure 2). Par surcroît, le sous-groupe en charge de la question de la qualité de vie a lui-même souligné la nécessité de distinguer, sans les mélanger, un nombre minimal de dimensions de cette qualité de vie : la santé, l’éducation, la sécurité économique et la sécurité des personnes. La réponse a été identique dans le cas de la soutenabilité, mais non sans avoir considéré les pistes existantes pour une approche unidimensionnelle plus globale de la soutenabilité. Ce point
- 295. La mesure de la soutenabilité 293 crucial du rapport nécessite quelques précisions. C’est celui sur lequel certaines confusions ont pu voir le jour. 2. Mesurer la soutenabilité : indice unique ou tableau de bord ? Pour conclure à l’impossibilité d’un indice unique de soutenabi- lité, il fallait explorer à fond les pistes disponibles pour sa construction. Quelles sont-elles ? Sur le papier, la démarche appa- raît assez simple. Pour reprendre les termes de Solow (1993), la soutenabilité est le fait de conserver dans le temps « une capacité généralisée à produire du bien-être économique » et plus précisé- ment de « doter les générations futures de tout ce qui sera nécessaire pour atteindre un niveau de vie au moins aussi bon que le nôtre et pourvoir pareillement aux besoins de la génération qui suivra. (…) Nous ne devons pas, au sens large, consommer le capital de l’humanité ». Le problème est donc d’identifier les composantes de ce « capital » dont dépend le bien-être futur et évaluer si on en transmet aux générations futures des quantités suffisantes pour que puisse être assurée cette chaîne intergénéra- tionnelle de soutenabilité décrite par Solow. Précisons le raisonnement par deux exemples volontairement contrastés. Dans les modèles de croissance usuels à un seul bien, la production courante sert à la fois à assurer la consommation courante – assimilée au bien-être instantané – et à reconstituer ou accumuler le capital productif qui permettra d’assurer la produc- tion future. Dans le cas standard2, hors progrès technique, la soutenabilité du niveau de vie courant est assurée si l’épargne brute est au moins égale à la dépréciation du capital courant, et donc si l’épargne nette est positive. Une épargne nette négative signifie que cette économie vit au-dessus de ses moyens. Il peut rester possible pour elle de maintenir, voire d’accroître, sa consomma- tion courante à la période suivante et aux périodes ultérieures, mais, ce faisant, elle aggrave encore son problème de soutenabilité 2. On met de côté le cas où l’état initial correspondrait à une situation de suraccumulation du capital dynamiquement inefficace. Il s’agit d’un cas où on peut se permettre une épargne temporairement négative sans mettre en cause la soutenabilité. Mais ce cas est empiriquement peu probable. Dans le cadre formel à la Arrow et al. (2003), il faudrait le prendre en compte en attribuant une valeur nulle à l’épargne, tant qu’elle est excédentaire.
- 296. 294 Didier Blanchet et, tôt ou tard, elle devra réviser son niveau de vie à la baisse, de manière plus ou moins brutale. C’est clairement ce qu’on qualifie de non soutenabilité, et cette non soutenabilité équivaut à une valeur négative pour le taux d’épargne net courant. Ce premier exemple peut laisser croire que le raisonnement ne s’applique qu’à une approche économique de la soutenabilité. Mais ce n’est pas le cas. L’approche a priori très différente de l’empreinte écologique (Wackernagel et Rees, 1995) peut être inté- grée au même cadre conceptuel, et c’est dans cet esprit que le rapport a procédé à un examen détaillé de son intérêt et de ses limites, également examinés dans d’autres travaux concomitants (Le Clézio, 2009, David et al., 2010). Cette approche inventorie un certain nombre de ressources jugées nécessaires au maintien des capacités productives et de la qualité de vie. Dans l’état actuel de l’indice, il s’agit uniquement de ressources renouvelables (sols, eau, qualité de l’air, forêts, ressources halieutiques,…). Pour de telles ressources, on peut essayer de détecter des situations de surexploi- tation dans lesquelles la ponction sur la ressource excède sa capacité de renouvellement spontané. On évalue donc pour chacune de ces ressources l’équivalent d’un taux de surexploitation ou de surconsommation, conceptuellement équivalent à un taux d’épargne net et c’est en combinant les informations sur les taux de surexploitation des différents actifs renouvelables qu’est construite l’empreinte globale3. Ce cadre analytique commun auquel on peut ainsi rattacher ces deux approches est qualifié, selon les auteurs, d’approche par le capital ou d’approche par les stocks et c’était celle qu’avait privi- légié le groupe UN/OCDE/Eurostat cité en introduction. Une fois identifiés les biens ou ressources transmissibles d’une période ou d’une génération à l’autre, il faut évaluer comment évoluent les quantités de chacun d’entre eux. A priori, pour généraliser l’approche du taux d’épargne usuel de la comptabilité nationale et 3. Plus exactement, alors que la soutenabilité au sens de l’épargne nette s’évalue en testant si ce taux d’épargne est supérieur ou inférieur à zéro, la soutenabilité au sens de l’empreinte écologique s’évalue en comparant la pression sur les ressources à leur capacité de régénération, i.e. on est dans une situation non-soutenable si le ratio est supérieur à un. On peut en principe passer d’un mode de comptabilisation à l’autre : par exemple, un ratio dépréciation/épargne brute apporte la même information que l’épargne nette, et se lit de la même manière que l’empreinte.
- 297. La mesure de la soutenabilité 295 celle de l’empreinte écologique, il faut envisager quatre grands groupes : les deux facteurs de production standard des modèles de croissance que sont le capital productif au sens usuel de la compta- bilité nationale et le capital humain et les deux grandes catégories de ressources naturelles qui sont les ressources renouvelables – celles sur lesquelles se concentre l’empreinte écologique – et non renouvelables, i.e. les ressources fossiles. Mais la liste peut être étendue : par exemple, léguer aux générations futures des institu- tions en bon état de fonctionnement ou un degré minimum de cohésion sociale sont aussi des formes de transmission de capital intangible qui ont toutes leur importance pour la soutenabilité du niveau de vie. À un tel stade de généralité, il est difficile d’être en désaccord avec la démarche. Les problèmes surgissent au niveau de la mise en œuvre, et notamment dans la façon de comptabiliser et d’agréger de manière plus ou moins poussée les informations sur ces diffé- rents facteurs de durabilité. C’est surtout sur le problème de l’agrégation que se concentrent les difficultés. Le rapport l’a discuté en repartant de la tentative conduite par une équipe de chercheurs de la Banque mondiale, celle dite de l’épargne nette ajustée, dont il a montré à la fois l’apport et les limites (voir encadré 1 et voir égale- ment la contribution à ce numéro de C. Antonin et al.). L’épargne nette ajustée combine des données sur l’évolution du capital productif (l’épargne au sens classique du terme), sa dépré- ciation, l’accumulation de capital humain, la consommation de ressources naturelles épuisables et renouvelables. Supposons que l’on accepte le choix de cette liste de composants et supposons que le problème de la mesure de chacun d’entre eux ait été bien resolu. Il reste le problème central de leur agrégation. Pour construire un indice synthétique de soutenabilité, il faut définir la manière dont on va pondérer les évolutions de ces différents facteurs de la soutenabilité. Sur ce point, contrairement à une affirmation fréquente, l’oppo- sition n’est pas entre ceux qui considèrent que l’agrégation peut se faire selon un étalon monétaire et ceux qui pensent qu’elle doit se faire selon d’autres critères, comme ce serait le cas avec des indices composites. Quelle que soit l’approche retenue, dès lors qu’il y a agrégation, il y a forcément attribution de valeurs relatives aux différentes composantes de la soutenabilité, et peu importe que ces
- 298. 296 Didier Blanchet valeurs relatives soient exprimées en termes monétaires ou dans n’importe quelle autre unité réelle ou fictive. On notera en particu- lier que l’empreinte écologique n’échappe en rien à cette règle, puisqu’elle ramène les taux de surexploitation des différentes ressources renouvelables à un étalon unique qui est l’hectare de surface terrestre exploitable. Encadré 1. L’épargne nette ajustée4 L’indicateur d’épargne nette ajustée est un indicateur agrégé de soute- nabilité, relevant très explicitement de l’approche par les stocks, et promu par une équipe de chercheurs de la Banque mondiale. Une place relativement importante y a été accordée dans le rapport, mais sans que celui-ci ait préconisé son adoption stricto sensu. L’examen parallèle de l’épargne nette ajustée et de l’empreinte écologique a plutôt servi à illus- trer les difficultés d’une approche unidimensionnelle de la soutenabilité. Précisons les choses. L'idée est de quantifier globalement, pour chaque pays, le sens de l'évolution de son capital « élargi », incluant à la fois son capital au sens économique usuel du terme – il s'agira donc de son taux d'épargne global net de la dépréciation du capital fixe –, son capital humain – dont la variation est estimée de manière très imparfaite par les dépenses d'éducation –, ses diverses ressources naturelles, qu'elle soient non renouvelables (ressources minérales) ou renouvelables (forêts, …). Cet indicateur est complété par un décompte des émissions dans l'atmosphère de CO2 et autres particules polluantes, considérées comme facteurs de dégradation du « capital » que constituent la qualité du climat et la qualité de l'air. Une telle approche, dans son principe, est bien en phase avec l'idée de quantifier la « surconsommation » nette des ressources. Elle le fait avec un cadre analytique qui s'articule aux concepts de la comptabilité natio- nale et elle a l'intérêt de rappeler que la soutenabilité n'est pas seulement une question environnementale : un pays qui préserverait ses ressources naturelles mais négligerait totalement l'investissement matériel ou l'éducation des jeunes générations ne serait pas dans une situation plus soutenable qu'un pays qui ferait les choix exactement inverses. Mais la démarche pose trois problèmes que la commission a analysés en détail. Le premier est celui du choix des poids relatifs qu'on attribue aux différents types de capitaux. Pour le capital économique au sens tradi- tionnel du terme, la valorisation est en général faite aux prix de marché, selon le cadre standard de la comptabilité nationale : c'est déjà faire l'hypothèse que ces prix de marché reflètent bien les flux de services futurs que pourront rendre ces éléments de capital physique ou finan- 4. Cet encadré est en partie repris de Clerc et al., 2010.
- 299. La mesure de la soutenabilité 297 cier. Cette hypothèse est discutable et sans doute a-t-elle été mise à mal par la crise économique récente. Pour le capital humain, il n'y a pas de valeur de marché explicite : il faut donc essayer de le valoriser indirectement à partir des perspectives de rémunération des individus de différentes qualifications. Une méthode plus simple se fonde uniquement sur le montant des dépenses d'éducation. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit d'approximations dont la valeur peut-être discutée. S'agissant des ressources naturelles pour lesquelles il existe des marchés – par exemple les ressources fossiles –, on peut s'appuyer sur les prix pratiqués sur ces marchés, mais cette démarche revient à nouveau à faire l'hypothèse que les prix révèlent bien l'importance que ces ressources pourront avoir à long terme pour les générations futures. Cette hypothèse est fragile, et l'impossibilité de se fonder sur des prix de marché devient totale pour les autres formes d'atteintes à l'environne- ment : ce qu'on qualifie aujourd'hui de prix du CO2, tel qu'il s'échange sur les marchés de droits à polluer, n'a pas de raison de bien traduire le degré auquel les émissions actuelles sont susceptibles d'affecter le bien- être futur. Le même raisonnement peut être appliqué pour d'autres formes d'atteintes à l'environnement telles que les atteintes à la qualité de l'eau ou les pertes de biodiversité. Plus fondamentalement, on peut discuter la pertinence d'une simple agrégation linéaire des variations des différents stocks de capitaux. Lue naïvement, cette agrégation revient à supposer que les différents types de ressources que nous transmettons aux générations futures sont parfaitement substituables les unes aux autres : l'indicateur restera bien orienté, par exemple, si nous laissons aux générations futures un envi- ronnement très dégradé, dès lors que nous leur léguons, en échange, des volumes importants de capital productif ou un niveau élevé de connais- sances techniques. Cette assertion est contestable : à partir d'un certain point, il est probable qu'on ne peut plus compenser la dégradation des conditions naturelles par la simple accumulation de capital physique ou l'innovation. Des versions plus élaborées de la notion d'épargne nette ajustée seraient mieux à même de répondre à cette objection, et la commission les a également explorées. La démarche consiste à attribuer un coeffi- cient de plus en plus élevé aux actifs naturels non substituables à mesure que leurs stocks se rapprochent des seuils critiques à partir desquels toute décroissance future deviendrait dramatique pour les conditions de vie. Par exemple, à mesure qu'une ressource minérale s'épuise, les prélèvements additionnels sur cette ressource se verraient affectés d'un poids relatif tendanciellement croissant reflétant sa rareté relative croissante. Mais il ne pourra pas davantage s'agir de prix révélés par les marchés. Ce serait aux statisticiens de les imputer sur la base de modèles de projections décrivant au mieux ce phénomène de rareté croissante (voir encadré 2).
- 300. 298 Didier Blanchet Si opposition il y a, elle est entre ceux pour qui l’agrégation pourrait se faire selon des prix de marché, et ceux qui pensent qu’elle doit se faire selon d’autres règles. Il s’agit cependant d’un point sur lequel la commission a tranché sans ambiguïté : au moins pour la composante environnementale, les prix de marché sont clairement un étalon inapproprié, pour autant d’ailleurs qu’ils exis- tent. Il s’agit en effet d’un domaine où l’on se heurte soit à l’absence totale de marché, soit à des marchés imparfaits dont les signaux-prix présentent un biais court-termiste qu’il s’agit juste- ment d’éviter. Comment faut-il alors procéder pour attribuer des valeurs à ces différents ingrédients de la soutenabilité : par la seule consultation démocratique, comme le prônent les partisans d’une réappropria- tion complète de ces questions de mesure par la société civile, ou par le calcul technocratique laissé aux mains des experts ? Dans le premier cas, on interrogerait les individus sur ce qui leur semble plus ou moins important de laisser aux générations futures, et on utiliserait ces préférences déclarées comme instruments de pondération. Cette option paraît difficile à suivre dans son intégra- lité. La consultation démocratique a de fait sa place dans les procédures d’évaluation, et certaines des préconisations du rapport en matière d’indicateurs subjectifs vont un peu dans ce sens : la collecte d’informations subjectives est bien l’une des façons d’iden- tifier les valeurs relatives que les individus accordent aux différentes composantes du bien-être. Mais la méthode paraît diffi- cilement transposable en matière de soutenabillité. L’agrégation de préférences exprimés par des agents partiellement informés et très inégalement soucieux des générations futures peut-elle réellement permettre une évaluation objective de la soutenabilité ? Il ne va pas de soi que cette approche nous donne une meilleure évaluation de ce qui attend les générations futures. Mais la solution du calcul technocratique ne pose pas moins de problèmes. Que suppose-t-elle ? Pour reprendre le terme technique des comptables nationaux, la question est de construire un système de prix « imputés » : donner une valeur à des choses auxquelles le marché n’en donne pas. La question se rencontre déjà pour la mesure du bien-être courant : évaluer la prix de la santé, donner une valeur au travail domestique ou au loisir requièrent des démarches indirectes, en partie conventionnelles et dont les
- 301. La mesure de la soutenabilité 299 présupposés théoriques seront toujours discutables. Le problème est démultiplié pour la question de la soutenabilité qui est une question qui implique le futur, par nature inconnu, et très impar- faitement prévisible. Encadré 2. Les prix imputés On parle de prix imputés lorsqu’on est amené à donner une valeur à des biens ou services pour lesquels il n’existe pas d’échange marchand. Une méthode d’imputation directe est l’évaluation contingente, qui consiste à interroger les intéressés sur les prix qu’ils seraient prêts à payer pour disposer de ces biens ou services de manière marchande. Cette méthode reste fragile car soumise à biais de déclaration. On préfère donc s’appuyer quand on le peut sur l’observation des comporte- ments effectifs. L’exemple typique consiste à valoriser le loisir sur la base du salaire moyen net de prélèvements : le raisonnement est que, si les agents optimisent librement leur temps travaillé, alors il devrait y avoir identité entre la valeur de l’heure marginale de loisir et le revenu moné- taire de l’heure marginale de travail. Cet exemple montre que l’imputation repose sur un modèle implicite de comportement des agents. Or on peut le juger discutable. Les statisticiens sont donc souvent réticents à ce type d’approche. Elle les éloigne de leur cœur de métier qui reste la collecte et l’agrégation de données brutes. Cette réti- cence se retrouve dans la première partie du rapport SSF, qui plaide certes pour une meilleure prise en compte des activités domestiques, mais plutôt dans le cadre de comptes satellites. La difficulté est considérablement amplifiée dans le domaine environ- nemental. Les méthodes de valorisation contingente sont souvent utilisées pour donner une valeur aux services actuellement rendus par l’environnement mais on reste dans une optique de bien-être instan- tané. La question de la soutenabilité est plus complexe : elle suppose de valoriser les services que l’environnement rendra dans le futur. Comment procéder ? On peut raisonner par analogie avec la valorisa- tion d’un actif au sens usuel du terme. La valeur d’un actif correspond au flux actualisé de dividendes qu’il génère. Dans le cas d’un actif naturel, ce flux de dividende est le cumul de ses contributions au bien-être collectif futur. Considérons la dégradation du patrimoine naturel que constitue l’émission d’une tonne de CO2. Pour lui donner une valeur, il faut projeter de quelle façon une tonne de CO2 émise aujourd’hui affecte la trajectoire économique et environnementale future et convertir cette projection en termes de bien-être social actualisé. En théorie, une telle façon de procéder est suffisamment flexible pour s’adapter à un grand nombre de cas de figure (Arrow et al., 2003) et en particulier pour résoudre l’opposition usuelle entre soutenabilité faible et forte, i.e. entre ceux qui ne voient pas de limites à la substitution entre actifs naturels et actifs produits par l’homme, et ceux qui considèrent
- 302. 300 Didier Blanchet qu’il existe des seuils critiques à partir desquels ces substitutions ne peuvent plus jouer. En l’occurrence, s’il existe un seuil critique pour le stock d’une ressource naturelle et si on dispose d’un modèle décrivant bien cet effet de seuil, cette méthode de calcul doit conduire à imputer à la ressource un prix relatif croissant très rapidement à l’approche de ce seuil, ce qui permet à l’indice d’envoyer le bon signal de soutenablité – tout ceci sans présager des signaux prix qu’enverraient les marchés. Autre exemple, si l’accumulation de capital productif a un effet externe négatif sur le capital naturel non pris en compte par le marché, imputer à ce capital physique un prix fictif ré-intégrant cette externalité permet de redonner le bon message de soutenabilité ou de non soutenabilité (Blanchet, Le Cacheux et Marcus, 2009). Mais les réponses qui sont ainsi apportées au problème de l’indice unique restent très théoriques : le rapport a surtout utilisé ce cadre formel pour illustrer la difficulté d’une mesure monodimensionnelle de la soutenabilité. Plus précisément, et ceci est développé dans le rapport, on connaît bien les principes théoriques selon lesquels devraient se faire ces imputations : il faut anticiper l’impact des variations présentes de chaque actif sur la trajectoire de bien-être collectif futur et c’est sur la base de ces impacts actualisés que se chiffrent les valeurs présentes de chaque actif. Mais on voit aussitôt le caractère assez artificiel de la construction, qui fait dépendre la mesure de la soutenabilité d’une projection complète de la trajectoire écono- mique et environnementale future. Il n’y a pas de surprise : mesurer le futur suppose une prévision de ce futur. Or c’est résoudre le problème en le supposant résolu car, si une telle projec- tion existait, la construction d’indices de soutenabilité deviendrait ipso facto inutile : si le futur est connu d’avance, on sait tout de suite si le niveau de vie et la qualité de vie courante vont être soute- nables ou pas. Nous ne sommes évidemment pas dans un tel monde : notre connaissance du futur est affectée d’incertitudes multiples. Ces incertitudes sont d’abord de type scientifique ou technologique : nous connaissons très imparfaitement les lois qui régissent l’évolu- tion des interactions entre économie, société et environnement. Elles sont également normatives et ceci recoupe des difficultés également rencontrées dans la mesure du bien-être courant. Il existe une incertitude sur la bonne façon de pondérer les ingré- dients du bien-être courant, il existe a fortiori une incertitude encore plus grande et inévitable sur ce que valoriseront le plus les
- 303. La mesure de la soutenabilité 301 générations futures, qui peut ne pas correspondre à ce que nous valorisons le plus aujourd’hui. Pour revenir sur la démarche de la préférence révélée par la consultation démocratique, ce sont surtout les préférences de ces générations futures que nous aurions besoin de révéler. 3. Une complication supplémentaire : la nécessité d'une approche globalisée L’approche par le capital aide aussi à bien faire ressortir une autre difficulté de la mesure de la soutenabilité, qui constitue égale- ment une ligne de clivage importante de la littérature existante. Il s’agit de la dimension internationale du problème. Devons-nous valoriser nos atteintes à l’environnement en fonction de leur impact sur notre propre soutenabilité, ou de leur impact sur une notion globale de soutenabilité, à l’échelon planétaire ? Là aussi, la question découle du fait que la mesure de la soutena- bilité n’est pas une simple mesure du présent, mais essentiellement une mesure du futur. Tant que la question est celle de la mesure du bien-être présent, on peut continuer d’accepter la logique « natio- nale » ou territorialisée de la plupart des indices concourant à la mesure de la qualité de vie courante. Le PIB par tête d’un pays donné, l’espérance de vie de sa population ou la qualité de l’air qu’on y respire sont certes sous l’influence de décisions ou de comportements adoptés en d’autres endroits du monde. Néan- moins, tant que la question est celle du bien-être courant, ce sont les valeurs constatées de ces variables qui importent et cela à un sens d’en calculer les niveaux hic et nunc, séparément pour chaque pays ou pour toute partition territoriale ou toute autre ventilation de la population mondiale. En matière de soutenabilité, ce raisonnement ne peut être main- tenu : ce qu’on doit quantifier est l’impact d’actions courantes sur un niveau de bien-être futur, et il devient impossible d’ignorer que nos actions courantes peuvent impacter à la fois le bien-être de nos propres descendants et celui des générations futures appelées à vivre en d’autres endroits du monde. Une approche autocentrée du développement durable garde certes son intérêt : il est toujours utile de connaître les perspectives de niveau de vie et de qualité de vie pour notre propre pays, et il existe une demande pour ce type
- 304. 302 Didier Blanchet d’indicateur. Mais un pays peut préserver sa qualité de vie, au moins jusqu’à un certain point, en exportant vers d’autres pays les effets négatifs à long terme de son comportement courant. Un distinguo s’avère donc nécessaire entre la soutenabilité vue d’un point de vue national, et les contributions de chaque pays à la soutenabilité globale. Le problème se pose pour l’ensemble des actifs naturels qui sont des biens publics globaux, communs à l’ensemble de l’humanité, notamment la qualité du climat et la biodiversité. Clairement, une approche de type empreinte écolo- gique se situe ou essaye de se situer dans cette logique globale. Les approches de type épargne nette ajustée sont plus ambiguës (voir à nouveau le texte de C. Antonin et al. dans ce même numéro). Le rapport a clairement conclu sur la nécessité de traiter ce problème de façon aussi complète et rigoureuse que possible. 4. Les préconisations du rapport En résumé, quelles ont été les préconisations du rapport ? Elles sont restées très ouvertes, et définissent des axes de travail plutôt qu’un programme fermé. Elles peuvent être reformulées en quatre points : — Un message clair en faveur de la dissociation entre mesures du bien-être courant et mesure(s) de la soutenabilité. — Pour cette dernière, nécessité d’une étape d’inventaire des ressources transmissibles dont dépend le niveau ou la qualité de vie future, qui ne soit ni exclusivement économique ni exclusi- vement environnemental. En fait, on voit naturellement apparaître ici ce que sont les trois piliers à la fois du développe- ment et de sa soutenabilité. Le développement à des dimensions à la fois économiques, sociales et environnementales, et la dura- bilité de ce développement dépend de l’accumulation ou de la préservation de composantes du « capital » qui relèvent égale- ment de ces trois domaines : capital économique et financier, capital humain et social, et capital naturel. On retrouve évidem- ment les trois piliers du développement durable tels que posés dans le rapport Brundtland. — Cet inventaire étant fait, recherche d’indicateurs d’évolution de ces différents facteurs ou vecteurs de la soutenabilité. Pour ceux qui constituent des biens collectifs mondiaux, nécessité que ces
- 305. La mesure de la soutenabilité 303 indicateurs quantifient bien les contributions de chaque entité géographique à la dépréciation ou à l’accumulation du bien collectif considéré. — Sur cette base, selon le degré de synthèse souhaité, envisager les possibilités d’agrégation des évolutions de ces différents vecteurs de la soutenabilité. Le rapport a retenu qu’il était éven- tuellement possible d’envisager une agrégation assez poussée pour les composantes les plus facilement monétarisables de la soutenabilité, le capital productif et le capital humain. Mais le rapport n’a pas suivi l’idée d’agrégation globale adoptée par les tenants de l’épargne nette ajustée, considérant que la base théo- rique et empirique était trop faible pour permettre de rendre commensurables des variations de capital économique et de capital environnemental. Le rapport a bien mis en avant ce que seraient les prérequis d’une telle agrégation et a montré que leur ampleur est trop forte pour qu’il soit possible d’envisager une modalité d’agrégation robuste et consensuelle. En un sens, concernant ce clivage entre dimensions environne- mentales et non environnementales de la soutenabilité, le rapport ne s’est pas senti en mesure de départager entre tenants des soute- nabilités dites « faible » et « forte », séparant ceux qui pensent respectivement que l’agrégation est possible ou impossible. Derrière cette opposition, il y a à la fois des jugements de valeurs et des différences de convictions quant aux possibilités de substitu- tion entre les deux catégories d’actifs et ce ne peut pas être aux systèmes statistiques publics de trancher entre ces deux visions. Leur fonction est plutôt de mettre à disposition les données élémentaires permettant aux chercheurs et aux acteurs du domaine de donner du contenu quantitatif à l’une ou l’autre de ces deux visions. 5. Approfondissements et mises en œuvre : travaux nationaux Comment s’inscrivent les travaux en cours par rapport à cet agenda ? Au niveau français tout d’abord, les messages du rapport ont servi de point d’appui pour conforter des évolutions qui étaient déjà en cours au sein du système statistique. Ceci vaut pour les
- 306. 304 Didier Blanchet préconisations de l’ensemble des trois parties du rapport. En matière de mesure du niveau de vie courant, on mentionnera notamment la mise en place d’un compte des ménages désagrégé par catégorie sociale, pour répondre à la demande d’indicateurs articulés à la comptabilité nationale mais faisant ressortir les dispa- rités entre ménages ou individus (Accardo et al., 2009), ou encore la mobilisation du système d'enquêtes sur les revenus et les condi- tions de vie pour la construction d’une mini batterie d’indicateurs non-monétaires de la qualité de vie (Albouy et al., 2010). On se refèrera à la section du site de l’Insee dédiée aux suites de la commission SSF pour davantage d’informations sur ces points5. Dans le sous-domaine plus spécifique de la soutenabilité qui nous intéresse ici, l’effort est porté conjointement par l’Insee et le Service de l’observation et des statistiques (SoeS) du Commissariat général au développement durable (Tregouët, 2010). Le tableau de bord qui est associé à la Stratégie nationale du développement durable est l’un des outputs de cette collaboration (SoeS/CGDD, 2011a) et la révision 2010-2013 de cette stratégie a été l’occasion d’en faire ressortir la logique « Stiglitzienne ». Il comprend des indicateurs en quantités physiques qui peuvent souvent s’inter- préter comme des variations de stocks d’un capital entrant dans la détermination du bien-être. Il comprend des indicateurs de pres- sion environnementale, comme la consommation de matières, ou encore des indicateurs de productivité matières répondant à l’enjeu d’une économie plus sobre en ressources naturelles. Au sein de ce tableau de bord, une importance particulière a été accordée à une meilleure mesure de l’empreinte carbone, avec la mise au point d’un calcul de cette empreinte selon l’approche demande finale (Lenglart et al., 2010), s’appuyant sur les comptes environnementaux en quantités physiques combinés avec les tableaux entrées-sorties de la comptabilité nationale. Cette approche est conforme à l’objectif de mesure des contributions nationales au réchauffement global en complément de l’approche traditionnelle par la production. Elle accompagne le développe- ment de ce mode de comptabilisation au niveau international (Nakano et al., 2009 ; Davis et Caldeira, 2010). Mais dans le cas de 5. http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/stiglitz/ performance_eco.htm
- 307. La mesure de la soutenabilité 305 la France, elle a été combinée à une autre des recommandations du rapport, à savoir la production d’indicateurs désagrégés puisque, en combinant cette méthode avec la désagrégation du compte des ménages par catégories sociales, on est en mesure de chiffrer les émissions de carbone associées à la consommation finale des diffé- rentes catégories de population. La construction d’indicateurs avec cette perspective « ménages » est en cours d’extension à d’autres formes de pression sur l’environ- nemment. Le SOeS vient de publier « l’empreinte eau » (SoeS- CGDD, 2011b). Des indicateurs nouveaux sont mis au point pour mieux décrire l’état de l’environnement : c’est le cas de l’indicateur de fragmentation des espaces naturels (SoeS-CGDD et al., 2011) ou encore d’un indicateur de qualité des eaux souterraines. 6. Initiatives internationales Qu’en est il au niveau international ? Comme on l’a indiqué en introduction, la sortie du rapport SSF avait suivi de peu ou a été concomitante d’initiatives apparentées, et tout notamment la communication GDP and Beyond de la commission européenne6 et le rapport du Working Group on Statistics for Sustainable Development OCDE/UNECE/Eurostat (WGSSD). De la première et du rapport SSF a directement découlé la mise en place d’un groupe de travail, le Sponsorship Group on measuring progress, well-being and sustainable development, coprésidé par le directeur général d’Eurostat et celui de l’Insee, réunissant quinze pays de l’UE-27, l’OCDE et l’UNECE. Ce groupe est chargé de faire des préconisations pour la mise en œuvre, par la statistique euro- péenne, des recommandations du rapport SSF et de « GDP and beyond » cohérentes avec d’autres initiatives politiques (Europe 2020, Stratégie de développement durable etc..). De même, le WGMSD poursuit ses travaux dans le cadre d’un nouveau groupe appelé Task Force for Measuring Sustainable Development (TFSD). La TFSD travaille dans la pratique en coordination assez étroite avec le Sponsorship, ne serait-ce qu’en raison de participants membres de ces deux groupes. Mais le travail de la TSFD, qui ne cherche pas à 6. www.beyond-gdp.eu
- 308. 306 Didier Blanchet définir un standard de statistique, reste de nature plus académique et moins opérationnel que celui du Sponsorship. Les travaux de ces deux groupes étant en cours de finalisation, il n’est pas possible de donner des informations définitives sur leurs préconisations et leur degré de convergence. Mais les documents d’étape qui ont d’ores et déjà été produits7 permettent de voir en quoi leurs approches suivent ou élargissent les lignes proposées par le rapport SSF. Dans les deux cas, la nécessité d’approches séparées de la mesure du bien-être courant et de sa soutenabilité sont clairement affir- mées. Dans le cas du Sponsorship Group, ceci découle mécanique- ment du fait qu’il s’est subdivisé en sous-groupes reconduisant à peu près la structure ternaire de la commission SSF, complétés par un groupe de synthèse transversale. Alors que le WGMSD avait choisi de se focaliser sur les aspects intergénérationnels de la soutenabilité dans une approche capital, la TFSD a réélargi son mandat pour y réinclure la problématique de la mesure du niveau de développement et de bien-être et les ques- tions de redistribution, donc pour couvrir à nouveau l’ensemble de la thématique Brundtlandienne. Mais ceci est fait en respectant le clivage entre mesure du bien-être courant et l’aspect intergénéra- tionnel correspondant à la soutenabilité, et ce dernier continue d’être abordé sous cette même approche par le capital élargi, avec notamment un travail plus élaboré sur les thèmes du capital humain et du capital social, en sus de la dimension environnemen- tale. Ceci converge avec l’option qui avait été retenue par le rapport SSF de ne pas se limiter à la dimension environnementale de la soutenabilité. Ensuite, dans l’un comme dans l’autre des deux groupes, pour ce qui concerne la dimension environnementale, la priorité est donnée à la mesure physique des degrés de pression sur les ressources. Le rapport SSF a été utilisé pour confirmer la difficulté d’une approche monétaire de cette dimension : le recours au calcul économique garde évidemment toute sa pertinence dans le 7. Pour la TFSD, on pourra par exemple consulter le rapport intermédiaire présenté au comité des Nations-Unies pour la comptabilité économique et environnementale, en juin 2011 (accessible à l’adresse : http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceea/meetings/UNCEEA-6- 14.pdf.
- 309. La mesure de la soutenabilité 307 domaine environnemental surtout au niveau microéconomique, lorsqu’il faut éclairer les choix de projet à conséquences écolo- giques. Mais ces approches microéconomiques restent, dans l’état actuel de l’art, très loin de pouvoir être étendues à la problématique des interactions globales entre l’économie et l’environnement. La priorité reste ainsi le calcul d’indicateurs de pression physique sur les ressources, calculés autant que possible dans le cadre conceptuel solide des comptes environnementaux. Face aux difficultés statis- tiques, les indicateurs proposés sont plutôt des indicateurs de flux que des indicateurs de stocks. Comme le conseille le rapport SSF, les agrégations d’indicateurs sont limitées aux cas pour lesquels on peut trouver des poids définis par des méthodes scientifiques. Enfin, comme le font les travaux en cours mentionnés plus haut au niveau français, ces groupes peuvent dans le même temps aborder des questions que le rapport SSF n’avait pas les moyens d’aborder, et on se permet de conclure en insistant ou en réinsis- tant sur deux de ces questions. D’une part, concernant les aspects physiques de la soutenabilité environnementale, le fait que le rapport SSF ait surtout illustré son propos par le cas des émissions de carbone sans aborder en détail des thématiques telles que les émissions d’autres polluants atmos- phériques, la pression sur les ressources en eau, la biodiversité, etc. On en a parfois conclu que la commission avait condidéré ces dimensions comme secondaires et avait voulu réduire la compo- sante environnementale de la soutenabilité à la seule question du changement climatique. Tel n’était évidemment pas le cas. Le cas des émissions de CO2 n’avait été mis en avant que comme exemple des difficultés à agréger la dimension environnementale et les autres dimensions de la soutenabilité et le rapport avait indiqué que le même type de raisonnement devait valoir pour les autres dimensions de la soutenabilité environnementale. Mais, contraire- ment à la démarche suivie simultanément par d’autres groupes d’experts (voir par exemple Röckström et al., 2009) il n’appartenait pas à une commission majoritairement composée d’économistes de formuler les propositions opérationnelles pour chacune de ces mesures, a fortiori pour la définition des seuils de résilience par rapport auxquels étalonner les indicateurs physiques de pression environnementale. L’eusse-t-elle fait qu’on lui aurait à juste titre reproché de se hasarder très au-delà de sa compétence. Le relais est
- 310. 308 Didier Blanchet naturellement passé à des spécialistes de l’environnement et des statistiques environnementales, et c’est ce que permettent de faire des groupes de travail élargis. D’autre part, une limite du rapport SSF avait été de ne quasi- ment pas aborder le thème de la contribution de l’environnement à la qualité de vie courante. Là encore, ceci a parfois été interprété comme signifiant que cet aspect était jugé secondaire par la commission. Sur ce point, la difficulté est venue du double mandat qui avait été confié au sous-groupe dont l’intitulé exact était « environnement/soutenabilité ». Ceci pouvait orienter son travail dans deux directions : soit se centrer sur les dimensions environne- mentales de l’ensemble de la thématique du développement durable, aussi bien dans sa dimension « bien-être courant » que dans sa dimension « bien-être futur », au risque d’être muet sur les autres composantes de la soutenabilité, soit se focaliser sur la thématique globale de la soutenabilité, dans ses dimensions envi- ronnementales et non-environnementales. On a choisi la seconde option, sur laquelle il avait semblé que le travail de synthèse et de clarification était le plus nécessaire. Mais ce choix ne signifie évidemment pas que la contribution directe de l’environnement au bien-être immédiat a été implicitement considérée comme un non-sujet. Les travaux en cours devraient permettre de lui redonner la place qu’il requiert au sein des indicateurs de la qualité de vie courante. Références bibliographiques Albouy V., P. Godefroy et S. Ollivier, 2010, « Une mesure de la qualité de vie », France Portrait Social – édition 2010, Coll. Insee Références, 99-146. Accardo J., V Bellamy., G. Consalès, M. Fesseau, S. Le Laidier et E. Raynaud, 2009, «Les inégalités entre ménages dans les comptes nationaux, une décomposition du compte des ménages », L’économie Française – Comptes et Dossiers – Edition 2009, Coll. Insee Références, 77:101. Arrow K. J., P. Dasgupta et K. G. Mäler, 2003, « Evaluating projects and assessing sustainable development in imperfect economies ». Environ- mental and resources economics, 26:647-685. Banque mondiale, 2006, Where is the Wealth of Nations ? Measuring capital in the 21st century. The World bank, Washington DC.
- 311. La mesure de la soutenabilité 309 Blanchet D., J. Le Cacheux et V. Marcus, 2009, « Adjusted net savings and other approaches to sustainability : some theoretical background », Document de travail, Insee/DESE n° 2009/10. Clerc M., M. Gaini et D. Blanchet, 2010, « Les préconisations du rapport Stiglitz/Sen/Fitoussi : quelques illustrations », L’économie française - comptes et dossiers – édition 2010, Coll. Insee références, 71:100. David M., C. Dormoy, E. Haye, B. Trégouët, 2010, Une expertise de l’empreinte écologique, Collection Études et Documents, SoeS-CGDD, n° 16. Davis S.J. et K. Caldeira, 2010, « Consumption-based accounting of CO2 emissions », Proceedings of the National Academy of Sciences, March 8. Gadrey J. et F. Jany-Catrice, 2007, Les nouveaux indicateurs de richesse. Seconde édition, Repères-La Découverte. UNECE/OECD/Eurostat, 2008, Report on measuring sustainable development: statistics for sustainable development, commonalities between current prac- tice and theory, (accessible à l’adresse http://www.unece.org/stats/ archive/03.03f.e.htm). Le Clézio P., 2009, L’empreinte écologique et les indicateurs du développement durable, Avis du Conseil économique, social et environnemental. Lenglart F., C. Lesieur et J.-L. Pasquier, 2010, « Les émissions de CO2 induites par l'ensemble du circuit économique en France », L'Économie Française - Édition 2010, Insee. Nakano S., A. Okamura, N. Sakurai, M. Suzuki, Y. Tojo et N. Yamano, 2009, « The measurement of CO2 embodiments in international trade : evidence from the harmonised input-output and bilateral trade data- base », OCDE/STI Working Paper 2009/3. Rockström J. et al., 2009, « A safe operating space for humanity », Nature, 461(7263) : 472:5. SOeS-CGDD/INSEE, 2011a, « Les indicateurs de la stratégie nationale de développement durable 2010-2013 », Repères CGDD, février 2011. SOeS-CGDD, 2011b, « Consommation des ménages et environnement Édition 2011 », Repères CGDD, Mars 2011 . SoeS-CGDD, IGN, MNHN, DRIEA-IF, 2011 (à paraître), « Mise au point d'un indicateur territorial de qualité écologique de l'occupation des sols ». Solow R., 1993, « An almost practical step toward sustainability », Resources Policy, 19(3) : 162-172. Stiglitz J., A. Sen et J.-P. Fitoussi, 2009, Richesse des nations et bien-être des individus, Odile Jacob. Trégouët B., 2010, « Un an de mise en œuvre des recommandations de la commission Stiglitz : vers une nouvelle génération d’indicateurs », Le point sur…, n° 64, SOeS/CGDD.
- 312. 310 Didier Blanchet Vanoli, 2002, Une histoire de la comptabilité nationale, Collection Repères, Ed. La Découverte. Wackernagel M. et W. Rees, 1995, Our ecological footprint : reducing human impact on the earth. New society publishers, the New Catalyst biore- gional series, Gabriola Island, B.C., 1995.
- 313. NOUVELLES RÉFLEXIONS SUR LA MESURE DU PROGRÈS SOCIAL ET DU BIEN-ÊTRE* Jean-Paul Fitoussi OFCE, Observatoire français des conjonctures économiques et Université Luiss Joseph E. Stiglitz Columbia University Dans la foulée du Rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi, nous proposons ici de nouvelles réflexions sur le progrès social et le bien-être, qui annoncent de nouveaux travaux et de nouvelles avancées. À partir de quelques exemples simples empruntés à l'actualité, nous montrons d'abord comment notre système statistique actuel, du fait à la fois des lacunes des indicateurs exis- tants et de l'absence d'alternatives crédibles, peut implicitement conduire à des conclusions de politique publique entachées d'erreur. Ceci importe au plus haut point car ce que nous mesurons affecte ce que nous faisons. Réduire le bien-être en vue d'augmenter quelque imparfaite mesure de la richesse matérielle que ce soit donne lieu à des politiques totalement erro- nées. Nous portons ensuite notre attention, selon cette même perspective critique des indicateurs et instruments de mesure actuels, sur des questions essentielles du débat économique contemporain telles que l'effet sur le chômage de la flexibilité des marchés du travail ou encore l'impact sur la croissance du degré d'ouverture financière des économies. Notre évaluation des mesures existantes de bien-être nous laisse convaincus à cet égard que, trop souvent, elles ont conduit les pays à s'orienter dans de mauvaises direc- tions, ou à tout le moins à adopter des politiques dont les bénéfices sont très discutables. Nous montrons en somme qu'il existe des possibilités considérables d'améliorer les indicateurs de bien-être et d'en développer de nouveaux pour mieux servir les buts collectifs des sociétés humaines. Mots-clés : Rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi, progrès social, mesure, bien-être, soutenabilité. * Communication présentée au 16e Congrès de l'Association internationale d'économie, Pékin, 4-8 juillet 2011. Revue de l’OFCE / Débats et politiques – 120 (2011)
- 314. 312 Jean-Paul Fitoussi et Joseph E. Stiglitz I l ne se passe pas une année sans que nos systèmes de mesure ne soient remis en question. La crise « financière » a révélé que nous (surtout les États-Unis) ne nous ne portions pas aussi bien que nous le pensions sur la base des indicateurs disponibles. Autrement dit, nous avons réalisé que notre croissance économique n’était en réalité pas soutenable, les mesures de la production ayant été exagérées par des phénomènes de bulles dans l'immobilier et par les profits fictifs réalisés dans le secteur financier. Le fait que dans certains pays (tels que les États- Unis) le PIB soit revenu au niveau d'avant la crise ne rend compte en aucune manière de la perte de bien-être qui a résulté de celle-ci. Avec près d'un Américain sur six exclu de l’emploi à temps plein – le reste étant confronté à l’angoisse de perdre sa maison ou son salaire – et les coupes sombres annoncées dans les dépenses publiques et sociales de base, la perte de bien-être est en réalité considérable. La situation en Espagne est encore pire, avec un taux de chômage supérieur à 20 % en moyenne et presque un jeune sur deux privé d’emploi. Les événements tragiques survenus au Japon cette année peuvent être considérés comme une métaphore de nos problèmes de mesure. Certains suggèrent que, bien que dans le court terme le PIB japonais décline, dans le long terme, il se relèvera suite aux efforts de reconstruction du pays. La catastrophe nucléaire a non seulement angoissé la population mais elle pourrait bien avoir des effets significatifs sur la santé d’un grand nombre de Japonais. Là aussi, les dépenses nécessaires pour répondre à cette menace pour- raient augmenter le PIB, peut-être même assez pour sortir le Japon de sa lancinante langueur économique. Mais nul ne prétendra que le Japon est en meilleur état après la catastrophe de Fukushima. Il faudrait une énorme augmentation du PIB pour compenser la destruction de capital, de tous les types d'actifs, que l'événement a causée, et pour atténuer l’angoisse face à l’avenir que tant de Japo- nais ressentent. Or nous ne sommes pas bien équipés – nos indicateurs ne sont pas correctement adaptés – pour mesurer la valeur des actifs perdus ou détruits. Et même si nous l’étions,
- 315. Nouvelles réflexions sur la mesure du progrès social et du bien-être 313 l'arithmétique de la réparation ne nous en dirait que peu sur la façon dont le bien-être du peuple japonais a évolué. La nature mécanique de nos modèles économiques ne nous dira rien des conséquences immatérielles des pertes irréversibles subies par la population. Dans la foulée de Fukushima, nous avons réalisé que nos mesures d’avant la catastrophe n'étaient pas plus justes. Le PIB japonais était peut-être artificiellement plus élevé du fait de la plus grande efficacité économique résultant de la dépendance au nucléaire (plutôt que l’usage des énergies renouvelables par exemple). La menace, aujourd’hui évidente aux yeux de tous, que représentait le traitement des combustibles usagés pour l'ensemble du pays peut avoir contribué alors à un PIB plus élevé en appa- rence. De la même manière les cadres comptables sous-évaluaient le risque réel avant la crise financière. Le cas japonais est donc une métaphore, car il souligne clairement les trois lacunes fondamen- tales de nos indicateurs économiques et sociaux : la mesure du « produit économique », la mesure du bien-être et la mesure de la soutenabilité. Un autre fait universel bien documenté est l'augmentation des inégalités au sein des nations qui caractérise le dernier quart de siècle au moins. Considérer la croissance du PIB ou même celle du revenu net ne nous dirait rien de l’évolution de ces inégalités, et nous donnerait certainement une fausse impression de l'évolution du bien-être sociétal. Il est à cet égard frappant de constater que dans les pays de l'OCDE l'augmentation des revenus de 80 % de la population a été plus faible que le taux de croissance global de l'économie (qui est, bien entendu, une moyenne) et d'autant plus faible que le décile considéré est bas. Si nous voulons des chiffres qui permettent d'évaluer l'impact de la croissance économique sur la société dans son ensemble, il nous faut à l’évidence savoir ce qui se passe pour la plupart des citoyens. Or le PIB ne nous dit rien à ce sujet. Un autre exemple nous est donné par la révolution dans le monde arabe, notamment en Tunisie, qui a ouvert une nouvelle ère politique dans cette région du monde. Certains économistes (voir par exemple Barro1) pensent que la liberté politique est un 1. Robert Barro, « Determinants of Economic Growth: a Cross-Country empirical Study », NBER Working Paper, n° 5698, août, 1996.
- 316. 314 Jean-Paul Fitoussi et Joseph E. Stiglitz produit de luxe, qui conduit à un taux inférieur de croissance, en raison de la quête de la redistribution à laquelle elle conduit. Mettant de côté le fait de savoir si ces allégations reposent sur de solides bases théoriques ou empiriques (dans le cas précis de la Tunisie au moins, le manque de démocratie a pu contribuer au développement de la corruption, laquelle a eu un effet débilitant sur la croissance), là aussi, le concept utilisé apparaît trompeur. Le PIB n'est pas une mesure du bien-être. Même s'il pouvait être montré qu’en régressant la croissance du PIB sur certains indices de liberté politique, la limitation de la liberté politique conduisait à des augmentations de PIB – et indépendamment de la fragilité de ces exercices empiriques – la conclusion que les pays seraient bien avisés de reporter dans le temps la démocratisation de leur société qu’ils ne peuvent se permettre de s’offrir n’a aucun sens. Il se pour- rait bien que le bien-être augmente davantage du fait de l’expansion des libertés politiques que consécutivement à une hausse du PIB, étant donné la façon dont le PIB est mesuré en pratique. En débattant des effets de la liberté politique sur l'évolu- tion du PIB, nous passons à côté du cœur de la question démocratique : le risque vital pris par les populations pour conquérir leur liberté porte témoignage que celui-ci est une composante fondamentale de leur bien-être. Voilà quelques exemples simples pris dans l’actualité qui montrent clairement comment notre système statistique actuel, du fait à la fois des lacunes des indicateurs existants et de l'absence d'alternatives crédibles, peut implicitement conduire à des conclu- sions erronées de politique publique. Ceci importe au plus haut point car ce que nous mesurons affecte ce que nous faisons. Réduire le bien-être en vue d'augmenter quelque imparfaite mesure de la richesse matérielle que ce soit donne lieu à des politiques totalement erronées. 1. Mesures et politiques Pour les économistes, ces préoccupations sont particulièrement importantes, car nous nous appuyons souvent sur les statistiques (les analyses économétriques en particulier) pour porter des juge- ments sur ce que sont de bonnes politiques. Ces jugements ne sont fiables que dans la mesure où les données sur lesquelles ils
- 317. Nouvelles réflexions sur la mesure du progrès social et du bien-être 315 s’appuient le sont. Certaines de ces études économétriques ont ainsi suggéré que les marchés financiers ou la libéralisation des marchés de capitaux ont contribué à une croissance économique plus élevée. Il est maintenant clair que les conclusions de ces études ont été viciées parce que (i) les chiffres du PIB dans les pous- sées de croissance étudiées ont été exagérés par les bulles qui accompagnent souvent les épisodes de libéralisation financière ; (ii) à moins d'un horizon temporel adéquat, les pertes qui suivent les épisodes de crise financière ne seront pas prises en compte et ces pertes peuvent plus que compenser les gains à court terme décou- lant des bulles auxquelles la libéralisation financière donne souvent lieu ; (iii) les conséquences en termes de répartition de ces politiques ne sont pas prises en compte ; de sorte que même si le PIB augmente, il peut en résulter un bien-être moins élevé pour la plupart des citoyens et (iv) les coûts pour le bien-être résultant par exemple de l'insécurité qui suit la volatilité qui accompagne habi- tuellement les mesures de libéralisation ne sont pas pris en compte. Les études empiriques qui ont été menées pour démontrer l'effet bénéfique de la libéralisation des marchés financiers sur la crois- sance et l'emploi sont sujettes au même genre de problèmes. Il y a donc un hiatus entre certaines des recommandations de politique publique que l’on entend généralement en la matière et la fragilité des éléments empiriques censés les soutenir. Pour prendre un autre exemple, on a vu dans les années récentes une multitude d'études économétriques visant à montrer de quelle manière certaines institutions du marché du travail, à travers les effets néfastes qu’elles ont sur la flexibilité de l’emploi, affectent négativement le chômage et la croissance. Les études qui portent sur l’impact supposé néfaste de certaines institutions sont, au mieux, en mesure d'expliquer des effets de second ordre. Deux études2 portant sur un échantillon de 19 pays de l'OCDE ont abouti de manière indépendante à la même conclusion : le capita- lisme est manifestement suffisamment robuste pour accueillir des cadres institutionnels fort différents3. 2. Voir Jean-Paul Fitoussi et Olivier Passet, « Réduction du chômage : les réussites en Europe », Conseil d’Analyse Économique, n° 23, La Documentation Française, 2000 ; et Richard Freeman, « Single peaked vs diversified capitalism : the relation between economic institutions and outcomes », NBER Working Paper, n° 7556, 2000.
- 318. 316 Jean-Paul Fitoussi et Joseph E. Stiglitz Mettons de côté pour le moment l’évaluation de l'affirmation selon laquelle des marchés du travail plus flexibles augmentent le PIB (en réduisant l’écart cumulé entre le PIB réel et potentiel) : quelle est l’utilité de ce constat si le PIB n'est pas, en réalité, la juste mesure du bien-être sociétal ?4 À vrai dire, beaucoup de partisans du fondamentalisme de marché – qui voient toute intervention externe, publique ou privée, comme une menace pour le bien-être – négligent générale- ment les « défaillances de marché », larges et bien documentées, qui sont particulièrement répandues sur le marché du travail et du capital. Certaines institutions ont précisément été créées pour pallier ces défaillances en matière d'assurance ou de formation. Si, par exemple, nos indicateurs ne tiennent pas compte des avantages en matière de sécurité que confère l'assurance chômage, la réforme qui s’impose n'est pas l'abolition de l'assurance chômage, mais de la métrique imparfaite qui conduit à cette conclusion erronée. Certaines de ces institutions peuvent être considérées comme reflé- tant un contrat social qui découle d'un processus démocratique. Il y a des gagnants et des perdants à toute réforme structurelle, dès lors une telle réforme a peu de chance d'aboutir à un résultat Pareto-optimal, ou ne serait-ce qu’à un soutien d’une majorité de l'électorat. Mais, et plus important encore, l'évolution vers une plus grande flexibilité du marché du travail pourrait affecter négative- ment au moins deux des facteurs déterminants du bien-être : la qualité des emplois (la quête d'un emploi décent) et la sécurité économique. En bref, sur la base de preuves empiriques très fragiles touchant à des phénomènes mal mesurés, nous pourrions tirer des 3. Cette conclusion est en contradiction avec la sagesse commune selon laquelle la diversité des structures institutionnelles joue un rôle déterminant dans l'explication tant du chômage que de la croissance. Les institutions comptent : l'expérience scandinave montre que les politiques actives du marché du travail et les institutions correspondantes peuvent permettre aux marchés du travail de mieux fonctionner, au moins dans les périodes où il n'y a pas de carence importante de la demande globale. Notre discussion se concentre ici sur les institutions qui conduiraient à des marchés du travail moins flexibles. 4. En particulier, la recherche issue du modèle dette-déflation Fisher-Greenwald-Stiglitz montre qu’avec des contrats imparfaitement indexés, une plus grande flexibilité des salaires et des prix peut être associée à des ralentissements économiques plus prononcés et des reprises moins assurées. Ainsi une étude en coupe de la volatilité a montré que la rigidité des salaires et des prix comptait bien moins que les facteurs liés aux marchés financiers (voir Easterly et al., 2001a, 2001b et 2003). Une sécurité plus faible dans l’emploi réduira la volonté des travailleurs d'investir dans le capital spécifique à l'entreprise, et peut donc compromettre la croissance et la productivité.
- 319. Nouvelles réflexions sur la mesure du progrès social et du bien-être 317 recommandations politiques dont la mise en œuvre peut réduire le bien-être des sociétés. Les inférences économétriques se révèlent particulièrement problématiques quand elles sont issues de régressions internatio- nales. Que cela nous plaise ou non, les comparaisons internationales de niveaux et plus encore de taux de croissance jouent en effet désormais un rôle très important dans la concep- tion des politiques publiques. Pour certains, ces régressions nous donnent des bases solides de décision dans la mesure où elles permettent d’isoler les effets de certains facteurs censés nous renseigner sur les différences de performance entre les pays. Il existe quantité de critiques bien connues de cette méthodo- logie. Par exemple, le plus souvent, ce type d’exercice consiste à imposer des limites aux coefficients pour qu’ils prennent des valeurs voisines d’un pays à l’autre comme si un modèle unique (à la fois économique et social) était en mesure d'expliquer les résul- tats économiques et le bien-être partout dans le monde tout à fait indépendamment des choix spécifiques et des arrangements insti- tutionnels mis en œuvre par les différents pays du globe. Si l'équation de ce modèle s’applique bien à un groupe de pays mais pas à un autre, l’estimation de panel conduira néanmoins à des résultats significatifs en raison de l'inclusion du premier groupe. Les conséquences sont évidentes : il serait erroné d'étendre d’éven- tuelles recommandations à un pays appartenant au second groupe. Notre préoccupation au sujet de ces exercices économétriques porte ici sur un autre problème. Les comparaisons ne sont significa- tives que si les procédures et les définitions utilisées pour calculer les comptes nationaux sont comparables et si il n’y a pas de biais dans la construction des séries de données elles-mêmes. Or, il existe encore de « grandes différences dans la façon dont les comptes nationaux sont construits, même parmi les pays européens, a fortiori entre l'Europe et les États-Unis »5. Ceci peut avoir de lourdes conséquences. Il n’y a aucun sens, par exemple, à adopter des réformes structurelles destinées à importer les « meilleures pratiques » du pays qui présente la meilleure performance en 5. Joachen Hartwig ,« On Misusing National Account Data for Governance Purposes », Working paper 05-101, KOF Swiss Economic Institute, ETH, Zurich, 2005.
- 320. 318 Jean-Paul Fitoussi et Joseph E. Stiglitz termes de taux de croissance si le taux de croissance des deux pays diffère principalement en raison des différences dans les manières dont leurs comptes nationaux sont respectivement calculés Un autre exemple qui reflète des lacunes dans la mesure du PIB reconnues depuis longtemps touche à l’analyse de l'effet de la taille du gouvernement sur la croissance. Parce que la production du secteur public est généralement mesurée par ses inputs, on fait l’hypothèse implicite de non-croissance de la productivité du secteur public, alors qu'en fait, dans certains cas (lorsque des études détaillées ont été réalisées) on observe une croissance rapide de la productivité. Inévitablement, cette hypothèse biaise les régressions inter-pays et conduit à l’idée que plus le secteur public est impor- tant, moins la croissance de la productivité est forte. Cette assertion ne résulte aucunement d’une compréhension empirique profonde : il s'agit simplement de la conséquence d'un artefact statistique. Considérons, par exemple, ce qui pourrait advenir si l'on décidait de privatiser la Social Security américaine (le système public de retraites). Nous savons que les coûts de transactions asso- ciés à ce système sont d’un ordre de grandeur plus faible que pour les programmes privés. Ce programme public est en fait d’une extraordinaire efficacité, et les enquêtes ont montré qu'il est aussi très réactif aux demandes des usagers. Sa privatisation aboutirait à des profits plus élevés pour le secteur des services financiers et des prestations plus faibles pour les retraités américains. Les profits plus élevés se traduiraient probablement par une augmentation du PIB. Mais le bien-être des Américains en serait diminué, et les gains de l'industrie financière s’opèreraient au détriment des retraités. Le bien-être, défini de façon appropriée, déclinerait. Mais il est facile de voir comment les exercices aveugles de régressions inter-pays qui sont devenus à la mode concluraient qu'une telle privatisation serait bonne pour la « croissance ». 2. Usage et abus du concept de soutenabilité Nous pouvons surmonter ces problèmes importants liés à la mesure du bien-être. La Commission sur la Mesure de la Perfor- mance Économique et du Progrès Social a identifié un certain nombre de réformes nécessaires dans cette optique6. Certaines pourraient mener à une meilleure mesure du PIB – de sorte que
- 321. Nouvelles réflexions sur la mesure du progrès social et du bien-être 319 même si le PIB n'est pas une mesure du bien-être, il soit une meilleure mesure de ce qu'il tente de mesurer. En effet, les besoins de nos systèmes statistiques sont multiples, et une métrique qui est adaptée à un but donné peut être mal adaptée à un autre. On ajoute à la confusion quand une mesure adaptée à un objectif statistique précis est utilisée pour mettre en évidence un autre phénomène économique. Par exemple, le PIB n'est ni une mesure du revenu, ni une mesure du bien-être. Ce que nous voulons mesurer est donc la question clé. On peut vouloir mesurer avec le PIB, par exemple, les niveaux d'activité des marchés, un des objec- tifs initiaux de la mesure du revenu national. Mais de plus en plus se fait sentir une demande d’aller au-delà des mesures de l'activité des marchés vers de véritables mesures du bien-être. Et même avant la crise, on s'inquiétait de la question de la soutenabilité et du fait que nos mesures ne nous disaient rien quant à cet enjeu. C'est pourquoi certains réclament non pas d’améliorer la mesure du PIB, mais de mettre davantage l'accent sur d'autres indi- cateurs. Considérer le revenu (réel) de l'individu médian et non le PIB par habitant nous donnerait ainsi une meilleure image de ce qui arrive à l'individu typique dans une société. Avant la crise, beaucoup pensaient que les États-Unis avaient eu de bons résultats économiques. Mais s'ils avaient prêté attention au revenu médian, ils auraient vu que les revenus étaient stagnants ou en déclin – et ces mesures ne prennent même pas en compte la plus grande insé- curité sociale liée à la réduction de la couverture de l'assurance maladie et des retraites qui ont résulté des réformes régressives des prestations sociales dans les dernières décennies. Si nous tournons à présent le regard vers l’avenir, notre préoccu- pation est que le niveau de vie dont nous jouissons aujourd'hui soit au moins celui des générations futures. Nos systèmes statistiques devraient nous dire si oui ou non ce que nous faisons est soute- nable, économiquement, écologiquement, politiquement ou socialement. Il y a toute raison de croire que, au moins dans certaines dimensions, ce que nous faisons n'est pas soutenable, mais les statistiques actuelles ne reflètent pas ce fait, exactement 6. Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen and Jean Paul Fitoussi, Mis-measuring our lives, Why GDP does not add up, The New Press 2010.
- 322. 320 Jean-Paul Fitoussi et Joseph E. Stiglitz comme elles ont donné peu d'indications sur le caractère insoute- nable de la croissance économique américaine dans les années précédant la crise. Et pourtant il est capital pour toute société de former un juge- ment, si imparfait soit-il, sur le caractère soutenable de sa consommation ou de son bien-être actuels, si les deux sont acquis au détriment des générations futures. Nous pouvons savoir dans une certaine mesure si la richesse d'une société est croissante ou décroissante (par habitant). Si cette richesse, convenablement mesurée, est en augmentation, on peut présumer que la société pourra faire à l'avenir ce qu’elle fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu’elle poura maintenir son revenu par habitant. Mais nous avons besoin d'une mesure globale de la richesse, et nous devons être sûrs que les valorisations qu’elle implique sont correctes. Une telle mesure complète comprend évidemment des mesures de capital physique, de capital humain et social et de capital naturel. Des changements dans ce stock de capital découlent de l'investissement en usines et matériel, dans l'éducation et les institutions, et de l'épuisement des ressources naturelles, de la dépréciation du capital physique et de la dégradation de l'environnement. Parce que nous savons par exemple que ces prix ne reflètent pas les véritables coûts sociaux liés aux émissions de carbone et l’effet potentiel d'un changement majeur du prix du carbone sur celui de tous les autres actifs, nous sommes réticents à utiliser les prix du marché pour évaluer la soutenabilité environnementale, suggérant plutôt l'utilisation simultanée de mesures physiques de l’état des écosystèmes terrestres. Mais ce concept de soutenabilité a été utilisé de façon abusive dans la foulée de la crise financière. L'absence d'un indicateur de soutenabilité peut certainement nous conduire à un développe- ment insoutenable, mais une mesure partielle peut nous conduire aussi sûrement à des politiques erronées qui finiraient par mettre en péril la pérennité d'une économie. Prenons l’exemple de l'Europe. Partageant une monnaie commune dans une crise mondiale, les pays de la zone euro sont actuellement à la recherche d'indicateurs de soutenabilité afin d'évaluer leur viabilité finan- cière – par laquelle ils signifient essentiellement la viabilité de la dette publique de chaque pays membre. Ces pays tentent donc de définir des objectifs de soutenabilité, de mettre en œuvre des poli-
- 323. Nouvelles réflexions sur la mesure du progrès social et du bien-être 321 tiques économiques favorables à celle-ci et de diffuser ces informations aux marchés financiers afin de réduire la pression sur les emprunts des secteurs public et privé. Le problème est que les pays européens fondent leur démarche sur une vision très partielle de la soutenabilité, à savoir celle de la dette publique, qui les conduit à imposer aux pays périphériques de la zone euro des programmes d'austérité, c'est-à-dire dans les faits des politiques macroéconomiques pro-cycliques, qui vont très certainement conduire à un taux beaucoup plus faible de la croissance écono- mique et peuvent éventuellement aboutir à la non-soutenabilité financière tant du secteur public que privé. Autrement dit, quelle que soit la mesure de soutenabilité que nous concevons, nous devons reconnaître qu’elle sera fondée sur notre imparfaite connaissance présente de l'avenir. Inévitablement, les mesures sont partiellement issues de modèles : de nombreux indicateurs sur lesquels nous concentrons notre attention ne constituent pas une fin en soi, mais des variables intermédiaires d'intérêt parce qu'ils permettent de mieux comprendre les choses dont nous nous soucions vraiment. La rela- tion entre ces variables intermédiaires et les choses dont nous nous soucions vraiment sont souvent incertaines et dépendent du modèle que nous utilisons. Mais il y a beaucoup d'incertitude au sujet du « bon » modèle. Par exemple, avant la crise, beaucoup ont cru que tous les pays devaient, pour maintenir une croissance élevée et stable, avoir une inflation faible et stable. Dans la foulée de la crise, il y a désormais un large consensus pour dire que l'infla- tion faible et stable n'était certainement pas une condition suffisante de la stabilité économique. C’est parce que les conclu- sions qui prévalaient alors étaient elles-mêmes fondées sur des modèles erronés. Et ces modèles encourageaient les économistes à se concentrer sur une variable unique, l'inflation, comme indica- teur des perspectives d'avenir du pays. Nous savons maintenant qu'il aurait fallu mettre davantage l'accent sur les indicateurs de stabilité financière. De même, ceux qui soutiennent à présent un autre critère de viabilité économique, le ratio dette/PIB, en affirmant que celui-ci ne doit pas excéder un niveau donné (disons 80 %) faute de quoi l’économie ne sera pas soutenable, fondent cette conclusion sur un modèle. Or, compte tenu du niveau actuel de la richesse (publique
- 324. 322 Jean-Paul Fitoussi et Joseph E. Stiglitz et privée), même des niveaux plus élevés de dette pourraient bien être soutenables, s’il y a assez d’accélération du progrès technolo- gique. La Grèce n'est pas en faillite : elle est menacée de l'être. Le jugement des marchés financiers peut être une intuition ration- nelle de ce que sera l'avenir, mais ne peut prétendre être plus que cela, étant donné les chimères sur lesquelles reposent certaines évaluations du prix des actifs. Dans cette optique, il n’est pas indiqué, par exemple, de forcer la main au gouvernement de la Grèce pour qu’il privatise ses actifs publics pour réduire la dette du pays. Une vente au rabais aggraverait en fait le bilan financier de l’État grec. 3. Comment évaluer le bien-être ? Les membres de notre Commission étaient convaincus que le PIB ne fournit pas une bonne mesure du bien-être, même en mettant de côté la question de savoir si celui-ci était soutenable. Nous avons donc recommandé la construction de mesures larges du bien-être susceptibles de prendre en considération certains des facteurs les plus importants qui affectent le bien-être, exclus de la mesure du PIB, comme la cohésion sociale. Dans notre rapport, et dans la discussion entourant sa présenta- tion, nous avons ainsi souligné un autre aspect du débat sur la mesure : alors que de mauvaises mesures peuvent fausser les poli- tiques publiques, un dialogue autour de ce dont nous, en tant que société, nous soucions et le fait que ces préoccupations soient adéquatement reflétées dans nos statistiques, pourraient contribuer non seulement à une meilleure compréhension des limites de ces mesures statistiques mais à la formulation de meilleures politiques, plus attentives aux préoccupations et aux valeurs des citoyens. Nous croyons que ce dialogue est désormais lancé. Dans de nombreux pays, notamment en France, en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni, des mesures ont été prises pour mettre en œuvre certaines des recommandations de notre rapport (voir dans ce numéro l’article de Blanchet). L'exercice empirique le plus complet a été entrepris par l'OCDE, qui a publié en mai 2011 les premiers résultats de son initiative « Better Life ». Cet exercice témoigne de la volonté de l’OCDE de dialoguer avec la société civile en permet- tant à chacun de construire son propre indice global de qualité de
- 325. Nouvelles réflexions sur la mesure du progrès social et du bien-être 323 vie. 11 indicateurs ont été retenus pour les 34 pays de l'OCDE et certains pays émergents, selon les domaines identifiés dans notre rapport. Les citoyens sont invités à calculer leur propre indice en sélectionnant le poids de chacun dans le bien-être grâce à un outil Internet interactif. Dix déterminants considérés sont objectifs (santé, emploi, éducation, conditions de logement etc.), et un indicateur est subjectif, à savoir la satisfaction à l’égard de la vie, obtenu grâce à des enquêtes. De tels déterminants subjectifs du bien-être sont évidemment importants. Une longue tradition philosophique considère les individus comme les meilleurs juges de leurs propres conditions. Mais ceux-ci sont également soumis à une sorte de problème d’« incohérence temporelle », car ils peuvent évaluer leur situation (ou même un événement particulier) d'une manière diffé- rente à différentes périodes du temps. Certaines personnes peuvent répondre à l'instant même où ils élèvent leurs enfants que cette activité est douloureuse, tandis que lorsqu'on leur demande vingt ans après de porter un jugement sur cette époque, ils s’en souvien- nent comme la plus satisfaisante de leur vie. La manière d’interpréter et d’utiliser ces différents résultats dans la recherche sur la mesure du bien-être est l’objet de nombreux travaux en cours7. Nous espérons que non seulement cette recherche conduira à de meilleures mesures, mais aussi que l'enga- gement actif avec la société civile se traduira par des politiques qui visent à l'amélioration du bien-être sociétal, évalué non pas par la mesure imparfaite du PIB, mais par de nouveaux indicateurs. 4. Bien-être et cycles économiques Cette nécessaire perspective plus large sur la mesure du bien- être est non seulement pertinente pour évaluer les progrès à long terme des sociétés, mais aussi pour comprendre les fluctuations cycliques, telles que celles que beaucoup de pays du monde connaissent au moment où nous écrivons ces lignes. Ironique- ment, c'est précisément afin de comprendre les fluctuations 7. Pour des études plus anciennes, voir par exemple Sunstein, C. R., Kahneman, D., Schkade, D., & Ritov, I., « Predictably incoherent judgments ». Stanford Law Review, 54 , 1153-1215, 2002 ; et Kahneman, D., & Krueger, A.B., « Developments in the measurement of subjective well- being », Journal of Economic Perspectives, 20 , 3-24. 2006.
- 326. 324 Jean-Paul Fitoussi et Joseph E. Stiglitz cycliques que le PIB a été initialement développé. Nous avons noté qu’avant la crise la valeur du PIB a été exagérée. Mais on peut tout autant affirmer que pendant la crise, la perte de bien-être peut être sous-estimée. Le rapport initial de notre Commission a souligné l'importance de l'emploi à ce sujet. C’est un point d’accord parmi les partisans de diverses mesures subjectives du bien-être : le chômage a un effet très néfaste sur la qualité de vie des gens. Les individus qui deviennent chômeurs rendent compte d’une plus faible qualité de vie, même en tenant compte de leur plus faible revenu. Et les effets indésirables du chômage persistent au fil du temps. Les chômeurs signalent également une prévalence plus élevée des différents niveaux d’affects négatifs (tristesse, stress et douleur) et la baisse des pensées positives (joie). On peut aussi soupçonner que les effets néfastes du chômage sont ressentis même par ceux qui ne sont pas chômeurs, en particulier dans les sociétés où le chômage est élevé. Ces mesures subjectives indiquent que les coûts du chômage dépassent la perte de revenu subie par ceux qui perdent leur emploi, reflétant à la fois l'existence d'effets non pécuniaires parmi les chômeurs et d’angoisses générées par le chômage dans le reste de la société. Aux États-Unis, quelque sept millions de familles ont déjà perdu leur maison depuis le déclenchement de la crise immobilière et des millions d’autres leur emploi. Les deux phénomènes contribuent à des niveaux accrus d'anxiété, même parmi ceux qui sont encore employés et propriétaires de leur logement. La propriété d’un loge- ment affecte le sentiment d’appartenance sociale des individus et leur participation à la vie de la communauté, par exemple dans les écoles de leur quartier – et peut-être donc le bien-être futur de leurs enfants. Nous disposons également d’éléments empiriques sur le lien entre expulsion du logement et santé des individus8. Tout cela suggère que les fluctuations économiques peuvent avoir des effets asymétriques sur le bien-être – quelque chose que nous devrions intuitivement savoir. Par ailleurs, certaines des conséquences adverses (par exemple sur la santé et l'éducation) peuvent être irréversibles. L'utilisation répandue du PIB comme indicateur de résultats intermédiaires ne nous permet pas de 8. Voir par exemple Janet Currie et Erdal Tekin, « Health Consequences of the Foreclosure Crisis » avril 2011.
- 327. Nouvelles réflexions sur la mesure du progrès social et du bien-être 325 prendre explicitement en compte ces effets néfastes, non seule- ment sur le niveau actuel de bien-être, mais aussi sur le stock de capital humain. L'économie des cycles d'affaires devrait être repensée à la lumière des divergences probables entre la fluctuation de la production et celle du bien-être. Il se pourrait bien que la tâche des gouvernements soit de concevoir des politiques visant à minimiser davantage le taux de chômage et sa variation au cours du cycle économique plutôt que des politiques visant à maximiser la croissance de sortie (telle que mesurée par le PIB). Certains des instruments de ces deux stratégies peuvent être les mêmes – les préoccupations de l'emploi sont au cœur de la stratégie macroéco- nomique globale – mais la première stratégie doit assurément reposer sur des instruments spécifiques complémentaires pour lisser l'évolution du chômage. Les risques eux-mêmes peuvent être très asymétriques : une longue période de chômage élevé peut avoir des conséquences beaucoup plus élevées à long terme que celles qui pourraient résulter d'une économie en surchauffe. Par ailleurs, à la lumière des arguments qui précèdent, une telle stra- tégie améliorera certainement le bien-être, même si elle peut avoir quelques effets négatifs sur la croissance mesurée par le PIB9. La conception d'une bonne politique ne peut pas être fondée sur la séparation artificielle entre les politiques sociales et les politiques macro-économiques : si le bien-être des populations est la fin ultime, l’étude du marché du travail et de la répartition des revenus doit être un élément central de l'analyse macroéconomique soute- nant les politiques de stabilisation. 5. Au-delà du PIB : l'expérience du Bhoutan Il nous faut inclure dans nos développements un autre exemple actuel, celui du Bhoutan, dont la quête d’une meilleure mesure du bien-être a commencé bien avant le travail de notre Commission. Quelque quarante ans plus tôt, le roi d’alors décida que l'objectif collectif de cette nation ne serait pas de maximiser le PIB, mais le BNB, le Bonheur National Brut. Plutôt que de se tourner vers une 9. Il convient de souligner, toutefois, qu'il y a quelques raisons de croire que davantage d'accent mis sur la sécurité de l'emploi pourrait également améliorer non seulement le bien-être actuel, mais même la croissance, par exemple en facilitant des investissements plus importants dans le capital humain et une plus grande volonté de prendre des risques.
- 328. 326 Jean-Paul Fitoussi et Joseph E. Stiglitz agence de développement économique et de planification pour la formulation de stratégies de développement, le pays a établi une Commission du Bonheur National Brut. Il ne s’agissait pas de se payer de mots. Des questions ont alors été soulevées qui ne le sont généralement pas lorsque le seul but est d’augmenter le PIB : (a) Quel est l'impact de notre activité économique sur l'environne- ment ? (la couverture forestière a été développée, même si la coupe des forêts pouvait conduire, dans le court terme, à l'augmentation du PIB). (a) Quid du « capital social » (la cohésion sociale) ? Cet effet n’est pratiquement jamais pris en compte dans le calcul du PIB. Or la confiance dans le gouvernement peut permettre une meilleure conformité aux réglementations environnementales (sans lequel des restrictions sur la coupe des forêts serait très diffi- cile à appliquer) ou plus de réactivité aux efforts du gouvernement pour améliorer l'éducation et la santé des enfants – des actions qui conduiront presque certainement à améliorer le PIB à l'avenir mais dont les avantages n’apparaissent pas dans le PIB d’aujourd'hui. De ces débats dont on ne rend ici compte que très partiellement ont émergé une approche plus holistique du développement, qui considère celui-ci comme une transformation de la société, qui peut bénéficier des progrès liés à la modernisation (par exemple une plus grande alphabétisation, une plus grande participation politique, une meilleure santé), tout en conservant ses valeurs traditionnelles et son sentiment d'identité et de cohésion. Le déve- loppement est ainsi considéré comme plus que la simple accumulation de plusieurs facteurs de production ou une augmen- tation statique de la productivité. De nouvelles questions sont posées, et de nouvelles approches en découlent : comment favo- riser par exemple l'apprentissage entrepreneurial et sociétal ? L'ouverture des chantiers de construction pour une nouvelle école à tous les entrepreneurs, étrangers ou nationaux, pourrait conduire à une réduction des coûts dans le court terme – une apparente meilleure performance économique aujourd'hui. Mais encourager des constructeurs locaux à utiliser des matériaux locaux et des techniques et plans qui s’accordent aux préférences et aux valeurs locales et qui pourraient présenter un intérêt pour d'autres acti- vités de construction peut engendrer beaucoup plus de bénéfices à long terme.
- 329. Nouvelles réflexions sur la mesure du progrès social et du bien-être 327 Le Bhoutan est résolument engagé dans un processus de trans- formation sociétale, et donc, pour ce pays, il était impératif de réfléchir profondément aux directions dans lesquelles la société se transforme. Mais c’est l'ensemble de nos sociétés qui évoluent, même si cette évolution peut paraître lente. S'ils sont bien conçus, nos indicateurs peuvent nous donner de précieux renseignements sur le point où nous sommes, et, au fil du temps, nous fournir une image de l'endroit où nous allons. Ils peuvent nous donner des informations nous permettant d'évaluer si nous atteignons ou pas nos objectifs collectifs et, même si nous réussissons à les atteindre, si nous devons ou pas nous en donner de nouveaux, pour relever de nouveaux défis. Notre évaluation des mesures existantes de bien-être nous laisse convaincus que, trop souvent, elles ont conduit les pays à s’orienter dans de mauvaises directions, ou à tout le moins à adopter des politiques dont les bénéfices sont très discutables. Notre quête de meilleures mesures nous a également convaincus qu'il existe aujourd'hui des instruments disponibles qui pourraient mieux nous guider. Nos recherches montrent en somme qu'il existe des possibilités considérables d’améliorer les indicateurs de bien-être et d’en développer de nouveaux pour mieux servir les buts collectifs des sociétés humaines. Références bibliograpiques Easterly W., R. Islam, et J.E. Stiglitz, 2001a, « Shaken and Stirred: Explai- ning Growth Volatility », Annual Bank Conference on Development Economics 2000, Washington: World Bank, pp. 191-212. —— , —— et —— , 2001b, « Shaken and Stirred: Volatility and Macroeco- nomic Paradigms for Rich and Poor Countries », Advances in Macroeconomic Theory, Jacques Drèze, ed., IEA Conference, Volume 133, Houndsmill: Palgrave, 2001, pp. 353-372. —— , —— et —— , 2003, « Volatility and Macroeconomic Paradigms for Rich and Poor Countries », in Jacques H. Drèze, ed., Advances in Macroe- conomic Theory, Volume 1, Palgrave MacMillian, pp. 352-372. Fitoussi, J.-P., A. Sen et J.E. Stiglitz, 2009, Mismeasuring Our Lives: Why GDP Doesn’t Add Up, New York: The New Press. (Original report, 2009 ; New Press edition, 2010) Also available at http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/ en/index.htm (accessed May 16, 2011).
- 330. 328 Jean-Paul Fitoussi et Joseph E. Stiglitz Kahneman D., A. B. Krueger, D. Schkade, N. Schwarz, et A. Stone, 2002 : « Toward National Well-Being Accounts », American Economic Review, mai, pp. 429-434. Kahneman D., A. B. Krueger, 2006 : « Developments in the Measurement of Subjective Well-Being », Journal of Economic Perspectives, Volume 20, n° 1, pp. 3-24.
- 331. Réalisation, composition : Najette Moummi Dépôt légal : 4e trimestre 2011 Directeur de la Publication : Philippe Weil Imprimé en France
- 332. politiques ÉCONOMIE Débatset DU DÉVELOPPEMENT SOUTENABLE sous la direction d’Éloi Laurent La question écologique redessine les frontières des disciplines scientifiques. La physique et la chimie, la biologie et la géologie se rapprochent, s’articulent et s’intègrent en une science de la Terre (Earth science) dont l’étude en systèmes (Earth systems) monte en puissance dans les meilleures universités du monde. Ce savoir nouveau ne pourra toutefois se muer en une véritable science de la soutenabilité qu’avec le concours des sciences sociales et des humanités, qui elles-mêmes commencent à organiser leur dialogue méthodologique sur le terrain écologique. La question de la place de l’économie dans cette recomposition fondamentale est donc aujourd’hui posée. Cet ouvrage collectif entend, à sa mesure, contribuer à l’éclairer. Sous la direction d’Éloi Laurent avec les contributions de Céline Antonin, Michael Ash, Didier Blanchet, James Boyce, Gaël Callonnec, Jean-Paul Fitoussi, Olivier Godard, Éloi Laurent, Jacques Le Cacheux, Thomas Mélonio, Elinor Ostrom, Frédéric Reynès, Joseph Stiglitz, Xavier Timbeau et Yasser Yeddir-Tamsamani. Cet ouvrage est le premier de la série Débats et politiques de la Revue de l’OFCE. REVUE DE L’OFCE 120 (2011) www.ofce.sciences-po.fr f










![8 Éloi Laurent
conscience du problème écologique et plus celui-ci s’aggrave sous nos
yeux. « La crise de l'environnement est plus aiguë, plus intransigeante
et plus répandue que jamais, malgré des connaissances scientifiques
plus étendues que jamais »2. Trois hypothèses au moins sont conce-
vables pour envisager ce paradoxe : la première tient au simple effet de
qualité de nos instruments de mesure, qui nous informent bien mieux
qu’avant sur l’état réel de problèmes environnementaux trop long-
temps négligés ; la deuxième, moins évidente, tient à la distance qui
peut se former entre ce que nous savons et ce que nous croyons : selon
Jean-Pierre Dupuy3, si nous savons davantage que par le passé (que la
Nature est devenue vulnérable), nous ne croyons pas assez ce que
désormais nous sommes censés savoir ; la dernière hypothèse, privilé-
giée ici, est que nous ne savons pas encore tout ce que nous devrions
savoir, et notamment sur une question cruciale : comment réformer les
systèmes humains pour préserver les systèmes naturels ?
Car si les sciences naturelles et physiques nous alertent – en nous
signalant des zones d’incertitude encore importantes4 – sur la réalité
des crises écologiques, elles ne nous donnent pas les moyens de trans-
former les attitudes et les comportements dans les sociétés humaines,
sociétés responsables du changement environnemental planétaire,
comportements et attitudes seuls à même d’en infléchir le cours. Des
spécialistes des océans, sièges de ce qui s’annonce, en lien avec la dyna-
mique climatique, comme la plus grave crise environnementale de
notre temps, pointent précisément ce chaînon manquant dans le
savoir écologique : « Les moyens techniques pour parvenir à des solu-
tions pour nombre de ces problèmes [affectant les océans, en
particulier leur acidification] existent déjà, mais... les valeurs sociétales
actuelles empêchent l'humanité de les traiter efficacement. Surmonter
ces obstacles est au cœur des changements fondamentaux nécessaires
pour parvenir à un avenir soutenable et équitable ... »5.
En termes plus provocants, on pourrait dire que les sciences sociales
et les humanités détiennent, en matière environnementale, la clé des
solutions aux problèmes révélés par les sciences dures. D’où la néces-
saire articulation des deux domaines si l’écologie ne veut pas se résumer
2. Adger, W.N., K. Brown, , D. Conway, 2010. « Progress in global environmental change ».
Global Environmental Change 20(4), 547-549.
3. Jean-Pierre Dupuy, 2002, Pour un catastrophisme éclairé, Paris, Seuil.
4. Cette incertitude proprement scientifique ne justifie en rien le soi-disant « scepticisme »
dont font commerce un certain nombre de charlatans intéressés, en particulier au sujet du
changement climatique. On ne peut que déplorer que ces mêmes charlatans croient bon
d'embrigader le discours économique dans leur navrante croisade pour « l'écologie positive ».
5. Rogers, A.D. et d'A. D. Laffoley, 2011, International Earth system expert workshop on ocean
stresses and impacts. Summary report. IPSO, Oxford, 18 p.](https://image.slidesharecdn.com/ecodevlptsoutenable-111201042518-phpapp01/85/Economie-du-developpement-soutenable-10-320.jpg)









![18 Elinor Ostrom
décennies nous fournissent un meilleur fondement pour l'analyse
des politiques publiques. Après ce bref survol du propos qui va
suivre, entrons dans le vif de mon cheminement intellectuel.
1. Le monde d’avant : les systèmes simples
Au milieu du XXe siècle, l'effort scientifique prédominant consis-
tait à faire rentrer le monde dans des modèles simples et à critiquer
les arrangements institutionnels qui n’y correspondaient pas. Je vais
brièvement passer en revue les hypothèses de base qui ont été
formulées alors et ont été depuis contestées par des chercheurs du
monde entier, en particulier Simon (1955) et Ostrom (2008).
1.1. Deux formes optimales d’organisation
Le marché était considéré comme l'institution optimale pour la
production et l'échange de biens privés. Pour les biens non privés,
en revanche, « le » gouvernement devait imposer des règles et des
prélèvements à des individus égocentrés afin qu’ils lui procurent
les ressources nécessaires pour fonctionner et s’abstiennent de
comportements égoïstes. Sans un gouvernement hiérarchique
susceptible de les contraindre à respecter les règles communes, en
effet, les citoyens et les représentants de la force publique n’obéi-
raient qu’à leur intérêt propre et ne parviendraient pas à fournir en
quantité efficace les biens publics tels que la paix et la sécurité, et
ce à toutes les échelles de gouvernement (Hobbes [1651] 1960 ;
Wilson, 1885). On recommandait par exemple qu’une seule entité
gouvernementale se substitue à la structure « chaotique » de la
gouvernance métropolitaine, pour en accroître l'efficacité, limiter
les conflits entre les différentes structures de gouvernement et
servir au mieux une population considérée comme homogène
(Anderson et Weidner, 1950 ; Gulick, 1957; Friesema, 1966). Cette
vision dichotomique du monde permet de rendre compte des inte-
ractions et des résultats sur les marchés pour la production et
l'échange de biens strictement privés (Alchian, 1950), mais elle
n’explique pas de manière satisfaisante la dynamique interne aux
entreprises privées (Williamson, 1975, 1986). Pas plus qu’elle ne
permet de comprendre la grande diversité des arrangements insti-
tutionnels que les humains bâtissent pour gouverner, fournir et
gérer les biens publics et les ressources communes.](https://image.slidesharecdn.com/ecodevlptsoutenable-111201042518-phpapp01/85/Economie-du-developpement-soutenable-20-320.jpg)






![Par-delà les marchés et les États 25
3. Élaboration d'un cadre pour analyser la diversité
des situations humaines
La complexité et la diversité des paramètres de terrain que nous
avons étudiées a généré un effort soutenu des collègues associés au
Workshop in Political Theory and Policy Analysis (« l’Atelier » ci-
après) pour élaborer le cadre d’analyse ADI (Analyse et Développe-
ment institutionnels)1 (Ostrom, 1975 ; Kiser et Ostrom, 1982 ;
McGinnis, 1999a, b, 2000 ; Ostrom, 1986, 2005).
Ce cadre d’analyse contient un ensemble de composantes
imbriquées que les chercheurs en sciences sociales peuvent utiliser
dans leurs efforts pour comprendre les interactions humaines et
leurs résultats en fonction de diverses situations institutionnelles.
Le cadre ADI s'appuie sur des travaux antérieurs sur les transactions
( Commons, [1924] 1968), la logique de situation (Popper, 1961), les
structures collectives (Allport, 1962), les cadres relationnels (Irving
Goffman, 1974), et la théorie du script (Schank et Abelson, 1977).
L'approche s'inspire également de l'œuvre de Koestler (1973) et de
Simon (1981, 1995) qui ont tous deux contesté l'hypothèse selon
laquelle le comportement humain et ses résultats seraient entière-
ment fondés sur un petit ensemble de irréductibles composantes.
Alors que les termes cadres, théories et modèles sont utilisés de
manière interchangeable par de nombreux chercheurs, nous utili-
sons ces concepts de façon imbriquée pour aller du plus général au
plus précis dans nos hypothèses de recherche. Le cadre ADI est
destiné à contenir l’ensemble le plus général de variables que
l'analyste institutionnel peut vouloir utiliser pour étudier une
variété de milieux institutionnels, telles que les interactions
humaines sur les marchés, dans les entreprises privées, au sein des
familles, des organisations communautaires, des assemblées législa-
tives et des agences gouvernementales. Il fournit aux chercheurs un
langage métathéorique permettant de discuter toute théorie parti-
culière ou de comparer les théories entre elles. Une théorie
spécifique est utilisée par un analyste pour spécifier quelles parties
du cadre sont jugées utiles pour expliquer divers résultats et quels
sont leurs rapports. Les théories microsociales, dont la théorie des
jeux, la théorie microéconomique, la théorie des coûts de transac-
1. Institutional Analysis and Development (IAD).](https://image.slidesharecdn.com/ecodevlptsoutenable-111201042518-phpapp01/85/Economie-du-developpement-soutenable-27-320.jpg)







![Par-delà les marchés et les États 33
pées par les utilisateurs correspondent bel et bien à cette structure
(William Blomquist et al., 1994). Dans tous les systèmes auto-orga-
nisés, nous avons constaté que les utilisateurs avaient créé des
règles de limites, pour déterminer qui pourrait utiliser les
ressources, des règles de choix relatives à la répartition du flux des
unités de la ressource, et des formes actives de contrôle et de sanc-
tion décentralisée des contrevenants aux règles communes
(Ibid.: 301). Mais nous n'avons pas trouvé un seul cas où les usagers
utilisaient une stratégie de réplique dure (grim trigger) – une forme
de punition par laquelle les individus, selon de nombreuses études
théoriques, étaient censés résoudre le problème des dilemmes
répétés (Dutta, 1990: 264).
4.3. Les faisceaux de droits de propriété liés aux ressources
communes
Les économistes de l’environnement ont utilisé le terme de
« ressources de propriété commune » pour se référer aux pêcheries
et aux ressources en eau (Gordon, 1954; Scott 1955; Bell, 1972).
Associer ainsi le terme de « propriété » à celui de « ressource »
introduit une grande confusion entre la nature d'un bien et
l'absence ou la présence d'un régime de propriété (Ciriacy-Wantrup
et Bishop, 1975). Une ressource commune peut être détenue et
gérée comme une propriété du gouvernement, une propriété
privée, une propriété communautaire, ou n’être détenue par
personne (Bromley, 1986). Une autre raison de l'absence de
connaissances sur les systèmes de propriété locale développés par
les utilisateurs était que de nombreux chercheurs présumaient que
si les utilisateurs ne possédaient pas le droit d'aliénation de leur
ressource – le droit de vendre leur bien –, ils ne détenaient pas de
droits de propriété véritables (Alchian et Demsetz, 1973; Anderson
et Hill, 1990 ; Posner, 1975).
Schlager et Ostrom (1992) s’appuyèrent sur les travaux antéri-
eurs de Commons ([1924] 1968) pour imaginer des systèmes de
droits de propriété contenant des faisceaux de droits plutôt qu’un
seul droit. La méta-analyse des études de cas existante a permis
d'identifier cinq droits de propriété que les individus utilisant des
ressources communes peuvent posséder de manière cumulative :
(i) l'accès, le droit de prendre part à une propriété donnée6 ; (ii)
le retrait, le droit de prélever les produits spécifiques d'une](https://image.slidesharecdn.com/ecodevlptsoutenable-111201042518-phpapp01/85/Economie-du-developpement-soutenable-35-320.jpg)



































































![Pour une justice environnementale européenne 101
approche peuvent être datés de la rédaction de la Convention de la
CEE sur « l'accès à l'information, la participation du public au
processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environne-
ment », adoptée le 25 Juin 1998 à Aarhus, lors de la quatrième
Conférence ministérielle du processus « Un environnement pour
l'Europe », dite Convention d'Aarhus. L'article premier de cette
Convention « garantit les droits d'accès à l'information sur l'envi-
ronnement, de participation du public au processus décisionnel et
d'accès à la justice en matière d'environnement ».
Le courant de la justice environnementale s'est diffusé en
Europe par l'entremise des pays anglo-saxons et on en voit
aujourd'hui les prolongements les plus aboutis au Royaume-Uni et
en Ecosse. Deux discours ont marqué cette nouvelle orientation. Le
premier a été prononcé en 2002 par Jack McConnell, alors premier
ministre de l'Ecosse : « les gens qui sont le plus préoccupés par
l'environnement en Ecosse sont ceux qui, chaque jour, font face
aux conséquences d'une mauvaise qualité de vie, et vivent dans un
environnement malsain – à proximité de la pollution industrielle,
au contact des échappements des voitures et camions, dans des
rues remplies d'ordures et dont les murs sont couverts de
graffitis »2. Pour McConnell, dès lors que « combler l'écart en
matière de qualité de vie parmi les citoyens exige aussi la justice
environnementale », il fallait développer de nouvelles politiques
publiques pour répondre à cette exigence. Tony Blair reprit cette
idée dans un discours de 2003, faisant valoir que « c'est par l'éléva-
tion du niveau général de notre environnement local que nous
avons le plus grand impact sur les régions les plus pauvres »3.
Le pouvoir exécutif écossais définit en 2005 une nouvelle stra-
tégie de développement soutenable dans laquelle la justice
environnementale fut reconnue comme une priorité4, affirmant
l'idée que : « les communautés les plus démunies peuvent aussi être
plus vulnérables à la pression de médiocres conditions
environnementales » et « ne doivent pas assumer un fardeau [envi-
ronnemental] disproportionné ». La nouvelle stratégie britannique
de développement soutenable national, « Securing the future – deli-
2. McConnell (2002).
3. Pour de plus amples développements, voir Laurent (2011a) et Laurent (2011b).
4. Voir sur ce point la Section 8 de Choosing our future: Scotland's sustainable development
strategy, The Scottish Executive, Edinburgh, 2005.](https://image.slidesharecdn.com/ecodevlptsoutenable-111201042518-phpapp01/85/Economie-du-developpement-soutenable-103-320.jpg)
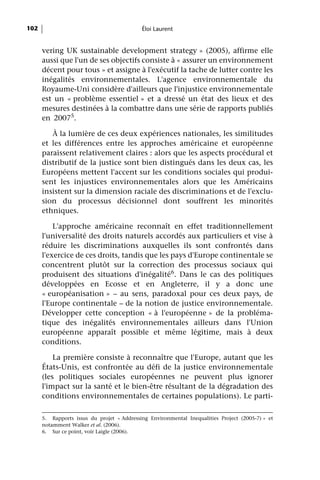

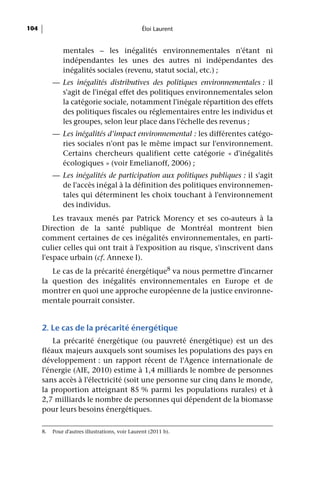






![Pour une justice environnementale européenne 111
tion thermique des logements privés géré par l'Agence nationale de
l'habitat vise 300 000 logements de propriétaires occupants
modestes et très modestes d'ici à 2017 et « l'éco-prêt logement
social », dont l'objet est la rénovation thermique du parc de loge-
ments sociaux les plus consommateurs en énergie, concernent
800 000 « logements énergivores »). Enfin, les tarifs sociaux de
l'énergie sont mal connus des bénéficiaires potentiels (En 2009,
940 000 foyers ont bénéficié de ces tarifs pour l'électricité alors que
2 millions sont éligibles et 298 000 en ont bénéficié pour le gaz
alors qu'un million sont éligibles). Beaucoup reste donc à faire en
France pour lutter contre ce fléau social-écologique dont on
commence seulement à prendre la mesure.
5. Quelle politique européenne ?
5.1. La question des indicateurs communs
Pour le programme de recherche European fuel Poverty and
Energy Efficiency (EPEE, 2005), une définition opératoire au niveau
de l'Union européenne consisterait à définir « la précarité énergé-
tique comme [touchant] un foyer qui éprouve des difficultés, voire
se trouve dans l'impossibilité, de chauffer correctement son loge-
ment à un prix raisonnable qui dépend de ses revenus ».
La Commission européenne (2010) propose pour sa part une
méthode quantitative à partir des données Household Budget
Survey (HBS) d'Eurostat. Il s'agit de comptabiliser pour les diffé-
rents pays de l'UE le nombre de ménages qui dépensent davantage
qu'un niveau donné de leur revenu en matière d'énergie, générale-
ment le double de la moyenne nationale. On obtient ainsi un
indicateur de « proportion des ménages dépensant une part consi-
dérable de leur revenu en énergie », comparable entre les différents
pays de l'UE (graphique 4).
Selon ces estimations14, il y aurait 27 millions de ménages euro-
péens (65 millions d'individus) dépensant de l'ordre du double de
la moyenne du pays dans lequel ils résident pour leur approvision-
nement en énergie, soit en moyenne 13 % des ménages des États
14. Qui fixent entre 7 % et 8 % la proportion en moyenne des dépenses en énergie des ménages
européens.](https://image.slidesharecdn.com/ecodevlptsoutenable-111201042518-phpapp01/85/Economie-du-developpement-soutenable-113-320.jpg)