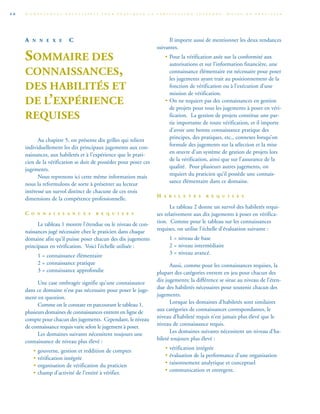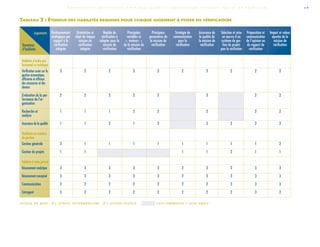La vérification intégrée
- 1. COMPÉTENCES NÉCESSAIRES pour PRATIQUER L A VÉRIFICATION INTÉGRÉE GUIDE DU PRATICIEN p a r E L A I N E M . M O R A S H E T W . D A V I D M O Y N A G H
- 2. Compétences nécessaires pour pratiquer la vérification intégrée. Guide du praticien © 1998 CCAF-FCVI Inc. Tous droits réservés. Aucune reproduction d’un extrait quel- conque de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, tant électronique que mécanique, en particulier par photocopie, microfilm, bande magnétique, disque ou autre, ne sera permise sans le consentement écrit de l’éditeur, CCAF-FCVI Inc. Publié par CCAF-FCVI Inc. 55, rue Murray, pièce 210 Ottawa CANADA K1N 5M3 (613) 241-6713 ISBN 0-919557-54-6 Imprimé et relié au Canada. Conception et mise en page : Paul Edwards Design Coordination de l’impression : Poirier Litho Traduction : Mme Nicole Plamondon, trad. a. Données de catalogage avant publication (Canada) Moynagh, W. David Compétences nécessaires pour pratiquer la vérification intégrée : guide du praticien Traduction de : Proficiency requirements for comprehensive auditing. Comprend des références bibliographiques. ISBN 0-919557-54-6 1. Vérification comptable. 2. Vérificateurs-comptables I. Morash, Elaine II. CCAF-FCVI Inc. III. Titre. HF5667.M6914 1998 657’.45 C98-900384-1
- 3. TABLE DES MATIÈRES A V A N T - P R O P O S .......................................................................................................................1 CHAPITRE 1 SOMMAIRE............................................................................................................................................................2 CHAPITRE 2 LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE, LE CONCEPT ...............................................................................................11 CHAPITRE 3 LE JUGEMENT PROFESSIONNEL EN VÉRIFICATION INTÉGRÉE .................................................................................14 CHAPITRE 4 COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE EN VÉRIFICATION INTÉGRÉE : CONNAISSANCES, HABILETÉS ET EXPÉRIENCE REQUISES ..19 CHAPITRE 5 CORRÉLATION ENTRE LES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES NÉCESSAIRES ET LES PRINCIPAUX JUGEMENTS EN VÉRIFICATION ..25 CHAPITRE 6 QUESTIONS CONNEXES .......................................................................................................................................36 CHAPITRE 7 CONCLUSIONS ....................................................................................................................................................38 A N N E X E S ......................................................................................................................................41 ANNEXE A HISTORIQUE DU PROJET DE RECHERCHE .............................................................................................................42 ANNEXE B DESCRIPTION D’UNE SÉANCE REMUE-MÉNINGES TYPE..........................................................................................46 ANNEXE C SOMMAIRE DES CONNAISSANCES, DES HABILETÉS ET DE L’EXPÉRIENCE REQUISES...................................................47 ANNEXE D INITIATIVES CONNEXES CONCERNANT LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE...........................................................52 ANNEXE E PERSONNES QUI ONT CONTRIBUÉ AU PROJET DE RECHERCHE ..............................................................................59 ANNEXE F BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE ..................................................................................................................................62 ANNEXE G DOCUMENTATION DE BASE .................................................................................................................................64 C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N
- 4. « UNE VÉRIFICATION NE PEUT ÊTRE MEILLEURE QUE LES PERSONNES QUI L’EFFECTUENT. » R E D D I T I O N D E C O M P T E S , R A P P O R T S S U R L A P E R F O R M A N C E E T V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E U N E V U E D ’ E N S E M B L E , F C V I , 1 9 9 6
- 5. AVANT-PROPOS C’est avec grand plaisir que la Fondation publie cet ouvrage qui offre aux praticiens ainsi qu’aux bureaux et organisations de vérification des conseils sur les com- pétences requises pour pratiquer la vérification intégrée. Avec l’évolution de la discipline de la vérification intégrée, l’interaction des praticiens avec les gestion- naires et les dirigeants ainsi que la contribution de cette forme de vérification à l’environnement de gouverne et de reddition de comptes, on constate que la question des compétences professionnelles du praticien revêt une importance particulière. Il est dans l’intérêt des praticiens, tout autant que des décideurs qu’ils secondent, d’en arriver à un consen- sus sur les compétences de base que l’on requiert du praticien en vérification intégrée. De telles exigences constituent d’importantes balises que peut utiliser la profession pour se bâtir une équipe de professionnels et pour s’assurer qu’elle offre à ses clients des services et des produits de plus en plus adaptés et utiles. D’autre part, ces exigences permettent à sa clientèle d’obtenir une assurance quant à la qualité du service et du pro- duit reçus. L’établissement d’une telle base constitue un élément essentiel de la prestation de tout service profes- sionnel. En partant des principaux éléments sur lesquels le praticien est appelé à poser un jugement professionnel, l’étude examine la nature, l’éventail et la combinaison des connaissances, des habiletés et de l’expérience requi- ses chez le praticien pour qu’il soit à même de poser ces jugements. La vérification intégrée connaît une évolution constante, et l’environnement de gouverne et de reddi- tion de comptes est en pleine transformation lui aussi. Tout comme la publication de 1984, Un guide sur ce que le praticien doit savoir pour effectuer des vérifications intégrées, le présent ouvrage se veut un document « vivant », c’est-à-dire un document qu’on modifiera et élargira selon les besoins. Ce projet de recherche n’aurait pu voir le jour sans la contribution de plusieurs douzaines de professionnels chevronnés qui, à diverses étapes du processus, ont donné généreusement de leur temps, de leurs conseils et de leur expérience. Il s’agit de vérificateurs législatifs, de vérificateurs internes, d’experts-comptables et de conseillers en administration, d’universitaires et de bien d’autres. Nous en avons dressé la liste à l’annexe E. M. Hugh R. Hanson a révisé la version anglaise du rapport, Mme Nicole Plamondon est responsable de sa traduction française, et Mme Suzanne Seebach ainsi que MM. Paul Edwards et Bernard Poirier en ont assuré la conception graphique et la production. La Fondation tient à remercier ces personnes, et en particulier le Bureau du vérificateur général de la Nouvelle-Écosse pour la contribution des services de Mme Elaine M. Morash, CA, comme membre de l’équipe de recherche. La FCVI tient tout spécialement à exprimer sa reconnaissance à Mme Morash, qui a tra- vaillé en étroite collaboration avec le directeur de recherche de la FCVI, W. David Moynagh. Nous espérons que cette publication aidera les bureaux et les organisations de vérification ainsi que tout praticien à évaluer leur propre situation et à pren- dre les mesures qui s’imposent pour améliorer leur com- pétence professionnelle. C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N 1
- 6. C H A P I T R E 1 SOMMAIRE I N T R O D U C T I O N Ce chapitre offre un survol des principaux résultats de l’étude menée par la FCVI sur la compétence profes- sionnelle en vérification intégrée. Les idées proposées ici découlent d’un processus consultatif impliquant un vaste éventail de praticiens chefs de file : vérificateurs législa- tifs, vérificateurs internes, experts-comptables, conseillers en gestion, universitaires et bien d’autres. L’objectif du présent rapport consiste à jeter des bases actuelles, intégrées et pratiques, permettant d’examiner les compétences qu’exigent les éléments essentiels d’une vérification intégrée – les principaux jugements professionnels —, et d’en acquérir une meilleure compréhension. Nous n’offrons pas de formule ni de modèle absolu. Cependant, nous abordons le sujet selon une nouvelle perspective. En se concentrant sur l’exercice du jugement professionnel et en incluant l’expérience comme dimension explicite de la compétence profes- sionnelle, le rapport se distingue du travail déjà accom- pli pour traiter de cette question complexe, et il se veut un complément aux ouvrages existants. Nous y traçons les grandes lignes d’une série de concepts, de cadres de travail et d’outils interreliés que les praticiens ainsi que les bureaux peuvent adapter et utiliser pour évaluer leurs besoins et, le cas échéant, pour prendre les mesures qui s’imposent afin de soutenir, d’élargir ou d’améliorer leur compétence professionnelle en vérifica- tion intégrée. HI S TO R I Q U E En 1984, la FCVI a publié le document Un guide sur ce que le praticien doit savoir pour effectuer des vérifi- cations intégrées. À l’époque, la vérification intégrée était considérée comme un art et une science très jeunes. Néanmoins, tant les décideurs que les praticiens de la vérification ont reconnu la nécessité de com- mencer à documenter les domaines de connaissances qui s’avéraient nécessaires pour ceux qui effectuaient la vérification intégrée, ou qui participaient à ce genre de travail. Le guide précité se voulait une première étape dans un processus visant à décrire cet ensemble de con- naissances, tout en admettant que, avec l’évolution de la pratique, les exigences connexes en matière de connais- sances évolueraient également. Depuis la publication du document de 1984, qua- torze années d’expérience additionnelles ont été accu- mulées en vérification intégrée. De nombreux changements sont survenus durant cette période et ce, au fur et à mesure que s’élargissait considérablement l’éventail des questions sur lesquelles portait la vérifica- tion intégrée, que de nouvelles approches de vérification voyaient le jour, et que les attentes face à la vérification devenaient plus exigeantes et plus précises. Dans cette atmosphère généralisée de change- ments, les vérificateurs ont cerné plusieurs problèmes avec lesquels leurs organisations doivent composer, problèmes qui sont aggravés par le fait qu’on n’a pas encore défini clairement les compétences profession- nelles requises des praticiens de la vérification intégrée. Il s’agit notamment : • de la remise en cause par le public des compé- tences du praticien de la vérification intégrée • du virage anticipé vers l’attestation des déclara- tions de la direction, et de la conviction que cela mettra davantage l’accent sur la preuve de la com- pétence professionnelle • de l’augmentation du nombre de membres du personnel ayant une formation autre qu’en comptabilité ou en vérification, et de la nécessité de définir les connaissances et les habiletés que doivent posséder ces individus • de la restriction des budgets de formation en rai- son des contraintes financières, et du désir d’utiliser avec sagesse les fonds disponibles. Depuis quelques années, on constate également une évolution importante dans l’environnement de gouverne, de prise de décision et de reddition de comptes dans lequel se pratique la vérification intégrée. Les membres des instances gouvernantes et les cadres dirigeants sont appelés à prendre des décisions de plus en plus difficiles et ce, sous la surveillance constante du public. Pour prendre et pour justifier ces décisions, instances gouver- nantes et dirigeants doivent disposer d’une information qui porte sur plusieurs aspects de la performance d’une organisation. Et, c’est dans ce contexte que le travail du praticien de la vérification intégrée a pris une importance croissante – soit en tant que fournisseur d’information, C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N2
- 7. soit en tant que certificateur indépendant de la justesse de l’information et de son exhaustivité. À la lumière de cette évolution, il faut se pencher sur les considérations suivantes : • ce que signifie cette évolution pour les compé- tences nécessaires à la pratique de la vérification intégrée • ce qu’il faut maintenant établir ou préciser • si la pratique de vérification intégrée a atteint un stade où les praticiens sont prêts à s’engager dans cette question, et en sont capables, avec un degré approprié d’introspection, de confiance et de con- sensus. Le présent projet de recherche a donc été entrepris pour répondre à cette évolution et à ces considérations, et pour poursuivre un aspect crucial du mandat continu de la FCVI – « de repousser les limites de la pratique de la vérification intégrée et d’appuyer ses praticiens ». Il est étroitement lié à deux autres initiatives clés de la FCVI. L’une est la consolidation des connaissances en vérification intégrée, publiée en 1996 sous le titre Reddition de comptes, rapports sur la performance et vérification intégrée. Une vue d’ensemble; l’autre est la refonte, entreprise en 1996–1997, du programme et des activités de formation et de perfectionnement de la FCVI. LA M I S E E N C O N T E X T E À P R O P O S D E L A T E R M I N O LO G I E Nous utilisons l’expression « vérification inté- grée », définie dans la documentation de la FCVI comme un concept plutôt que comme une technique. Plus précisément, ce concept englobe les trois aspects connexes de la reddition de comptes : la présentation de l’information financière; la conformité aux autorisa- tions; et la gestion économique, efficiente et efficace des ressources et des deniers. La vérification financière et la vérification de conformité étant des processus bien éta- blis depuis des années, l’expression « vérification inté- grée » est souvent utilisée pour désigner le troisième (et le plus récent) volet qui porte sur les questions de performance générale. Nous avons adopté cet usage dans le présent rapport. De plus, comme nous l’expliquons ci-dessous, par l’expression « vérification intégrée », nous désignons trois méthodes de vérification : celle axée sur les sys- tèmes et les pratiques de gestion, celle axée sur la per- formance, et celle axée sur l’attestation des déclarations de la direction sur la performance. SI T U E R L A V É R I F I C AT I O N I N T É G R É E Dans leur travail, les praticiens sont appelés à composer avec différentes responsabilités et fonctions, dont la vérification intégrée. Comme l’indique le graphique à la figure 1, les responsabilités du praticien peuvent aussi s’étendre à d’autres formes de vérification (comme la vérification de conformité et la vérification financière), au rôle de conseiller, et à toute une gamme de questions touchant la gestion et l’administration de son organisation. La présente étude se concentre sur la vérification intégrée et sur les compétences nécessaires pour la prati- quer. C’est donc dans ce contexte qu’il faudra inter- préter les résultats de cette recherche. FI G U R E 1 C H A P I T R E 1 : S O M M A I R E 3 ConsultationConsultation Vérification intégrée Autre type de vérificationAutre type de vérification Questions de gestionQuestions de gestion
- 8. ST R U C T U R E D U R A P P O RT Le présent rapport comporte six chapitres et sept annexes. Le chapitre 2 présente un aperçu du concept de « compétence professionnelle » tel qu’utilisé dans le contexte de notre étude. On y décrit la compétence en termes de trois dimensions interreliées – connaissances, habiletés et expérience. Le chapitre 3 porte sur le concept de « jugement pro- fessionnel », et plus précisément sur les principaux juge- ments que porte le vérificateur et qui constituent la base de la discussion ultérieure sur la compétence professionnelle. Nous y avons relevé et décrit dix jugements principaux que doit poser le praticien de la vérification intégrée dans le cadre de son travail. Au chapitre 4, nous abordons la ques- tion des exigences quant aux connaissances, aux habiletés et à l’expérience qui se rapportent à la pratique de la vérifica- tion intégrée et à ces principaux jugements. Nous mettons l’accent non seulement sur les catégories ou domaines de connaissances, d’habiletés et d’expérience requises, mais aussi sur leurs aspects qualitatifs. Le chapitre 5 contient une série de grilles qui relient individuellement les dix principaux jugements aux connaissances, aux habiletés et à l’expérience que le praticien de la vérification intégrée se doit de posséder pour poser ces jugements. Le chapitre 6 souligne les observations faites au cours de l’étude sur deux questions auxiliaires de recherche. Dans quelle mesure les jugements à poser en vérification et les compétences professionnelles requises pour y arriver dif- fèrent-ils pour le vérificateur externe et pour le vérificateur interne ? Et, quel rôle le spécialiste est-il appelé à jouer en ce qui concerne les principaux jugements professionnels qui caractérisent la pratique de la vérification intégrée ? Au chapitre 7, nous traçons les grandes lignes des conclusions émergeant de la recherche et expliquons la façon dont les praticiens et leurs bureaux peuvent utiliser les résultats de recherche comme base pour éva- luer et améliorer leur compétence professionnelle. À l’annexe A, nous donnons l’historique du projet de recherche. Nous y résumons le travail qui a mené au projet, le thème principal de ce dernier et l’approche adoptée pour effectuer l’étude. À l’annexe B, nous décrivons une séance remue-méninges type. Ces discus- sions de groupes ont constitué la principale composante de l’étude. En reprenant l’information présentée au chapitre 5 et en la reformulant, nous résumons à l’annexe C les connaissances, les habiletés et l’expérience requises par rapport aux dix jugements clés à porter en vérification. L’annexe D résume les initiatives connexes lancées dans le domaine des compétences professionnelles, par la FCVI, les organismes professionnels de comptabilité et de vérification, diverses organisations, et bien d’autres, tant au Canada qu’à l’étranger. À l’annexe E, nous dressons la liste de tous les partic- ipants aux diverses étapes du projet depuis le travail pré- liminaire – plus de quatre-vingt-dix personnes en tout. À l’annexe F, nous présentons une bibliographie sommaire des publications examinées et analysées durant l’étape d’examen de la documentation du projet de recherche. Comme nous le mentionnons à l’annexe G, vous pouvez obtenir un exemplaire du document de référence synthétisant les résultats de cette analyse docu- mentaire auprès de la FCVI. L E P R O J E T D E R E C H E R C H E Comme nous l’avons signalé précédemment, le projet trouve ses fondements dans le travail déjà effec- tué par la FCVI : le guide sur les compétences profes- sionnelles publié en 1984 et le manuel de 1996 intitulé Reddition de comptes, rapports sur la performance et véri- fication intégrée. Une vue d’ensemble. Dans la mesure du possible, nous avons aussi tiré profit du vaste éven- tail de travaux effectués par d’autres organisations et organismes professionnels : recherches, documentation et initiatives connexes. (L’annexe D présente un survol de ces dernières.) La portée et le thème principal de ce projet de recherche ont été élaborés, discutés et retravaillés au cours d’une série d’ateliers spéciaux, de séances du congrès de la FCVI et de réunions des comités de recherche et de gou- verne. Ces activités se sont déroulées de 1993 à 1995. DÉ C I S I O N S I N I T I A L E S S E RVA N T D E F O N D E M E N T S Les décisions initiales suivantes se sont dégagées de ces premières consultations et elles ont servi de fondements au projet de recherche. • Adopter la définition suivante de la vérification : La vérification renforce les liens de responsabilité qui découlent de l’obligation de rendre compte. C’est une évaluation des systèmes et pratiques de gestion, ou une C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N4
- 9. évaluation des déclarations de la direction en matière de performance qui permet de déterminer la fidélité de l’information communiquée, ou encore une éva- luation de la performance globale. L’évaluation doit être indépendante, objective, fondée sur des critères et destinée à l’instance gouvernante ou à tout autre intervenant investi de responsabilités semblables. • Ne pas limiter la recherche à la question des « connaissances » que doit posséder le praticien. Il faut aussi se pencher sur les « habiletés » et sur l’« expérience », deux dimensions qui, avec les connaissances, constituent la notion de « compé- tence professionnelle ». • Se concentrer d’abord sur les principaux juge- ments que le praticien est appelé à poser dans le cadre de la vérification intégrée. • Aborder la question de la compétence profession- nelle de manière à faciliter l’utilisation des résul- tats dans une variété de contextes professionnels. MÉ T H O D E D E R E C H E R C H E Les deux principales composantes de l’approche adoptée pour mener à bien ce projet ont consisté en : • une revue et une analyse de la documentation, dont le travail connexe effectué par d’autres • des consultations auprès d’un vaste éventail de praticiens chefs de file, issus des principaux secteurs de la pratique de la vérification intégrée, dont : des vérificateurs législatifs, des vérificateurs internes, des experts-comptables, des conseillers en gestion, des universitaires. Dans la plupart des cas, ces consultations se sont déroulées sous forme de symposiums remue-méninges. En tout, huit de ces rencontres, auxquelles quatre-vingts prati- ciens chevronnés ont participé, ont eu lieu à travers le pays. L E C O N C E P T D E « C O M P É T E N C E P R O F E S S I O N N E L L E » Le concept de « compétence professionnelle », tel qu’utilisé dans le présent rapport, englobe trois dimen- sions interreliées : les connaissances, les habiletés et l’expérience. Il n’inclut pas un examen des aptitudes de base et des caractéristiques ou traits personnels des indi- vidus appelés à effectuer de la vérification intégrée, tenant pour acquis que la « matière première » néces- saire pour devenir un vérificateur efficace est déjà présente. Ces attributs personnels, que Spencer & Spencer appellent les « compétences essentielles1 », sont particulièrement importants pour l’élaboration des stratégies de recrutement – principale préoccupation dans le domaine de la vérification, mais sur laquelle le présent rapport de recherche ne se concentre pas. Ce projet de recherche innove en traitant l’expé- rience comme une dimension explicite de la compé- tence professionnelle. Généralement parlant, les autres initiatives lancées dans ce domaine ont soit omis d’aborder cette dimension, ou bien l’ont traitée de façon implicite seulement. Au chapitre 2, nous expliquons le concept de « compétence professionnelle » plus en détail. S O M M A I R E D E S R É S U L T A T S D E L A R E C H E R C H E JU G E M E N T P R O F E S S I O N N E L E N V É R I F I C AT I O N I N T É G R É E Chaque facette du travail du praticien exige que ce dernier fasse preuve de jugement professionnel. Cependant, certaines décisions qu’il prend au sujet soit de l’orientation de la fonction de vérification intégrée, soit d’une mission particulière de vérification intégrée, revêtent une telle importance qu’elles auront un effet profond et déterminant sur la qualité du processus de vérification, sur le produit qui en découle, ainsi que sur la considération donnée à ce produit et sur son utilisa- tion. Ce sont ces principaux jugements qui ont servi de point de départ à notre recherche. CA D R E D E T R AVA I L S U R L E S P R I N C I PA U X J U G E M E N T S Quels sont les principaux points sur lesquels le vérificateur est appelé à poser un jugement profession- nel dans le cadre d’une vérification ? Voilà la première question citée dans le mandat du projet de recherche; c’est aussi la première question posée aux personnes consultées durant l’étude. Pour arriver à répondre à cette question, il a fallu tout un processus de formulation et de raffinement qui s’est échelonné sur plusieurs mois de discussions avec quelques douzaines de praticiens chevronnés. À partir des travaux faits pendant les symposiums remue-méninges, des discussions de l’équipe de C H A P I T R E 1 : S O M M A I R E 5 1 LYLE M. SPENCER & SIGNE M. SPENCER, COMPETENCE AT WORK : MODELS FOR SUPERIOR PERFORMANCE, CANADA, JOHN WILEY & SONS LTD., 1993, P. 11-12.
- 10. recherche et de l’examen de la documentation, on a dégagé les dix « jugements » clés suivants que le prati- cien est appelé à poser en vérification. • le positionnement stratégique du bureau ou de la fonction de vérification par rapport à la vérifica- tion intégrée • l’orientation et l’objet de chaque mission de vérifi- cation • le modèle de vérification à adopter pour la mis- sion de vérification • les principales variables et les « moteurs » de la mission de vérification : les trois notions interre- liées d’ « étendue », d’ « importance relative » et de « degré de certitude à offrir » • les principaux paramètres de la mission de vérifica- tion : les critères de vérification, les éléments probants, l’utilisation du travail d’un autre vérifica- teur ou examinateur, les procédés de vérification • la stratégie de communication pour la mission de vérification • l’assurance de la qualité de la mission de vérification; • la sélection et la mise en œuvre d’un système de gestion de projets approprié pour la mission de vérification • la préparation et la communication de l’opinion ou du rapport de vérification intégrée • l’impact et la valeur ajoutée de la mission de véri- fication. Au chapitre 3, nous expliquons chacun de ces points. QU I P O S E C E S J U G E M E N T S P R O F E S S I O N N E L S ? Nous nous sommes concentrés sur le praticien individuel et sur les principaux jugements qu’il est appelé à porter dans le cadre de son travail. Les discus- sions tenues durant les séances remue-méninges indiquent que bien souvent ces jugements sont posés par des praticiens exerçant leur profession à des éche- lons différents et jouant des rôles distincts au sein de l’organisation de vérification et que ces praticiens sont appuyés par un processus de consultation auquel peu- vent participer, selon les circonstances, d’autres mem- bres de l’équipe de vérification ou des spécialistes possédant une expertise relativement à certains aspects des éléments visés par la mission. Occasionnellement, une discussion préliminaire avec un supérieur au sein de l’organisation de vérification peut aussi avoir lieu avant que le jugement soit porté. Il faut souligner le rôle crucial que jouent les membres de l’équipe et les spécialistes. Premièrement, ils contribuent par leurs connaissances et leur expertise à la formulation initiale du jugement. Deuxièmement, ils effectuent le travail de vérification conformément au jugement porté. Et troisièmement, lorsque le travail de vérification signale la nécessité de revoir les postulats sur lesquels repose le jugement initial, ils doivent prendre une décision importante, à savoir quand et comment porter cette situation à l’attention des autres pour que le jugement soit réexaminé. En fin de compte, toutefois, c’est toujours à un seul praticien que revient la tâche de porter un ou plusieurs de ces jugements cruciaux. CO N N A I S S A N C E S R E Q U I S E S Par « connaissances », on entend la somme des informations qu’une personne possède dans une matière donnée. Il est important de noter que les connaissances s’acquièrent de plusieurs façons – par un programme d’études ou de formation, l’apprentissage auprès d’autres personnes, et l’expérience de travail en vérifica- tion intégrée et autres types de vérification, dans dif- férents champs d’activité et dans le bénévolat. CA D R E R É F É R E N T I E L S U R L E S C O N N A I S S A N C E S R E Q U I S E S On a cerné treize catégories ou domaines de con- naissances se rapportant aux principaux jugements à poser en vérification intégrée. La nature et l’étendue des connaissances que doit posséder le praticien en véri- fication intégrée, ou connaissances auxquelles il doit avoir accès, dépendent du ou des jugements particuliers qu’il est appelé à porter. Si le praticien doit faire appel aux connaissances – ou encore aux habiletés ou à l’ex- périence – d’un spécialiste pour poser son jugement, il se doit de posséder une connaissance de base suffisante en la matière pour être en mesure d’évaluer et d’utiliser efficacement le travail de ce dernier. Voici les domaines de connaissances relevés : • gouverne, gestion et reddition de comptes • performance • systèmes et pratiques de gestion • contrôle • vérification axée sur la gestion économique, effi- ciente et efficace des ressources et des deniers (c.- à-d. la vérification intégrée) • vérification axée sur la conformité aux autorisa- C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N6
- 11. tions et sur l’information financière • organisation de vérification du praticien • champs d’activité de l’entité à vérifier • science du comportement • disciplines connexes • recherche et analyse • gestion de projets • assurance de la qualité. Une fois les domaines de connaissances définis, il est utile de déterminer l’étendue des connaissances requises. À cet égard, trois niveaux ont été établis : • connaissance élémentaire • connaissance pratique • connaissance approfondie. Au chapitre 4, nous expliquons chacun de ces domaines et niveaux. HA B I L E T É S R E Q U I S E S Par « habileté », on entend la capacité du praticien à effectuer une tâche physique ou intellectuelle. CA D R E R É F É R E N T I E L S U R L E S H A B I L E T É S R E Q U I S E S Les recherches et les consultations menées nous ont permis de dégager les dix domaines d’habiletés sui- vants se rapportant aux principaux jugements à porter en vérification intégrée. La nature et l’étendue des habiletés que doit posséder le praticien en vérification intégrée, ou habiletés auxquelles il doit avoir accès, dépendent du ou des jugements particuliers qu’il est appelé à poser ou à soutenir. Nous avons ensuite regroupé ces domaines en trois catégories : habiletés d’ordre professionnel ou technique, habiletés en matière de gestion et habiletés d’ordre général. Habiletés d’ordre professionnel ou technique Ces habiletés incluent la capacité d’appliquer les concepts, les principes, les méthodes et les techniques de : • vérification axée sur la gestion économique, effi- ciente et efficace des ressources et des deniers (c.-à-d. la vérification intégrée) • évaluation de la performance d’une organisation • recherche et analyse • assurance de la qualité. Habiletés en matière de gestion • gestion générale • gestion de projets Habiletés d’ordre général • raisonnement analytique • raisonnement conceptuel • communication • entregent Comme pour la dimension « connaissances », nous avons établi les trois niveaux suivants concernant l’étendue des habiletés : • niveau de base • niveau intermédiaire • niveau avancé. Au chapitre 4, nous expliquons chacun de ces domaines et niveaux d’habiletés. EX P É R I E N C E R E Q U I S E Par « expérience », on entend la mise en applica- tion par le praticien de ses connaissances et de ses habiletés dans l’exercice de sa profession. CA D R E R É F É R E N T I E L S U R L’E X P É R I E N C E R E Q U I S E Dans son rapport de 1986 concernant l’enquête sur l’effondrement de la CCB et de la Northern Bank, le juge Willard Estey, commentant sur la vérification, a précisé trois facteurs qu’il estime pertinents pour définir l’expérience du vérificateur : le nombre d’années d’expérience en vérification ou l’étendue de l’expérience acquise, l’échelon de responsabilité auquel cette expé- rience a été acquise et enfin le contexte dans lequel elle l’a été (qui, dans ce cas-ci, signifiait une expérience acquise dans l’industrie bancaire ou auprès d’institu- tions financières de dépôt). En se basant sur le raisonnement du juge Estey, il importe de tenir compte de quatre aspects de l’expé- rience : la nature, le rôle, l’étendue et le contexte. Le fait qu’il existe moins de catégories pour cette dimen- sion que pour les « connaissances » et « habiletés » ne signifie aucunement que l’expérience constitue la dimension la moins importante de la compétence pro- fessionnelle. Au contraire, comme un des participants aux séances remue-méninges nous l’a signalé, « c’est souvent l’expérience qui fait toute la différence ». C H A P I T R E 1 : S O M M A I R E 7
- 12. Voici trois autres aspects de l’expérience qu’il faut considérer : Rôle • expérience acquise en tant que membre d’équipe • expérience acquise en tant que chef de projet • expérience acquise en tant que dirigeant Étendue • une « certaine » expérience qui, dans notre propos, se comptabilise à « moins de 2 ans » d’expérience • une expérience « significative » qui, dans notre propos, se comptabilise à « entre 2 et 4 ans » d’expérience • une « vaste » expérience qui, dans notre propos, se comptabilise à un « minimum de 5 ans » d’expé- rience. Contexte • Il s’agit ici de déterminer s’il est nécessaire ou non pour le praticien de posséder une expérience dans la vérification d’entités exerçant leurs activités dans le même domaine ou dans un domaine similaire. Une fois de plus, comme nous l’avons mentionné pour les dimensions « connaissances » et « habiletés », le type d’expérience que doit posséder le praticien en véri- fication intégrée, ou l’expérience à laquelle il doit avoir accès, dépend du ou des jugements particuliers qu’il est appelé à poser. Au chapitre 4, nous expliquons ces aspects de l’ex- périence. C O R R É L A T I O N E N T R E L E S J U G E M E N T S E T L A C O M P É T E N C E R E Q U I S E Le chapitre 5 présente une série de grilles illus- trant les liens entre les principaux jugements d’une part et les connaissances, les habiletés et l’expérience requises d’autre part. En ce qui concerne les connaissances requises, lorsqu’on regarde tous les points sur lesquels le praticien a un jugement professionnel à poser, ce sont les domaines de connaissances suivants qui doivent retenir le plus l’attention : • la gouverne, la gestion et la reddition de comptes : les concepts, les théories, les principes, les nou- velles façons de penser et les progrès, etc. • la vérification intégrée : les concepts, les théories, les principes, l’éthique, les nouvelles façons de penser, les progrès, etc. • l’organisation de vérification du praticien : l’envi- ronnement, le mandat, la philosophie, les straté- gies, les politiques, etc. • l’entité à vérifier : le champ d’activité. Quant aux habiletés requises, lorsqu’on regarde encore tous les points sur lesquels le praticien a à poser un jugement professionnel, l’accent est mis sur les habiletés du praticien dans les domaines suivants : • l’exécution de la vérification intégrée • l’évaluation de la performance de l’entité • le raisonnement analytique et conceptuel • la communication. Au sujet de l’expérience requise, la tendance est de répartir les prises de décisions à l’échelon approprié, c’est- à-dire que les jugements à poser sur l’orientation de la fonction de vérification intégrée ou de la mission en question reviennent au praticien qui assume le rôle de « dirigeant », et que les jugements concernant la planifi- cation, l’exécution et la présentation des résultats de la mission de vérification reviennent au praticien qui joue le rôle de « chef de projet ». Dans les deux cas, on requiert du praticien concerné une expérience allant de « signi- ficative » à « vaste » en vérification afin de s’assurer que des jugements professionnels appropriés seront portés. Il importe pour le praticien de posséder au moins une quelconque expérience dans le champ d’activité de l’entité à vérifier, ou dans un domaine similaire, pour tout ce qui concerne les jugements clés à poser sur la planification de la vérification et sur la présentation des résultats (p. ex., les décisions touchant l’étendue, le degré de certitude à offrir, les critères de vérification, etc. d’une part, et la formulation des conclusions ou de l’opinion du vérificateur et leur présentation d’autre part). Pour ce qui est des autres jugements à porter par le praticien, on estime que l’expérience en vérification peut plus facilement se transférer d’une situation à une autre. Nous tenons à souligner que l’information présen- tée dans les grilles doit servir de « guide », et non pas d’instructions à suivre à la lettre; cette information per- met d’établir la corrélation entre les jugements à poser en vérification et les compétences requises correspondantes. C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N8
- 13. Q U E S T I O N S C O N N E X E S On s’est également penché sur les deux points de recherche auxiliaires suivants : • la mesure dans laquelle les jugements à porter en vérification et les compétences professionnelles re- quises pour y arriver diffèrent quelque peu pour le vérificateur externe et pour le vérificateur interne • le rôle du spécialiste en ce qui concerne les juge- ments à poser en vérification et les compétences professionnelles requises. Nous pouvons communiquer certaines des obser- vations recueillies au cours de nos consultations. En ce qui concerne la première question, la stratégie commune a consisté à demander la participa- tion des vérificateurs tant internes qu’externes aux symposiums remue-méninges et de les réunir en plusieurs sous-groupes qui avaient à se pencher sur diverses questions. Si les jugements à poser en vérifi- cation ou si les compétences professionnelles requises dans ce but comportaient des différences inhérentes, que l’on soit vérificateur interne ou externe, on a pensé que cela serait mis en évidence dans les délibéra- tions en sous-groupes, ou dans les exposés présentés ou encore dans les discussions qui ont eu lieu en plénière. Dans l’ensemble, aucune différence n’a été signalée ni par les sous-groupes, ni durant les discus- sions en plénière. Pour ce qui est de la deuxième question – le rôle du spécialiste —, certains groupes ont mentionné que son intervention est vraisemblablement de mise pour appuyer les jugements à porter sur les questions con- cernant les principales variables qui constituent le moteur de la vérification (étendue, degré de certitude à offrir et importance relative), les paramètres clés (critères de vérification convenables, éléments probants suffisants et adéquats, etc.) et l’assurance de la qualité. Pour les grandes organisations de vérification, souvent ces spécialistes feraient déjà partie du personnel perma- nent (dans le domaine de la gestion des ressources humaines, de la mesure de l’efficacité, etc.). Pour les organisations de plus petite taille, on ferait appel à des spécialistes de l’extérieur, ce qui soulèverait le défi d’avoir à s’assurer que ces experts sont correctement sensibilisés aux politiques et procédés de vérification du bureau ou de l’organisation afin de savoir en quoi et comment leur travail se rapporte à la mission de vérifi- cation. Nous tenons à mentionner ici les Normes relatives aux missions de certification, promulguées par l’ICCA après le lancement du projet de recherche de la FCVI sur les compétences professionnelles. Dans ces normes de 1997, on aborde la question du spécialiste selon deux perspectives2 : • ce que doit savoir le spécialiste pour faire le lien entre le travail qui lui est confié et l’objectif de la mission • ce que doit savoir le praticien pour établir la com- pétence du spécialiste ainsi que pour superviser et utiliser efficacement le travail de ce dernier. Au moment d’aller sous presse, l’ICCA planifiait d’effectuer d’autres recherches dans ce domaine. Ces observations sont abordées plus en détail au chapitre 6. C O N C L U S I O N Dans ce rapport, nous cernons les principaux points sur lesquels le praticien de la vérification intégrée est appelé à porter un jugement professionnel, et éta- blissons la corrélation entre ces jugements et les compé- tences professionnelles nécessaires (connaissances, habiletés et expérience) pour chacun d’eux. Toute pro- fession doit pouvoir composer ouvertement et franche- ment avec ce type de dossier. Les praticiens effectuent la vérification intégrée dans un environnement complexe, fluide et exigeant. Étant donné l’élargissement des services de vérification (comme la certification) et la sophistication des pro- duits et des services offerts à des clients et consomma- teurs de plus en plus avertis, tout indique qu’on n’assistera pas à un changement de sitôt. Il est dans l’intérêt à la fois des praticiens et des hauts dirigeants qu’ils secondent d’arriver à un consen- sus sur les compétences professionnelles requises pour pratiquer la vérification intégrée. C’est ainsi que les praticiens et leurs bureaux pourront évaluer, élaborer et démontrer leur compétence professionnelle. Quant aux clients, ils pourront ainsi obtenir une assurance sur la qualité des services ou des produits reçus. Les résultats de ce projet de recherche ajoutent à notre compréhension de la compétence professionnelle C H A P I T R E 1 : S O M M A I R E 9 2 INSTITUT CANADIEN DES COMPTABLES AGRÉÉS, MANUEL DE L’ICCA, PARA. 5025.29–.34, .61.
- 14. en vérification intégrée. Comme pour le document publié en 1984, le présent rapport se veut un document « vivant », que l’on modifiera et élargira selon les besoins. C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N1 0
- 15. « LE PRATICIEN ET LES AUTRES PERSONNES QUI PARTICIPENT À LA MISSION DE CERTIFICATION DOIVENT AVOIR UNE COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE ADÉQUATE À L’EXÉCUTION DE CE TYPE DE MISSION. » N O R M E S R E L A T I V E S A U X M I S S I O N S D E C E R T I F I C A T I O N , I C C A , 1 9 9 7 « LES AUDITEURS INTERNES DOIVENT EFFECTUER LEURS TRAVAUX AVEC COMPÉTENCE ET CONSCIENCE PROFESSIONNELLE. » N O R M E S P O U R L A P R A T I Q U E P R O F E S S I O N N E L L E D E L ’ A U D I T I N T E R N E , I F A C I , 1 9 8 5 C H A P I T R E 2 LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE, LE CONCEPT I N T R O D U C T I O N Comme nous l’avons mentionné, quatorze ans se sont écoulés depuis la publication du document de la FCVI Un guide sur ce que le praticien doit savoir pour effectuer des vérifications intégrées. Durant cette période, beaucoup d’expérience a été emmagasinée et une nouvelle façon de penser a émergé. L’environnement de gouverne et de reddition de comptes dans lequel s’effectue la vérification est devenu plus complexe, plus fluide et plus exigeant. Et les clients, tout comme la direction, connaissent mieux la vérification intégrée, ses processus et produits ainsi que leur utilisation. Voilà en partie pourquoi les personnes consultées nous ont conseillés de ne pas limiter l’étendue et la portée de la présente étude à une simple mise à jour du document de 1984 sur les compétences requises. Même si une telle mise à jour s’avérait nécessaire, il fal- lait aussi tenir compte d’autres dimensions, notamment celles des habiletés et de l’expérience. Ce conseil a été accepté et incorporé dans le mandat de notre recherche. L A C O M P É T E N C E P R O F E S - S I O N N E L L E , L E C O N C E P T L’expression « compétence professionnelle » décrit l’étendue du présent projet. Ce terme est connu chez les nombreux praticiens à qui s’adresse le présent rapport. Il est utilisé, par exemple, dans les Normes relatives aux missions de certi- fication, publiées par l’ICCA en 1997. « Le praticien et les autres personnes qui par- ticipent à la mission de certification doivent avoir une compétence professionnelle adéquate à l’exécution de ce type de mission3. » C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N 1 1 3 IBID., PARA. 5025.28.
- 16. De plus, on emploie l’expression dans les Normes pour la pratique professionnelle de l’audit interne, publiées par l’Institute of Internal Auditors : « Compétence professionnelle – Les auditeurs internes doivent effectuer leurs travaux avec compétence et conscience professionnelle4 . » Il est intéressant de noter qu’en anglais il existe une distinction entre les termes « proficiency » et « com- petency » pour décrire la notion de compétence profes- sionnelle. Le mot competency comporte de nombreuses descriptions, définitions et nuances, tant dans la docu- mentation générale que dans son application. À titre d’exemple, il désigne parfois les habiletés et les connais- sances. Il a aussi été utilisé pour décrire l’habileté et la volonté d’accomplir une tâche. Souvent, on décrit ou définit ce terme comme une caractéristique sous-jacente à la performance d’un individu, qui inclut non seule- ment des connaissances et des habiletés, mais également des caractéristiques personnelles comme les principes, les valeurs, les croyances, les attitudes, les traits de per- sonnalité et la motivation. Nous tenons aussi à men- tionner, à titre d’exemple supplémentaire, le rapport de 1997 de l’AICPA sur les Services de certification, dans lequel le terme signifie « à la fois ce que les vérificateurs individuels savent et ce que ceux-ci et les équipes de vérification font ». Le terme anglais « proficiency », toutefois, décrit plus précisément la portée particulière du projet de recherche de la FCVI. Nous nous sommes concentrés sur les connaissances, les habiletés et l’expérience du praticien, et non pas sur l’éventail des aptitudes et des caractéristiques ou traits personnels souvent associés au mot « competency ». Pour en savoir davantage sur la dis- tinction à faire entre les termes anglais « competency » et « proficiency », veuillez consulter l’ouvrage de Willis5 . Par conséquent, lorsque nous utilisons l’expression « compétence professionnelle » dans le présent rapport, nous parlons des connaissances, des habiletés et de l’ex- périence que doit posséder le praticien de la vérification intégrée pour être à même d’exercer un jugement pro- fessionnel et de prendre les décisions qui s’imposent. De plus, nous avons adopté les définitions suivantes des trois dimensions de la compétence professionnelle : • connaissances : la somme des informations que possède le praticien dans une matière donnée6 • habiletés : la capacité du praticien à effectuer une certaine tâche physique ou intellectuelle7 • expérience : la mise en application par le praticien de ses connaissances et habiletés dans l’exercice de sa profession. La figure 2 suivante décrit le concept de la compé- tence professionnelle et la corrélation entre les trois dimensions. FI G U R E 2 : CO M P É T E N C E P R O F E S S I O N N E L L E CO N S I D É R AT I O N S A D D I T I O N N E L L E S S U R L A D I M E N S I O N D’E X P É R I E N C E D E L A C O M P É T E N C E P R O F E S S I O N N E L L E Dans leur ouvrage intitulé Executive Leadership, Jaques et Clement considèrent l’expérience comme le « grand maître » qui enseigne plusieurs choses qui s’a- joutent à notre bagage de connaissances et à l’apprentis- sage de nouvelles habiletés et ce, parfois sans même que nous en ayons conscience8 . C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N1 2 4 INSTITUT FRANÇAIS DES AUDITEURS ET CONTRÔLEURS INTERNES, NORMES POUR LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE DE L’AUDIT INTERNE. VERSION BILINGUE DES NORMES D’AUDIT INTERNE DE L’I.I.A. (INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS) ÉTABLIE PAR A.T.H. (ASSOCIATION TECHNIQUE D’HARMONISATION), PARIS, IFACI, 1985, P. 200-1. 5 SHERRY L. WILLIS, MAINTAINING PROFESSIONAL COMPETENCE : APPROACHES TO CAREER ENHANCEMENT, VITALITY & SUCCESS THROUGHOUT A WORK LIFE, SAN FRANCISCO, JOSSEY-BASS INCORPORATED, 1990, P. 3. SELON WILLIS, LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE COMPORTE DEUX GRANDES CATÉGORIES : PREMIÈREMENT, LES « COMPÉTENCES » PROPRES À LA PROFESSION OU À LA DISCIPLINE EN QUES- TION : (1) LES CONNAISSANCES DE BASE TOUCHANT LA DISCIPLINE; (2) LES HABILETÉS TECHNIQUES CONSIDÉRÉES ESSENTIELLES À L’EXERCICE DE LA PROFESSION; ET (3) LA CAPACITÉ À RÉSOUDRE LES TYPES DE PROBLÈMES RENCONTRÉS DANS L’EXERCICE DE LA PROFESSION. DEUXIÈMEMENT, LES « CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES » DE L’INDIVIDU QUI FACILITE LE PERFECTIONNEMENT ET LE MAINTIEN DE SA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE : CAPACITÉ INTELLECTUELLE, TRAITS PERSONNELS, MOTIVATION, ATTITUDES, ET VALEURS. 6 ADAPTÉE DE SPENCER & SPENCER, OP. CIT., P. 10. 7 IBID, P. 11. 8 ELLIOTT JAQUES AND STEPHEN D. CLEMENT, EXECUTIVE LEADERSHIP, ARLINGTON, CASON HALL & CO. PUBLISHERS, 1991, 1994, P. 77. CONNAISSANCES H A B I L E T É S E X P É R I E N C E
- 17. Dans le présent rapport, l’innovation consiste à traiter l’expérience comme une dimension explicite de la compétence professionnelle du praticien. À cet égard, l’étendue du projet de recherche diffère des autres initiatives dans le domaine, initiatives qui, généralement parlant, ont soit omis d’aborder la dimen- sion d’expérience ou l’ont traitée mais de façon implicite seulement. Le raisonnement qui nous pousse à traiter de l’ex- périence comme d’une dimension explicite s’explique peut-être mieux par l’analogie suivante entre la jeune recrue talentueuse et le professionnel aguerri. La recrue talentueuse peut posséder les connaissances et les habiletés nécessaires mais, contrairement au profession- nel aguerri, elle n’a pas encore eu l’occasion de démon- trer qu’elle est capable d’appliquer efficacement ses connaissances et ses habiletés sur une période pro- longée, à des niveaux de responsabilités différents, ou dans des milieux variés. Dans son rapport publié en 1986 concernant l’en- quête sur l’effondrement de la CCB et la Northern Bank (intitulé Report of the Inquiry into the Collapse of the CCB and Northland Bank), l’honorable Willard Estey a recommandé que : « la Loi sur les banques soit modifiée pour exiger que le vérificateur activement en charge de la vérification de la banque ait au moins cinq ans d’expérience, acquise à un poste de niveau supérieur, dans l’exécution des vérifica- tions des institutions bancaires et autres institu- tions financières de dépôt9 ». Selon le juge Estey, appuyé en cela par diverses soumissions présentées à sa commission d’enquête, l’as- socié responsable de la mission de vérification devrait posséder une expérience de cette étendue, de ce niveau et de cette diversité pour être en mesure de s’acquitter de ses responsabilités en vertu de la Loi sur les banques. Le Rapport du Comité spécial chargé d’étudier le rôle du vérificateur (le Rapport Adams), publié par l’ICCA en 1978, souligne lui aussi l’importance de la dimension d’expérience : « Nous estimons que les gens qui, dans le public, ont besoin des services d’un vérificateur, sont en droit de s’attendre à ce que ceux qui sont autorisés à offrir de tels services aient une forma- tion adéquate et des connaissances et une expé- rience à jour. Les méthodes et les procédés de vérification évoluent constamment et, comme nous l’avons mentionné précédemment, nous estimons que l’expérience est une caractéristique essentielle que doit posséder le vérificateur prati- cien. Les comptables agréés qui ont poursuivi une carrière en dehors du champ de la vérifica- tion devraient être tenus de rafraîchir leurs con- naissances et leur expérience avant d’avoir le droit de signer un rapport du vérificateur10. » L’importance de l’expérience comme un aspect essentiel de la compétence professionnelle du praticien, particulièrement là où il s’agit de l’exercice du jugement professionnel, est discutée en profondeur dans le rap- port de recherche publié par l’ICCA en 1995 sous le titre Le jugement professionnel en vérification. La plupart des professions exigent de leurs mem- bres une période d’expérience pratique avant d’accepter l’adhésion pleine et entière d’une personne (à titre d’exemple, les futures comptables agréés doivent acqué- rir 30 mois d’expérience). Cette exigence démontre l’importance que les professions accordent à l’expé- rience. Pendant notre examen des progrès et de la docu- mentation sur la compétence professionnelle dans les organisations de vérification, nous avons trouvé seule- ment une organisation qui aborde explicitement la question des exigences en matière d’expérience pour la pratique de la vérification intégrée11 . Compte tenu de l’objet principal du projet de recherche de la FCVI – la formulation de principaux jugements par les praticiens de la vérification intégrée —, il importe d’amener la dimension « expé- rience » dans l’équation de la compétence profession- nelle tout en reconnaissant, bien entendu, qu’elle est fondamentalement liée aux dimensions « connais- sances » et « habiletés » (tout comme ces deux dernières dimensions le sont entre elles aussi). C H A P I T R E 2 : L A C O M P É T E N C E P R O F E S S I O N N E L L E , L E C O N C E P T 1 3 9 WILLARD Z. ESTEY, REPORT OF THE ENQUIRY INTO THE COLLAPSE OF THE CCB AND NORTHLAND BANK, OTTAWA, APPROVISIONNEMENTS ET SERVICES CANADA, 1986, P. 298. 10 INSTITUT CANADIEN DES COMPTABLES AGRÉÉS, RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL CHARGÉ D’ÉTUDIER LE RÔLE DU VÉRIFICATEUR, (PRÉSIDÉ PAR JOHN W. ADAMS, FCA), TORONTO, ICCA, P. 67. 11 LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC TRAITE EXPLICITEMENT DE L’EXPÉRIENCE DANS SON GUIDE DES TÂCHES QUANT AUX STANDARDS FIXÉS POUR LES VÉRIFICATEURS (CHARGÉS DE PROJET ET ÉQUIPIERS) ŒUVRANT EN OPTIMISATION DES RESSOURCES; LES EXIGENCES SONT DÉCRITES EN TERMES DE NOMBRE D’ANNÉES, DE NOMBRE DE VOR, ET DE NATURE DU TRAVAIL (C.-À-D. COMPLEXITÉ DES VÉRIFICATIONS).
- 18. « LE JUGEMENT PROFESSIONNEL EST L’ESSENCE DE LA VÉRIFICATION. » L E J U G E M E N T P R O F E S S I O N N E L E N V É R I F I C A T I O N , I C C A , 1 9 9 5 C H A P I T R E 3 LE JUGEMENT PROFESSIONNEL EN VÉRIFICATION INTÉGRÉE I N T R O D U C T I O N Chaque facette du travail du praticien exige que ce dernier fasse preuve de jugement professionnel. Cepen- dant, certaines décisions qu’il prend au sujet soit de l’orientation de la fonction de vérification intégrée, soit d’une mission particulière de vérification intégrée revêtent une telle importance qu’elles auront un effet profond et déterminant sur la qualité du processus de vérification, sur le produit qui en découle, ainsi que sur la considération donnée à ce produit et sur son utilisation. Les discussions pendant les séances remue- méninges ont mis en évidence que, souvent, des juge- ments ou des décisions de ce type sont appuyés par un processus de consultation. Celui-ci implique, selon les circonstances, des discussions avec d’autres membres de l’équipe de vérification, avec des spécialistes qui possè- dent une expertise relativement à certains aspects des éléments visés par la mission et, occasionnellement, avec une personne occupant un poste plus élevé dans la hiérarchie de l’organisation de vérification. En fin de compte, toutefois, c’est toujours à un seul praticien que revient la tâche de porter le jugement crucial. Comme nous l’avons mentionné précédemment, le projet de recherche a commencé par une étude des principaux jugements que le praticien en vérification intégrée est appelé à poser. Nous avons décidé de nous pencher sur l’exercice du jugement professionnel en vérification pour deux raisons : • d’abord, nous adoptons ainsi une approche de recherche axée sur les résultats, ce qui facilite aussi la tâche de différencier entre les compétences pro- fessionnelles de base requises et les autres; et • nous fonctionnons avec une base commune que peuvent utiliser l’ensemble des praticiens en vérifi- cation intégrée, en tenant compte du fait qu’il C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N1 4
- 19. existe des variations quant à la taille et à la struc- ture des organisations, quant au niveau hiérar- chique où se situe le praticien, quant à la répartition de l’autorité et des responsabilités pro- fessionnelles associées à chacun de ces niveaux, etc. La première question à régler concerne l’éventail et la nature des points sur lesquels le praticien doit exercer un jugement professionnel en vérification inté- grée. La deuxième porte sur les compétences profes- sionnelles requises – à la fois les connaissances, les habiletés et l’expérience – du praticien pour qu’il soit à même d’exercer ce jugement. Une fois qu’on est arrivé à un consensus sur ces deux questions, on peut se demander quel praticien ou bien quel niveau hiérar- chique au sein d’une organisation particulière est appelé à poser des jugements dans le cadre de la vérification intégrée et, selon la réponse obtenue, on peut ensuite déterminer les connaissances, les habiletés et l’expé- rience que doit posséder le praticien (ou le praticien de tel ou tel niveau hiérarchique) au sein de l’organisation, ou encore l’organisation elle-même. Ainsi, l’adoption des principaux points sur lesquels le praticien doit exercer son jugement profes- sionnel comme point de départ nous a permis de déli- miter les recherches, de nous concentrer sur les aspects importants et d’obtenir la flexibilité nécessaire pour que les résultats du projet de recherche puissent être appliqués aux différents contextes opérationnels. C A D R E R É F É R E N T I E L S U R L E S P R I N C I P A U X J U G E M E N T S E N V É R I F I C A T I O N Quels sont les principaux points sur lesquels le vérificateur est appelé à poser un jugement profession- nel dans le cadre de la vérification intégrée ? Voilà la première question énoncée dans le mandat du projet de recherche; c’est aussi la première question que l’on a posée aux personnes consultées durant l’étude. Pour arriver à y répondre, il a fallu passer par tout un processus de formulation et de raffinement qui s’est échelonné sur plusieurs mois de discussions avec plusieurs douzaines de praticiens chevronnés. À partir des travaux accomplis pendant les sympo- siums remue-méninges, des discussions de l’équipe de recherche et de l’examen de la documentation, on a dégagé dix « jugements » clés que le praticien est appelé à porter en vérification. Ces jugements sont présentés au tableau 1. DE S C R I P T I O N D E C E S P R I N C I PA U X J U G E M E N T S Chacun de ces dix points comporte habituellement une série de décisions secondaires qui entrent en ligne de compte dans l’exercice du jugement professionnel. LE P O S I T I O N N E M E N T S T R AT É G I Q U E D U B U R E A U O U D E L A F O N C T I O N D E V É R I F I C AT I O N PA R R A P P O RT À L A V É R I F I C AT I O N I N T É G R É E . IL S’AG I T D E D É T E R M I N E R : • les attentes, les besoins en matière d’information et la capacité de l’instance gouvernante, de la direction et, le cas échéant, des autres parties intéressées • le rendement antérieur du travail de vérification effectué dans le passé en ce qui concerne sa qua- lité, son influence et sa valeur ajoutée • la philosophie, les orientations stratégiques, les normes et la capacité de l’organisation de vérification • la stratégie de communication de l’organisation de vérification • la structure ou la nature de l’univers et du cycle de vérification • les projets de vérification à sélectionner C H A P I T R E 3 : L E J U G E M E N T P R O F E S S I O N N E L E N V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E 1 5 TABLEAU 1 PRINCIPAUX JUGEMENTS EN VÉRIFICATION LES PRINCIPAUX JUGEMENTS QUE POSE LE PRATICIEN EN VÉRIFICA- TION INTÉGRÉE PORTENT SUR LES POINTS SUIVANTS : • LE POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE DU BUREAU OU DE LA FONC- TION DE VÉRIFICATION PAR RAPPORT À LA VÉRIFICATION INTÉGRÉE • L’ORIENTATION ET L’OBJET DE CHAQUE MISSION DE VÉRIFICATION • LE MODÈLE DE VÉRIFICATION À ADOPTER POUR LA MISSION DE VÉRIFICATION • LES PRINCIPALES VARIABLES ET LES « MOTEURS » DE LA MISSION DE VÉRIFICATION • LES PRINCIPAUX PARAMÈTRES DE LA MISSION DE VÉRIFICATION • LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION POUR LA MISSION DE VÉRIFI- CATION • L’ASSURANCE DE LA QUALITÉ DE LA MISSION DE VÉRIFICATION • LA SÉLECTION ET LA MISE EN ŒUVRE D’UN SYSTÈME DE GESTION DE PROJETS APPROPRIÉ POUR LA MISSION DE VÉRIFICATION • LA PRÉPARATION ET LA COMMUNICATION DE L’OPINION OU DU RAPPORT DE VÉRIFICATION INTÉGRÉE • L’IMPACT ET LA VALEUR AJOUTÉE DE LA MISSION DE VÉRIFICATION.
- 20. L’O R I E N TAT I O N E T L’O B J E T D E L A M I S S I O N D E V É R I F I C AT I O N . IL S’AG I T D E D É T E R M I N E R : • le niveau de connaissances requises sur le champ d’activité de l’entité à vérifier • si la quantité de ressources est suffisante pour effectuer la vérification, dont la nécessité de faire appel à un ou des spécialistes d’une autre partie de l’organisation ou de l’extérieur • l’à-propos d’entreprendre une mission particulière de vérification • l’éventuelle valeur ajoutée que procure la vérification • l’objectif de la vérification LE M O D È L E D E V É R I F I C AT I O N À A D O P T E R P O U R L A M I S S I O N D E V É R I F I C AT I O N . IL S’AG I T D E D É T E R M I N E R : • la possibilité ou l’à-propos d’utiliser un certain modèle ou d’adopter une certaine approche compte tenu des circonstances – le modèle de rapport axé sur les systèmes et les pratiques de gestion, le mo- dèle de rapport axé sur l’attestation des déclarations de la direction en matière de performance ou le modèle de rapport axé sur la performance. LE S P R I N C I PA L E S VA R I A B L E S E T L E S « M OT E U R S » D E L A M I S S I O N D E V É R I F I C AT I O N . IL S’AG I T D E D É T E R M I N E R : • l’étendue de la vérification • les seuils d’importance relative • le degré de certitude à offrir et le risque que pose la mission de vérification LE S P R I N C I PA U X PA R A M È T R E S D E L A M I S S I O N D E V É R I F I C AT I O N . IL S’AG I T D E D É T E R M I N E R : • les critères de vérification appropriés • la quantité et la qualité des éléments probants à recueillir • la nature et l’étendue de l’utilisation du travail d’un autre vérificateur • les procédés convenables de vérification LA S T R AT É G I E D E C O M M U N I C AT I O N . IL S’AG I T D E D É T E R M I N E R : • les destinataires, l’objet de la communication, le moment propice et la façon de procéder. Cela comprend les communications au sein de l’organi- sation de vérification et celles avec le client, la direction de celui-ci et, le cas échéant, les autres parties intéressées. L’A S S U R A N C E D E L A Q U A L I T É D E L A M I S S I O N D E V É R I F I C AT I O N . IL S’AG I T D E D É T E R M I N E R : • le système approprié d’assurance de la qualité à mettre en place pour la vérification • la qualité du processus et du produit de la vérifica- tion LA S É L E C T I O N E T L A M I S E E N Œ U V R E D’U N S Y S T È M E D E G E S T I O N D E P R O J E T S A P P R O P R I É P O U R L A M I S S I O N D E V É R I F I C AT I O N . IL S’AG I T D E D É T E R M I N E R : • la stratégie et le système de gestion de projets à mettre en place pour la mission de vérification (le calendrier et le budget des activités cruciales, la supervision du travail des spécialistes, etc.) • l’adéquation des progrès réalisés aux diverses étapes cruciales • les actions qui s’imposent pour régler les pro- blèmes ou les événements imprévus LA P R É PA R AT I O N E T L A C O M M U N I C AT I O N D E L’O P I N I O N O U D U R A P P O RT D E L A V É R I F I C AT I O N I N T É G R É E . IL S’AG I T D E D É T E R M I N E R : • les conclusions de la vérification • le contenu du rapport • la façon de formuler le rapport L’I M PAC T E T L A VA L E U R A J O U T É E D E L A M I S S I O N D E V É R I F I C AT I O N . IL S’AG I T D E D É T E R M I N E R : • si les actions prises à l’égard des constatations et des observations découlant de la mission de vérifi- cation sont suffisantes • l’impact et la valeur ajoutée que procure la mis- sion de vérification, et les raisons pour cela. CO N S I D É R AT I O N S A D D I T I O N N E L L E S Il convient de préciser certains aspects de ce cadre de travail sur les principaux jugements en vérification. En premier lieu, l’étude de la question des princi- paux jugements en vérification se situe à deux niveaux. Le premier concerne les principaux jugements qui por- tent sur la fonction de vérification (le positionnement stratégique de l’organisation de vérification). Le second niveau concerne les principaux jugements qui portent sur une mission de vérification en particulier (p. ex., l’orien- tation et l’objet de la vérification). Dans le premier cas, il s’agit de jugements vraisemblablement déclenchés par le cycle de planification et de révision stratégique de l’orga- C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N1 6
- 21. nisation de vérification ou peut-être par de grands change- ments ou événements dans l’environnement externe ou interne (un grand remaniement au niveau de l’instance gouvernante, un changement ou un événement important touchant le lien qui découle de l’obligation qu’a la direc- tion de rendre des comptes à l’instance gouvernante, un nouveau chef de vérification, un changement important au niveau des principes ou de la pratique professionnelle, etc.). Dans le second cas, il s’agit de jugements à poser en fonction de chaque mission de vérification. En second lieu, certains jugements principaux sont portés dans une séquence de temps linéaire se rapportant à un stade particulier du processus de vérification (p. ex., la décision sur le modèle de vérification à adopter est prise au début de la mission). D’autres jugements prin- cipaux affectent chacune des étapes du processus de véri- fication ou sont plus « fluides », dans le sens qu’ils sont posés à un certain stade de la vérification mais qu’ils peuvent être revus et modifiés à un autre stade du processus lorsqu’on a obtenu plus d’informations ou lorsque les circonstances ont changé par rapport à ce qui avait été prévu. À titre d’exemple, les jugements concer- nant la stratégie de communication, l’assurance de la qualité et la gestion de projets sont revus tout au long du processus; ils revêtent une grande importance non seulement à toutes les étapes de la vérification mais aussi après son exécution, au cours de l’examen de l’impact et de la valeur ajoutée de la vérification. À la figure 3 qui suit, on présente graphiquement certaines des dynamiques les plus difficiles à saisir et à inclure dans une simple énumération comme celle don- née ci-dessus. Dans le périmètre extérieur du graphique, on cite toute une gamme de facteurs exerçant une puissante influence sur les principaux jugements que les praticiens sont appelés à poser. QU I P O S E C E S P R I N C I PA U X J U G E M E N T S E N V É R I F I C AT I O N ? Nous nous sommes concentrés sur le praticien et sur les jugements particuliers qu’il doit poser dans le cadre de son travail. Les discussions tenues durant les séances remue-méninges indiquent que bien souvent ces jugements sont portés par des praticiens exerçant leur profession à des échelons différents et jouant des rôles distincts au sein de l’organisation de vérification. Ces praticiens sont appuyés par un processus de consulta- tion auquel peuvent participer, selon les circonstances, d’autres membres de l’équipe de vérification ou des spé- cialistes possédant une expertise sur certains aspects des éléments visés par la mission. Occasionnellement, une discussion préliminaire avec un supérieur au sein de l’organisation de vérification peut aussi avoir lieu avant de porter le jugement. Il importe de souligner le rôle crucial que jouent les membres de l’équipe et les spécialistes. Première- ment, ils contribuent par leurs connaissances et leur expertise à la formulation initiale du jugement. Deuxièmement, ils effectuent le travail de vérification conformément au jugement posé. Et troisièmement, lorsque le travail de vérification signale la nécessité de revoir les postulats sur lesquels repose le jugement ini- tial, ils doivent prendre une décision importante, à savoir quand et comment porter cette situation à l’at- tention des autres pour que le jugement soit réexaminé. En fin de compte, toutefois, c’est toujours à un seul praticien que revient la tâche de porter un ou plusieurs de ces jugements cruciaux. Au tout début du projet, nous avons examiné la possibilité de commencer notre travail en classant les principaux jugements à poser en vérification selon le niveau ou le poste approprié dans une organisation de vérification. Cependant, la diversité des organisations de vérification en termes de taille, de structure hiérarchique, et ainsi de suite, nous a vite obligés à constater que cet exercice était impossible. Dans les organisations de plus grande taille, où la structure hiérarchique est plus élaborée, le pouvoir décisionnel est plus largement dis- persé, tandis que dans les organisations de plus petite taille, il est plus centralisé. La capacité professionnelle du personnel, de même que la culture et le style de gestion, sont autant de facteurs qui entrent en jeu à cet égard. C H A P I T R E 3 : L E J U G E M E N T P R O F E S S I O N N E L E N V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E 1 7
- 22. FI G U R E 3 : PR I N C I PA U X J U G E M E N T S P O S É S PA R L E P R AT I C I E N E N V É R I F I C AT I O N I N T É G R É E C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N1 8 Opinion Rapport Paramètres de lamission Modèle de vérification à adopter Orientation et objet de la missionPositionnementstratégiquedel’organisationdevérification Valeur ajoutée Attentes et besoins des parties intéressées Normes professionnelles Mandat de vérification Modèles de vérification Environnement de contrôle de l’entité à vérifier Éthique (Code de conduite) Assurance de la qualité Stratégiedecommunication Gestiondeprojets Assurance/risque Importancerelative Étendue Ressources de vérification, dont connaissances, habiletés et expérience
- 23. « POUR BIEN S’ACQUITTER [DE LA VASTE GAMME DE MISSIONS QU’ILS SONT APPELÉS À EFFECTUER], LES VÉRIFICATEURS INTERNES DOIVENT POSSÉDER DES HABILETÉS ET DES CONNAISSANCES DANS PLUSIEURS DISCIPLINES DIFFÉRENTES […] ILS DOIVENT ÊTRE D’EXCELLENTS COMMUNICATEURS […] ILS DOIVENT ÊTRE DES PENSEURS LOGIQUES […] » A C O M M O N B O D Y O F K N O W L E D G E F O R T H E P R A C T I C E O F I N T E R N A L A U D I T I N G , I . I . A . , 1 9 9 2 C H A P I T R E 4 COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE EN VÉRIFICATION INTÉGRÉE : CONNAISSANCES, HABILETÉS ET EXPÉRIENCE REQUISES I N T R O D U C T I O N La première étape pour déterminer les connais- sances, les habiletés et l’expérience requises du praticien de la vérification intégrée consiste à établir les principaux jugements qu’il est appelé à poser dans le cadre de son travail; voilà sur quoi le chapitre 3 a porté. Dans le présent chapitre, nous décrivons les connaissances, les habiletés et de l’expérience jugées nécessaires pour que le praticien soit à même de poser des jugements appropriés. Nous présentons un cadre référentiel pour la discussion du degré, de l’étendue ou de la nature de chacune de ces dimensions de la compétence professionnelle. C A D R E R É F É R E N T I E L S U R L E S C O N N A I S S A N C E S R E Q U I S E S Comme nous l’avons mentionné précédemment, le terme « connaissances » dans le présent rapport signi- fie les informations qu’une personne possède dans une matière donnée. Il est important de noter que ces con- naissances s’acquièrent de plusieurs façons – un pro- gramme d’études ou de formation, l’apprentissage auprès d’autres professionnels, et l’expérience de travail en vérification intégrée et autres types de vérification, dans différents champs d’activité et dans le bénévolat. C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N 1 9
- 24. CO N N A I S S A N C E S R E Q U I S E S : PA R D O M A I N E Nos recherches nous ont permis de dégager treize domaines de connaissances se rapportant aux princi- paux jugements à poser en vérification intégrée (tableau 2). La nature et l’étendue des connaissances que doit posséder le praticien en vérification intégrée, ou connaissances auxquelles il doit avoir accès, dépen- dent des jugements particuliers qu’il est appelé à poser ou à soutenir. Si le praticien doit faire appel aux con- naissances – ou encore aux habiletés ou à l’expérience – d’un spécialiste pour poser son jugement, il se doit de posséder une connaissance de base suffisante en la matière pour être en mesure d’évaluer et d’utiliser effi- cacement le travail de ce dernier. TABLEAU 2 CONNAISSANCES REQUISES : PAR DOMAINE • GOUVERNE, GESTION ET REDDITION DE COMPTES • PERFORMANCE • SYSTÈMES ET PRATIQUES DE GESTION • CONTRÔLE • VÉRIFICATION AXÉE SUR LA GESTION ÉCONOMIQUE, EFFICIENTE ET EFFICACE DES RESSOURCES ET DES DENIERS (C.-À-D. LA VÉRIFI- CATION INTÉGRÉE) • VÉRIFICATION AXÉE SUR LA CONFORMITÉ AUX AUTORISATIONS ET SUR L’INFORMATION FINANCIÈRE • ORGANISATION DE VÉRIFICATION DU PRATICIEN • CHAMP D’ACTIVITÉ DE L’ENTITÉ À VÉRIFIER • SCIENCE DU COMPORTEMENT • DISCIPLINES CONNEXES • RECHERCHE ET ANALYSE • GESTION DE PROJETS • ASSURANCE DE LA QUALITÉ. DE S C R I P T I O N D E S D O M A I N E S D E C O N N A I S S A N C E S • Gouverne, gestion et reddition de comptes. Une connaissance des concepts, des théories, des principes, des cadres référentiels, des structures, des processus, des interrelations ainsi que des nouveaux enjeux, réflexions et développements touchant la gouverne, la gestion et la reddition de comptes. • Performance. Une connaissance des concepts, des théories, des principes, des cadres référentiels, des pratiques touchant la comptabilité, la mesure et la présentation de l’information, ainsi que des nou- veaux enjeux, réflexions et développements liés à la notion de la « performance » d’une organisation. • Systèmes et pratiques de gestion. Une connais- sance des concepts, des théories, des principes, des cadres référentiels, des pratiques de mesure et de présentation de l’information, ainsi que des nou- veaux enjeux, réflexions et développements liés aux systèmes et pratiques de gestion comme la planification, la gestion des opérations, la gestion des ressources humaines, le contrôle et la gestion financière, la technologie de l’information, les sys- tèmes d’information, etc. • Contrôle. Une connaissance des concepts, des théories, des principes, des cadres référentiels, des pratiques et des critères, ainsi que des nouveaux enjeux, réflexions et développements touchant le contrôle. Cela comporte aussi une connaissance de la théorie, des cadres référentiels et des techniques touchant la gestion ou l’évaluation des risques. • Vérification axée sur la gestion économique, efficiente et efficace des ressources et des deniers (c.-à-d. la vérification intégrée). Une connaissance des concepts, des théories, des principes, de l’éthique, des normes, des modèles, des processus, des pratiques ainsi que des nou- veaux enjeux, réflexions et développements touchant la vérification intégrée. • Vérification axée sur la conformité aux autori- sations et sur l’information financière. Une connaissance des concepts, des théories, des principes, de l’éthique, des normes, des modèles, des processus, des pratiques ainsi que des nou- veaux enjeux, réflexions et développements touchant ce champ de vérification – connaissances pouvant être obtenues par un programme d’en- seignement ou une formation formelle. • Organisation de vérification du praticien. Une connaissance de sa propre organisation de vérifica- tion incluant son mandat, sa philosophie, son sys- tème de valeurs, ses orientations stratégiques, son approche face à la gestion des risques, ses buts, sa politique, ses pratiques, ses ressources ainsi que les nouveaux enjeux, réflexions et développements qui la concernent. • Champ d’activité de l’entité à vérifier. Une connaissance des aspects suivants : le mandat, les objectifs et les plans opérationnels de l’entité à C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N2 0
- 25. vérifier, ainsi que l’environnement dans lequel elle exerce ses activités; le mandat, les attentes, les besoins et les caractéristiques de son instance gou- vernante et de sa direction, de même que la nature et l’historique des prises de décision et des liens de responsabilité découlant de l’obligation de rendre compte concernant ces deux parties; l’éthique et le système de valeurs qui sous-tendent l’orientation de la direction et la gestion de l’organisation; la nature des activités de l’entité et la façon dont celles-ci sont structurées et organisées, le mode d’obtention des ressources nécessaires et la presta- tion des services; la performance et les antécédents de l’entité en ce qui concerne la vérification, ainsi que les conditions, les enjeux, les pratiques et la performance concernant l’industrie à laquelle l’en- tité à vérifier appartient; enfin, la nature des risques liés aux activités de l’entité et leur gestion. • Science du comportement. Une connaissance des concepts, des théories, des principes et des pratiques touchant l’étude scientifique du com- portement humain et organisationnel. • Disciplines connexes. Une connaissance des sciences sociales, de l’administration publique et des affaires, de la comptabilité de gestion et finan- cière, et des autres disciplines se rapportant aux activités de l’entité à vérifier. • Recherche et analyse. Une connaissance de la conception des recherches, des méthodes d’échan- tillonnage et des techniques connexes en matière de collecte et d’analyse des données. Une approche qui gagne en popularité et qu’on pour- rait inclure ici est l’analyse des meilleures pra- tiques ou des balises. Une connaissance de l’informatique (matériel et logiciel) se classe aussi dans cette catégorie de connaissances. • Gestion de projets. Une connaissance des principes, des normes, des pratiques, des tech- niques et des outils touchant la gestion de projets. • Assurance de la qualité. Une connaissance des principes, des normes, des pratiques et des tech- niques se rapportant à la mission de vérification. NIVEAU OU ÉTENDUE DES CONNAISSANCES REQUISES Une fois que l’on a cerné les domaines de connais- sances, il est utile de déterminer l’étendue des connais- sances requises. Au tableau 3, nous définissons les trois niveaux de connaissance. TABLEAU 3 NIVEAU OU ÉTENDUE DES CONNAISSANCES REQUISES • CONNAISSANCE ÉLÉMENTAIRE : UNE CONNAISSANCE GÉNÉRALE DES ENJEUX, DES PRATIQUES ET DES DÉVELOPPEMENTS FONDA- MENTAUX, AINSI QUE DE LEUR PORTÉE. • CONNAISSANCE PRATIQUE : UNE BONNE CONNAISSANCE PRATIQUE DES CONCEPTS, DES THÉORIES, DES PRINCIPES, DES NORMES, DES CADRES RÉFÉRENTIELS, DES PROCÉDURES, ETC., EN LA MATIÈRE. • CONNAISSANCE APPROFONDIE : UNE CONNAISSANCE APPRO- FONDIE DE LA RAISON D’ÊTRE ET DU FONCTIONNEMENT DES DIVERS ASPECTS DU DOMAINE. C A D R E R É F É R E N T I E L S U R L E S H A B I L E T É S R E Q U I S E S Comme nous l’avons mentionné, le terme « habiletés » dans le présent rapport signifie la capacité du praticien à effectuer une certaine tâche physique ou intellectuelle. HA B I L E T É S R E Q U I S E S : PA R D O M A I N E Les recherches nous ont permis de dégager dix catégories ou domaines d’habiletés se rapportant aux principaux jugements à porter en vérification intégrée. La nature et l’étendue des habiletés que doit posséder le praticien en vérification intégrée, ou auxquelles il doit avoir accès, dépendent du ou des jugements particuliers qu’il est appelé à porter ou à soutenir. Comme pour les connaissances requises, les habiletés requises sont présentées sous forme de cadre référentiel comportant deux parties : le tableau 4 dresse la liste des domaines d’habiletés, regroupés en trois caté- gories : habiletés d’ordre professionnel ou technique, habiletés en matière de gestion, et habiletés d’ordre général; le tableau 6 définit les degrés ou l’étendue des habiletés requises. C H A P I T R E 4 : C O M P É T E N C E P R O F E S S I O N N E L L E E N V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E : C O N N A I S S A N C E S , H A B I L E T É S E T E X P É R I E N C E R E Q U I S E S 2 1
- 26. TABLEAU 4 HABILETÉS REQUISES : PAR DOMAINE HA B I L E T É S D’O R D R E P R O F E S S I O N N E L O U T E C H N I Q U E LA CAPACITÉ D’APPLIQUER LES CONCEPTS, LES PRINCIPES, LES MÉTHODES ET LES TECHNIQUES EN MATIÈRE DE : • VÉRIFICATION AXÉE SUR LA GESTION ÉCONOMIQUE, EFFICIENTE ET EFFICACE DES RESSOURCES ET DES DENIERS (C.-À-D. LA VÉRIFI- CATION INTÉGRÉE) • ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE D’UNE ORGANISATION • RECHERCHE ET ANALYSE • ASSURANCE DE LA QUALITÉ HA B I L E T É S E N M AT I È R E D E G E S T I O N • GESTION GÉNÉRALE • GESTION DE PROJETS HA B I L E T É S D’O R D R E G É N É R A L • RAISONNEMENT ANALYTIQUE • RAISONNEMENT CONCEPTUEL • COMMUNICATION • ENTREGENT D E S C R I P T I O N D E S D O M A I N E S D ’ H A B I L E T É S HA B I L E T É S D’O R D R E P R O F E S S I O N N E L O U T E C H N I Q U E La capacité d’appliquer les concepts, les principes, les méthodes et les techniques en matière de : • Vérification axée sur la gestion économique, efficiente et efficace des ressources et des deniers (c.-à-d. la vérification intégrée) • Évaluation de la performance d’une organisa- tion. La capacité d’effectuer du travail d’évalua- tion de la performance comme l’examen ou l’évaluation des opérations, des programmes ou des politiques, les études sur l’efficacité organisa- tionnelle, la planification stratégique et la consul- tation de gestion. • Recherche et analyse • Assurance de la qualité HA B I L E T É S E N M AT I È R E D E G E S T I O N • Gestion générale. La capacité de planifier, d’or- ganiser et de contrôler les opérations ainsi que de diriger le personnel, de le motiver et de dévelop- per ses capacités. • Gestion de projets. La capacité d’établir des objectifs de projet, de déterminer les actions re- quises et d’en établir le calendrier, de déterminer les ressources nécessaires et de les mobiliser, d’établir une stratégie de contrôle du projet, de superviser l’exécution d’un projet, et d’apporter les modifications nécessaires, le cas échéant. HA B I L E T É S D’O R D R E G É N É R A L • Raisonnement analytique12. La capacité de comprendre une situation en saisissant bien cha- cune de ses composantes, de traiter et d’évaluer l’information et les données, de déterminer les causes et les effets, de faire des inférences logiques, et d’organiser l’information et les données. • Raisonnement conceptuel13 . La capacité de regrouper toutes les composantes pour saisir la si- tuation dans sa globalité, de reconnaître les simili- tudes et les relations entre des situations sans liens apparents, de saisir les enjeux et les questions sous-jacentes dans des situations complexes, de départager les aspects importants et ceux qui le sont moins, et enfin d’utiliser un raisonnement créatif, conceptuel et inductif pour appliquer les concepts existants ou en définir de nouveaux, pour tirer des leçons de l’expérience acquise, et pour penser en fonction de l’avenir. • Communication. La capacité d’écouter et de percevoir ainsi que d’expliquer et de présenter des idées (oralement et par écrit) de façon claire, con- cise, logique et convaincante, tout en tenant compte du lecteur visé. • Entregent. La capacité de négocier les enjeux, de résoudre les problèmes, et d’établir des relations de travail efficaces avec ses collègues, avec les dirigeants et avec le client (l’instance gouver- nante). C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N2 2 12 ADAPTÉE DE SPENCER & SPENCER, OP. CIT. 13 IBID.
- 27. NI V E A U O U É T E N D U E D E S H A B I L E T É S R E Q U I S E S Au tableau 5, nous définissons les trois niveaux concernant les habiletés requises. TABLEAU 5 NIVEAU OU ÉTENDUE DES HABILETÉS REQUISES • NIVEAU DE BASE. LA CAPACITÉ D’AGIR AVEC COMPÉTENCE DANS LE TRAITEMENT DES QUESTIONS ORDINAIRES RELEVANT DE LA PRATIQUE COURANTE OU S’INSCRIVANT À L’INTÉRIEUR DE PARAMÈTRES BIEN ÉTABLIS. • NIVEAU INTERMÉDIAIRE. LA CAPACITÉ D’AGIR AVEC COMPÉTENCE DANS LE TRAITEMENT DES QUESTIONS COMPLEXES ET DE LEUR APPORTER UN CERTAIN ÉLÉMENT DE NOUVEAUTÉ. • NIVEAU AVANCÉ. LA CAPACITÉ D’AGIR AVEC COMPÉTENCE DANS LE TRAITEMENT DES QUESTIONS HAUTEMENT COMPLEXES POU- VANT SOULEVER DES DÉBATS OU METTRE À L’ÉPREUVE DES FAÇONS CONVENTIONNELLES DE PENSER OU DE PRATIQUER. C A D R E R É F É R E N T I E L S U R L ’ E X P É R I E N C E R E Q U I S E Comme nous l’avons mentionné, par « expé- rience », on entend la mise en application par le prati- cien de ses connaissances et de ses habiletés dans l’exercice de sa profession. Dans son rapport de 1986 concernant l’enquête sur l’effondrement de la CCB et de la Northern Bank, le juge Willard Estey, commentant sur la vérification, a précisé trois facteurs qu’il estime pertinents pour définir l’expérience du vérificateur : le nombre d’années d’ex- périence en vérification ou l’étendue de l’expérience acquise, l’échelon de responsabilité auquel cette expé- rience a été acquise et enfin le contexte dans lequel elle l’a été (qui, dans ce cas-ci, signifiait une expérience acquise dans l’industrie bancaire ou auprès d’institu- tions financières de dépôt). En se basant sur le raisonnement du juge Estey et sur le contenu des cadres référentiels élaborés pour les connaissances et les habiletés requises, nous avons préparé le cadre référentiel suivant, comportant deux parties. Dans la première partie (tableau 6), on indique le domaine d’expérience requis et dans la seconde (tableau 7), on traite de trois aspects de l’expérience acquise en vérification : le rôle, l’étendue et le contexte. Le fait qu’il existe moins de catégories pour cette dimension que pour les « connaissances » et « habiletés » ne signifie aucunement que l’expérience constitue la dimension la moins importante de la compétence pro- fessionnelle. Au contraire, comme l’un des participants aux séances remue-méninges nous l’a signalé, « c’est sou- vent l’expérience qui fait toute la différence ». Comme nous l’avons précisé pour les dimensions « connaissances » et « habiletés », la nature de l’expérience que doit posséder le praticien en vérification intégrée, ou l’expérience à laquelle il doit avoir accès, dépend du ou des jugements particuliers qu’il est appelé à poser. EX P É R I E N C E R E Q U I S E : PA R D O M A I N E Comme nous le mentionnons au tableau 6, le type d’expérience requise est une expérience en vérifica- tion axée sur la gestion économique, efficiente et effi- cace des ressources et des deniers. Une expérience acquise dans d’autres champs d’activité ou dans d’autres types de vérification peut aider le praticien dans son travail, mais c’est l’expérience en vérification intégrée que l’on juge nécessaire ici. TABLEAU 6 EXPÉRIENCE REQUISE EN VÉRIFICATION : PAR DOMAINE • VÉRIFICATION AXÉE SUR LA GESTION ÉCONOMIQUE, EFFICIENTE ET EFFICACE DES RESSOURCES ET DE DENIERS (C.-À-D. LA VÉRIFICATION INTÉGRÉE). EX P É R I E N C E R E Q U I S E , S E LO N L E S A S P E C T S « R Ô L E », « É T E N D U E » E T « C O N T E X T E » Au tableau 7, nous abordons les trois aspects de l’expérience requise en vérification intégrée : le rôle, l’é- tendue et le contexte. En ce qui concerne l’étendue, nous utilisons comme critère de mesure le nombre d’années d’expérience. C H A P I T R E 4 : C O M P É T E N C E P R O F E S S I O N N E L L E E N V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E : C O N N A I S S A N C E S , H A B I L E T É S E T E X P É R I E N C E R E Q U I S E S 2 3
- 28. TABLEAU 7 EXPÉRIENCE REQUISE EN VÉRIFICATION SELON LES ASPECTS : « RÔLE », « ÉTENDUE » ET « CONTEXTE » RÔ L E • EXPÉRIENCE ACQUISE EN TANT QUE MEMBRE DE L’ÉQUIPE • EXPÉRIENCE ACQUISE EN TANT QUE CHEF DE PROJET • EXPÉRIENCE ACQUISE EN TANT QUE DIRIGEANT ÉT E N D U E • UNE CERTAINE EXPÉRIENCE QUI, DANS NOTRE PROPOS, SE COMP- TABILISE À MOINS DE 2 ANS D’EXPÉRIENCE • UNE EXPÉRIENCE SIGNIFICATIVE QUI, DANS NOTRE PROPOS, SE COMPTABILISE À ENTRE 2 ET 4 ANS D’EXPÉRIENCE • UNE VASTE EXPÉRIENCE QUI, DANS NOTRE PROPOS, SE COMP- TABILISE À UN MINIMUM DE 5 ANS D’EXPÉRIENCE. CO N T E X T E • S’IL EST NÉCESSAIRE OU NON POUR LE PRATICIEN DE POSSÉDER UNE EXPÉRIENCE DANS LA VÉRIFICATION D’ENTITÉS EXERÇANT LEURS ACTIVITÉS DANS LE MÊME DOMAINE OU DANS UN DOMAINE SIMILAIRE. C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N2 4
- 29. C H A P I T R E 5 CORRÉLATION ENTRE LES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES NÉCESSAIRES ET LES PRINCIPAUX JUGEMENTS EN VÉRIFICATION I N T R O D U C T I O N Une partie importante des travaux des symposiums remue-méninges a été consacrée à discuter de la corréla- tion qui existe entre chacun des principaux jugements en vérification, d’une part, et les connaissances, les habiletés et l’expérience requises chez le praticien de la vérification intégrée qui doit porter le jugement, d’autre part. C O R R É L A T I O N E N T R E L E J U G E M E N T E N V É R I F I C A T I O N E T L A C O M P É T E N C E P R O F E S S I O N N E L L E R E Q U I S E Dans les dix grilles des pages suivantes, nous indiquons les liens entre chacun des jugements en véri- fication et les connaissances, les habiletés et l’expérience correspondantes requises. Voici les domaines qui retiennent le plus l’attention : Connaissances • gouverne, gestion et reddition de comptes • vérification intégrée • organisation de vérification du praticien • champ d’activité de l’entité à vérifier. Habiletés • vérification intégrée • évaluation de la performance d’une organisation • raisonnement analytique et conceptuel • communication et entregent. Quant à la dimension « expérience » de la compé- tence professionnelle, le rôle « dirigeant » est lié au juge- ment portant sur l’orientation de la fonction ou de la mission particulière de vérification intégrée. Les juge- ments ayant trait à la planification, à l’exécution et à la présentation des résultats de la mission de vérification sont liés au rôle « chef de projet ». Une expérience dans la vérification d’organismes exerçant leurs activités dans le même domaine que celui de l’entité à vérifier est jugée importante comme base pour poser les jugements sur l’orientation de la fonction ou de la mission de vérification intégrée, sur la planifi- cation de la mission, sur son exécution et sur le rapport qui en découle. Pour les autres jugements à poser, la nécessité d’avoir acquis une expérience de vérification dans l’entité même à vérifier, ou dans une entité simi- laire, n’est pas considérée comme un préalable essentiel; pour ceux-ci, on estime que l’expérience en vérification est relativement transférable d’une situation à une autre. LE C T U R E D E S G R I L L E S Dans les pages qui suivent, nous présentons dix grilles, une pour chacun des principaux jugements en vérification. Sur chacune des grilles, on indique la cor- rélation entre le jugement et les domaines et niveaux de connaissances, d’habiletés et d’expérience requises pour poser ce jugement en toute confiance. Les points en noir confirment l’existence de cette corrélation. Pour l’un ou l’autre jugement, il se peut qu’on ait estimé que certains domaines de connaissances, d’ha- biletés ou d’expérience ne s’appliquent pas; dans ces cas, on a simplement laissé les points en blanc. La structure différente du cadre référentiel sur la dimension « expérience » nous oblige à préciser davan- tage la lecture des grilles. Pour cette dimension, un seul domaine d’expérience est cité : la vérification axée sur la gestion économique, efficiente et efficace des ressources et des deniers. Cependant, il importe de considérer trois aspects de l’expérience acquise en vérification inté- grée : le rôle, l’étendue et le contexte. Dans les grilles, le point en noir correspondant à l’aspect « contexte » signifie qu’on estime nécessaire pour le praticien d’avoir acquis une expérience dans le champ d’activité de l’en- tité à vérifier ou dans un champ similaire. C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N 2 5
- 30. C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N2 6 COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE EN VÉRIFICATION INTÉGRÉE . . . L E S C O N N A I S S A N C E S S U I V A N T E S , . . . * POUR PLUS DE DÉTAILS, VOIR P. 19-21. J U G E M E N T P R I N C I P A L : POUR POSER UN JUGEMENT SUR... LE POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE DU BUREAU OU DE LA FONCTION DE VÉRIFICATION PAR RAPPORT À LA VÉRIFICATION INTÉGRÉE... LE PRATICIEN DOIT POSSÉDER... Gouverne, gestion et reddition de comptes ❍ ❍ q Performance ❍ q ❍ Systèmes et pratiques de gestion ❍ q ❍ Contrôle ❍ q ❍ Vérification axée sur la gestion économique, efficiente ❍ ❍ q et efficace des ressources et des deniers Vérification axée sur la conformité aux q ❍ ❍ autorisations et sur l'information financière Organisation de vérification du praticien ❍ ❍ q Champ d'activité de l'entité à vérifier ❍ q ❍ Science du comportement ❍ q ❍ Disciplines connexes q ❍ ❍ Recherche et analyse q ❍ ❍ Gestion de projets q ❍ ❍ Assurance de la qualité q ❍ ❍ DOMAINES CONNAISSANCE ÉLÉMENTAIRE CONNAISSANCE PRATIQUE CONNAISSANCE APPROFONDIE . . . L E S H A B I L E T É S S U I V A N T E S . . . * POUR PLUS DE DÉTAILS, VOIR P. 21-23. DOMAINES NIVEAUDEBASE NIVEAUINTERMÉDIAIRE NIVEAUAVANCÉ Habiletés d'ordre professionnel ou technique Vérification axée sur la gestion économique, efficiente ❍ ❍ q et efficace des ressources ou des deniers Évaluation de la performance d’une organisation ❍ q ❍ Recherche et analyse q ❍ ❍ Assurance de la qualité q ❍ ❍ Habiletés en matière de gestion Gestion générale ❍ ❍ q Gestion de projets q ❍ ❍ Habiletés d'ordre général Raisonnement analytique ❍ ❍ q Raisonnement conceptuel ❍ ❍ q Communication ❍ ❍ q Entregent ❍ ❍ q . . . E T L ' E X P É R I E N C E S U I V A N T E . * POUR PLUS DE DÉTAILS, VOIR P. 23-24. ASPECT « RÔLE » ASPECT « ÉTENDUE » ASPECT « CONTEXTE » MEMBRE CHEF DE CERTAINE SIGNIFICATIVE VASTE RELATIVEMENT AU CHAMP DOMAINE D’ÉQUIPE PROJET DIRIGEANT <2ANS 2-4ANS >5ANS D'ACTIVITÉDEL'ENTITÉÀVÉRIFIER Vérification axée sur la gestion ❍ ❍ q ❍ ❍ q q économique, efficiente et efficace des ressources et des deniers EXPÉRIENCE EXPÉRIENCE EXPÉRIENCE
- 31. C H A P I T R E 5 : C O R R É L A T I O N E N T R E L E S C O M P É T E N C E S P R O F E S S I O N N E L L E S N É C E S S A I R E S E T L E S P R I N C I P A U X J U G E M E N T S E N V É R I F I C A T I O N 2 7 COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE EN VÉRIFICATION INTÉGRÉE . . . L E S C O N N A I S S A N C E S S U I V A N T E S , . . . * POUR PLUS DE DÉTAILS, VOIR P. 19-21. J U G E M E N T P R I N C I P A L : POUR POSER UN JUGEMENT SUR... L'ORIENTATION ET L'OBJET DE CHAQUE MISSION DE VÉRIFICATION... LE PRATICIEN DOIT POSSÉDER... Gouverne, gestion et reddition de comptes ❍ q ❍ Performance ❍ q ❍ Systèmes et pratiques de gestion ❍ q ❍ Contrôle ❍ q ❍ Vérification axée sur la gestion économique, efficiente ❍ ❍ q et efficace des ressources et des deniers Vérification axée sur la conformité aux q ❍ ❍ autorisations et sur l'information financière Organisation de vérification du praticien ❍ ❍ q Champ d'activité de l'entité à vérifier ❍ q ❍ Science du comportement q ❍ ❍ Disciplines connexes q ❍ ❍ Recherche et analyse q ❍ ❍ Gestion de projets q ❍ ❍ Assurance de la qualité q ❍ ❍ DOMAINES CONNAISSANCE ÉLÉMENTAIRE CONNAISSANCE PRATIQUE CONNAISSANCE APPROFONDIE . . . L E S H A B I L E T É S S U I V A N T E S . . . * POUR PLUS DE DÉTAILS, VOIR P. 21-23. DOMAINES Habiletés d'ordre professionnel ou technique Vérification axée sur la gestion économique, efficiente ❍ q ❍ et efficace des ressources ou des deniers Évaluation de la performance d’une organisation ❍ q ❍ Recherche et analyse q ❍ ❍ Assurance de la qualité q ❍ ❍ Habiletés en matière de gestion Gestion générale q ❍ ❍ Gestion de projets q ❍ ❍ Habiletés d'ordre général Raisonnement analytique ❍ ❍ q Raisonnement conceptuel ❍ ❍ q Communication ❍ q ❍ Entregent ❍ q ❍ . . . E T L ' E X P É R I E N C E S U I V A N T E . * POUR PLUS DE DÉTAILS, VOIR P. 23-24. ASPECT « RÔLE » ASPECT « ÉTENDUE » ASPECT « CONTEXTE » MEMBRE CHEF DE CERTAINE SIGNIFICATIVE VASTE RELATIVEMENT AU CHAMP DOMAINE D’ÉQUIPE PROJET DIRIGEANT <2ANS 2-4ANS >5ANS D'ACTIVITÉDEL'ENTITÉÀVÉRIFIER Vérification axée sur la gestion ❍ ❍ q ❍ q ❍ q économique, efficiente et efficace des ressources et des deniers EXPÉRIENCE EXPÉRIENCE EXPÉRIENCE NIVEAUDEBASE NIVEAUINTERMÉDIAIRE NIVEAUAVANCÉ
- 32. C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N2 8 COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE EN VÉRIFICATION INTÉGRÉE . . . L E S C O N N A I S S A N C E S S U I V A N T E S , . . . * POUR PLUS DE DÉTAILS, VOIR P. 19-21. J U G E M E N T P R I N C I P A L : POUR POSER UN JUGEMENT SUR... LE MODÈLE DE VÉRIFICATION À ADOPTER POUR LA MISSION DE VÉRIFICATION... LE PRATICIEN DOIT POSSÉDER... Gouverne, gestion et reddition de comptes ❍ q ❍ Performance ❍ q ❍ Systèmes et pratiques de gestion ❍ q ❍ Contrôle ❍ q ❍ Vérification axée sur la gestion économique, efficiente ❍ ❍ q et efficace des ressources et des deniers Vérification axée sur la conformité aux q ❍ ❍ autorisations et sur l'information financière Organisation de vérification du praticien ❍ ❍ q Champ d'activité de l'entité à vérifier ❍ q ❍ Science du comportement q ❍ ❍ Disciplines connexes q ❍ ❍ Recherche et analyse q ❍ ❍ Gestion de projets ❍ ❍ ❍ Assurance de la qualité ❍ q ❍ DOMAINES CONNAISSANCE ÉLÉMENTAIRE CONNAISSANCE PRATIQUE CONNAISSANCE APPROFONDIE . . . L E S H A B I L E T É S S U I V A N T E S . . . * POUR PLUS DE DÉTAILS, VOIR P. 21-23. DOMAINES Habiletés d'ordre professionnel ou technique Vérification axée sur la gestion économique, efficiente ❍ q ❍ et efficace des ressources ou des deniers Évaluation de la performance d’une organisation ❍ q ❍ Recherche et analyse q ❍ ❍ Assurance de la qualité ❍ q ❍ Habiletés en matière de gestion Gestion générale q ❍ ❍ Gestion de projets ❍ ❍ ❍ Habiletés d'ordre général Raisonnement analytique ❍ ❍ q Raisonnement conceptuel ❍ ❍ q Communication ❍ q ❍ Entregent ❍ q ❍ . . . E T L ' E X P É R I E N C E S U I V A N T E . * POUR PLUS DE DÉTAILS, VOIR P. 23-24. ASPECT « RÔLE » ASPECT « ÉTENDUE » ASPECT « CONTEXTE » MEMBRE CHEF DE CERTAINE SIGNIFICATIVE VASTE RELATIVEMENT AU CHAMP DOMAINE D’ÉQUIPE PROJET DIRIGEANT <2ANS 2-4ANS >5ANS D'ACTIVITÉDEL'ENTITÉÀVÉRIFIER Vérification axée sur la gestion ❍ ❍ q ❍ q ❍ ❍ économique, efficiente et efficace des ressources et des deniers EXPÉRIENCE EXPÉRIENCE EXPÉRIENCE NIVEAUDEBASE NIVEAUINTERMÉDIAIRE NIVEAUAVANCÉ
- 33. C H A P I T R E 5 : C O R R É L A T I O N E N T R E L E S C O M P É T E N C E S P R O F E S S I O N N E L L E S N É C E S S A I R E S E T L E S P R I N C I P A U X J U G E M E N T S E N V É R I F I C A T I O N 2 9 COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE EN VÉRIFICATION INTÉGRÉE . . . L E S C O N N A I S S A N C E S S U I V A N T E S , . . . * POUR PLUS DE DÉTAILS, VOIR P. 19-21. J U G E M E N T P R I N C I P A L : POUR POSER UN JUGEMENT SUR... LES PRINCIPALES VARIABLES ET LES « MOTEURS » DE LA MISSION DE VÉRIFICATION... LE PRATICIEN DOIT POSSÉDER... Gouverne, gestion et reddition de comptes ❍ q ❍ Performance ❍ q ❍ Systèmes et pratiques de gestion ❍ q ❍ Contrôle ❍ q ❍ Vérification axée sur la gestion économique, efficiente ❍ ❍ q et efficace des ressources et des deniers Vérification axée sur la conformité aux q ❍ ❍ autorisations et sur l'information financière Organisation de vérification du praticien ❍ q ❍ Champ d'activité de l'entité à vérifier ❍ ❍ q Science du comportement q ❍ ❍ Disciplines connexes q ❍ ❍ Recherche et analyse ❍ q ❍ Gestion de projets ❍ ❍ ❍ Assurance de la qualité q ❍ ❍ DOMAINES CONNAISSANCE ÉLÉMENTAIRE CONNAISSANCE PRATIQUE CONNAISSANCE APPROFONDIE . . . L E S H A B I L E T É S S U I V A N T E S . . . * POUR PLUS DE DÉTAILS, VOIR P. 21-23. DOMAINES Habiletés d'ordre professionnel ou technique Vérification axée sur la gestion économique, efficiente ❍ ❍ q et efficace des ressources ou des deniers Évaluation de la performance d’une organisation ❍ q ❍ Recherche et analyse ❍ q ❍ Assurance de la qualité q ❍ ❍ Habiletés en matière de gestion Gestion générale q ❍ ❍ Gestion de projets ❍ ❍ ❍ Habiletés d'ordre général Raisonnement analytique ❍ ❍ q Raisonnement conceptuel ❍ ❍ q Communication ❍ q ❍ Entregent ❍ q ❍ . . . E T L ' E X P É R I E N C E S U I V A N T E . * POUR PLUS DE DÉTAILS, VOIR P. 23-24. ASPECT « RÔLE » ASPECT « ÉTENDUE » ASPECT « CONTEXTE » MEMBRE CHEF DE CERTAINE SIGNIFICATIVE VASTE RELATIVEMENT AU CHAMP DOMAINE D’ÉQUIPE PROJET DIRIGEANT <2ANS 2-4ANS >5ANS D'ACTIVITÉDEL'ENTITÉÀVÉRIFIER Vérification axée sur la gestion ❍ q ❍ ❍ ❍ q q économique, efficiente et efficace des ressources et des deniers EXPÉRIENCE EXPÉRIENCE EXPÉRIENCE NIVEAUDEBASE NIVEAUINTERMÉDIAIRE NIVEAUAVANCÉ
- 34. C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N3 0 COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE EN VÉRIFICATION INTÉGRÉE . . . L E S C O N N A I S S A N C E S S U I V A N T E S , . . . * POUR PLUS DE DÉTAILS, VOIR P. 19-21. J U G E M E N T P R I N C I P A L : POUR POSER UN JUGEMENT SUR... LES PRINCIPAUX PARAMÈTRES DE LA MISSION DE VÉRIFICATION... LE PRATICIEN DOIT POSSÉDER... Gouverne, gestion et reddition de comptes ❍ q ❍ Performance ❍ ❍ q Systèmes et pratiques de gestion ❍ ❍ q Contrôle ❍ ❍ q Vérification axée sur la gestion économique, efficiente ❍ ❍ q et efficace des ressources et des deniers Vérification axée sur la conformité aux q ❍ ❍ autorisations et sur l'information financière Organisation de vérification du praticien ❍ q ❍ Champ d'activité de l'entité à vérifier ❍ ❍ q Science du comportement q ❍ ❍ Disciplines connexes ❍ q ❍ Recherche et analyse ❍ q ❍ Gestion de projets ❍ ❍ ❍ Assurance de la qualité ❍ q ❍ DOMAINES CONNAISSANCE ÉLÉMENTAIRE CONNAISSANCE PRATIQUE CONNAISSANCE APPROFONDIE . . . L E S H A B I L E T É S S U I V A N T E S . . . * POUR PLUS DE DÉTAILS, VOIR P. 21-23. DOMAINES Habiletés d'ordre professionnel ou technique Vérification axée sur la gestion économique, efficiente ❍ ❍ q et efficace des ressources ou des deniers Évaluation de la performance d’une organisation ❍ q ❍ Recherche et analyse ❍ q ❍ Assurance de la qualité ❍ q ❍ Habiletés en matière de gestion Gestion générale q ❍ ❍ Gestion de projets ❍ ❍ ❍ Habiletés d'ordre général Raisonnement analytique ❍ ❍ q Raisonnement conceptuel ❍ ❍ q Communication ❍ q ❍ Entregent ❍ q ❍ . . . E T L ' E X P É R I E N C E S U I V A N T E . * POUR PLUS DE DÉTAILS, VOIR P. 23-24. ASPECT « RÔLE » ASPECT « ÉTENDUE » ASPECT « CONTEXTE » MEMBRE CHEF DE CERTAINE SIGNIFICATIVE VASTE RELATIVEMENT AU CHAMP DOMAINE D’ÉQUIPE PROJET DIRIGEANT <2ANS 2-4ANS >5ANS D'ACTIVITÉDEL'ENTITÉÀVÉRIFIER Vérification axée sur la gestion ❍ q ❍ ❍ ❍ q q économique, efficiente et efficace des ressources et des deniers EXPÉRIENCE EXPÉRIENCE EXPÉRIENCE NIVEAUDEBASE NIVEAUINTERMÉDIAIRE NIVEAUAVANCÉ
- 35. C H A P I T R E 5 : C O R R É L A T I O N E N T R E L E S C O M P É T E N C E S P R O F E S S I O N N E L L E S N É C E S S A I R E S E T L E S P R I N C I P A U X J U G E M E N T S E N V É R I F I C A T I O N 3 1 COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE EN VÉRIFICATION INTÉGRÉE . . . L E S C O N N A I S S A N C E S S U I V A N T E S , . . . * POUR PLUS DE DÉTAILS, VOIR P. 19-21. J U G E M E N T P R I N C I P A L : POUR POSER UN JUGEMENT SUR... LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION POUR LA MISSION DE VÉRIFICATION... LE PRATICIEN DOIT POSSÉDER... Gouverne, gestion et reddition de comptes ❍ q ❍ Performance q ❍ ❍ Systèmes et pratiques de gestion q ❍ ❍ Contrôle q ❍ ❍ Vérification axée sur la gestion économique, efficiente ❍ ❍ q et efficace des ressources et des deniers Vérification axée sur la conformité aux ❍ ❍ ❍ autorisations et sur l'information financière Organisation de vérification du praticien ❍ q ❍ Champ d'activité de l'entité à vérifier ❍ q ❍ Science du comportement ❍ q ❍ Disciplines connexes q ❍ ❍ Recherche et analyse q ❍ ❍ Gestion de projets q ❍ ❍ Assurance de la qualité q ❍ ❍ DOMAINES CONNAISSANCE ÉLÉMENTAIRE CONNAISSANCE PRATIQUE CONNAISSANCE APPROFONDIE . . . L E S H A B I L E T É S S U I V A N T E S . . . * POUR PLUS DE DÉTAILS, VOIR P. 21-23. DOMAINES Habiletés d'ordre professionnel ou technique Vérification axée sur la gestion économique, efficiente ❍ q ❍ et efficace des ressources ou des deniers Évaluation de la performance d’une organisation ❍ ❍ ❍ Recherche et analyse ❍ ❍ ❍ Assurance de la qualité ❍ ❍ ❍ Habiletés en matière de gestion Gestion générale q ❍ ❍ Gestion de projets q ❍ ❍ Habiletés d'ordre général Raisonnement analytique ❍ q ❍ Raisonnement conceptuel ❍ q ❍ Communication ❍ q ❍ Entregent ❍ q ❍ . . . E T L ' E X P É R I E N C E S U I V A N T E . * POUR PLUS DE DÉTAILS, VOIR P. 23-24. ASPECT « RÔLE » ASPECT « ÉTENDUE » ASPECT « CONTEXTE » MEMBRE CHEF DE CERTAINE SIGNIFICATIVE VASTE RELATIVEMENT AU CHAMP DOMAINE D’ÉQUIPE PROJET DIRIGEANT <2ANS 2-4ANS >5ANS D'ACTIVITÉDEL'ENTITÉÀVÉRIFIER Vérification axée sur la gestion ❍ q ❍ ❍ q ❍ ❍ économique, efficiente et efficace des ressources et des deniers EXPÉRIENCE EXPÉRIENCE EXPÉRIENCE NIVEAUDEBASE NIVEAUINTERMÉDIAIRE NIVEAUAVANCÉ
- 36. C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N3 2 COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE EN VÉRIFICATION INTÉGRÉE . . . L E S C O N N A I S S A N C E S S U I V A N T E S , . . . * POUR PLUS DE DÉTAILS, VOIR P. 19-21. J U G E M E N T P R I N C I P A L : POUR POSER UN JUGEMENT SUR... L'ASSURANCE DE LA QUALITÉ DE LA MISSION DE VÉRIFICATION... LE PRATICIEN DOIT POSSÉDER... Gouverne, gestion et reddition de comptes ❍ ❍ q Performance ❍ ❍ q Systèmes et pratiques de gestion ❍ ❍ q Contrôle ❍ ❍ q Vérification axée sur la gestion économique, efficiente ❍ ❍ q et efficace des ressources et des deniers Vérification axée sur la conformité aux ❍ ❍ ❍ autorisations et sur l'information financière Organisation de vérification du praticien ❍ ❍ q Champ d'activité de l'entité à vérifier q ❍ ❍ Science du comportement q ❍ ❍ Disciplines connexes q ❍ ❍ Recherche et analyse ❍ q ❍ Gestion de projets ❍ q ❍ Assurance de la qualité ❍ ❍ q DOMAINES CONNAISSANCE ÉLÉMENTAIRE CONNAISSANCE PRATIQUE CONNAISSANCE APPROFONDIE . . . L E S H A B I L E T É S S U I V A N T E S . . . * POUR PLUS DE DÉTAILS, VOIR P. 21-23. DOMAINES Habiletés d'ordre professionnel ou technique Vérification axée sur la gestion économique, efficiente ❍ ❍ q et efficace des ressources ou des deniers Évaluation de la performance d’une organisation ❍ ❍ q Recherche et analyse ❍ q ❍ Assurance de la qualité ❍ ❍ q Habiletés en matière de gestion Gestion générale q ❍ ❍ Gestion de projets q ❍ ❍ Habiletés d'ordre général Raisonnement analytique ❍ ❍ q Raisonnement conceptuel ❍ ❍ q Communication ❍ q ❍ Entregent ❍ q ❍ . . . E T L ' E X P É R I E N C E S U I V A N T E . * POUR PLUS DE DÉTAILS, VOIR P. 23-24. ASPECT « RÔLE » ASPECT « ÉTENDUE » ASPECT « CONTEXTE » MEMBRE CHEF DE CERTAINE SIGNIFICATIVE VASTE RELATIVEMENT AU CHAMP DOMAINE D’ÉQUIPE PROJET DIRIGEANT <2ANS 2-4ANS >5ANS D'ACTIVITÉDEL'ENTITÉÀVÉRIFIER Vérification axée sur la gestion ❍ q ❍ ❍ ❍ q ❍ économique, efficiente et efficace des ressources et des deniers EXPÉRIENCE EXPÉRIENCE EXPÉRIENCE NIVEAUDEBASE NIVEAUINTERMÉDIAIRE NIVEAUAVANCÉ
- 37. C H A P I T R E 5 : C O R R É L A T I O N E N T R E L E S C O M P É T E N C E S P R O F E S S I O N N E L L E S N É C E S S A I R E S E T L E S P R I N C I P A U X J U G E M E N T S E N V É R I F I C A T I O N 3 3 COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE EN VÉRIFICATION INTÉGRÉE . . . L E S C O N N A I S S A N C E S S U I V A N T E S , . . . * POUR PLUS DE DÉTAILS, VOIR P. 19-21. J U G E M E N T P R I N C I P A L : POUR POSER UN JUGEMENT SUR... LA SÉLECTION ET LA MISE EN ŒUVRE D'UN SYSTÈME DE GESTION DE PROJETS APPROPRIÉ POUR LA MISSION DE VÉRIFICATION... LE PRATICIEN DOIT POSSÉDER... Gouverne, gestion et reddition de comptes ❍ ❍ ❍ Performance q ❍ ❍ Systèmes et pratiques de gestion q ❍ ❍ Contrôle q ❍ ❍ Vérification axée sur la gestion économique, efficiente ❍ ❍ q et efficace des ressources et des deniers Vérification axée sur la conformité aux ❍ ❍ ❍ autorisations et sur l'information financière Organisation de vérification du praticien ❍ ❍ q Champ d'activité de l'entité à vérifier ❍ q ❍ Science du comportement ❍ q ❍ Disciplines connexes q ❍ ❍ Recherche et analyse q ❍ ❍ Gestion de projets ❍ q ❍ Assurance de la qualité ❍ q ❍ DOMAINES CONNAISSANCE ÉLÉMENTAIRE CONNAISSANCE PRATIQUE CONNAISSANCE APPROFONDIE . . . L E S H A B I L E T É S S U I V A N T E S . . . * POUR PLUS DE DÉTAILS, VOIR P. 21-23. DOMAINES Habiletés d'ordre professionnel ou technique Vérification axée sur la gestion économique, efficiente ❍ q ❍ et efficace des ressources ou des deniers Évaluation de la performance d’une organisation ❍ ❍ ❍ Recherche et analyse ❍ ❍ ❍ Assurance de la qualité ❍ q ❍ Habiletés en matière de gestion Gestion générale q ❍ ❍ Gestion de projets ❍ q ❍ Habiletés d'ordre général Raisonnement analytique ❍ q ❍ Raisonnement conceptuel ❍ q ❍ Communication ❍ q ❍ Entregent ❍ q ❍ . . . E T L ' E X P É R I E N C E S U I V A N T E . * POUR PLUS DE DÉTAILS, VOIR P. 23-24. ASPECT « RÔLE » ASPECT « ÉTENDUE » ASPECT « CONTEXTE » MEMBRE CHEF DE CERTAINE SIGNIFICATIVE VASTE RELATIVEMENT AU CHAMP DOMAINE D’ÉQUIPE PROJET DIRIGEANT <2ANS 2-4ANS >5ANS D'ACTIVITÉDEL'ENTITÉÀVÉRIFIER Vérification axée sur la gestion ❍ q ❍ ❍ q ❍ ❍ économique, efficiente et efficace des ressources et des deniers EXPÉRIENCE EXPÉRIENCE EXPÉRIENCE NIVEAUDEBASE NIVEAUINTERMÉDIAIRE NIVEAUAVANCÉ
- 38. C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N3 4 COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE EN VÉRIFICATION INTÉGRÉE . . . L E S C O N N A I S S A N C E S S U I V A N T E S , . . . * POUR PLUS DE DÉTAILS, VOIR P. 19-21. J U G E M E N T P R I N C I P A L : POUR POSER UN JUGEMENT SUR... LA PRÉPARATION ET LA COMMUNICATION DE L'OPINION OU DU RAPPORT DE VÉRIFICATION INTÉGRÉE... LE PRATICIEN DOIT POSSÉDER... Gouverne, gestion et reddition de comptes ❍ ❍ q Performance ❍ ❍ q Systèmes et pratiques de gestion ❍ ❍ q Contrôle ❍ ❍ q Vérification axée sur la gestion économique, efficiente ❍ ❍ q et efficace des ressources et des deniers Vérification axée sur la conformité aux ❍ ❍ ❍ autorisations et sur l'information financière Organisation de vérification du praticien ❍ q ❍ Champ d'activité de l'entité à vérifier ❍ ❍ q Science du comportement ❍ q ❍ Disciplines connexes ❍ q ❍ Recherche et analyse ❍ q ❍ Gestion de projets q ❍ ❍ Assurance de la qualité ❍ q ❍ DOMAINES CONNAISSANCE ÉLÉMENTAIRE CONNAISSANCE PRATIQUE CONNAISSANCE APPROFONDIE . . . L E S H A B I L E T É S S U I V A N T E S . . . * POUR PLUS DE DÉTAILS, VOIR P. 21-23. DOMAINES Habiletés d'ordre professionnel ou technique Vérification axée sur la gestion économique, efficiente ❍ q ❍ et efficace des ressources ou des deniers Évaluation de la performance d’une organisation ❍ q ❍ Recherche et analyse ❍ q ❍ Assurance de la qualité ❍ q ❍ Habiletés en matière de gestion Gestion générale q ❍ ❍ Gestion de projets q ❍ ❍ Habiletés d'ordre général Raisonnement analytique ❍ ❍ q Raisonnement conceptuel ❍ ❍ q Communication ❍ ❍ q Entregent ❍ ❍ q . . . E T L ' E X P É R I E N C E S U I V A N T E . * POUR PLUS DE DÉTAILS, VOIR P. 23-24. ASPECT « RÔLE » ASPECT « ÉTENDUE » ASPECT « CONTEXTE » MEMBRE CHEF DE CERTAINE SIGNIFICATIVE VASTE RELATIVEMENT AU CHAMP DOMAINE D’ÉQUIPE PROJET DIRIGEANT <2ANS 2-4ANS >5ANS D'ACTIVITÉDEL'ENTITÉÀVÉRIFIER Vérification axée sur la gestion ❍ q ❍ ❍ ❍ q q économique, efficiente et efficace des ressources et des deniers EXPÉRIENCE EXPÉRIENCE EXPÉRIENCE NIVEAUDEBASE NIVEAUINTERMÉDIAIRE NIVEAUAVANCÉ
- 39. C H A P I T R E 5 : C O R R É L A T I O N E N T R E L E S C O M P É T E N C E S P R O F E S S I O N N E L L E S N É C E S S A I R E S E T L E S P R I N C I P A U X J U G E M E N T S E N V É R I F I C A T I O N 3 5 COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE EN VÉRIFICATION INTÉGRÉE . . . L E S C O N N A I S S A N C E S S U I V A N T E S , . . . * POUR PLUS DE DÉTAILS, VOIR P. 19-21. J U G E M E N T P R I N C I P A L : POUR POSER UN JUGEMENT SUR... L'IMPACT ET LA VALEUR AJOUTÉE DE LA MISSION DE VÉRIFICATION... LE PRATICIEN DOIT POSSÉDER... Gouverne, gestion et reddition de comptes ❍ q ❍ Performance ❍ q ❍ Systèmes et pratiques de gestion ❍ q ❍ Contrôle ❍ q ❍ Vérification axée sur la gestion économique, efficiente ❍ ❍ q et efficace des ressources et des deniers Vérification axée sur la conformité aux ❍ ❍ ❍ autorisations et sur l'information financière Organisation de vérification du praticien q ❍ ❍ Champ d'activité de l'entité à vérifier ❍ q ❍ Science du comportement ❍ q ❍ Disciplines connexes ❍ q ❍ Recherche et analyse ❍ q ❍ Gestion de projets q ❍ ❍ Assurance de la qualité ❍ q ❍ DOMAINES CONNAISSANCE ÉLÉMENTAIRE CONNAISSANCE PRATIQUE CONNAISSANCE APPROFONDIE . . . L E S H A B I L E T É S S U I V A N T E S . . . * POUR PLUS DE DÉTAILS, VOIR P. 21-23. DOMAINES Habiletés d'ordre professionnel ou technique Vérification axée sur la gestion économique, efficiente ❍ q ❍ et efficace des ressources ou des deniers Évaluation de la performance d’une organisation ❍ q ❍ Recherche et analyse ❍ q ❍ Assurance de la qualité ❍ q ❍ Habiletés en matière de gestion Gestion générale ❍ q ❍ Gestion de projets q ❍ ❍ Habiletés d'ordre général Raisonnement analytique ❍ ❍ q Raisonnement conceptuel ❍ ❍ q Communication ❍ ❍ q Entregent ❍ q ❍ . . . E T L ' E X P É R I E N C E S U I V A N T E . * POUR PLUS DE DÉTAILS, VOIR P. 23-24. ASPECT « RÔLE » ASPECT « ÉTENDUE » ASPECT « CONTEXTE » MEMBRE CHEF DE CERTAINE SIGNIFICATIVE VASTE RELATIVEMENT AU CHAMP DOMAINE D’ÉQUIPE PROJET DIRIGEANT <2ANS 2-4ANS >5ANS D'ACTIVITÉDEL'ENTITÉÀVÉRIFIER Vérification axée sur la gestion ❍ ❍ q ❍ ❍ q ❍ économique, efficiente et efficace des ressources et des deniers EXPÉRIENCE EXPÉRIENCE EXPÉRIENCE NIVEAUDEBASE NIVEAUINTERMÉDIAIRE NIVEAUAVANCÉ
- 40. C H A P I T R E 6 QUESTIONS CONNEXES I N T R O D U C T I O N Au cours de notre étude, nous nous sommes également penchés sur les deux questions suivantes : • la mesure dans laquelle les jugements à poser en vérification et les compétences professionnelles re- quises pour y arriver diffèrent quelque peu pour le vérificateur externe et pour le vérificateur interne • le rôle du spécialiste en ce qui concerne le juge- ment en vérification et la compétence profession- nelle. O B S E R V A T I O N S E T D I S C U S S I O N Compte tenu de la structure des symposiums remue-méninges et de la priorité donnée aux questions concernant le jugement en vérification et la compétence professionnelle, ces rencontres ne nous ont pas vraiment permis d’aborder ni la question du vérificateur externe c. le vérificateur interne ni celle du rôle du praticien comme deux points distincts à l’ordre du jour. Au cours des symposiums cependant, des commentaires sur ces deux questions ont été relevés. LE V É R I F I C AT E U R E X T E R N E C . L E V É R I F I C AT E U R I N T E R N E La stratégie commune adoptée durant les sympo- siums remue-méninges a consisté à faire participer des vérificateurs tant externes qu’externes aux mêmes sous- groupes. On a pensé que les différences caractéris- tiques, s’il en existait, auraient été mises en évidence soit dans les délibérations en sous-groupes, soit dans les dis- cussions en plénière. Dans l’ensemble cependant, aucune différence majeure n’a été signalée. Voici les points et les observations soulevés : EN C E Q U I C O N C E R N E L E S J U G E M E N T S E N V É R I F I C AT I O N En général, on a estimé que les jugements sont essentiellement les mêmes pour ces deux types de prati- ciens. De plus, autant pour le vérificateur externe que pour le vérificateur interne, ces jugements se situent davantage sur le plan stratégique, même si ces deux praticiens exercent leurs activités dans un environ- nement de gouverne sensiblement différent : le vérifica- teur externe a pour clients des instances élues ou nommées, comme les législatures et les conseils d’ad- ministration; le vérificateur interne, selon le type d’en- treprise qui l’emploie, a pour client le chef de la direction (et parfois le conseil d’administration). Certains ont relevé que l’environnement de gouverne du vérificateur interne est plus centralisé que celui du vérificateur externe, et c’est peut-être pour cette raison aussi que d’autres participants aux sympo- siums ont souligné que cet environnement est moins complexe. On a aussi observé qu’en vérification interne, le client exerce habituellement une plus grande influence sur les jugements concernant la sélection des éléments à vérifier et sur l’étendue de la mission, et également que l’étendue de la vérification a tendance à être en général plus restreinte que, par exemple, pour la vérification législative. Les vérificateurs internes ont aussi indiqué qu’une plus grande pression est exercée sur eux (que, par exemple, sur les vérificateurs législa- tifs) pour montrer l’impact et la valeur ajoutée de leur travail de vérification. EN C E Q U I C O N C E R N E L E S C O N N A I S S A N C E S R E Q U I S E S En général, on considère que l’éventail de connais- sances requises chez le praticien est sensiblement le même que la vérification soit externe ou interne. Plusieurs per- sonnes observent qu’on s’attend à ce que les vérificateurs internes possèdent une meilleure connaissance de l’entité à vérifier. Compte tenu de la nature de leur rôle, ces derniers auront aussi vraisemblablement tendance à met- tre un plus grand accent sur une connaissance en vérifica- tion axée sur la conformité aux autorisations. Quant aux vérificateurs externes, on estime qu’ils font plus souvent appel aux services de spécialistes extérieurs. EN C E Q U I C O N C E R N E L E S H A B I L E T É S R E Q U I S E S Plusieurs participants aux symposiums remue- méninges ont observé que les habiletés requises des vérificateurs internes et celles des vérificateurs externes convergent actuellement. Aucune différence inhérente et significative n’a été relevée. C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N3 6
- 41. EN C E Q U I C O N C E R N E L’E X P É R I E N C E R E Q U I S E E N V É R I F I C AT I O N Le processus général pour choisir la personne qui posera le jugement et pour déterminer l’expérience re- quise par celle-ci afin d’y arriver est le même qu’il s’agisse d’une vérification interne ou externe. LE R Ô L E D U S P É C I A L I S T E Pour autant que cela concerne le rôle du spécia- liste, comme nous l’avons déjà mentionné, les partici- pants ont observé que la contribution du spécialiste se situe vraisemblablement au niveau des jugements qui ont trait aux principales variables constituant le moteur de la vérification (étendue, degré de certitude à offrir et importance relative), aux principaux paramètres (critères de vérification convenables, éléments probants suffisants et adéquats, etc.) et à l’assurance de la qualité. Pour les grandes organisations de vérification, ces spécialistes peuvent déjà faire partie du personnel perma- nent (dans le domaine de la gestion des ressources humaines, de la mesure de l’efficacité, etc.). Pour les organisations de plus petite taille, on ferait appel à des spécialistes de l’extérieur, ce qui soulèverait le défi d’avoir à s’assurer que ces experts sont correctement sensibilisés aux politiques et procédés de vérification du bureau ou de l’organisation afin de savoir en quoi et comment leur travail se rapporte à la mission de vérification. Le défi à relever par le praticien ici consiste à pos- séder une connaissance suffisante pour superviser, inter- préter et utiliser le travail du spécialiste dans le cadre de la mission globale de la vérification. Ces deux questions sont discutées dans les Normes relatives aux missions de certification14, promulguées par l’ICCA après le lancement de l’étude de la FCVI sur la compétence professionnelle. Au moment de mettre sous presse, l’ICCA prévoyait effectuer d’autres recherches dans ce domaine. C H A P I T R E 6 : Q U E S T I O N S C O N N E X E S 3 7 14 MANUEL DE L’ICCA, PARA. 5025.29-.34, .61.
- 42. C H A P I T R E 7 CONCLUSIONS C E Q U E N O U S M O N T R E L ’ É T U D E On peut tirer plusieurs conclusions de la recherche qui a mené à la publication du présent rap- port. Les voici énoncées succinctement. D’abord, les praticiens admettent la nécessité d’avoir des lignes directrices à jour sur la compétence professionnelle en vérification intégrée. Ce qui existe actuellement ne suffit plus; la diversité de la pratique nous oblige à revoir les exigences en matière de compé- tence. Par ailleurs, ces lignes directrices doivent être suffisamment souples, car elles s’adressent à des prati- ciens et à des organisations qui exercent leurs activités dans des environnements fort variés. Une vaste documentation existe en la matière et, de manière générale, elle porte sur une discussion et un examen des connaissances et des habiletés requises chez le praticien. Dans la présente étude, nous avons ajouté la dimension « expérience » comme un autre facteur important à considérer; la compétence professionnelle comporte donc trois dimensions : connaissances, habiletés et expérience. Il est à la fois possible et utile d’aborder le sujet en cernant les principaux jugements que le praticien doit poser en vérification. Une fois qu’on a obtenu un consensus sur ces principaux jugements, on peut déter- miner pour chacun d’eux les connaissances, les habiletés et l’expérience requises pour que le praticien puisse exercer un jugement professionnel en toute confiance. Enfin, on peut formuler les lignes directrices sur la compétence professionnelle en vérification intégrée sous forme de cadres référentiels basés sur les principaux jugements à poser par les praticiens en vérification. U S A G E S P O T E N T I E L S D E S R É S U L T A T S D ’ É T U D E Les résultats de cette étude peuvent être utilisées de plusieurs façons. Voici des exemples d’utilisation possible pour les vérificateurs, les organisations et les clients, ainsi que pour ceux qui offrent des services de soutien en matière de perfectionnement professionnel dans le domaine de la vérification intégrée et des ser- vices de certification. LE V É R I F I C AT E U R Nos propos peuvent servir d’outils aux praticiens pour évaluer leur propre compétence professionnelle en fonction des principaux jugements qu’ils sont appelés à poser ou, selon les circonstances, à soutenir en vérification. Les praticiens peuvent ensuite utiliser les résultats de cette autoévaluation pour démontrer leur compé- tence professionnelle relativement à leurs rôles et responsabilités. Par ailleurs, ils peuvent s’en servir pour cerner leurs besoins en perfectionnement professionnel et déterminer les domaines particuliers à améliorer et ce, soit en fonction de leurs responsabilités actuelles ou comme moyen de se positionner pour assumer des responsabilités plus importantes dans leur carrière. Tout praticien appelé à exercer un jugement pro- fessionnel relativement à la conception ou au déploiement des équipes de vérification dans le cadre de missions particulières trouvera dans cet ouvrage des conseils pratiques. L’O R G A N I S AT I O N D E V É R I F I C AT I O N Nos propos s’adressent également aux organisa- tions de vérification. À titre d’exemple, les outils peu- vent servir de guide dans les discussions sur plusieurs questions clés. Quelle est la nature des principaux juge- ments en vérification qu’il faut poser au sein de l’orga- nisation ? Dans l’organisation, qui porte ces divers jugements ? Dans quelle mesure cela est-il approprié, compte tenu de l’orientation de la direction de l’organi- sation ? Les personnes qui posent ces jugements possè- dent-elles la compétence requise ? Les résultats de ces discussions aident l’organisa- tion de vérification à cerner les besoins en perfection- nement professionnel et à concevoir des stratégies pour répondre à ces besoins (p. ex., éducation, formation et affectations). On peut également les utiliser pour la planification des carrières et de la relève. De plus, nos propos peuvent aider l’organisation de vérification à cerner les domaines d’expertise qu’elle doit établir et développer, ou à décider quand il con- vient de faire appel à des spécialistes de l’extérieur. C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N3 8
- 43. CL I E N T S Tout comme les résultats de l’étude servent de base aux praticiens et aux organisations de vérification pour démontrer leur compétence professionnelle, ils permettent aussi aux clients d’obtenir une certaine assurance quant à la qualité des services et produits qu’ils reçoivent. FO U R N I S S E U R S D E S O U T I E N E N M AT I È R E D E P E R F E C T I O N N E M E N T Les concepts et les cadres référentiels présentés dans ce rapport peuvent servir de points de référence à ceux qui offrent des produits et des services de perfection- nement aux praticiens en vérification intégrée et ce, en ce qui concerne les programmes d’études, les plans de cours ainsi que la conception et la mise sur pied de cours. * * * * * Les résultats de cette recherche ajoutent à notre compréhension de la compétence professionnelle en vérification intégrée. Comme pour le document publié en 1984, le présent rapport se veut un document « vivant », que l’on modifiera et élargira selon les besoins. C H A P I T R E 7 : C O N C L U S I O N S 3 9
- 44. C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N4 0 ANNEXES C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N
- 45. A N N E X E A HISTORIQUE DU PROJET DE RECHERCHE I N T R O D U C T I O N La genèse du projet de recherche se trouve dans les résultats de la seconde revue quinquennale de la FCVI effectuée par son conseil d’administration au début des années 1990. Cette revue a permis de cerner plusieurs domaines demandant une étude plus poussée, dont la nécessité de procurer un soutien aux praticiens de la vérification intégrée. Une fois la revue terminée, on a dressé un plan stratégique pour guider le travail de la FCVI au cours des trois années suivantes. Approuvé par le con- seil d’administration de la FCVI, ce plan comportait plusieurs initiatives touchant l’orientation stratégique visant à « appuyer les praticiens de la vérification inté- grée ». Le premier travail consistait à consolider l’ensem- ble des connaissances en vérification intégrée, réunissant ainsi près de deux décennies de réflexion et de pratique. Le deuxième travail portait sur la nécessité de mettre à jour, de réviser et d’élargir le programme et les activités de perfectionnement de la FCVI afin de tenir compte de cette consolidation de l’ensemble des connaissances. Enfin, le troisième travail concernait la nécessité d’exa- miner la question de la compétence professionnelle en vérification intégrée. On reconnaissait l’étroite corréla- tion entre ces trois initiatives. Comme nous l’avons mentionné précédemment, il y a dix ans la FCVI avait déjà abordé un aspect de la compétence professionnelle lors de la publication de son document intitulé Un guide sur ce que le praticien doit savoir pour effectuer des vérifications intégrées. On estimait que le travail de recherche à entreprendre dans le domaine des compétences professionnelles s’ap- puierait sur cette première publication. D É V E L O P P E M E N T S A B O U T I S S A N T A U P R O J E T S U R L A C O M P É T E N C E P R O F E S S I O N N E L L E PR E M I È R E S C O N S U LTAT I O N S Comme travail préparatoire au projet sur la com- pétence professionnelle, et compte tenu du projet mené en parallèle sur la consolidation de l’ensemble des con- naissances accumulées en vérification intégrée, on a franchi certaines étapes exploratoires. Ces étapes avait pour objet d’obtenir le point de vue des praticiens sur les aspects suivants : l’étendue du projet, les facteurs et les décisions devant influencer son objet, les propositions et les questions à aborder et enfin la façon de procéder. Le processus a débuté par une réunion avec les chefs de file en vérification intégrée œuvrant dans les bureaux de vérification législative fédéral et provinciaux. Lors de cette rencontre, les participants ont signalé les problèmes avec lesquels leurs organisations devaient composer, problèmes aggravés par le fait qu’on n’avait pas encore défini clairement la compétence profession- nelle du praticien en vérification intégrée. Plusieurs observations et questions ont découlé de cette discus- sion, notamment : • la récente remise en cause par le public des com- pétences du praticien de la vérification intégrée • la nécessité d’élargir l’étendue de la vérification au-delà des domaines traditionnels afin de donner une valeur ajoutée et un soutien aux priorités des gouvernements, et l’impact qu’aura ce virage sur les connaissances et les habiletés requises chez le praticien • le virage anticipé vers l’attestation des déclarations de la direction, et la conviction que cela mettra davantage l’accent sur la preuve de la compétence professionnelle • l’augmentation du nombre de membres du per- sonnel ayant une formation autre qu’en comp- tabilité ou en vérification, et la nécessité de définir les connaissances et les habiletés que doivent pos- séder ces individus • une meilleure connaissance de la vérification inté- grée chez les entités à vérifier, occasionnant ainsi une augmentation de la demande pour des vérifi- cations et la création d’attentes plus élevées C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N 4 1
- 46. • la restriction des budgets de formation en raison des contraintes financières, et le désir d’utiliser avec sagesse les fonds disponibles. À la lumière de ces développements, le groupe de vérificateurs législatifs a estimé nécessaire de mettre à jour le document de 1984 sur les compétences requises du praticien et de tenir compte de cette mise à jour dans toute activité de formation et de perfectionnement de la FCVI. Pour démontrer leur compétence en vérifi- cation intégrée, les praticiens devaient, selon ce groupe, pouvoir s’appuyer sur des normes ainsi que sur un ensemble de connaissances bien définies. Par ailleurs, les bureaux de vérification législative ont indiqué qu’il leur fallait un ensemble de connaissances bien articulées pour les guider dans leurs efforts d’assurer la formation de leur personnel et pour les aider à élaborer des plans de carrière appropriés. En 1993, dans le cadre du congrès national de la FCVI, Larry Meyers (alors sous-vérificateur général du Canada) a insisté sur cette problématique. Dans son allocution, il a mentionné la tendance émergente d’obtenir un consensus sur le travail à accomplir et a déclaré que le temps était venu de passer à l’action. « [...] rien n’a été fait parce que c’est difficile, et parce que nous n’avions ni le consensus ni la volonté nécessaires. Cependant, nous pos- sédons aujourd’hui une plus grande expéri- ence [...] Il nous faut passer à l’action! » DÉ C I S I O N S C L É S S E RVA N T D E F O N D E M E N T S Comme étape suivante, la FCVI a organisé un symposium remue-méninges; cette fois-ci, elle réunis- sait des représentants d’un éventail plus large de prati- ciens en vérification intégrée, dont des vérificateurs législatifs, des vérificateurs internes ainsi que des experts-comptables et conseillers en gestion. Ce sympo- sium avait pour but d’obtenir des conseils sur les objec- tifs du projet de recherche, sur son étendue et sur la façon de procéder. Les délibérations de ce symposium nous ont per- mis de dégager les principaux éléments du plan de recherche. Les décisions clés prises initialement ont servi de fondements au projet de recherche. DÉ F I N I T I O N D E L A V É R I F I C AT I O N Premièrement, on a décidé d’adopter la définition suivante de la vérification : La vérification renforce les liens de respon- sabilité qui découlent de l’obligation de rendre compte. C’est une évaluation des systèmes et pratiques de gestion, ou une évaluation des déclarations de la direction en matière de per- formance qui permet de déterminer la fidélité de l’information communiquée, ou encore une évaluation de la performance globale. L’évaluation doit être indépendante, objec- tive, fondée sur des critères et destinée à l’instance gouvernante ou à tout autre inter- venant investi de responsabilités semblables. FO C A L I S AT I O N S U R L E S P R I N C I PA U X J U G E M E N T S E N V É R I F I C AT I O N Deuxièmement, on a décidé de se concentrer en priorité sur les principaux jugements que le praticien est appelé à poser dans le cadre de la vérification intégrée. Ce point de départ nous permettait d’adopter une approche de recherche axée sur les résultats et de fonc- tionner avec une base commune, laquelle était jugée nécessaire en raison des variations importantes dans la taille et la structure des organisations de vérification. ÉL A R G I S S E M E N T D E L’É T E N D U E D E L A C O M P É T E N C E P R O F E S S I O N N E L L E Troisièmement, on a décidé de ne pas limiter la recherche à la question des « connaissances ». Il a été jugé important de se pencher sur les « habiletés » et sur l’ « expérience », deux dimensions qui, avec les connais- sances, constituent la notion de « compétence profes- sionnelle ». De ces trois dimensions, c’est l’ « expérience » qui est perçue comme l’innovation du présent rapport de recherche. BE S O I N D E F L E X I B I L I T É Quatrièmement, on a décidé d’aborder la question de la compétence professionnelle de manière à faciliter l’utilisation des résultats dans une variété de contextes professionnels. Un vaste éventail de praticiens participent à la pratique de la vérification intégrée (p. ex., les vérificateurs législatifs, les vérificateurs internes, les professionnels œuvrant dans les cabinets d’experts-comptables offrant des services de vérification interne et externe). Les orga- 4 2 A N N E X E A : H I S T O R I Q U E D U P R O J E T D E R E C H E R C H E
- 47. nisations de vérification auxquelles appartiennent ces praticiens varient par leur taille et leur structure hiérar- chique. À titre d’exemple, les grands cabinets privés comptent des milliers de professionnels; le nombre de ces derniers dans les bureaux de vérification législative varie entre plusieurs centaines et moins d’une vingtaine; et les fonctions de vérification interne peuvent disposer d’un nombre se situant entre plusieurs douzaines de profes- sionnels à seulement quelques individus. Qui plus est, les praticiens exerçant à différents niveaux hiérarchiques au sein de leur organisation peu- vent être appelés à poser des jugements qui eux-mêmes sont d’une nature différente. Cela s’explique parfois par des facteurs comme la taille de l’organisation de vérifi- cation, sa culture de gestion et la capacité profession- nelle de ses praticiens. Les praticiens peuvent aussi travailler selon des modèles de vérification différents (c.-à-d. le modèle axé sur la vérification des systèmes et des pratiques de ges- tion, le modèle axé sur l’attestation des déclarations de la direction sur la performance, ou le modèle axé sur la vérification de la performance, ou encore un modèle hybride basé sur ceux-ci). La vérification intégrée peut s’exercer dans le con- texte de la vérification interne ou dans celui de la vérifi- cation externe, et ainsi de suite. On a donc estimé que le projet de recherche devrait tenir compte de toutes ces différences et qu’il faudrait articuler ses résultats de façon à permettre leur utilisation dans les divers contextes professionnels décrits précédemment. MI S E À L’E S S A I D E C E RTA I N E S D E S P R O P O S I T I O N S D E B A S E En 1994, dans le cadre du congrès national de la FCVI, on a organisé une séance consacrée à ce projet de recherche. Celle-ci a eu lieu après la tenue du sympo- sium remue-méninges et après qu’on ait pris les déci- sions initiales sur lesquelles fonder le projet de recherche. L’objet consistait à obtenir le point de vue d’un nombre encore plus élevé de praticiens et de débattre un certain nombre des propositions clés touchant la compétence professionnelle. Le débat a été suivi par un questionnaire; dans celui-ci, on invitait les participants à voter sur les principales propositions et à donner leurs commentaires. Les questions, au nombre de 122, ont été analysées et utilisées dans les recherches. Voici les deux propositions qui ont retenu le plus l’at- tention et le consensus des participants : • tout praticien en vérification intégrée doit pouvoir démontrer qu’il possède une compétence mini- male (peu importe l’éducation reçue ou l’expé- rience acquise) • il est nécessaire et possible de déterminer et de mesurer les connaissances et l’expérience requises. Les congressistes ont aussi appuyé la proposition que ces exigences envers le praticien en matière de com- pétence professionnelle devraient être définies en termes de responsabilités et de jugements à poser en vérification. L E P R O J E T D E R E C H E R C H E S U R L A C O M P É T E N C E P R O F E S S I O N N E L L E Les résultats de ces initiatives exploratoires ont constitué la base de l’élaboration du mandat du projet de recherche qui a été approuvé par le comité de recherche de la FCVI. Le mandat consistait à cerner les principaux juge- ments à poser en vérification intégrée et ensuite à déter- miner les connaissances, les habiletés et l’expérience requises chez le praticien pour être en mesure de poser ces jugements. Il s’agissait aussi de déterminer si les jugements à poser en vérification intégrée et si la compé- tence professionnelle requise pour y arriver sont les mêmes pour le vérificateur externe et pour le vérificateur interne, et de définir le rôle du spécialiste dans tout cela. L’approche adoptée pour mener à bien cette étude a comporté deux volets : d’une part, un examen de la documentation et des travaux effectués par d’autres, et d’autre part, la tenue d’une série de séances remue- méninges avec des praticiens issus des principaux secteurs de la pratique de la vérification intégrée. EX A M E N D E L A D O C U M E N TAT I O N Au premier stade du projet de recherche, nous avons mené une étude approfondie de toute documen- tation pertinente. La méthodologie adoptée pour exécuter cet exa- men a comporté plusieurs étapes. Une recherche sur support électronique a permis de repérer toute la docu- mentation publiée dans ce domaine. Plusieurs discus- sions ont été engagées avec des individus et des groupes possédant des connaissances et une expérience en vérifi- C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N 4 3
- 48. cation intégrée ou dans la définition de la compétence professionnelle. On a mené des consultations pour obtenir des pistes sur la documentation existante et ce, tant sur des ouvrages publiés que sur des écrits non publiés mais accessibles au public. Ces étapes nous ont permis de dresser une biblio- graphie initiale d’une cinquantaine de documents que nous avons ensuite examinés. Les éléments clés relevés et analysés ont ensuite fait l’objet d’un document de discussion. Celui-ci est devenu à toutes fins utiles un document « vivant » que nous avons mis à jour pério- diquement tout au long du projet de recherche. SY M P O S I U M S R E M U E -M É N I N G E S Compte tenu de la nature exploratoire de la recherche et de la complexité du sujet à traiter, les sym- posiums remue-méninges sont devenus la principale composante de l’approche de recherche adoptée. (À l’annexe B, on décrit le déroulement d’une séance remue-méninges type.) Au total, nous avons tenu huit séances remue- méninges, auxquelles ont participé quelque quatre-vingts professionnels chefs de file en vérification intégrée, dont des vérificateurs législatifs, des vérificateurs internes, des experts-comptables et des universitaires. Dans presque tous les cas, les groupes ont représenté tous les secteurs de la pratique. La composition de ces groupes a con- tribué à l’obtention de discussions animées; même si la majorité des participants partageaient essentiellement une connaissance et une expérience commune en vérifi- cation intégrée, chacun a abordé les questions de recherche en fonction de son propre bagage : son man- dat de vérification, sa perspective organisationnelle, ses responsabilités et son niveau d’expérience. Les séances remue-méninges se sont échelonnées sur plusieurs mois, à divers endroits au pays. Durant les semaines séparant la tenue de ces séances, nous avons pu retravailler le document de discussion, les cadres référentiels et le déroulement des séances en fonction des commentaires et des conseils reçus lors des séances précédentes. Ainsi, les travaux d’un groupe s’appuyaient sur les délibérations du groupe précédent. Au premier symposium, les participants se sont penchés sur les questions préliminaires à trancher pour répondre aux deux objectifs de la recherche, soit de déterminer les principaux jugements à poser en vérifica- tion intégrée et de définir les compétences requises pour y arriver. Les travaux de ce premier symposium ont donc servi de base aux délibérations du deuxième groupe de participants qui se sont penchés toujours sur ces deux même objectifs de recherche. Le processus adopté, consistant à tenir des délibérations, à retravailler les documents de discussion et à tenir d’autres délibéra- tions, a permis à l’équipe de recherche de présenter aux participants de chaque nouveau symposium un docu- ment de discussion plus complet et des cadres référen- tiels plus précis. RÉ D AC T I O N D U R A P P O RT La dernière étape du processus de recherche a con- sisté à rédiger le rapport qui réunit les résultats de l’exa- men de la documentation, les délibérations des symposiums remue-méninges et les consultations con- nexes. On a présenté pour discussion l’ébauche du rap- port à un vaste éventail de personnes qui ont contribué au projet, et on y a apporté les révisions appropriées. 4 4 A N N E X E A : H I S T O R I Q U E D U P R O J E T D E R E C H E R C H E
- 49. A N N E X E B DESCRIPTION D’UNE SÉANCE REMUE- MÉNINGES TYPE Une séance remue-méninges type s’échelonne sur une journée et implique la participation de huit à douze personnes et de deux animateurs. La séance comporte plusieurs étapes. En plénière, on présente d’abord aux participants un survol du projet : les fondements et les objectifs du projet; un résumé des propositions et des postulats clés; une explication des principales questions à trancher et de l’approche à adopter; et, une revue de l’état d’avan- cement des travaux et des résultats obtenus jusqu’à ce jour. Toujours en plénière, on invite ensuite les partici- pants à discuter du cadre référentiel sur les principaux jugements. Plus tard dans la journée, ces jugements serviront de fondements à un examen des compétences professionnelles requises pour poser chacun de ces juge- ments. Dans presque tous les symposiums, les discus- sions sur ces jugements portent sur toute une gamme de questions au fur et à mesure que les participants explorent les points de vue des uns et des autres, ainsi que le cadre référentiel fourni. Après cette étape, on présente un aperçu du concept de « compétence professionnelle », soit les connaissances, les habiletés et l’expérience requises. Habituellement, cela incite les participants à une discussion générale. C’est à ce stade-ci du symposium qu’on divise les participants en sous-groupes pour qu’ils discutent et établissent une corrélation entre les principaux juge- ments à poser et les connaissances, les habiletés et l’ex- périence requises pour y arriver. Après leurs délibérations, les sous-groupes revien- nent en plénière pour présenter leurs résultats et en dis- cuter davantage. Les deux dernières étapes occupent la majeure partie de la journée. Nous avons eu rarement le temps de discuter des questions de recherche auxiliaires : la mesure dans laquelle les jugements à poser en vérifica- tion et les compétences professionnelles requises pour y arriver ne sont pas les mêmes pour le vérificateur externe et pour le vérificateur interne; et le rôle du spé- cialiste en ce qui concerne ces jugements et la compé- tence professionnelle. Cependant, il est arrivé fréquemment que certains aspects de ces deux questions aient été soulevés dans les discussions générales. Qui plus est, ces symposiums et les divers sous-groupes ont été composés à la fois de vérificateurs externes et de vérificateurs internes. Par conséquent, s’il existait des différences inhérentes, elles auraient été mises en évi- dence dans les exposés des sous-groupes ainsi que dans les discussions subséquentes en plénière. Enfin, au sujet des quatre cadres référentiels étudiés – Principaux jugements en vérification, Connaissances requises, Habiletés requises et Expérience requise – les participants sont aussi invités à se pencher sur les trois questions suivantes : • A-t-on omis un élément crucial ? • A-t-on inclus un élément qui ne devrait pas figurer dans le cadre référentiel ? • En ce qui concerne les éléments inclus dans le cadre référentiel, et ceux qui devraient y figurer, quelle(s) autre(s) amélioration(s) doit-on y apporter ? En se basant sur les réponses à ces questions et sur les discussions tenues au cours de la journée, on retra- vaille les cadres référentiels et le document de discussion qui serviront de fondements aux participants de la prochaine séance remue-méninges. C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N 4 5
- 50. A N N E X E C SOMMAIRE DES CONNAISSANCES, DES HABILITÉS ET DE L’EXPÉRIENCE REQUISES Au chapitre 5, on présente dix grilles qui relient individuellement les dix principaux jugements aux con- naissances, aux habiletés et à l’expérience que le prati- cien de la vérification se doit de posséder pour poser ces jugements. Nous reprenons ici cette même information mais nous la reformulons de sorte à présenter au lecteur intéressé un survol distinct de chacune de ces trois dimensions de la compétence professionnelle. C O N N A I S S A N C E S R E Q U I S E S Le tableau 1 montre l’étendue ou le niveau de con- naissances jugé nécessaire chez le praticien dans chaque domaine afin qu’il puisse poser chacun des dix jugements principaux en vérification. Voici l’échelle utilisée : 1 = connaissance élémentaire 2 = connaissance pratique 3 = connaissance approfondie Une case ombragée signifie qu’une connaissance dans ce domaine n’est pas nécessaire pour poser le juge- ment en question. Comme on le constate en parcourant le tableau 1, plusieurs domaines de connaissances entrent en ligne de compte pour chacun des jugements. Cependant, le niveau de connaissance requis varie selon le jugement à poser. Les domaines suivants nécessitent toujours une connaissance de niveau plus élevé : • gouverne, gestion et reddition de comptes • vérification intégrée • organisation de vérification du praticien • champ d’activité de l’entité à vérifier. Il importe aussi de mentionner les deux tendances suivantes. • Pour la vérification axée sur la conformité aux autorisations et sur l’information financière, une connaissance élémentaire est nécessaire pour poser les jugements ayant trait au positionnement de la fonction de vérification ou à l’exécution d’une mission de vérification. • On ne requiert pas des connaissances en gestion de projets pour tous les jugements à poser en véri- fication. La gestion de projets constitue une par- tie importante de toute vérification, et il importe d’avoir une bonne connaissance pratique des principes, des pratiques, etc., connexes lorsqu’on formule des jugements sur la sélection et la mise en œuvre d’un système de gestion de projets lors de la vérification, ainsi que sur l’assurance de la qualité. Pour plusieurs autres jugements, on requiert du praticien qu’il possède une connais- sance élémentaire dans ce domaine. H A B I L E T É S R E Q U I S E S Le tableau 2 donne un survol des habiletés requi- ses relativement aux dix jugements à poser en vérifica- tion. Comme pour le tableau sur les connaissances requises, on utilise l’échelle d’évaluation suivante : 1 = niveau de base 2 = niveau intermédiaire 3 = niveau avancé. Aussi, comme pour les connaissances requises, la plupart des catégories entrent en jeu pour chacun des dix jugements; la différence se situe au niveau de l’éten- due des habiletés nécessaires pour soutenir chacun des jugements. Lorsque les domaines d’habiletés sont similaires aux catégories de connaissances correspondantes, le niveau d’habileté requis n’est jamais plus élevé que le niveau de connaissance requis. Les domaines suivants nécessitent un niveau d’ha- bileté toujours plus élevé : • vérification intégrée • évaluation de la performance d’une organisation • raisonnement analytique et conceptuel • communication et entregent. C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N4 6
- 51. E X P É R I E N C E R E Q U I S E On met l’accent ici est mis sur l’expérience acquise en vérification axée sur la gestion économique, efficiente et efficace des ressources et deniers (c.-à-d. la vérification intégrée). Cela ne signifie aucunement qu’une expérience dans d’autres types de vérification, ou dans d’autres contextes, ne peut pas assister le praticien dans sa formulation des jugements à poser en vérifica- tion intégrée. Par contre, cela veut dire qu’une expéri- ence en vérification intégrée est nécessaire comme base pour poser ces jugements, compte tenu que la nature de l’expérience acquise en vérification intégrée peut varier selon le jugement dont il s’agit. Le tableau 3 présente un survol des aspects « rôle », « étendue » et « contexte » de l’expérience requise rela- tivement aux dix jugements à poser en vérification. Les jugements portant sur le positionnement ou l’orientation de la fonction de vérification intégrée ou de la mission particulière reviennent au praticien qui assume le rôle de « dirigeant » (désigné comme D dans le tableau 3), tandis que les jugements portant sur la planification, l’exécution et la communication des résul- tats de la mission reviennent au praticien qui assume le rôle de « chef de projet » (désigné comme C). Dans tous les cas, on exige un niveau d’expérience variant entre ce que l’on qualifie d’expérience significative (de 2 à 4 ans) et de vaste expérience (5 ans ou plus). En attribuant les différents jugements au rôle de dirigeant ou de chef de projet, les personnes consultées ont tou- jours tenu à préciser l’important rôle de soutien que jouent les membres de l’équipe et, le cas échéant, les spécialistes quant aux jugements à poser en vérification. Dans l’aspect « contexte », on indique qu’il est nécessaire qu’une partie de l’expérience pour certains jugements ait été acquise dans la vérification d’entités exerçant leurs activités dans le même domaine ou dans un domaine similaire. Une telle expérience de vérifica- tion est importante parce qu’elle sert de fondements aux jugements à poser relativement au positionnement de la fonction de vérification intégrée et à la planification, à l’exécution et à la communication des résultats d’une mission particulière. La nécessité de posséder une expérience dans la vérification de la même entité ou d’une entité similaire n’est pas essentielle par contre pour les autres jugements à poser; pour ces derniers, on estime que l’expérience en vérification peut plus facile- ment se transférer d’une situation à une autre. C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N 4 7
- 52. 4 8 A N N E X E C : S O M M A I R E D E S C O N N A I S S A N C E S , D E S H A B I L I T É S E T D E L ’ E X P É R I E N C E R E Q U I S E S Gouverne, gestion et reddition de comptes Performance Systèmes et pratiques de gestion Contrôle Vérification axée sur la gestion économique, efficiente et efficace des ressources et des deniers Vérification axée sur la conformité aux autori- sations et sur l'infor- mation financière Organisation de véri- fication du praticien Champ d'activité de l'entité à vérifier Science du comportement Disciplines connexes Recherche et analyse Gestion de projets Assurance de la qualité Positionnement stratégique par rapport à la vérification intégrée 3 2 2 2 3 1 3 2 2 1 1 1 1 Orientation et objet de chaque mission de vérification intégrée 2 2 2 2 3 1 3 2 1 1 1 1 1 Modèle de vérification à adopter pour la mission de vérification 2 2 2 2 3 1 3 2 1 1 1 2 Principales variables et « moteurs » de la mission de vérification 2 2 2 2 3 1 2 3 1 1 2 1 Principaux paramètres de la mission de vérification 2 3 3 3 3 1 2 3 1 2 2 2 Stratégie de communication pour la vérification 2 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 Assurance de la qualité de la mission de vérification 3 3 3 3 3 3 1 1 1 2 2 3 Sélection et mise en œuvre d'un système de gestion de projets pour la vérification 1 1 1 3 3 2 2 1 1 2 2 Préparation et communication de l'opinion ou du rapport de vérification 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 1 2 Impact et valeur ajoutée de la mission de vérification 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 Jugements Domaines de connaissancess TABLEAU 1 : ÉTENDUE DES CONNAISSANCES REQUISES POUR CHAQUE JUGEMENT À POSER EN VÉRIFICATION C O N N A I S S A N C E É L É M E N TA I R E 2 = C O N N A I S S A N C E P R AT I Q U E 3 = C O N N A I S S A N C E A P P R O F O N D I E C A S E O M B R AG É E = S A N S O B J E T
- 53. C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N 4 9 Habiletés d'ordre pro- fessionnel ou technique Vérification axée sur la gestion économique, efficiente et efficace des ressources et des deniers Évaluation de la per- formance de l’or- ganisation Recherche et analyse Assurance de la qualité Habiletésenmatière degestion Gestion générale Gestion de projets Habiletésd'ordregénéral Raisonnement analytique Raisonnement conceptuel Communication Entregent Positionnement stratégique par rapport à la vérification intégrée 3 2 1 1 3 1 3 3 3 3 Orientation et objet de chaque mission de vérification intégrée 2 2 1 1 1 1 3 3 2 2 Modèle de vérification à adopter pour la mission de vérification 2 2 1 2 1 3 3 2 2 Principales variables et « moteurs » de la mission de vérification 3 2 2 1 1 3 3 2 2 Principaux paramètres de la mission de vérification 3 2 2 2 1 3 3 2 2 Stratégie de communication pour la vérification 2 1 1 2 2 2 2 Assurance de la qualité de la mission de vérification 3 3 2 3 1 1 3 3 2 2 Sélection et mise en œuvre d'un système de ges- tion de projets pour la vérification 2 2 1 2 2 2 2 2 Préparation et communication de l'opinion ou du rapport de vérification 2 2 2 2 1 1 3 3 3 3 Impact et valeur ajoutée de la mission de vérification 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2 Jugements Domaines d’habiletés TABLEAU 2 : ÉTENDUE DES HABILETÉS REQUISES POUR CHAQUE JUGEMENT À POSER EN VÉRIFICATION N I V E A U D E B A S E 2 = N I V E A U I N T E R M É D I A I R E 3 = N I V E A U AVA N C É C A S E O M B R AG É E = S A N S O B J E T
- 54. 5 0 A N N E X E C : S O M M A I R E D E S C O N N A I S S A N C E S , D E S H A B I L I T É S E T D E L ’ E X P É R I E N C E R E Q U I S E S TABLEAU 3 : EXPÉRIENCE REQUISE POUR CHAQUE JUGEMENT À POSER EN VÉRIFICATION, SELON LES ASPECTS « RÔLE », « ÉTENDUE » ET « CONTEXTE » D = D I R I G E A N T C = C H E F D E P R O J E T 2-4 = E X P É R I E N C E S I G N I F I C AT I V E , 2 À 4 A N S ≥5 = VA S T E E X P É R I E N C E , 5 A N S O U P LU S CA = C H A M P D 'AC T I V I T É D E L 'E N T I T É À V É R I F I E R C A S E O M B R AG É E = G É N É R A L Vérification axée sur la gestion économique, efficiente et efficace des ressources et des deniers Aspects Rôle Étendue Contexte Positionnement stratégique par rapport à la vérification intégrée D ≥5 CA Orientation et objet de chaque mission de vérification intégrée D 2-4 CA Modèle de vérification à adopter pour la mission de vérification D 2-4 Principales variables et « moteurs » de la mission de vérification C ≥5 CA Principaux paramètres de la mission de vérification C ≥5 CA Stratégie de communication pour la vérification C 2-4 Assurance de la qualité de la mission de vérification C ≥5 Sélection et mise en œuvre d'un système de gestion de projets pour la vérification C 2-4 Préparation et communication de l'opinion ou du rapport de vérification C ≥5 CA Impact et valeur ajoutée de la mission de vérification D ≥5 Jugements Domaine d’expérience
- 55. C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N 5 1 A N N E X E D INITIATIVES CONNEXES CONCERNANT LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE Depuis quelques années, la question de la compé- tence professionnelle du vérificateur retient de plus en plus l’attention et ce, au fur et à mesure que l’environ- nement de gestion dans lequel le vérificateur est appelé à travailler se transforme et que la profession de vérifica- tion elle-même évolue. Cette annexe décrit une grande variété d’initiatives lancées par la FCVI et par bien d’autres organisations pour examiner les questions liées à la compétence pro- fessionnelle – selon le point de vue du comptable ou du vérificateur, mais aussi dans d’autres contextes. I N I T I A T I V E S L A N C É E S P A R L A F C V I En 1984, la FCVI publie un document intitulé, Un guide sur ce que le praticien doit savoir pour effectuer des vérifications intégrées. À cette époque, la vérification inté- grée est encore considérée comme un art ou une science très jeunes. Néanmoins, les décideurs ainsi que les vérifi- cateurs admettent la nécessité de commencer à développer une documentation sur le genre de connaissances que doivent posséder les praticiens en vérification intégrée, ainsi que toute autre personne participant à ces travaux. Le document vise à répondre à la question : Quelles connaissances une personne doit-elle posséder pour être qualifiée de praticien en vérification intégrée ? L’ouvrage met l’accent sur les connaissances et n’aborde pas spécifiquement les autres dimensions comme les habiletés, l’expérience et les aptitudes. L’objet du docu- ment consiste à aider les praticiens actuels et éventuels en vérification intégrée à définir leurs besoins et à plani- fier leurs programmes en matière de perfectionnement professionnel. Se voulant la première étape d’un processus d’articulation de cet ensemble de connais- sances, le guide tient compte du fait qu’avec l’évolution de la pratique de la vérification intégrée, les compé- tences connexes requises évolueront elles aussi. En 1987, la Fondation publie le rapport de recherche intitulé La communication et la vérification de l’information sur l’efficacité dans le secteur public. Ce rap- port trace les grandes lignes d’une approche selon laquelle les dirigeants communiquent l’information sur l’efficacité de l’organisation sous forme de déclarations de la direc- tion et ce, afin d’aider l’instance gouvernante à se faire une opinion sur la performance de l’organisation. Cette approche est possible, précise-t-on dans le rapport, seule- ment s’il existe un système de contrôle et de vérification, dont un aspect fondamental consiste à obtenir une décla- ration de fiabilité pour appuyer ces déclarations de la direction sur l’efficacité. Le Groupe indépendant chargé de cette étude invite alors les vérificateurs à investir dans leur propre perfectionnement sur ces questions et à par- ticiper à l’élaboration – tant théorique que pratique – des concepts de comptabilité et de vérification nécessaires en matière de performance pour soutenir une telle approche. On vient alors de monter la barre de la compétence pro- fessionnelle requise ! En 1991, la FCVI publie le rapport de recherche intitulé Le Rapport de vérification intégrée. Concepts, ques- tions et pratiques. Cette publication vise à aider le prati- cien ainsi que le client à clarifier les choix à poser – et leurs implications à poser – lorsqu’ils discutent des vérifi- cations à effectuer. On y explore les questions de certifi- cation et d’importance relative et on offre des conseils et des recommandations au praticien pour qu’il aborde ces questions de façon explicite et claire dans le rapport de vérification intégrée. La barre de la compétence profes- sionnelle vient d’être relevée d’un autre cran ! En 1996, la Fondation publie l’ouvrage intitulé Reddition de comptes, rapport sur la performance et vérifi- cation intégrée. Une vue d’ensemble. Ce manuel est le fruit d’un grand projet de recherche entrepris par la FCVI pour mettre à jour et pour consolider l’ensemble de connaissances que l’on peut associer avec la pratique actuelle de la vérification intégrée. Ce manuel fournit donc des fondements solides, nécessaires pour jeter les bases de la recherche actuelle de la FCVI sur la compé- tence professionnelle. Au cours de l’exercice 1996-1997, la FCVI entre- prend la refonte totale de son programme et de ses acti- vités de formation et de perfectionnement. L’objet de ce travail est d’établir un programme complet et intégré de formation destiné aux praticiens, programme qui s’ap- puie sur l’ensemble des connaissances décrites dans le
- 56. C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N5 2 manuel de 1996. Ces travaux tiennent compte des résul- tats de l’étude sur la compétence professionnelle. I N I T I A T I V E S P R O V E N A N T D ’ A U T R E S S O U R C E S Le principe directeur adopté pour ce projet de recherche consiste à utiliser, si possible, le travail mené par d’autres ou à s’en servir comme base. Le projet débute donc par un examen approfondi de la documentation publiée sur la compétence professionnelle et, lorsque cela était adéquat, d’une sélection d’ouvrages non publiés. Plusieurs organismes professionnels et certaines organisations de vérification – au Canada et à l’étranger – ont effectué des travaux importants dans ce domaine. Voici une brève description du thème, des réflexions et des résultats de quelques-unes de ces initiatives. OR G A N I S M E S P R O F E S S I O N N E L S D E C O M P TA B I L I T É E T D E V É R I F I C AT I O N IN S T I T U T C A N A D I E N D E S C O M P TA B L E S AG R É É S (ICCA) Depuis de nombreuses années, l’ICCA aborde la question de la compétence professionnelle selon dif- férents points de vue et dans plusieurs contextes. Constamment considéré comme une question d’importance cruciale, le sujet retient l’attention dans des initiatives fondamentales, comme le rapport de 1986 du Comité des stratégies à long terme de l’ICCA intitulé Le défi du changement et le rapport précurseur de 1996 du Groupe de travail pancanadien sur la vision de la profession. À titre d’exemple, dans le rapport sur la Vision, on présente la question des connaissances et des compétences comme l’un des huit axes stratégiques essentiels à l’accomplissement de la mission et à la réali- sation de la vision énoncée dans ce document et sur lesquels il faut focaliser les efforts15 . Les Normes de vérification de l’optimisation des ressources de 1988 et les Normes relatives aux missions de certification de 1997 traitent explicitement, elles aussi, de la compétence professionnelle. Dans les normes de 1997, on stipule que : « Le praticien et les autres personnes qui par- ticipent à la mission de certification doivent avoir une compétence professionnelle adéquate à l’exécution de ce type de mission16 . » Les normes de certification traitent aussi des défis soulevés par la question des compétences profession- nelles pour le praticien, lorsque celui-ci a recours à des spécialistes pendant une mission. Parmi les autres travaux connexes utilisés, citons le rapport de 1981 intitulé Report of the Committee to Study Specialization in the Canadian Chartered Accountancy Profession (publié en anglais seulement), le rapport de recherche de 1995 intitulé Le jugement pro- fessionnel en vérification, et le projet de recherche sur la Prise de renseignements comme source d’éléments probants17. De plus, le Programme en vue de l’admission au sein de la profession de comptable agréé de l’ICCA constitue un source utile de références. Bien qu’il ne se limite pas à la vérification intégrée, le Programme présente un ensemble d’idées sur les connaissances des concepts et techniques de vérification, et sur les habiletés de base connexes; cette ensemble s’est avéré particulièrement utile pour la présente étude sur la compétence professionnelle. On peut aussi s’attendre à ce que le travail du Groupe de travail sur les services de certification (travail en cours au moment de mettre sous presse) ait des implications sur les compétences professionnelles. Ce groupe de travail de l’ICCA collabore, entre autres, avec l’American Institute of CPAs sur plusieurs projets de certification, dont la mesure de la performance, l’éva- luation du risque et le commerce électronique. Tous ces projets comportent d’importantes considérations sur la compétence professionnelle. AM E R I C A N IN S T I T U T E O F CE RT I F I E D PU B L I C AC C O U N TA N T S (AICPA) Le comité spécial de l’AICPA sur les services de cer- tification s’est vu attribuer le mandat d’analyser l’état, tant actuel que futur, de la fonction de vérification ou de certi- fication ainsi que les tendances qui la façonnent, et d’en faire rapport. En 1997, après deux années de recherches, il publie son rapport sur support électronique. Un aspect du travail de ce comité porte sur le domaine des compétences, c’est-à-dire sur les connais- sances et les habiletés nécessaires aujourd’hui à la presta- tion des services de certification, ainsi que sur les compétences qui seront requises à l’avenir. A N N E X E D : I N I T I A T I V E S C O N N E X E S C O N C E R N A N T L A C O M P É T E N C E P R O F E S S I O N N E L L E 15 ICCA, RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL PANCANADIEN SUR LA VISION DE LA PROFESSION, TORONTO, ICCA, FÉVRIER 1996, P. 27-29. 16 MANUEL DE L’ICCA, PARA. 5025.28 17 AU MOMENT DE METTRE LE PRÉSENT RAPPORT SOUS PRESSE, CE PROJET N’AVAIT PAS ENCORE ÉTÉ TERMINÉ.
- 57. C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N 5 3 Le travail du sous-comité chargé d’examiner cette question s’appuie sur le travail considérable accompli par les cabinets de CPA pour cerner les compétences, sur les discussions supplémentaires tenues avec les pro- fessionnels en ressources humaines de ces cabinets et sur les résultats de l’étude de 1993 intitulée Competency- based Standards for Professional Accountants in Australia and New Zealand, soit « les normes basées sur les com- pétences professionnelles à l’intention des experts- comptables en Australie et en Nouvelle-Zélande ». (On discute de cette étude plus loin.) Dans son rapport, le comité de l’AICPA relève dix-neuf domaines de compétences (soit, une combinai- son d’habiletés et de connaissances) pertinents à la prestation de services de certification aujourd’hui, et quinze autres domaines qui devront être requis à l’avenir. Il en conclut qu’il existe vingt et un domaines de compétences dans lesquels le certificateur doit avoir acquis une bonne expertise lorsqu’il a affaire avec ce que l’on caractérise dans le rapport de l’AICPA comme d’ « évolution des services de vérification ou d’attesta- tion ». Il s’agit des domaines suivants : • normes de vérification • normes comptables • esprit d’analyse • consultation en administration • connaissance des affaires • communications • aptitudes intellectuelles • commercialisation et vente • gestion du risque de vérification • établissement de schémas • développement des ressources humaines • gestion des relations • rapidité et capacité d’adaptation • technologie • compréhension des processus opérationnels du client • vérification • connaissance des processus impliqués dans l’éta- blissement de la mission, de la vision et des objectifs • connaissance des stratégies d’entreprise • connaissance théorique des mesures et compé- tences en matière de définition et d’élaboration des mesures • compréhension des données et de leurs limites • compréhension de l’analyse de sensibilité. De plus, le comité de l’AICPA estime que d’autres domaines de services s’ouvrent actuellement pour les certificateurs. Les plus marquants sont les domaines comme la mesure de la performance de l’entreprise, l’évaluation du risque et le commerce électronique, domaines pour lesquels l’AICPA indique que des com- pétences professionnelles additionnelles sont requises. OR G A N I S M E S P R O F E S S I O N N E L S E N AU S T R A L I E E T E N NO U V E L L E -ZÉ L A N D E En 1993, on termine une vaste étude sur les com- pétences professionnelles des experts-comptables en Australie et en Nouvelle-Zélande. Voici la définition de l’approche adoptée face à l’étude des compétences professionnelles : « La compétence professionnelle com- prend une notion relationnelle – la façon dont des dimensions distinctes (connaissances, habiletés et attitudes) entrent en jeu dans l’accomplissement de tâches dans des contextes particuliers de travail (l’efficacité du travail accompli, ou la performance). La compétence professionnelle se manifeste dans la performance. Donc, elle se définit en fonction du type particulier de tâche à accomplir, en termes de travail à effectuer et de qualité avec laquelle la performance est réalisée. Les perfor- mances ainsi définies sont donc appelées des normes de compétence professionnelle18 . » Six domaines différents de pratique pour les comptables sont examinés au cours de l’étude. De tous, c’est le premier domaine – celui de la vérification – qui nous intéresse ici. Le rapport d’étude définit les compé- tences requises pour trois types de missions de vérifica- tion, soit : les missions axées sur les déclarations (vérification de l’information financière et celle non financière préparées par la direction); les missions axées sur la conformité aux autorisations; et les missions axées sur la vérification de la performance (évaluation de la qualité des processus touchant la gestion, les opérations et les procédés dans une organisation). 18 W.P. BIRKETT, COMPETENCY-BASED STANDARDS FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS IN AUSTRALIA AND NEW ZEALAND, AUSTRALIE, AUSTRALIAN SOCIETY OF CERTIFIED PRACTISING ACCOUNTANTS, INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF AUSTRALIA, ET NEW ZEALAND SOCIETY OF ACCOUNTANTS, 1993, P. IX.
- 58. C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N5 4 IN S T I T U T D E S V É R I F I C AT E U R S I N T E R N E S La dernière édition du Common Body of Knowledge for the Practice of Internal Auditing (CBOK) de l’Institut remonte à 1992. S’appuyant sur un vaste sondage mené auprès des praticiens, le rapport relève plus de trois cents domaines de compétences dans vingt disciplines différentes. Périodiquement, l’Institut met à jour ce manuel et, au moment de mettre sous presse, il est en train de le faire. Ce travail s’inscrit dans le cadre d’une étude plus vaste traitant du cadre référentiel sur la compétence professionnelle en vérification interne. Les résultats de cette étude devront être publiés avant la fin de 1998. OR G A N I S AT I O N S D E V É R I F I C AT I O N Plusieurs organisations de vérification au Canada et à l’étranger se sont aussi penchées sur la question des compétences professionnelles nécessaires à la pratique de la vérification de l’optimisation des ressources. BU R E A U D U V É R I F I C AT E U R G É N É R A L D U CA N A D A Dans le cadre d’un programme continu, le Bureau du vérificateur général du Canada a mis au point un modèle de compétences définissant les compétences générales qui s’appliquent à trois échelons du personnel de vérification (le vérificateur, le chef de mission et le cadre supérieur) engagé soit dans des travaux d’attestation, soit dans la vérification d’optimisation des ressources (VOR). Le niveau de compétence est établi en fonction des trois échelons du personnel affecté à la vérification. Le modèle s’appuie sur une seule compétence principale pour le Bureau, soit : « Vérification législative – Fournir des assurances fiables, pertinentes et en temps opportun et d’autre information sur le rendement financier et le rendement des programmes afin d’aider les lé- gislateurs à tenir le gouvernement comptable19. » Des compétences générales soutiennent cette com- pétence principale et se divisent en cinq catégories : • Efficacité organisationnelle – il s’agit de créer le soutien interne et externe nécessaire au Bureau pour remplir son mandat. Pour ce faire, il faut comprendre et promouvoir la mission, les valeurs et les objectifs du Bureau, obtenir le soutien des autres en vue d’actions et de résultats particuliers, favoriser l’apprentissage et le perfectionnement des employés du Bureau, et assurer la promotion du développement durable. • Compétences professionnelles – il s’agit d’acquérir et d’appliquer les connaissances et les compétences professionnelles nécessaires pour effectuer le tra- vail attribué. Cela sous-entend des connaissances dans les domaines suivants : gouverne, maîtrise professionnelle, compétences techniques, résolu- tion de problèmes et prise de décision, connais- sance du client, et gestion des produits. • Établissement des relations – il s’agit d’établir des relations de confiance et de respect avec les collègues et les entités vérifiées, c’est-à-dire de savoir travailler en équipe et constituer des équipes, et de savoir tra- vailler avec les clients et d’autres personnes. • Expertise en communications – il s’agit essentielle- ment de posséder des compétences dans les domaines suivants : discussions et exposés, rédac- tion et communication de l’information, et com- munications informelles. • Efficacité personnelle – il s’agit d’entretenir une relation dynamique, engagée et équilibrée à l’égard du travail. Pour ce faire, il faut posséder des attri- buts personnels comme les valeurs et l’engagement, l’initiative, la capacité et un engagement face à l’environnement et au développement durable. Parce que le Bureau compte du personnel dans d’autres disciplines que celles de l’expertise-comptable et de la vérification, il est particulièrement intéressant de voir comment le modèle aborde la question des compé- tences professionnelles requises des praticiens non for- més en expertise-comptable ou en vérification. Le modèle générique met davantage l’accent sur la nécessité de conserver le statut professionnel et de faire preuve de maîtrise professionnelle, mais il ne précise pas l’obten- tion d’une qualité ou d’un titre professionnel particulier. BU R E A U D U V É R I F I C AT E U R G É N É R A L D E L A CO LO M B I E - BR I TA N N I Q U E Dans le cadre d’un processus s’appliquant à l’ensemble de l’administration, le Bureau a mis au point une série d’énoncés sur la compétence professionnelle de son unité de vérification sur la performance20 . A N N E X E D : I N I T I A T I V E S C O N N E X E S C O N C E R N A N T L A C O M P É T E N C E P R O F E S S I O N N E L L E 19 BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA, MODÈLE DE COMPÉTENCES, OTTAWA, BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA, 1997, SOMMAIRE–P. 1-2. 20 BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, COMPETENCIES BY LEVEL, VICTORIA, OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL OF BRITISH COLUMBIA, 1997, P. 3-15.
- 59. C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N 5 5 Le modèle définit les éléments de travail et établit la corrélation entre ceux-ci et les connaissances, les habiletés, la volonté ou les qualités que l’employé doit posséder pour être en mesure de s’acquitter correcte- ment de son travail. Chaque élément de travail est relié à un des quatre échelons du personnel : le premier vérificateur, le chef de projet, le chef de projet principal, et le directeur principal. Par « connaissance », on entend une connaissance des faits, des théories, des systèmes, des approches et des éléments liés au travail à effectuer. Par « habileté » ou « capacité », on entend une expertise dans l’application de ses aptitudes, de ses connaissances et de son talent à effectuer les travaux. Six éléments de travail sont associés à la dimen- sion « connaissance » : • pratiques de gouverne, de reddition de comptes ou de mesure de la performance dans l’administra- tion publique • méthodologie en matière de vérification de la per- formance ou d’étude de la performance ou d’é- tude opérationnelle • différents modèles de vérification • questions de gestion à trancher dans l’administra- tion gouvernementale et dans le secteur public • domaines fonctionnels comme : la planification stratégique, la gestion financière, la comptabilité, le marketing, la gestion des opérations, la gestion des ressources humaines, et la gestion des systèmes d’information • un secteur gouvernemental comme la santé, l’édu- cation, les services sociaux et les transports. Douze éléments de travail sont associés aux habiletés d’ordre technique ou analytique : • sélection du projet de vérification • détermination de l’étendue de la vérification et préparation du plan de vérification • élaboration des critères d’évaluation touchant les pratiques de gestion et de reddition de comptes • sélection et application des méthodes de collecte de données • triage et évaluation de l’information, et formula- tion d’une conclusion • informatique • gestion de la mission de vérification • services au client • écoute et expression orale • expression écrite • présentation • engagement auprès des associations profession- nelles, le cas échéant. La dernière catégorie concerne la gestion. Celle-ci comporte les cinq éléments de travail suivants : • gestion du temps • gestion du personnel et sa formation • leadership • travail d’équipe • engagement face au bureau et contribution à la VOR. Comme le Bureau du vérificateur général du Canada, le bureau de vérification de la C.-B. compte parmi son personnel des employés qui n’ont pas une formation en comptabilité ou en vérification. De plus, le bureau s’at- tend, comme le bureau fédéral, à ce que son personnel con- serve son statut professionnel, même si aucune désignation professionnelle distincte n’est attribuée. LE VÉ R I F I C AT E U R G É N É R A L D U QU É B E C Dans son Guide des tâches (1994), le Vérificateur général du Québec articule ses exigences sur les connais- sances, les habiletés et l’expérience requises de ses prati- ciens et établit la corrélation entre ces exigences et les principales responsabilités conférées aux équipiers et chargés de projet œuvrant en vérification d’optimisation des ressources. L’inclusion explicite de la dimension « expérience » distingue son travail de ceux que l’on vient d’examiner. À Québec, on classe les connaissances en deux catégories : les connaissances professionnelles et les connaissances administratives. Connaissances professionnelles • normes et techniques professionnelles • vérification financière • informatique • milieu gouvernemental • optimisation des ressources La catégorie des connaissances administratives concerne essentiellement la gestion en général. De plus, les connaissances requises se situent à trois niveaux : connaissance de base, connaissance intermédiaire et connaissance approfondie. Les habiletés sont classées en trois catégories : habiletés de gestion, habiletés intellectuelles et habiletés interpersonnelles.
- 60. C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N5 6 Habiletés de gestion • planification • organisation • contrôle • prise de décision Habiletés intellectuelles • esprit d’analyse • esprit de synthèse • expression orale • expression écrite • jugement • créativité • méthode Habiletés interpersonnelles • autonomie • leadership • ouverture d’esprit • sens des responsabilités • relations humaines • esprit d’équipe • proactivité Par ailleurs, les exigences en matière d’habiletés se situent à l’un ou l’autre des deux niveaux suivants : les habiletés essentielles et les habiletés importantes. Quant à la dimension « expérience », deux caté- gories sont établies : l’expérience professionnelle et l’en- cadrement. Dans les deux cas, les exigences relatives à l’expérience requise sont décrites en termes quantitatifs et qualificatifs – nombre d’années, nombre de missions de vérification et complexité du travail effectué. NAT I O N A L AU D I T OF F I C E (ROYA U M E -UN I ) En 1995, le National Audit Office du Royaume- Uni publiait Competency statements for value for money specialists (soit « énoncés sur la compétence profession- nelle des spécialistes en vérification d’optimisation des ressources »). Le travail consistait à cerner six grands critères qui rendent explicites les facteurs clés de la per- formance efficace des individus et du Bureau, aujour- d’hui et dans le futur21 . Pour chaque critère, un énoncé décrit la compétence requise en termes de travail à accomplir par le personnel. On énumère ensuite les connaissances et les habiletés requises du personnel. Dans le rapport, on stipule d’abord les compé- tences requises chez tous les membres du personnel (les vérificateurs de l’information financière et de l’optimisa- tion des ressources) et ensuite, on précise les compé- tences se rapportant uniquement à la vérification d’optimisation des ressources. Les compétences sont organisées selon les quatre échelons au sein de la fonc- tion de vérification d’optimisation des ressources : ceux qui effectuent les activités de vérification; ceux qui gèrent les équipes et les projets; ceux qui dirigent les opérations; et, ceux qui mènent l’unité. Un grand nombre de compétences sont liées à la capacité de s’acquitter du rôle de gestion concerné au sein de l’organisation, et elles peuvent donc englober des responsabilités plus vastes que le fait de poser des jugements sur une mission de vérification d’optimisa- tion des ressources. Les compétences concernant les habiletés tech- niques se situent toutes à un niveau élevé et exigent du vérificateur qu’il possède des qualités et des titres perti- nents, ou qu’il soit inscrit à un programme de forma- tion afin de les acquérir, ou encore qu’il possède une expertise22 . On ne mentionne aucune qualité ni titre professionnel. Nous tenons à souligner qu’une caractéristique intéressante de ce travail est qu’on y perçoit les compé- tences sous un aspect cumulatif. On précise dans le rapport que, pour chaque rôle, on suppose que le prati- cien possède une compétence dans les comportements appropriés aux échelons inférieurs23 . AU T R E S O R G A N I S AT I O N S E T I N D I V I D U S Depuis une quinzaine d’années, une vaste docu- mentation existe sur la compétence professionnelle. Naturellement, cette documentation comporte des différences ou des contradictions dans les approches décrites. Parfois ces différences se situent sur le plan cul- turel ou géographique, comme le souligne Iles24 , qui fait cette constatation en comparant les approches courantes aux États-Unis (approches axées sur la personne et sur l’analyse des tâches, telle l’entrevue concernant les com- portements) à l’approche privilégiée au Royaume-Uni (technique axée sur l’analyse de travail par tâche). A N N E X E D : I N I T I A T I V E S C O N N E X E S C O N C E R N A N T L A C O M P É T E N C E P R O F E S S I O N N E L L E 21 NATIONAL AUDIT OFFICE, COMPETENCY STATEMENTS FOR VALUE FOR MONEY PRACTITIONERS, LONDRES, NATIONAL AUDIT OFFICE, 1995, P. 2. 22 IBID., P. 11. 23 IBID., TABLE DES MATIÈRES. 24 PAUL A. ILES, « ACHIEVING STRATEGIC COHERENCE IN HRD THROUGH COMPETENCE-BASED MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT », PERSONNEL REVIEW, VOL. 22, NO 6, 1993, P. 68.
- 61. C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N 5 7 Néanmoins, cette documentation est une mine d’or en ce qui concerne les idées qui ont exercé une cer- taine influence sur le présent rapport ainsi que sur bien d’autres. Parmi d’autres ouvrages qui pourraient intéresser le lecteur, citons celui de Spencer et Spencer25 , deux chefs de file en la matière depuis plusieurs années. En 1993, ils publient un livre décrivant diverses approches pour effectuer des études sur la compétence profession- nelle; certains aspects de ces approches ont été utilisés dans notre projet de recherche (c.-à-d. le recours aux groupes d’experts pour obtenir des données). Ce livre décrit aussi plusieurs modèles génériques s’appliquant à diverses catégories de travail, dont la catégorie des pro- fessionnels et celle des gestionnaires. Le travail de pionnier effectué de concert par l’American Management Association, par le cabinet d’experts-conseils McBer and Company situé à Boston, et par D.C. McLelland dans le domaine des entrevues menées pour mieux saisir les comportements est abon- damment cité dans la documentation et utilisé dans la pratique. Cette technique consiste à interviewer des personnes dont la performance est supérieure; on leur demande de réfléchir à des situations particulières qui ont réellement eu lieu et sur les compétences qui leur ont permis d’atteindre les bons résultats obtenus26 . L’avantage de cette technique réside dans le fait qu’elle capte de l’information que d’autres méthodes ne réussis- sent pas à nous permettre d’obtenir, information sur ce qui définit par exemple un comportement efficace ou non efficace, et sur la manière dont les personnes inter- viewées ont acquis les compétences professionnelles clés. Cette technique comporte cependant certains incon- vénients : elle est coûteuse puisqu’elle nécessite un nombre élevé d’entrevues. L’entrevue pour connaître les comportements, ou une variation de cette technique, a été utilisée par le professeur W. P. Birkett dans l’étude de 1993 menée en Australie et en Nouvelle-Zélande ainsi que dans le tra- vail effectué en 1997 par le Bureau du vérificateur général du Canada. Comme ouvrages supplémentaires de nature générale pouvant intéresser le lecteur, nous proposons le Tronc commun de connaissances de l’Institut des con- seillers en management du Canada, et le projet de do- cument intitulé Profil global de compétence : Un modèle préparé par la Commission de la fonction publique du Canada. Le Tronc commun de connaissances27 de l’Institut des conseillers en management du Canada met l’accent sur les habiletés et les connaissances en gestion générale dans des domaines comme la gestion des ressources humaines, la gestion financière, la gestion des technolo- gies de l’information, la gestion des opérations, la ges- tion du marketing, et la gestion de la planification stratégique. Ce document se penche aussi sur les habiletés et les connaissances en consultation de gestion qui concernent la profession de conseiller en gestion, le processus de consultation, la pratique de gestion et les communications. L’ébauche du document préparé par la Commission de la fonction publique du Canada, Profil global de compétence : Un modèle28 , contient une liste exhaustive de compétences en gestion (y compris les habiletés et les capacités, les connaissances, les aptitudes et autres attributs). À titre d’exemple, dans le domaine des habiletés et des capacités, on relève soixante-quatre compétences distinctes. Ces compétences sont bien définies et le Profil nous a servi de document de référence utile pour cette recherche sur la compétence professionnelle. Enfin, nous proposons au lecteur qui le désire de consulter la bibliographie présentée à l’annexe F. Plusieurs de ces publications ont été résumées dans un document distinct portant sur l’examen de la documen- tation effectué dans le cadre de cette étude. 25 SPENCER & SPENCER, OP. CIT. 26 ILES, OP. CIT., P. 63. 27 INSTITUT DES CONSEILLERS EN MANAGEMENT DU CANADA, TRONC COMMUN DE CONNAISSANCES, QUATRIÈME ÉDITION, S.L., INSTITUT DES CONSEILLERS EN MANAGEMENT DU CANADA, SEPTEMBRE 1993. 28 COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA, PROFIL GLOBAL DE COMPÉTENCE : UN MODÈLE, NOVEMBRE 1996 (PROJET DE RAPPORT NON PUBLIÉ).
- 62. C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N5 8 A N N E X E E PERSONNES QUI ONT CONTRIBUÉ AU PROJET DE RECHERCHE Ce projet de recherche n’aurait pu voir le jour sans la contribution de quelque quatre-vingt-dix professionnels qui, à diverses étapes du processus, ont donné généreusement de leur temps et de leur énergie. Il s’agit de vérifica- teurs législatifs, de vérificateurs internes, d’experts-comptables et de conseillers en administration, d’universitaires et de bien d’autres. Dans bien des cas, ces praticiens occupent les postes les plus élevés dans leur organisation en matière de vérification intégrée. Voici la liste des individus interviewés, des personnes qui ont pris part aux activités menant à la réalisation de ce projet, des participants aux séances remue-méninges et de ceux qui ont contribué d’une façon ou d’une autre au projet de recherche. John Affleck Bureau du vérificateur général du Canada Richard Alain Vidéotron Gordon H. Aue Ministère du Développement économique et du Commerce de l’Ontario Claude Beauregard École nationale d’administration publique Gilles Bédard Le Vérificateur général du Québec Carol Bellringer Ville de Winnipeg Lyne Bergeron Ministère de la Justice du Québec Huguette Bertrand Ralph Black Bureau du vérificateur général du Nouveau-Brunswick Kendall Blunden Ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse Walter Bordne Bureau du vérificateur provincial de l’Ontario Guy Breton Le Vérificateur général du Québec Neil Brown Arthur Andersen Claude Carter Bureau du vérificateur général de la Nouvelle-Écosse Ghislain Cayer Le Vérificateur général du Québec James Currie Programme des Nations Unies pour le développement Jim Cutt Université de Victoria Alec Davidson Coopers & Lybrand Roger Deblois Le Vérificateur général du Québec Robert Dion Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal Sheila Dodds Bureau du contrôleur général de la Colombie-Britannique Marilyn Dolenko KPMG Canada Endre Dolhai Bureau du vérificateur général de la Colombie-Britannique David Fairbotham Bureau du contrôleur général de la Colombie-Britannique Judy Ferguson Bureau du vérificateur provincial de la Saskatchewan Jean-Luc Ferland Le Vérificateur général du Québec Yvan Gaudette Bureau du vérificateur général du Canada Yves Gauthier Groupe conseil – KPMG Murray Gill Bureau du vérificateur général du Nouveau-Brunswick Jennifer Glen Ville de Winnipeg Jean-Paul Gobeil Deloitte & Touche
- 63. C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N 5 9 J. Peter Gregory Bureau du vérificateur général de la Colombie-Britannique Michael Heffernan Bureau du vérificateur provincial de la Saskatchewan Jacques Henrichon Le Vérificateur général du Québec Ken Hoffman Bureau du vérificateur général de l’Alberta Jamie Hood Bureau du vérificateur général du Canada Eric Hopper Bureau du vérificateur général du Nouveau-Brunswick Bernard Howlett Bureau du vérificateur général de Terre-Neuve Mark Irvine Manitoba Telephone System Fred Jaakson Conseils et vérification Canada Claude Janes Bureau du vérificateur général de Terre-Neuve Warren Johnson Bureau du vérificateur provincial du Manitoba Janet Jones Bureau du vérificateur général du Canada Peter Kasurak Bureau du vérificateur général du Canada Joy Keenan Institut Canadien des Comptables Agréés Bob Kellington Manitoba Hydro Michael Kennedy KPMG Canada Martin Leblanc Groupe conseil – KPMG Amy Lee BC Rail Ken Leishman Bureau du vérificateur provincial de l’Ontario Barbara Lillie Ministère des Finances du Manitoba Surintendant Raymond Lincourt Gendarmerie royale du Canada Mary Jane Loustel Collège communautaire de Red River Ingrid Loewen Société des alcools du Manitoba Alec Mackie Bureau du contrôleur général de la Colombie-Britannique Harvey MacLeod Bureau du vérificateur général de l’Île-du-Prince-Édouard Elizabeth MacRae Agence canadienne de développement international Ken MacRae Bureau du vérificateur général de l’Île-du-Prince-Édouard Neill MacRae BDO Dunwoody Beth Marshall Bureau du vérificateur général de Terre-Neuve Sunny Mathieson Bureau du contrôleur général de la Colombie-Britannique Yvan Mathieu Le Vérificateur général du Québec Les McAdams Bureau du vérificateur général de la Colombie-Britannique Jane McCannell Bureau du vérificateur général de la Colombie-Britannique Michael McLaughlin Bureau du vérificateur général du Canada Larry Meyers Bureau du vérificateur général du Canada Bonnie Miller Bureau du vérificateur général du Canada Wayne Murphy Bureau du vérificateur général de l’Île-du-Prince-Édouard Donald Neufeld Bureau du vérificateur général de l’Alberta John Noseworthy Bureau du vérificateur général de Terre-Neuve John O’Brien Bureau du vérificateur général du Canada James Otterman Bureau du vérificateur provincial de l’Ontario Marc Ouelette Le Vérificateur général du Québec Doris Paradis Le Vérificateur général du Québec Colin Potts Deloitte & Touche Bob Prosser Ville de Saskatoon Ross Quane Deloitte & Touche Elie Rabbat Hydro-Québec Bill Rafuse Bureau du vérificateur général du Canada Norm Ricard Bureau du vérificateur provincial du Manitoba
- 64. C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N6 0 John Rossetti Bureau du vérificateur général du Canada Roy Salmon Bureau du vérificateur général de la Nouvelle-Écosse Robin Sellar Société canadienne des postes Ellen Shillabeer Bureau du vérificateur général du Canada Peter Simeoni Bureau du vérificateur général du Canada Ken Swain Conseils et vérification Canada Jean-Noël Thériault Le Vérificateur général du Québec Jean-Marc Villeneuve Le Vérificateur général du Québec Brent White Bureau du vérificateur général du Nouveau-Brunswick Brian Whiteside Bureau du vérificateur provincial du Manitoba Al Whitla Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada Kathleen Wong Insurance Corporation of British Columbia Julie Wood Secrétariat du Conseil de gestion de l’Ontario Carman Young Banque du Canada A N N E X E E : P E R S O N N E S Q U I O N T C O N T R I B U É A U P R O J E T D E R E C H E R C H E
- 65. C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N 6 1 A N N E X E F BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE AICPA, COMITÉ SPÉCIAL SUR LES SERVICES DE CERTIFICATION. Report of the Special Committee on Assurance Services, New York, American Institute of Certified Public Accountants, 1997. BIRKETT, W.P. A Question of Competence, dans le Australian Accountant, (une série d’articles publiés mensuellement d’août 1992 à décembre 1992), Melbourne, Australian Society of Accountants, Commonwealth Institute of Accountants et Australian Institute of Cost Accountants, 1992. BIRKETT, W.P. Competency-based Standards for Professional Accountants in Australia and New Zealand : Discussion Paper, Australie, Australian Society of Certified Practising Accountants, Institute of Chartered Accountants of Australia, et New Zealand Society of Accountants, août 1993. BOAM, Rosemary et Paul SPARROW. Designing and Achieving Competency : A competency-based approach to developing people and organizations, Londres–New York, McGraw-Hill Book Company, 1992. BOURSE DE TORONTO, COMITÉ SUR LA GOUVERNE D’ENTREPRISE. Where Were the Directors : Guidelines for Improved Corporate Governance in Canada, (présidé par Peter Dey), Toronto, Bourse de Toronto, décembre 1994. BROWN, Reva B. Meta-competence : A Recipe for Reframing the Competence Debate dans Personnel Review, vol. 22, no 6, Farnborough (Angleterre), Gower Press, 1993. BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE. Competencies by Level, 1997 (ouvrage non publié). BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA. Bureau du vérificateur général du Canada : Modèle de compétences, 1997 (ouvrage non publié). BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA. Manuel de vérification intégrée, Ottawa, BVG Canada, 1990. BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA. Projet de rapport du Groupe d’étude sur les connaissances et les compétences, 1987 (ouvrage non publié). BURGOYNE, John G. The competence movement : Issues, stakeholders and prospects, dans Personnel Review, vol. 22, no 6, Farnborough (Angleterre), Gower Press, 1993. BURKE, John, éd. Competency Based Education and Training, Londres–New York, The Falmer Press, 1989. COLLINS, Michael. Competence in Adult Education : A New Perspective, Lanham (Maryland), University Press of America, 1987. COLQUHOUN, Andrew. From professional conduct to professional competence, dans Accountancy, vol. 114, no 1213, septembre 1994, Londres, Institute of Chartered Accountants in England and Wales, 1994. COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA. Profil global de compétence : Un modèle, novembre 1996 (projet de rapport non publié). CURRY, Lynn et Jon F. WERGIN, et associés. Educating Professionals : Responding to New Expectations for Competence and Accountability, San Francisco, Jossey-Bass Inc. Publishers, 1993. DIVISION OF ACADEMIC AND PROFESSIONAL PROGRAMS, CONTINUING EDUCATION. The Evaluation of Continuing Education for Professionals : A Systems View, Seattle, Université de Washington, 1979. ESTEY, L’honorable Willard Z. Report of the Inquiry into the Collapse of the CCB and Northland Bank, Ottawa, Approvisionnements et Services Canada, 1986. FINANCIAL REPORTING COUNCIL OF THE LONDON STOCK EXCHANGE. Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance (sir Adrian Cadbury, président), Londres, London Stock Exchange, 1992. FITZPATRICK, Robert. Critique du livre Competence at Work : Models for Superior Performance, dans Personnel Psychology, vol. 47, no 2, été 199, Houston, Personnel Psychology Inc., 1994. FONDATION CANADIENNE POUR LA VÉRIFICATION INTÉGRÉE. La communication et la vérification de l’information sur l’efficacité dans le secteur public, Ottawa, FCVI, 1987. FONDATION CANADIENNE POUR LA VÉRIFICATION INTÉGRÉE. Le rapport de vérification intégrée : concepts, questions et pratiques, Ottawa, FCVI, 1991. FONDATION CANADIENNE POUR LA VÉRIFICATION INTÉGRÉE. Un guide sur ce que le praticien doit savoir pour effectuer des vérifications intégrées, (document de discussion), Ottawa, FCVI, 1984. GRANT, Gerald et associés. On Competence : A Critical Analysis of Competence-Based Reforms in Higher Education, San Fancisco, Jossey-Bass Inc. Publishers, 1979. ILES, Paul A. Achieving Strategic Coherence in HRD through Competence-based Management and Organization Development, dans Personnel Review, vol. 22, no 6, Farnborough (Angleterre), Gower Press, 1993. INSTITUT CANADIEN DES COMPTABLES AGRÉÉS – GROUPE DE TRAVAIL SUR LES SERVICES DE CERTIFICATION. Rapport d’étape, Toronto, ICCA, mai 1997.
- 66. C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N6 2 INSTITUT CANADIEN DES COMPTABLES AGRÉÉS. « Normes relatives aux missions de certification », dans le Manuel de l’ICCA, vol. II, ch. 5025, Toronto, ICCA, avril 1997. INSTITUT CANADIEN DES COMPTABLES AGRÉÉS. Le défi du changement, rapport du Comité des stratégies à long terme de l’ICCA, (présidé par Keith Dalglish, FCA), Toronto, ICCA, 1986. INSTITUT CANADIEN DES COMPTABLES AGRÉÉS. Le jugement professionnel en vérification, Rapport de recherche, (étude présidée par D.J. Low, FCA), Toronto, ICCA, 1995. INSTITUT CANADIEN DES COMPTABLES AGRÉÉS. Normes régissant les missions de certification : Document de travail, Toronto, Conseil des normes de vérification - ICCA, 1992. INSTITUT CANADIEN DES COMPTABLES AGRÉÉS. Rapport de la Commission sur les attentes du public à l’égard de la vérification, (présidé par William J. Macdonald), Toronto, ICCA, 1988. INSTITUT CANADIEN DES COMPTABLES AGRÉÉS. Rapport du Comité spécial chargé d’étudier le rôle du vérificateur, (présidé par John W. Adams, FCA), Toronto, ICCA, 1978. INSTITUT CANADIEN DES COMPTABLES AGRÉÉS. Report of the Committee to Study Specialization in the Canadian Chartered Accountancy Profession, (présidé par W.D. Grace, FCA), Toronto, ICCA, 1981. INSTITUT DES CONSEILLERS EN MANAGEMENT DU CANADA. Tronc commun de connaissances, quatrième édition, s.l., Institut des conseillers en management du Canada, 1993. INSTITUT FRANÇAIS DES AUDITEURS ET CONTRÔLEURS INTERNE. Normes pour la pratique professionnelle de l’audit interne : Version bilingue des normes d’Audit interne de l’I.I.A. (Institute of Internal Auditors) établie par A.T.H. (Association Technique d’Harmonisation), Paris, IFACI, juin 1995. INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS, THE. A Common Body of Knowledge for the Practice of Internal Auditing, Floride, The Institute of Internal Auditors, 1992. INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS. Standards of Ethical Conduct for Management Accountants, dans Management Accounting, vol. 76, no 8, février 1995, É.-U., Institute of Management Accountants, 1995. INSTITUTS PROVINCIAUX DE COMPTABLES AGRÉÉS AU CANADA ET AUX BERMUDES. Programme en vue de l’admission au sein de la profession de comptable agréé, Toronto, Institut Canadien des Comptables Agréés, 1996. JAQUES, Elliott et Stephen D. CLEMEN. Executive Leadership, Arlington, Cason Hall & Co. Publishers, 1991, 1994. LECLERC, G., W. David MOYNAGH, Jean-Pierre BOISCLAIR, et Hugh HANSON. Reddition de comptes, rapports sur la performance et vérification intégrée : Une vue d’ensemble, Ottawa, CCAF-FCVI Inc., 1996. MORGAN, Gareth. Riding the Waves of Change : Developing Managerial Competencies for a Turbulent World, San Francisco, Jossey-Bass Inc. Publishers, 1988. NATIONAL AUDIT OFFICE (R.-U.). Competency statements for value for money specialists, Londres, National Audit Office, 1995. NICKSE, Ruth, éd. Competency-Based Education : Beyond Minimum Competency Testing, New York, Teachers College Press, Université Columbia, 1981. PEDLEY, Lynda. Internal Auditing in the 90’s and Auditor Qualifications to Meet Today’s Demands, projet de recherche en gestion dans le cadre du programme de MBA de l’Université Queen’s, 1995. POTTINGER, Paul S. et Joan GOLDSMITH, éd. Defining and Measuring Competence, San Francisco, Jossey-Bass Inc. Publishers, 1979. ROY, Robert H. et James H. MACNEILL. Horizons for a Profession : The common body of knowledge for certified public accountants, parrainé par le Carnegie Corporation of New York et l’AICPA, 1967. SAGER, William H. Characteristics of a Professional Accountant, dans The National Public Accountant, vol. 37, no 1, janvier 1992, Washington (D.C.), National Society of Public Accountants, 1992. Sanford, Dr Barbara, éd. Strategies for Maintaining Professional Competence : A Manual for Professional Associations and Faculties, Toronto, Canadian Scholars’ Press Inc., 1989. SENGE, Peter. The Fifth Discipline : The Art and Practice of the Learning Organization, New York, Doubleday–Currency, 1990. SHORT, Edmund C. Competence: Inquiries Into Its Meaning and Acquisition in Educational Settings, Lanham (Maryland), University Press of America, Inc., 1984. SPENCER, Lyle M. et Signe M. SPENCER. Competence at Work : Models for Superior Performance, Canada, John Wiley & Sons Ltd., 1993. STERNBERG, Robert J. et John KALLIGAN, éd. Competence Considered, New Haven, Yale University Press, 1990. TOVEY, Philip. Quality Assurance in Continuing Professional Education : an analysis, Londres–New York, Routledge, 1994. WILLIS, Sherry L. Maintaining Professional Competence : Approaches to Career Enhancement Vitality and Success Throughout a Work Life, San Francisco, Jossey-Bass Inc. Publishers, 1990. WOODRUFFE, Charles. What is Meant by a Competency, dans Leadership and Organizational Development Journal, vol. 14, no 1, Bradford (Angleterre), MCB Publications, 1993. A N N E X E F : B I B L I O G R A P H I E S O M M A I R E
- 67. C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N 6 3 A N N E X E G DOCUMENTATION DE BASE Pour obtenir un exemplaire du Literature-Review Background Report (FCVI, 1998), il vous suffit de communiquer avec la FCVI.






















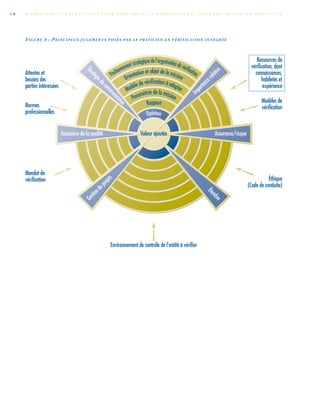
![« POUR BIEN S’ACQUITTER [DE LA VASTE GAMME DE MISSIONS
QU’ILS SONT APPELÉS À EFFECTUER], LES VÉRIFICATEURS
INTERNES DOIVENT POSSÉDER DES HABILETÉS ET DES
CONNAISSANCES DANS PLUSIEURS DISCIPLINES DIFFÉRENTES
[…] ILS DOIVENT ÊTRE D’EXCELLENTS COMMUNICATEURS […]
ILS DOIVENT ÊTRE DES PENSEURS LOGIQUES […] »
A C O M M O N B O D Y O F K N O W L E D G E F O R T H E P R A C T I C E O F
I N T E R N A L A U D I T I N G , I . I . A . , 1 9 9 2
C H A P I T R E 4
COMPÉTENCE
PROFESSIONNELLE
EN VÉRIFICATION
INTÉGRÉE :
CONNAISSANCES,
HABILETÉS ET
EXPÉRIENCE
REQUISES
I N T R O D U C T I O N
La première étape pour déterminer les connais-
sances, les habiletés et l’expérience requises du praticien
de la vérification intégrée consiste à établir les principaux
jugements qu’il est appelé à poser dans le cadre de son
travail; voilà sur quoi le chapitre 3 a porté. Dans le
présent chapitre, nous décrivons les connaissances, les
habiletés et de l’expérience jugées nécessaires pour que le
praticien soit à même de poser des jugements appropriés.
Nous présentons un cadre référentiel pour la discussion
du degré, de l’étendue ou de la nature de chacune de ces
dimensions de la compétence professionnelle.
C A D R E R É F É R E N T I E L S U R L E S
C O N N A I S S A N C E S R E Q U I S E S
Comme nous l’avons mentionné précédemment,
le terme « connaissances » dans le présent rapport signi-
fie les informations qu’une personne possède dans une
matière donnée. Il est important de noter que ces con-
naissances s’acquièrent de plusieurs façons – un pro-
gramme d’études ou de formation, l’apprentissage
auprès d’autres professionnels, et l’expérience de travail
en vérification intégrée et autres types de vérification,
dans différents champs d’activité et dans le bénévolat.
C O M P É T E N C E S N É C E S S A I R E S P O U R P R A T I Q U E R L A V É R I F I C A T I O N I N T É G R É E . G U I D E D U P R A T I C I E N 1 9](https://image.slidesharecdn.com/lavrificationintgre-150823131418-lva1-app6892/85/La-verification-integree-23-320.jpg)






















![• la restriction des budgets de formation en raison
des contraintes financières, et le désir d’utiliser
avec sagesse les fonds disponibles.
À la lumière de ces développements, le groupe de
vérificateurs législatifs a estimé nécessaire de mettre à
jour le document de 1984 sur les compétences requises
du praticien et de tenir compte de cette mise à jour
dans toute activité de formation et de perfectionnement
de la FCVI. Pour démontrer leur compétence en vérifi-
cation intégrée, les praticiens devaient, selon ce groupe,
pouvoir s’appuyer sur des normes ainsi que sur un
ensemble de connaissances bien définies. Par ailleurs,
les bureaux de vérification législative ont indiqué qu’il
leur fallait un ensemble de connaissances bien articulées
pour les guider dans leurs efforts d’assurer la formation
de leur personnel et pour les aider à élaborer des plans
de carrière appropriés.
En 1993, dans le cadre du congrès national de la
FCVI, Larry Meyers (alors sous-vérificateur général du
Canada) a insisté sur cette problématique. Dans son
allocution, il a mentionné la tendance émergente
d’obtenir un consensus sur le travail à accomplir et a
déclaré que le temps était venu de passer à l’action.
« [...] rien n’a été fait parce que c’est difficile,
et parce que nous n’avions ni le consensus ni
la volonté nécessaires. Cependant, nous pos-
sédons aujourd’hui une plus grande expéri-
ence [...] Il nous faut passer à l’action! »
DÉ C I S I O N S C L É S S E RVA N T D E F O N D E M E N T S
Comme étape suivante, la FCVI a organisé un
symposium remue-méninges; cette fois-ci, elle réunis-
sait des représentants d’un éventail plus large de prati-
ciens en vérification intégrée, dont des vérificateurs
législatifs, des vérificateurs internes ainsi que des
experts-comptables et conseillers en gestion. Ce sympo-
sium avait pour but d’obtenir des conseils sur les objec-
tifs du projet de recherche, sur son étendue et sur la
façon de procéder.
Les délibérations de ce symposium nous ont per-
mis de dégager les principaux éléments du plan de
recherche. Les décisions clés prises initialement ont
servi de fondements au projet de recherche.
DÉ F I N I T I O N D E L A V É R I F I C AT I O N
Premièrement, on a décidé d’adopter la définition
suivante de la vérification :
La vérification renforce les liens de respon-
sabilité qui découlent de l’obligation de rendre
compte. C’est une évaluation des systèmes et
pratiques de gestion, ou une évaluation des
déclarations de la direction en matière de per-
formance qui permet de déterminer la fidélité
de l’information communiquée, ou encore
une évaluation de la performance globale.
L’évaluation doit être indépendante, objec-
tive, fondée sur des critères et destinée à
l’instance gouvernante ou à tout autre inter-
venant investi de responsabilités semblables.
FO C A L I S AT I O N S U R L E S P R I N C I PA U X J U G E M E N T S E N
V É R I F I C AT I O N
Deuxièmement, on a décidé de se concentrer en
priorité sur les principaux jugements que le praticien est
appelé à poser dans le cadre de la vérification intégrée.
Ce point de départ nous permettait d’adopter une
approche de recherche axée sur les résultats et de fonc-
tionner avec une base commune, laquelle était jugée
nécessaire en raison des variations importantes dans la
taille et la structure des organisations de vérification.
ÉL A R G I S S E M E N T D E L’É T E N D U E D E L A C O M P É T E N C E
P R O F E S S I O N N E L L E
Troisièmement, on a décidé de ne pas limiter la
recherche à la question des « connaissances ». Il a été
jugé important de se pencher sur les « habiletés » et sur
l’ « expérience », deux dimensions qui, avec les connais-
sances, constituent la notion de « compétence profes-
sionnelle ». De ces trois dimensions, c’est
l’ « expérience » qui est perçue comme l’innovation du
présent rapport de recherche.
BE S O I N D E F L E X I B I L I T É
Quatrièmement, on a décidé d’aborder la question
de la compétence professionnelle de manière à faciliter
l’utilisation des résultats dans une variété de contextes
professionnels.
Un vaste éventail de praticiens participent à la
pratique de la vérification intégrée (p. ex., les vérificateurs
législatifs, les vérificateurs internes, les professionnels
œuvrant dans les cabinets d’experts-comptables offrant
des services de vérification interne et externe). Les orga-
4 2 A N N E X E A : H I S T O R I Q U E D U P R O J E T D E R E C H E R C H E](https://image.slidesharecdn.com/lavrificationintgre-150823131418-lva1-app6892/85/La-verification-integree-46-320.jpg)